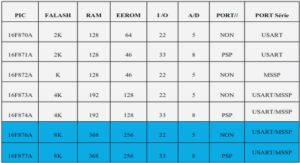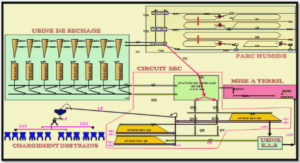Validation de l’écoulement dans le canal hydrodynamique
Avril 1940
Il y a de ces moments où les heures avancent à reculons. Où les minutes et les secondes prennent le temps d’exister pleinement. Les derniers mois s’étaient égrainés ainsi. Péniblement. Le conflit armé avait été gelé dans le temps. Les Anglais l’appelaient la phoney war. Les Français, « la drôle de guerre ». Selon les journaux, les pays alliés se terraient derrière la ligne Maginot et les Allemands, derrière la ligne Siegfried. Campés sur leur position, aucun d’eux n’osait lancer d’offensive. Face à face, enragés, mais immobiles. La Belgique et le Luxembourg coincés entre les deux.
Au pays, les journaux semblaient oublier que le Canada était en guerre. Croiser le chemin d’un militaire était devenue chose courante. Ça n’impressionnait plus personne. Le sentiment d’urgence que les foules partageaient en silence s’était dissipé. Durant un instant, on avait même cru que l’Angleterre accepterait la paix proposée par Hitler. Ç’aurait alors été un conflit éphémère. Et dans un futur non si lointain, on se serait même demandé s’il avait réellement existé. Mais ce n’était pas si simple apparemment.
Au début septembre, le gouvernement fédéral avait instauré la loi sur les mesures de guerre. Les autorités pouvaient réquisitionner tout ce qui pourrait servir à remporter le conflit. Les usines fabriquant des munitions fonctionnaient à plein régime à Montréal, et on parlait d’en construire d’autres. Le Canadien Pacifique construisait des chars dans ses usines Angus dans le quartier Rosemont. Les compagnies Bombardier et GM, à Valcourt, assemblaient des motoneiges à expédier sur le front. Même les usines de vêtements et de chaussures étaient mises à contribution. Les familles étaient rationnées afin que le pays contribue à l’effort de guerre, mais, comme le taux de chômage avait diminué considérablement déjà, on n’en faisait pas tout un plat. Les temps difficiles imposés par la crise économique semblaient un lointain souvenir. Le soir venu, les rues prenaient vie, et une atmosphère de temps des fêtes régnait partout. La province était en effervescence, et les gens étaient fébriles.
Dans les rues de Montréal, on parlait davantage de politique et du renouveau insufflé par le Parti libéral d’Adélard Godbout. Les projets étaient nombreux : droit de vote des femmes, école obligatoire, nationalisation de l’hydroélectricité, etc.
De son côté, Marielle s’improvisait suffragette et assistait à des conférences sur les droits des femmes. Elle prônait avec grande conviction que la femme était l’égal de l’homme, ce qui exaspérait Bastien. Pour ma part, je prenais de plus en plus goût aux discussions politiques des militaires. On me demandait même mon opinion de temps à autre, ce qui m’amusait. C’était un changement subtil, mais on sentait que quelque chose était en marche. Finalement, Paul Gouin avait raison; la belle province se refaisait une beauté.
Les hommes des Fusiliers Mont-Royal avaient fini par recevoir toutes leurs pièces d’uniforme. Ils occupaient depuis le début novembre l’ancien Motordrome sur la rue Sherbrooke. Du coup, finies les parades dans la ville, finis les entraînements dans les parcs et dans les cours d’école. Le bâtiment permettait aux hommes de s’entraîner plus fréquemment sans être interrompus par les intempéries et les interventions policières. Le commandant était ravi, et le capitaine-adjudant pouvait enfin faire régner sa loi. Thomas, lui, voyait l’entraînement comme un jeu. Je lui découvrais un petit côté espiègle que je n’avais pas soupçonné jusqu’ici.
De mon côté, j’avais eu du mal à cacher ma joie lorsque Marielle regagna son logement. Si sa présence me désennuyait, je n’étais pas contre le fait de retrouver ma quiétude. Je repris pleinement possession de mon appartement lors d’un jour de congé durant lequel je commençai à déplacer les meubles selon ma convenance. J’habitais désormais un peu plus chez moi que chez mon père.
Au fil des semaines, nous avions remarqué que les hommes fréquentaient un peu moins le bar depuis qu’ils séjournaient au Motordrome puisque leur entraînement s’était intensifié. Ainsi, tous les après-midi, nous réfléchissions à un moyen d’attirer plus de clientèle, civile ou militaire.
Assise sur mon tabouret derrière le comptoir, je jonglais avec la comptabilité lorsque Marielle ouvrit grande la porte et effectua une révérence à faire rougir de honte les plus grandes reines de ce monde.
— Je sais qu’il n’est que 12 h 45, ma darling, mais veux-tu connaître mon idée de génie ou tu préfères attendre de finir de calculer ta colonne?
— J’opte pour le calcul, répondis-je avec assurance.
— D’accord! Alors, voilà! enchaîna-t-elle. J’étais en train de repasser ma tenue d’aujourd’hui quand je me suis dit : il sera si triste de voir tous ces beaux jeunes hommes
partir pour l’Europe. C’est sérieux la guerre, ils pourraient se faire très mal, tu sais!
— Vraiment?
— Il faut me croire! m’assura-t-elle en hochant de la tête.
Les conclusions de Marielle me renvoyèrent à ma propre naïveté. Je croyais toujours qu’elle possédait un nombre limité de bêtises à prononcer par jour, mais elle arrivait toujours à me surprendre. Au lieu de perdre une énergie précieuse à lui expliquer l’énormité de son discours, je décidai d’abandonner.
— Alors, je me suis dit qu’on pourrait les divertir un peu pour leur remonter le moral, poursuivit-elle.
— Je croyais que c’était déjà ce qu’on faisait?
— En les noyant dans l’alcool, oui. Mais on pourrait faire plus encore.
— Si tu penses à les rendre ivres morts, c’est non. Et tu es virée! On ne peut pas se permettre de se mettre à dos la Police des liqueurs.
— Pour qui me prends-tu? J’ai pensé à quelque chose de mieux : un concours de photo!
Était-elle sérieuse en me proposant cette idée farfelue ou allait-elle me révéler sa vraie idée de génie? On ne savait jamais quand elle blaguait. Dans l’espoir que la deuxième option soit la bonne, je tendis l’oreille. Marielle dut lire la stupéfaction sur mon visage puisqu’elle commença à parler sans même penser à respirer entre ses phrases.
— Ne refuse pas tout de suite, laisse-moi parler avant, m’ordonna-t-elle. Ces hommes partiront probablement en Europe mettre leur vie en danger pour leur pays. Plusieurs malheureux ne reviendront pas ou seront très amochés. J’ai donc pensé qu’en organisant un concours de photos, ils auraient des clichés d’eux à offrir à leur famille alors qu’ils sont encore en un morceau. Enfin, tu comprends… En plus, ils pourront partir avec un souvenir de leurs amis en poche. Ce sera génial pour le moral des troupes! Alors, qu’en dis-tu?
— Et s’ils ne partent pas pour l’Europe? Si la guerre n’a pas lieu?
— Ça leur fera des souvenirs quand même, darling!
— On pourra gagner de l’argent en organisant une soirée spéciale, murmurai-je après quelques instants de réflexion. Mais quel sera le prix à gagner?
— Je sais pas! chantonna-t-elle avec assurance. C’est le petit hic…
Bastien entra au même moment. Marielle trépignait sur place comme une enfant devant le père Noël. Intrigué, Bastien leva un sourcil.
— Prends garde à toi, l’avertis-je. Elle est dangereusement en forme aujourd’hui!
— Allez, dis oui! ajouta-t-elle. On se fera un paquet de fric!
— Laisse-moi y penser, répondis-je en rassemblant mes papiers. Pendant ce temps, explique ton idée à Bastien.
Elle trépigna de nouveau en se rendant derrière le comptoir. Bastien vint la rejoindre alors qu’elle s’emparait de tasses à café.
— Tu vas voir, tu vas dire que je suis un génie!
— Rien de moins? grogna-t-il.
Je traversai dans l’autre pièce et m’assis à mon bureau afin de finir mes calculs. Au bout d’un moment, avachie sur ma chaise de bois, je me souvins du vieil appareil photo que j’avais trouvé en arrivant au Poppydrille. Aux dires de ma grand-mère, mon père n’avait jamais eu de talent artistique, encore moins comme photographe. Les quelques photos de ma mère, mal cadrées ou floues, en témoignaient.
Le coffret de cuir brun était sur le haut de l’étagère. Je tentai de m’en emparer en me mettant sur le bout des orteils : impossible. Je pris un cintre sur le porte-manteau et tentai de dégager une boîte. Elle me tomba dessus en s’ouvrant. Des photographies s’éparpillèrent sur le plancher. Tant pis, je les ramasserais plus tard. Mon second essai fut plus fructueux. Je réussis à faire tomber le coffret que j’attrapai de justesse. Je l’ouvris, intriguée, en prenant place sur le divan. Il contenait l’un de ces vieux appareils fabriqués par Kodak il y a plusieurs années.
Tandis que je dépoussiérais l’appareil, je songeai que je n’avais aucune photo de mon père. Ma grand-mère avait fait disparaître les rares clichés où mes deux parents apparaissaient pour que mon père n’ait jamais existé. En faisant cela, c’était une partie de moi qu’elle avait jetée aux ordures. Et aujourd’hui, je peinais à recoller les morceaux.
Plus j’y pensais, plus l’idée de Marielle ne me semblait pas aussi farfelue qu’elle le paraissait. Je rassemblai dans une caisse quelques bricoles.
Marielle et Bastien, curieusement intéressé, étaient assis au comptoir.
— Tu sais, Clara, je dois admettre que son idée n’est pas mauvaise. Mais qu’est-ce que c’est que tout ça? ajouta-t-il en s’emparant de ma boîte.
— Du matériel pour le concours. Marielle lâcha un cri de joie.
— J’en reviens pas! Tu es d’accord pour le faire, ma darling?
— Si vous êtes tous les deux d’accord, je ne vois pas pourquoi je refuserais.
Pendant qu’elle s’extasiait, je sortis le contenu de la boîte. Bastien s’empara de l’appareil photo de mon père. L’air intrigué, il observa l’objet sous tous ses angles.
— Je te prêterai mon appareil, Marielle, et tu pourras prendre toutes les photos que tu veux de Bastien. On choisira les moins belles et on les affichera sur le mur à côté du juke-box.
— Les plus laides?
— Tu les choisiras personnellement! Ça lui apprendra à grogner.
Malgré mes moqueries, Bastien était immuable. Il scrutait le boîtier comme s’il cherchait comment l’ouvrir. Un creux s’était formé entre ses sourcils alors qu’il mordillait sa lèvre inférieure.
— Je crois qu’il reste une pellicule à l’intérieur… je m’en occupe, expliqua-t-il en se levant. J’en profiterai pour vérifier s’il fonctionne toujours. Nous en aurons besoin pour prendre des photos des hommes. Nous pourrions même le laisser à leur disposition.
— Un photomaton! claironna Marielle en tapant des mains.
— Excellente idée, Bastien.
Sur ces mots, il quitta le bar, l’air aussi soucieux.
Bastien revint quelque temps avant l’ouverture du Poppydrille. Il s’installa au piano pendant que Marielle et moi nous affairions à préparer la banderole et discutions des critères de sélection des photos pour le concours. Au bout d’un moment, Marielle me fit signe d’aller le rejoindre en me disant qu’elle terminerait seule les derniers détails.
Je m’installai sur le banc à côté de Bastien et, d’un accord muet, nous entreprîmes de jouer à quatre mains un air joyeux. Marielle chantonnait et dansait en travaillant, ce qui nous faisait rire. Les premiers clients arrivaient et se groupaient autour de l’instrument. Entre deux transactions, ma serveuse installait la banderole sur le mur, entre le juke-box et la table de billard. Quelques clients s’en étaient informés. Tous approuvaient, ce qui rendait Marielle euphorique.
Un peu plus tard, profitant de l’accalmie, je décidai d’aller ranger la boîte de photos que j’avais fait tomber un peu plus tôt dans la journée. Assise sur le plancher, je pris le temps d’observer les clichés des archives de mon père. Il y avait des photos du Poppydrille avant sa transformation en bar, des photos de l’ouverture officielle et du premier client servi. D’autres de Bastien plus jeune, en uniforme, dans ce que je devinais être les tranchées de la Grande Guerre.
Il y en avait une de ma mère en robe de mariée, souriante, jeune. Pleine de cette chaleur que dégagent les amoureuses. Puis, une autre lorsqu’elle était enceinte de moi, arborant péniblement son ventre rebondi duquel je devais sortir quelque temps après. Les cernes sous ses yeux trahissaient sa fatigue. Ses traits tirés : on peinait à croire que c’était la même femme, à quelques mois d’intervalle. C’était probablement l’une des dernières photos d’elle. La seule de nous deux. Je n’avais connu ma mère que de l’intérieur. Elle ne m’avait touchée qu’à travers elle, bercée que du son de sa voix. Et je n’en gardais aucun souvenir. Je l’avais cherchée toute ma vie, mais je n’avais trouvé personne à qui confier mes découvertes et mes secrets, de qui apprendre à faire des tresses. J’aurais voulu savoir quelle part d’elle je portais en moi, la remercier de s’être battue pour que je puisse vivre. Puis, le fait de ne jamais pouvoir lui présenter mes enfants me bouleversa.
Tandis que des larmes roulaient sur mes joues, mes yeux croisèrent un foulard offert par la mère de Marielle sur ma patère. Un tricot, des fils entremêlés, formant un tout, protecteur du froid, gardien de la chaleur de ceux qui le portent : je me dis que c’était cela, une famille. Dans mon foulard à moi, il y avait de grandes mailles. Impossibles à raccommoder.
Thomas choisit ce moment pour me rejoindre dans le bureau. Il avait d’abord tambouriné doucement, puis entrouvert la porte. Il s’était glissé dans la pièce sur le bout des pieds et m’avait rejointe sur le plancher. Tout en caressant mon dos, il écarta délicatement la photo de ma mère pour l’observer.
— Tu as ses yeux, murmura-t-il.
Il me berça en chantonnant. Je n’aurais voulu essouffler mes peines dans les bras d’une autre personne.
— Je suis désolée, Thomas, hoquetai-je en me détachant de lui. Je ne pourrai pas me marier.
Du bout de son doigt, il essuya une larme sur ma joue.
— Je ne te l’ai pas encore demandé, répondit-il en souriant faiblement, mais ce n’est pas grave… On trouvera un moyen.
Je hochai la tête. Ses mains robustes cueillirent mon visage. Ses lèvres frôlèrent les miennes, caressèrent ma bouche délicatement comme si une plume y dansait. Je tressaillis et poussai un léger soupir. Mon corps entier me poussait vers lui, mais ma tête me disait qu’il ne le fallait pas. Je me dégageai un instant, tentant en vain de reprendre mes esprits. Son souffle réchauffait mon cou. Les poils de ma nuque se dressèrent lorsqu’il déposa ses lèvres sur ma peau. Puis le long de mon cou. Mes lèvres. Longuement. Je ne pensais plus à la photo. Je ne pensais plus à ma peine. Plus rien ne m’importait que Thomas et moi.
La porte s’ouvrit et Bastien plongea la tête dans la pièce. Il se retira brusquement et claqua la porte.
— Bastien? dit Thomas.
Je hochai la tête, incapable de prononcer une seule parole.
— Eh bien, j’ai été content de te connaître, ajouta-t-il en ricanant.
Il m’aida à me relever. Je chancelai quelque peu en me rendant vers la porte. J’espérais que Thomas ne s’en rende pas compte. En déposant ma main sur la poignée, je restai comme figée. Ce moment ne devait pas se terminer. Pas encore. Thomas caressa mes cheveux sous mon chignon. Ma tête se renversa quelque peu. Il embrassa mon cou en faisant glisser sa main le long de mon bras. Nos doigts s’entremêlèrent autour de la poignée. Un gémissement m’échappa. J’aurais damné le ciel pour être seule avec Thomas.
— Il va falloir ouvrir la porte, Clara.
Pas question, pensai-je. Encore quelques instants de plus. Rien qu’un me suffirait.
— Non, répondis-je.
À ces mots, Thomas me tourna face à lui. Il appuya une main sur la porte afin qu’elle ne s’ouvre pas. De l’autre, il attira mon visage au sien et m’embrassa avec avidité. Son corps
se souda au mien. Je me surpris à approcher ses hanches des miennes.
De l’autre côté de la porte, Bastien se racla la gorge. Puis, il frappa quelques coups timides. Thomas s’arracha à moi.
— Marielle… Marielle a besoin d’aide, siffla Bastien.
Tandis que j’agrippais la poignée, Thomas s’agenouilla et entreprit de ranger les photos dans la boîte.
— J’y vais, Bastien, répondis-je.
J’ouvris toute grande la porte, et un coup de vent fit voleter mes boucles rebelles. D’une main assurée, je retins Bastien qui tentait d’entrer dans le bureau et le poussai vers le bar.
— Occupe-toi de distribuer, je préparerai les commandes avec Marielle, lui ordonnai-je.
Le bar se vidait par vagues. Quand les derniers clients furent partis, Thomas se proposa pour ramener Marielle chez elle. Le petit malin évitait ainsi les tempêtes de Bastien auxquelles je n’échapperais probablement pas.
Pendant que mon doorman fermait à clef, je m’installai au piano et entamai l’opus 9 des nocturnes de Chopin. Bastien prit place derrière moi, sur la banquette près du mur. Sa colère me glaçait l’échine. Mais plus il irradiait, plus j’accentuais les changements de rythme, les accents et les nuances.
À la fin du deuxième mouvement, je le sentais se détendre quelque peu. Puis, sa présence s’estompa. Les yeux fermés, je me laissai guider par les envolées lyriques. Mes doigts courraient d’une note à l’autre comme s’ils se souvenaient du chemin vers la mélodie.
À la fin du troisième mouvement, lorsque mes doigts caressèrent les dernières notes, la musique se mua en réverbérations qui ne semblaient pas vouloir se taire. Suspendues là, au-dessus de nos têtes, de petites fées persistaient à danser.
Bastien attendit le silence. Et bien après.
— Tu n’as jamais aussi bien joué, Clara, murmura-t-il en prenant place sur le tabouret à côté de moi.
Je fixai la partition. Je ne pouvais me résigner à quitter l’état de grâce dans lequel je m’étais plongée. Je savais que j’avais franchi une ligne interdite, mais je n’arrivais pas à me convaincre que mon moment passé avec Thomas méritait d’être écorché. Bastien se racla la gorge.
— Ton père était un virtuose, se risqua-t-il. Quelque chose comme un petit génie qui n’avait pas demandé à l’être.
Je n’avais pas envie qu’il me parle de mon père. Sa vie m’importait peu, pensai-je en me retournant lentement. Ç’aurait pu être n’importe qui, mon père. Au lieu de ça, il a choisi de n’être personne. Je restai toutefois silencieuse. Par respect pour Bastien.
— Je l’ai connu en 1918, à Amiens. J’étais mutilé de l’intérieur. J’avais perdu trop de frères d’armes. Tué trop d’hommes. Ton père, lui, semblait immuable.
Il plongea son regard vers le sol. Ses mains tremblaient légèrement. Il prit une profonde inspiration.
— Un soir, nous avions trouvé refuge dans une petite maison près de la cathédrale. Les bombardements résonnaient jusque dans nos poitrines. Je n’arrivais pas à me calmer. C’est alors que ton père a tiré une photo de la poche de sa vareuse.
Bastien déposa une photo racornie à côté de moi sur le banc. Malgré les taches et les plis, on distinguait parfaitement une femme décharnée tenant dans ses bras un enfant enroulé dans une petite courtepointe identique à celle qui recouvrait le dossier de la chaise berçante de mon père dans mon appartement. Je fermai les yeux en tentant de déglutir malgré ma gorge qui se serrait de plus en plus. Il existait bien une photo de moi et de ma mère, toutes deux vivantes.
— Ton père m’a expliqué votre histoire. Il a connu ta mère à une soirée paroissiale et l’a aimée dès les premiers instants. Ils étaient très proches l’un de l’autre et, un soir, l’inéluctable s’est produit. Ils ont dû se marier quelques semaines plus tard, avant que le corps de ta mère ne révèle ses formes. Ils ont été très heureux, malgré la colère de ton grand-père. Malheureusement, la santé de ta mère s’est détériorée. Vers le sixième mois de sa grossesse, elle a dû tenir le lit. Selon ton père, elle était si blême et si maigre que le médecin ne croyait pas qu’elle arriverait à te mettre au monde.
Bastien emmêlait et démêlait ses doigts, comme s’il ne savait pas quoi faire avec eux.
— Ton grand-père paternel était un homme très sévère, continua-t-il. Selon lui, un homme n’en était pas un s’il n’avait pas fait la guerre. Alors, quand la Grande Guerre a éclaté, il a forcé ses fils à s’enrôler, les menaçant de les chasser de sa ferme s’ils refusaient. Ton père a tenté d’argumenter avec ton grand-père, expliquant que ta mère et toi auriez besoin de lui, mais ça n’a rien changé. Tu comprends?
J’acquiesçai. Mon père ne voulait pas nous quitter. S’il perdait son emploi à la ferme, il ne pouvait plus nous nourrir et payer un médecin pour ma mère. L’armée lui donnait un salaire généreux. Il n’avait pas le choix. Toute ma vie, j’avais détesté mon père parce que je croyais qu’il nous avait abandonnées. Je regrettais maintenant de n’avoir pu le connaître.
— Il est donc parti pour Valcartier pour s’enrôler comme volontaire, expliqua Bastien. Il a embarqué pour l’Angleterre au début octobre 1914. Quelques mois plus tard, il a reçu une lettre de ta grand-mère qui expliquait que ta mère n’avait pas survécu à l’accouchement. Elle a ajouté que si la guerre prenait fin bientôt, elle ne lui conseillait pas de revenir dans votre coin de pays. Ton grand-père maternel était tellement en colère contre lui qu’il avait démoli une partie de la grange à mains nues. Lorsqu’il était saoul, il jurait de le tuer. Elle a promis de le tenir au courant. Elle avait glissé cette photo dans l’enveloppe. Je me souviendrai toujours du regard de ton père lorsqu’il m’a dit : « J’ai tué ma femme, Bastien… C’est de ma faute. C’est moi qui ai fait ça. Et à cause de ça, je ne pourrai jamais voir mon enfant. En réalité, je suis mort depuis longtemps. »
Des larmes roulaient sur mes joues. Je voulais que Bastien se taise. Je n’avais plus la force d’en entendre davantage. Ma poitrine se comprimait sous l’effet de l’émotion, et je peinais à respirer. Mais je ne pus me résoudre à lui demander d’arrêter son récit, alors je détournai le regard.
— La seule chose qui le tenait en vie, Clara, c’était qu’il ne voulait pas te décevoir. Il disait que s’il ne pouvait pas te connaître, un jour tu apprendrais qui il était. Et tu serais fière de lui. Alors, il s’est battu comme un roi. Il prenait part à tous les combats et refusait toutes les promotions qui l’éloigneraient du front. Je me suis collé à lui et me suis laissé porter jusqu’à la fin de la guerre. Nous ne nous sommes jamais quittés après. Il a acheté le bar avec l’argent si durement gagné dans les tranchées, et j’ai accepté de travailler à ses côtés. Ta grand-mère lui écrivait souvent, mais elle ne voulait pas qu’il revienne, même après la mort de ton grand-père. Chaque fois, ça le mettait à l’envers. Alors, il s’asseyait au piano et y déversait ses souffrances. Comme tu l’as fait tout à l’heure.
Bastien risqua un mouvement dans ma direction, mais se ravisa. Il finit par joindre les mains comme lors d’une prière. Je l’imitai en serrant mes mains très fort, jusqu’à ce que mes jointures craquent. J’espérais ainsi ne pas m’écrouler sous le poids de ma peine.
— Si… si je te raconte tout ça, Clara, c’est parce que j’ai juré à ton père de veiller sur toi. Je lui ai promis que je ferais tout pour que tu ne répètes pas les mêmes erreurs que lui.
Thomas est un homme bien. Je le connais suffisamment pour dire qu’il est sincère avec toi. Rien ne me ferait plus plaisir que de vous voir réunis. Mais, s’il part à la guerre et n’en revient pas, je ne pourrai jamais me le pardonner. Alors, attends. S’il te plaît, attends qu’il revienne.
Le barrage finit par céder. Des larmes déferlaient sur mes joues. Je hochai de la tête en hoquetant. Bastien avait raison. Thomas et moi, c’était impossible. Pas avant la fin de la guerre. J’étais soudainement honteuse de ce que nous avions fait plus tôt. Bastien me prit dans ses bras et joignit sa peine à la mienne.
En silence, il me reconduisit sur le divan dans le bureau et me borda.
Au petit matin, je le trouvai recroquevillé sur la banquette du bar, recouvert de son manteau.
|
Table des matières
1. Les méandres des ramilles
Septembre 1939
Octobre 1939
Avril 1940
Mai 1940
Épilogue – Août 1942
Réflexion sur les impacts de l’utilisation d’une focalisation interne dans les romans historiques
Introduction
2. Le roman historique
2.1 Les méandres des ramilles, un roman historique
2.2 Le réel objectif dans le roman historique
2.3 La subjectivité et la place de la fiction dans le roman historique
3. La focalisation interne
3.1 Définition de la focalisation interne
3.2 L’intériorité du personnage principal
3.3 La restriction de champ
3.3.1 Les choix nécessaires de l’auteur
3.3.2 Les trahisons nécessaires de l’auteur
3.4 La problématique de la focalisation interne dans le roman historique
Conclusion
Bibliographie .
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet