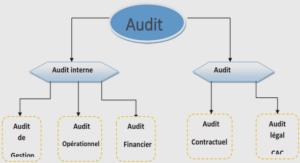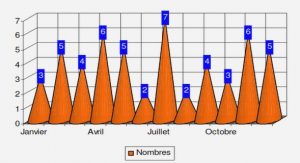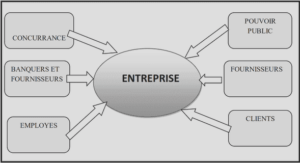A l’échelon de l’économie mondiale, et au cours de ces dernières décennies, il s’est engagé un grand mouvement de réformes économiques, et plus particulièrement, dans les pays du tiers monde. Ces mutations économiques ont causé de nombreuses contestations, quant à leurs particularités théoriques, politiques, et économiques que par l’ampleur de leurs mise en application dans de nombreux pays ; Au-delà de leurs perspectives, ces reformes semblent faire l’unanimité quant à la nécessité de leurs applications.
La gestion centralisée
Sous l’ombre de la gestion centralisé, le fonctionnement et l’organisation de l’entreprise publique avait engendré l’évolution des différents modes de gestion. Elle avait été dominée alternativement par l’autogestion, la société nationale, l’entreprise nationale puis la gestion socialiste et la restructuration organique et financière.
L’Autogestion
Au lendemain de l’indépendance, pour défendre l’intérêt du pays, les travailleurs ont pris en main la gérance de leur propre unité industrielle, en conséquence, des comités de gestion ont été créer, d’où leur membre étaient des travailleurs de l’entité; Un acte participatif a incité l’Etat de le formalisé juridiquement par l’autogestion . Considéré comme entreprise publique autogérer, toute entité ayant plus de dix salariés et déclarées vacantes. Elle était structurée en 3 organes principaux : l’assemblée générale des travailleurs, le comité de gestions et le directeur de l’entreprise.
La société nationale
Dès 1964, pour prendre en main la gérance de certaines activités, récupérer les richesses et les leviers de financement, l’Etat a crée plusieurs sociétés dont le but est de faire naître le projet économique et social, en outre, pour appliquer la stratégie d’érection de l’économie, et étendre la propriété publique. Ce mode de gestion est appelé la société nationale.
La société nationale est spécifiée par une centralisation des structures, sa gestion est confiée à un directeur général nommé par décret et sur proposition du ministère tutelle, assisté d’un organe appelé parfois conseil d’administration ou conseil d’orientation et elle utilisait la comptabilité commerciale.
L’organisation de cette société a connu trois modèles : le premier mode d’organisation, la société nationale était ordonnée comme une société anonyme dotée d’un conseil d’administration ; le second mode d’organisation qui dissimule deux axes principaux, un reproduisait la préoccupation d’un contrôle administratif et l’autre introduisait la participation des travailleurs , cette organisation avait été traduit par la commission de contrôle composé de 08 membre : 04 représentants l’Etat, 01de la banque centrale, 01 de la caisse Algérienne de développement et 02 travailleurs ;d’autre part, le dernier mode d’organisation était caractérisé par une structure autoritaire, un directeur générale nommé par décret et dispose de tous pouvoirs sous la tutelle du ministre.
De même, La société nationale a rencontré de nombreux problèmes (l’absence d’un système homogène, l’hétérogénéité des niveaux technologiques, un objectif économique socialiste dans environnement dominé par les mécanismes du marché et d’une économie capitaliste, etc.…), qui ont mis terme à ce mode de gestion, et fin à sa vie économique.
L’entreprise nationale et la gestion socialiste (G.S.E)
En 1970, Sur les vestiges du système antécédent, L’entreprise nationale était créée dont le but d’améliorer la situation. Cette période a connue un nouveau mécanisme au sein de l’économie nationale, il s’agit, en effet, de la planification et de la réforme financière. L’ordonnance de janvier 1970 (instituant la planification), préconise la planification comme moyen d’aménagement économique. La planification centralisée a suscité une suite de retentissement sur l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise publique; comme la perte de l’autonomie, un programme planifié, etc. L’entreprise publique était devenue un organe déconcentré de l’administration de l’Etat.
Pour atteindre les objectifs du plan, il a fallu centraliser les ressources financières, des réformes financières avait été mise en œuvre afin d’assurer le financement rationnel des projets d’investissements à l’échelle macro-économique.
Sur ce, des nouveaux éléments d’organisation de l’entreprise publique avait été introduit par la loi de finance 1970 complétée par celle de 1971. Par conséquence, l’entreprise publique avait exercé la fonction instrumentale au service de l’administration économique, car elle était soumise aux injonctions de son ministère tutelle, aux prescriptions, ministère du finances, ministère du commerces, ministère du travail, et de la banque auprès de la quelle était domiciliée etc.. ; Ceci avait réduit complètement son champ décisionnel et avait éliminé son autonomie.
Du quelle, l’entreprise publique à partir 1970 était devenue un espace d’accumulation du capital étatique ou précisément dit un outil opérationnel d’exécution des projets d’investissements qui ont été déterminé par le plan. A cet effet, l’avènement de la planification centralisé et de la réforme financière l’entreprise publique était devenu un organe déconcentré de l’administration économique de l’Etat.
Après l’adoption de la planification, la réforme financière, la nationalisation des hydrocarbures le 24/02/1971 et la promulgation des textes de la révolution agraire le 08/11/1971 fut survenu des textes promulguant la gestion socialiste des entreprises ( G.S.E), et cela fut le 16/11/1971.
Ces textes avait crée des profonds mutation sur le plan théorique, ils avaient constitué l’un des éléments fondamentaux pour l’assemblage du puzzle nécessaire à la construction du Socialisme. Cette réforme visait à uniformiser la structure juridique des entreprises publiques, et elle se caractérisait fondamentalement par l’institutionnalisation de la participation des travailleurs à la gestion de leur entreprise et ils avaient été considérés comme des producteurs gestionnaires.
L’organisation et la gestion socialiste des entreprises avaient été progressivement mises en place à partir 1972. Les organes de gestion sont: l’assemblée des travailleurs, les commissions spécialisées qui sont en nombre cinq, la commission économique et financière , la commission des affaires sociales et culturelles , la commission du personnel et du formation , la commission de discipline , la commission d’hygiène et de sécurité , et le conseil de direction. D’autre textes avaient été promulgués qui dessinaient toujours l’organisation de cette entité, il s’agit de : le décret N°75-149 du 21/11/1975 relatif aux conseil de direction des entreprises socialiste à caractère économique, et le décret N° 75/150 du 21/11/1975 relatif aux prérogatives des assemblées des travailleurs des entreprises socialiste à caractère économique.
La restructuration des entreprises
Un bilan économique évaluatif pour la période 1967- 1978 fut démontré plusieurs dysfonctionnements (le déséquilibre financier avait engendré le dérèglement économique, la rigidité dans le fonctionnement de l’économie et la grande complexité de la gestion, etc..) qui avait affété la gestion de l’entreprise publique. Ces dysfonctionnements avait été à l’origine de la crise publique, et de remettre en cause l’ancien mode de gestion. Le finalité de cette restructuration avait été présenté dans des textes législatives qui se résume dans les points suivant : l’efficacité, la décentralisation, et la responsabilisation des différents agents de l’économie.
Au début des années 1980, la centaine de sociétés nationales a été restructurée en plus de cinq cents entreprises publiques, et le mode d’intégration vertical de chaque société nationale était cassé, voir transformer en concentration horizontale ou plutôt en séparation des fonctions de l’amont et de l’aval. Par exemple: la société NAFTAL est née de cette restructuration de SONATRACH en 1982 puis la séparation de raffinage et de la distribution en 1987.
Suite à cette démarche, les entreprises publiques étaient fractionnées en nombre variable d’entreprises nouvelles, selon des critères fonctionnels et géographiques. Ce pendant, une fois isolées les unes des autres, coupées à la fois de l’amont et de l’aval du cycle de production, devait faire face à de nombreux problèmes financiers; Mais elles étaient incapables de dégager des cash-flows positifs nécessaires au remboursement de la dette, encore moins de participer au budget de l’état et acheter des bons de trésor. Commencée en 1983/1984, la crise économique en Algérie a été aggravée, dés 1986, par les chutes des prix du pétrole et du dollar qui ont réduit les revenus des exportations, fondés à 95% sur les hydrocarbures. A cet effet, les décideurs ont pensé, ou bien, obligés de revoir la restructuration des entreprises publiques et de lancer un nouveau mode de réorganisation » L’autonomie ».
|
Table des matières
Introduction Générale
Chapitre I : L’évolution du contrôle au sein de l’entreprise publique Algérienne & La dimension Historique de l’Audit
Section I : l’évolution de l’entreprise publique Algérienne
Section II : la dimension historique et culturelle de l’Audit
Section III : l’Histoire de l’Audit dans l’entreprise publique Algérienne
Conclusion
Chapitre II : L’Audit comptable et Financier
Section I : Introduction à l’Audit comptable et financier
Section 2: l La Méthodologie de l’Audit Comptable et Financier
Section 3 : Techniques, Rapport, et la responsabilité de l’Auditeur financier
Conclusion
Chapitre III : L’Audit Comptable et Financier au sein du groupe GIC ERCO
Section 1 : Le Groupe GIC ERCO
Section 2 : la filiale SCIBS
Conclusion
Conclusion Générale