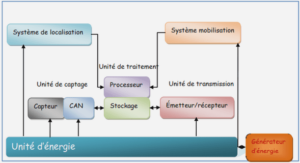La musique et l’approche sensible
Avant tout, il est possible d’approcher la musique de deux façons : sur son contexte, lorsque l’on cherche à comprendre les dimensions sociales et spatiales qui rentrent en jeu lors du processus musical, associé par ailleurs à des dynamiques politiques ou économiques, mais aussi sur son essence même. La musique est avant tout un processus artistique, une émanation personnelle ou collective qui est le reflet d’une expression de l’homme. Les processus de contextualisation peuvent être approchés par les sciences humaines. La discipline musicologique va essayer quant à elle de comprendre, sans ignorer le contexte pour autant, des processus ayant attrait à l’essence de la musique, en parti dans sa méthode scientifique en analysant les caractéristiques mélodiques, harmoniques, rythmiques de la musique, ses arrangements, etc. Toutefois, ces méthodes rigoureuses de l’analyse musicale se rapprochent comme elles peuvent de l’aspect sensible de la musique perçue comme un art, qui reste un domaine un peu éloigné des disciplines scientifiques.
Cependant de plus en plus de travaux scientifiques s’accordent sur l’importance de comprendre le sensible dans leurs approches. Le philosophe et sociologue Pierre Sansot, dans son ouvrage « Les formes sensibles de la vie sociale » (1986) précise ceci : « Le sensible, c’est toujours ce qui nous affecte et retentit en nous » (Sansot, 1986, p.38), puis rajoute « Dans le sensible, il n’y a pas lieu de séparer le réel et l’imaginaire » (Sansot, 1986, p.39). L’étude du sensible permet d’apporter dans le domaine des sciences sociales un pan de réflexion qui s’attarde sur des thématiques qui restent souvent mystérieuses, pouvant être perçues comme trop insaisissables face aux méthodes utilisées. Alain Mons propose dans son ouvrage « Les lieux du sensible : villes, hommes, images » (2013) une approche du sensible par la dimension spatiale, en associant des lieux avec des affects. Il énonce que « les lieux ambiants nous touchent par les images qu’ils déclenchent » (Mons, 2013, p.79), et évoque dans son chapitre 14 l’idée d’une géographie affective, notamment par ces mots : « Lorsque nous traversons certains lieux, certaines atmosphères spatiales, des images affluent dans notre imagination » (Mons, 2013, p.204). Pour lui, l’approche du sensible doit se faire par la déconstruction de la méthode scientifique classique et l’avènement de ce qu’il appelle une « pensée voyageuse », une « poétique de la recherche conceptuelle » : « pourquoi opérer une ‘‘classification rationaliste’’, tenir un langage rigoriste et rassurant, prôner un ‘’conceptualisme’’ scientiste, instrumental qui est sans aucune résonance avec un réel bigarré, troué, mineur, paradoxal, étrange ? » (Mons, 2013, p.8). Il propose de porter plus d’attention à nos perceptions, à nos sens dans notre approche. Ainsi, pour le sens auditif, « il faudrait distinguer les traits d’une physionomie sonore à travers les tonalités, les signaux et les empreintes » (Mons, 2013, p.156), reprenant dans ce sens des travaux de Murray Schafer sur le paysage sonore que nous évoquerons par la suite. La musique est dans son travail perçue comme un exemple d’objet qui demande pour son analyse l’utilisation d’une approche sensible.
J’ai essayé dans mon approche du phénomène musical dans le métro de poursuivre certaines de ces idées ; tout d’abord en utilisant mon sens auditif pour essayer d’apercevoir un environnement sonore propre au métro, pour pouvoir par la suite le mettre en relation avec celui du musicien. Ensuite, car l’expression artistique du musicien dans le métro, la façon dont il va réussir à créer un univers musical assez puissant pour qu’une foule de personnes s’arrêtent autour de lui, jusqu’à parfois perturber le passage du flux de transit du métro répond à des critères qui dépassent l’entendement scientifique classique : c’est l’aura du musicien, ce qui émane de lui, qui va souvent permettre à un espace de lui donner des caractéristiques de place. Les musiciens seraient sûrement plus capables que les voyageurs d’apercevoir dans le métro des ambiances, des puissances sensibles de l’espace environnant, discrètes mais présentes, qu’ils arriveraient selon leur talent à faire rentrer en résonnance avec leur musique. Comme le rappelle Alain Mons, « il existe un fabuleux talent de ces lieux méconnus, discrets, qui nous échappent, lié au fait qu’ils servent avant tout de lieux de passage » (Mons, 2013, p.114). Essayer de regarder le métro autrement que comme un lieu où l’on transite ne nous apporterait pas de très grandes richesses sur l’analyse de cet espace ?
Le sonore et le musical en géographie
Comme nous avons pu le faire pressentir précédemment, la géographie intègre de plus en plus dans ses paradigmes le fait musical et sonore. La considération de la musique dans la discipline est une des conséquences de l’ouverture des champs d’approches qu’a permis le tournant culturel dans la géographie. La revue Géographies et Cultures, créée en 1992 par Paul Claval, un des premiers théoriciens de la nouvelle géographie culturelle française, a ainsi intitulé sa 59e parution, en 2006, « Géographies et Musiques : Quelles perspectives ? ». Cette parution dirigée par la géographe Claire Guiu propose un recueil d’articles qui amènent à réfléchir sur les possibilités de recoupement entre les problématiques spatiales et musicales. Le premier article, écrit par Claire Guiu, propose une épistémologie de l’utilisation du fait musical en géographie.
En lien avec l’approche du sensible que nous avons évoquée, la place que la géographie accorde de plus en plus à l’objet musical semble découler d’une volonté de plus prendre en compte dans l’analyse l’importance des perceptions. S’intéresser aux perceptions comme outil de travail amène souvent à remettre en question l’utilisation quasi exclusive dans l’analyse géographique du sens visuel, pour s’intéresser à l’information que peuvent capter nos autres sens. Notre oreille reçoit ainsi l’ensemble des informations sonores, que l’on peut comprendre comment l’ensemble des sons émis par les hommes et leurs créations, par le vivant et la nature. A l’intérieur de ces sons, on retrouve la musique qui est comprise comme un arrangement de sons organisés par l’homme. Claire Guiu cite ainsi quelques rares géographes qui dès les années 1930 auraient pris en compte le fait sonore (G. de Gironcourt, V. Cornish, Granö), ou encore A. Siegfried qui a cherché dans les années 1950 à mettre en avant une géographie « ouverte aux ‘’zones mal explorées’’ du monde sensible » (Guiu, 2006, p.12). La géographie « humaniste » de Yi Fu Tuan des années 1960, marquant une distance avec une géographie plus quantitative, aurait aussi accentué l’intérêt de la géographie à l’égard des perceptions. La géographie aurait ainsi de façon marginale mais progressive intégrée de plus en plus ces nouvelles thématiques, durant les années 1960, puis en s’accroissant dans les années 1970 et 1980. On peut d’ailleurs aussi citer l’approche que la géographie inspirée de l’Ecole de géographie culturelle de Berkeley (Californie) a fait de la musique moins par le fait sonore mais plutôt par son contexte sociospatial, tel que George Carney, « géomusicologue », qui a étudié dans les années 1970 les différents genres de musiques américaines sous formes d’aires culturelles. C’est finalement le tournant culturel des années 1990 qui a entraîné une plus large prise en compte du phénomène musical. L’assouplissement du paradigme et la curiosité grandissante pour des processus sociaux et spatiaux apparus dans la ville postmoderne pousse la géographie à considérer la musique sous un tout autre angle. Mike Crang énonce, dans son ouvrage « Cultural Geography » (1998), que « Lorsque l’on pense à la géographie de la musique, nous devons penser aux espaces créés » (Crang, 1998, p.92), en particulier aux « espaces d’affect ». On peut comprendre ici que la géographie culturelle cherche à percevoir la musique non plus comme une entité à fixer, mais comme un processus culturel fluide qui évolue selon les lieux dans lequel il se trouve, et surtout qui contribue à les modifier et à les recréer.
En parallèle, certains travaux scientifique basés sur le sonore m’ont inspiré dans ma recherche. Le son est perçu, dans les travaux de géographie urbaine, comme un outil pour percevoir certaines dynamiques de constructions spatiales. Torsten Wissmann, dans son ouvrage « Geographies Of Urban Sound » (2014), précise que le son est une « […] part fondamentale de la vie urbaine, quelque chose d’essentiel pour comprendre le sense of place en ville »2 (Wissmann, 2014, p.1). Le son peut être étudié dans l’optique de mettre en place un « paysage sonore »,comme l’a théorisé le compositeur Robert Murray Schafer dans son ouvrage « The Tuning Of The World » (1977), c’est-à-dire un portrait sensible d’un espace, en prenant en compte toutes ses caractéristique sonores, sons, musique, signaux, tonalités, etc. Pour parvenir à percevoir cette dimension, R.M. Schafer propose la méthode du « soundwalking », la « promenade sonore », qui se résume dans l’idée de se déplacer dans l’espace en focalisant son attention sur notre perception auditive. Prendre en compte cette théorie dans mon étude m’a permis de dégager dans le métro, en utilisant mon enregistreur sonore, des traits particuliers qui participeraient à son identité sonore, mais aussi de les mettre en relation avec la musique produite, qui vient s’ajouter sur un paysage sonore déjà conséquent. La note du compositeur et géographe Andrea Martignoni, « Objets et paysages sonores », paru dans la revue « Géographies et musique : quelles perspectives ? » (Géographies et Cultures n°59, 2006) vient à ce propos avancer une idée intéressante : il existe, comme l’a montré Pierre Schaeffer dans son ouvrage « Le Traité des Objets Musicaux » (1966), quatre stades de perception auditive. « Ouïr » est le premier stade, correspondant à une attitude peu active de l’auditeur qui évolue dans un fond sonore qui retient peu son attention. L’étape d’ « entendre » apparaît lorsqu’une figure sonore se détache du fond et que l’attention de l’auditeur s’y tourne. « Ecouter » signifie réussir à prendre en compte l’information portée par le son. Enfin, « comprendre », correspond à l’entrée de l’auditeur dans un monde de valeur. Cette théorie m’a permis d’avancer l’idée que lors de son déplacement dans le métro, le voyageur, lorsqu’il va se retrouver en présence d’un musicien, va procéder à ces différents stades de perception auditive : un son, une musique particulière va se détacher du fond sonore qu’il perçoit (bruits de pas, des wagons, signaux, annonces, etc) et, pour le cas des musiciens de couloir, va arriver de plus en plus proche du voyageur au fur et à mesure que sa marche va l’emmener à passer devant le musicien. L’information acquise, il va, si il le souhaite, et c’est là un des grands défis du musicien, s’arrêter pour rentrer dans le monde de valeur de ce dernier. Ce concept m’amène à penser que la trame sonore d’un espace est en perpétuelle recomposition selon les sons qui arrivent à nous et il est au final difficile d’appréhender un environnement sonore comme celui du métro comme un « paysage », qui sous-entend une certaine fixité. A propos, Claire Guiu, dans l’ouvrage « Soundspaces. Espaces, expériences et politiques du sonore » (2014), co-écrit avec Guillaume Faburel, Marie-Madeleine Mervant-Roux, Henry Torgue et Philippe Woloszyn, avance le concept de « Soundspaces [espaces sonores] », qui « […] fait ici écho et contrepoint aux travaux mobilisant la notion de « Soundscape » [paysage sonore], créé et théorisée par le mouvement de l’écologie sonore dans les années 1970. Point d’ambition paysagère ici, mais bien la volonté de construire de nouveaux espaces de savoirs et d’actions » (Guiu, 2014, p.12). Cette dernière phrase résume bien l’idée que j’estime primordiale de pouvoir écrire pour, au-delà de simplement relater un fait, arriver à construire une réflexion nouvelle, une pensée. Il y a pour mon travail un défi qui va dans ce sens : je cherche à montrer en quoi les musiciens sont capables d’apporter un univers de sens tout à fait différent et inédit dans l’univers de transport du métro. J’aimerais pouvoir construire tout au long de mon mémoire cette idée, pas forcément évidente à démontrer, que la musique peut amener à repenser l’utilisation d’un espace public aussi régulé et ordonné qu’est le métro parisien. Pour ce faire, je vais ainsi mêler les divers acquis scientifiques mentionnés ici avec mes observations réalisées sur le terrain et mes réflexions personnelles, pour distinguer des pistes de compréhension du phénomène autour de deux points corrélés. J’étudierai dans un premier temps les caractéristiques du métro qui en font un espace-outil utilisé pour le déplacement, pour dans la dernière partie de mon mémoire y introduire le vécu des musiciens et la création d’un espace de musique au travers de leurs performances.
LE METRO COMME UN ESPACE DE TRANSPORT
Mon but ici n’est pas tant de réaliser un inventaire exhaustif de toutes les caractéristiques du métro mais davantage de pouvoir mieux comprendre la logique dans laquelle s’est mis en place cet espace, et dans laquelle se déroulent les processus de mobilités urbaines. Mon idée directrice est de pouvoir mettre en lumière les différents aspects qui ont fait du métro un espace fonctionnel de transport dans lequel on passe, dans lequel on transite sans jamais vraiment s’arrêter, un endroit en quelque sorte privé d’expérience. Le chapitre suivant qui traitera du phénomène musical que l’on peut retrouver dans le métro viendra se placer en contrepoint de cette idée. Si mon étude s’intéresse au métro de Paris, j’évoquerai toutefois secondairement l’apport que réalise à ce réseau la place du RER. Cette précision m’a paru utile à être signifiée compte tenu de la logique similaire de transport qui régit ces deux espaces, d’autant plus que les deux structures sont souvent combinées dans le parcours quotidien des voyageurs en Ile de France.
Le métro, un espace fonctionnel
Généralités
Le métro et le RER forment un vaste espace de transport en Ile de France. Les 14 lignes de métro ainsi que 2 lignes de RER sont contrôlées par le groupe RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens). Ce groupe est un EPIC (Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial), c’est-à-dire une personne morale de droit public, qui s’occupe de la gestion d’un service public, le transport en commun. Un EPIC est mis en place lorsque l’on se rend compte de l’importance d’une tutelle publique, c’est-à-dire de l’Etat, sur un service dont l’aspect public rend désuet une gouvernance totale par une entreprise privée. Nous reviendrons sur la mise en place du service RATP par la suite du chapitre. La RATP contrôle également la majeure partie des lignes de tramways et de bus en Ile-de-France, ainsi que divers projets de transports publics à l’international. Elle collabore en grande partie en Ile-de-France avec la SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer français), entreprise publique française, notamment sur la gestion du RER. A noter que l’établissement public administratif du STIF (Syndicat des Transports d’Ile-de-France) est l’organisme chargé de faire autorité en matière d’organisation des transports en Ile de France, et donc se partage sur ce territoire les modes de gestion du transport public avec la RATP et la SNCF. Le métro, ou réseau métropolitain de Paris, constitue un ensemble de 14 lignes, plus deux lignes « bis » – la ligne 3 bis et la ligne 7 bis – qui s’étendent sur un réseau de 219,9 kilomètres, selon les sources du STIF, desservant un total de 302 stations, principalement sur Paris intra-muros, ainsi que quelquefois en proche banlieue. L’ancrage territorial du métro se réalise donc sur Paris et est centré exclusivement sur Paris : le réseau métropolitain qui se développe en proche banlieue procède selon des extensions de lignes déjà existantes qui relient les périphéries proches de Paris à son centre. Ce réseau est principalement sous-terrain, mis à part 20 kilomètres de viaducs sur Paris (sur des tronçons des lignes 1, 2, 5 et 6) et de réseau à la surface sur des parties en banlieues des lignes 1, 5, 8 et 13. Selon les chiffres de la RATP, 5,26 millions de personnes utilisaient le métro chaque jour en 2013.
Le RER (Réseau Express Régional – d’île de France) représente un réseau de 5 lignes (A, B, C, D et E) sur 587 kilomètres de voies, desservant 257 stations. Comme son nom l’indique, le RER a une vocation plus régionale que le métro. Une de ses fonctions initiales fut de relier le réseau ferré de Paris aux gares de banlieue, et par ce biais d’accroître les mobilités sur le territoire extérieur à Paris intra-muros en Ile de France. Aujourd’hui seules 33 stations du RER desservent la commune de Paris. Les 75,6 kilomètres souterrains du métro sont surtout présents au sein de Paris, le réseau de banlieue étant surtout réalisés en surface. L’ensemble du réseau RER est fréquenté par 2,7 millions de voyageurs par jour en 2014, selon les chiffres du STIF. A noter qu’il faut bien distinguer la notion de RER et de Transilien : cette dernière correspond au réseau des trains de banlieues appartenant uniquement à la SNCF et comprenant une partie du RER, mais aussi d’autres lignes de transport en Ile de France, qui s’étendent même au-delà de la région, jusqu’en Picardie, Haute-Normandie et région Centre.
Les caractéristiques de l’espace transport
Je vais tout d’abord proposer de réfléchir sur les composantes et caractéristiques du réseau métropolitain afin de mieux pouvoir mettre en évidence le rôle de celui-ci dans les mobilités urbaines et l’influence qu’il exerce sur les voyageurs. L’idée ici est de montrer comment le métro, aménagé et organisé par des organismes qui y font autorité, va conformer les voyageurs qui l’utilisent dans un cadre de transport bien spécifique. Le sociologue et sémioticien argentin Eliséo Véron a en 1986 travaillé en collaboration avec la RATP sur le métro parisien afin d’étudier une future implantation du câble de fibre optique, permettant le transport de données immatérielles sur cet espace. Son étude, « Le Métro empire des signes : stratégies pour le câble » (1986) dépasse toutefois la mise en place de ce dispositif et propose une étude croisée du réseau métropolitain et des comportements des voyageurs. Il a cherché à « mettre au point un ‘‘langage’’ de description des espaces du réseau RATP permettant de tracer des ‘’cartes’’ pertinentes par rapport à l’implantation du câble » (Véron, 1986, page 9). Je vais réfléchir ici sur ses concepts de dimensions narratives et d’espaces types du métro pour cadrer mes propres observations de terrain. L’idée du sociologue est d’explorer la « dimension narrative » des espaces du métro, de montrer comment ceux-ci viennent influer sur les mouvements des voyageurs. Pour lui, « les caractéristiques d’un lieu donné du réseau à un moment donné […] pourraient être cernées par le moyen d’une grille articulant ces deux problématiques [espace du réseau et comportements des voyageurs] » (Véron, 1986, page 19). Le métro est ainsi perçu au fil du « récit de voyage » des usagers.
Il existerait ainsi trois dimensions narratives au sein du métro. La première est progressive : ce sont les espaces qui vont amener le voyageur à avancer vers une certaine direction. L’organisation spatiale et la signalétique mise en place dirait au voyageur : « Avancez ! ». La deuxième dimension est connective. Elle demande au voyageur de prendre une direction parmi d’autres, lui disant : « Choisissez ! ». La troisième correspond à un lieu d’attente, où l’espace va immobiliser le voyageur, lui disant : « Ne bougez pas ! ». L’idée ici est celle d’une prise en charge que la RATP réalise sur les voyageurs par l’intermédiaire de l’aménagement spatial : les voyageurs seraient ainsi cadrés dans leur déplacement autour des trois comportements énoncés, ainsi que d’un comportement dit « de charge », où ceux-ci viennent réaliser des actions dans le but de prendre en charge leur voyage (achat de billets, consultation d’une carte ou d’un plan). Ces comportements sont décrits comme narratifs, car ils vont dans le sens de l’esprit de déplacement conformé au métro. Ceci permet au sociologue de dégager des espaces-types du métro, associés aux différentes étapes du récit du voyageur qui est schématisé sur un trajet-type par l’entrée dans le métro, la prise d’un wagon, la possible prise d’une correspondance et d’un autre wagon, puis de la sortie de l’espace métropolitain.
Les marqueurs du transport
Si le métro peut être utilisé par la RATP afin de contrôler et diriger les flux humains qui y transitent, c’est en grande partie grâce aux marqueurs spatiaux que l’on y rencontre. Le discours directionnel de la RATP se fait au travers d’un ensemble de signes qui guident et structurent les trajets. Ce sont avant tout les panneaux de direction, qui indiquent une ligne (au fond blanc), une sortie (au fond bleu) ou un lieu particulier à l’extérieur (au fond marron). Dans ces panneaux de direction, nous pouvons aussi retrouver celui en vert qui indique une sortie par le symbole d’un homme semblant courir vers un extérieur, lumineux et blanc, que l’on retrouve sur les portes de sortie où sur les murs, agrémenté d’une petite flèche. Le fait que cet homme court souligne d’ailleurs l’idée que le métro est un endroit que l’on prend essentiellement pour en ressortir, pour revenir le plus vite possible à la surface. La figure 4, prise dans le couloir de sortie de Pernety, présente ce symbole sur la porte (battant de droite) et répété juste derrière sur le mur, ce qui pose aussi la question d’une sur-signalisation, d’autant plus que la photo ne permet pas de le voir, mais il n’y a pas de couloir à gauche, la direction prise se faisant ainsi forcément dans le sens indiqué par le symbole.
Corrélés aux panneaux de direction, on retrouve les panneaux qui interdisent un accès. Ce sont les panneaux rouges en hauteurs indiquant en blanc « Passage Interdit », et plus rarement un panneau de sens interdit comme ceux utilisés pour la signalisation routière, que l’on retrouve en hauteur ou sur un escalier mécanique pour nous indiquer que nous allons nous y engager en sens inverse (l’engagement dans le bon sens est représenté par une flèche verte). On retrouve aussi les panneaux jaunes nous interdisant sous peine de danger l’accès aux rails, inscrits à l’avant, au milieu et à l’arrière du quai.
Il y a aussi les marqueurs indiquant une conduite à respecter, ou à mettre en oeuvre pour le bon déroulement du trajet. C’est par exemple le signe très connu du lapin, indiquant de ne pas mettre ses doigts dans la porte, ou plus rarement qui indique de ne pas monter à bord du train lorsque l’on entend le signal sonore. Plus généralement, ce sont tous les signes qui précisent une conduite à avoir lorsque l’on utilise certaines infrastructures : les portes de sortie – comme visible sur le battant gauche de la porte de la figure 4 – où il faut faire passer enfants et bagages d’abord, ou encore les escaliers mécaniques, où il est précisé qu’il faut y tenir les enfants en bas âge, qu’il ne faut pas freiner le fonctionnement de l’escalier ni s’asseoir sur les bandes utilisées pour se tenir. On retrouve ici aussi les panneaux présents dans les wagons et dans les couloirs d’interdiction de fumer, ou les panneaux au sein des wagons soulignant les règles d’usage à respecter. On peut encore citer les marquages jaunes au sol sur les quais de certaines lignes (figure 5) qui indiquent grâce à des flèches un mouvement combiné et successif d’entrée et de sortie du wagon : surtout en cas de fort afflux, les personnes qui attendent sur les quais doivent se conformer à la réglementation indiquée par ce marquage pour laisser au centre la voie libre aux personnes qui sortent.
Le contexte historique
L’idée d’une mise en place d’un réseau métropolitain dans la deuxième partie du XIXe siècle vient d’une volonté de décongestionner la surface de Paris. Mais celle-ci a longtemps été freinée par des affrontements entre divers groupes ayant des intérêts divergents sur le métro (Margairaz, 1989). L’Etat voulait faire du métro un moyen de transport qui permettrait de joindre les grandes gares de Paris et les trains de banlieues, tandis que l’autorité de la Ville de Paris cherchait à créer un « réseau dense d’intérêt local limité au territoire intra-muros » (Margairaz, 1989, p.17). S’ajoutaient à ces difficultés les rapports difficiles entre les compagnies privées des transports déjà en place sur le territoire parisien, les omnibus et le tramway, pour qui le métro pourrait devenir un redoutable concurrent. C’est toutefois les autorités de la Ville de Paris qui réussissent à imposer leur gouvernance du projet, en partie en lien avec l’approche de l’Exposition Universelle de 1900 se déroulant à Paris. Cet évènement, dont l’apparition datant de 1851 pouvant être corrélé avec les bouleversements engendrés en Europe de l’Ouest lors de la Révolution Industrielle, est un moyen pour chaque pays de présenter ses nouvelles innovations techniques et industrielles. Les Expositions Universelles sont aussi un reflet d’une certaine compétitivité que connaissaient les villes européennes en termes de progrès techniques. L’apparition d’un métro à Paris lors de cette exposition peut être ainsi comprise comme une volonté d’entrer dans la modernité, dans la « danse du progrès », d’autant plus que beaucoup d’autres villes européennes possédaient déjà le réseau métropolitain. Nous verrons par la suite comment cette idée de modernité reste encore aujourd’hui présente dans le discours dominant qui accompagne les mutations techniques et spatiales du métro parisien.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE 1 : CONTEXTUALISATION DE L’ETUDE
I) REFLEXIONS PERSONNELLES ET METHODOLOGIQUES
1) MON CHEMINEMENT PERSONNEL
2) MON RAPPORT AU METRO
3) EVOLUTION DES PROBLEMATIQUES
4) METHODOLOGIES ENTREPRISES SUR LE TERRAIN
II) INSCRIPTION DANS LA CONNAISSANCE SCIENTIFIQUE
1) LE POSTMODERNISME
2) LE TOURNANT CULTUREL
3) LES CONCEPTS GEOGRAPHIQUES UTILISES
4) LA MUSIQUE ET L’APPROCHE SENSIBLE
5) LE SONORE ET LE MUSICAL EN GEOGRAPHIE
PARTIE 2 : LE METRO COMME UN ESPACE DE TRANSPORT
I) LE METRO, UN ESPACE FONCTIONNEL
1) GENERALITES
2) LES CARACTERISTIQUES DE L’ESPACE TRANSPORT
3) LES MARQUEURS DU TRANSPORT
4) CONTEXTUALISATION
5) LES ESPACES CORRELES A LA DIMENSION FONCTIONNELLE
5.1) L’espace technicien
5.2) L’espace de confort
5.3) L’espace sécuritaire
6) LA CONSIDERATION DU SENSIBLE DANS LE METRO
II) LA PLACE DE L’HOMME DANS LE METRO
1) LE VOYAGEUR DANS L’ESPACE FONCTIONNEL DU METRO
2) LA CONSIDERATION DU FLUX DE TRANSIT
3) LE METRO : UN ESPACE DESHUMANISE ?
3.1) Un non-lieu
3.2) Réflexion sur l’espace transport
4) L’ESPACE VECU DU METRO
4.1) Les pratiques « vécues » des usagers
4.2) La considération du métro comme un espace public
PARTIE 3 : LE FAIT MUSICAL DANS LE METRO
I) LE PHENOMENE DES MUSICIENS DANS LE METRO
1) PREAMBULE
2) L’USAGE DU METRO PAR LES MUSICIENS
3) LES ESPACES UTILISES DANS LE METRO
3.1) Le cas des stations
3.2) Le cas des rames
3.3) Les « pôles » de l’activité musicale
4) RAPPORTS ENTRE MUSICIENS
5) RAPPORT AVEC LA RATP
II) LA CREATION D’UN ESPACE MUSICAL
1) LES QUALITES SENSIBLES DU MUSICIEN
2) L’ARTICULATION ENTRE ESPACE MUSICAL ET ESPACE DE PASSAGE
2.1) L’étude par l’écoute sonore
2.2) Les comportements des voyageurs face à la musique
2.3) La qualité de place de l’espace musical
3) ETUDES DE CAS
3.1) Etude de cas n°1
3.2) Etude de cas n°2
4) LES SPECIFICITES DE LA PRESTATION DANS LES RAMES
5) QUELLE PLACE A LA MUSIQUE DANS LE METRO ?
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
TABLE DES ILLUSTRATIONS
TABLE SONORE
ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet