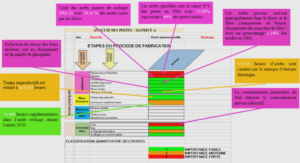Les sols constituent la base du système productif en Afrique sub-saharienne. Au Sénégal, il est difficile d’envisager une amélioration de la productivité agricole sans une restauration de la fertilité des sols, naturellement faible et qui s’est dégradée après plusieurs décennies d’exploitation agricole (Khouma et al., 2005). Les Niayes, zone d’horticulture par excellence, n’échappent pas à cette dynamique. Dans la Niaye de Pikine, la dégradation des sols se manifeste par une baisse du taux de matière organique parfois accompagnée d’une acidification ou d’une salinisation ; on assiste de ce fait à une baisse des rendements accentuée par le cloisonnement des surfaces cultivables sous l’effet de l’urbanisation galopante et de l’ensablement des cuvettes (Fall et al., 2000).
Ainsi pour augmenter les rendements, les paysans des Niayes, notamment ceux des zones périurbaines comme Pikine, utilisent les eaux usées non-traitées qui ont la réputation de réduire le cycle des cultures maraîchères. Ils augmentent par conséquent le nombre de rotation dans l’année (Gaye & Niang, 2002). L’utilisation de ces eaux usées se fait au profit des eaux de puits nommés « céanes » traditionnellement utilisées pour l’irrigation. Dans certains cas, les eaux usées sont mélangées avec les eaux de « céanes ». Cette pratique n’est cependant pas sans risque sur l’environnement. Ces eaux usées riches en matières en suspension, en azote minéral et en coliformes fécaux font en effet planer des risques de colmatage du sol, de pollution de la nappe phréatique; de salinisation et d’acidification (Gaye & Niang, 2002 ; Seck, 2005 ; Ndiaye et al., 2006; Ndour et al., 2008 ).
La phase solide du sol
Plus important quantitativement (environ 83 % en poids et 52 % en volume dans un sol bien équilibré), elle conditionne le comportement des autres phases (Gaucher, 1968). Cette phase solide comprend une fraction minérale et une fraction organique.
La fraction minérale
Elle reflète la composition des matériaux de base dont est issu le sol (roche-mère; collision d’origine éolienne, hydrique ou gravitaire) et les aléas de sa genèse (Musy & Soutter, 1991). Elle représente, d’après Gaucher (1968), 81 % en poids et 48 % en volume du sol. Elle détermine la texture et entre dans la constitution de la structure, deux propriétés essentielles des sols.
La texture du sol
Les propriétés les plus importantes du sol dépendent des dimensions de ses constituants, c’est-à-dire de la granulométrie du sol (Gaucher, 1968). En outre les particules élémentaires entrants dans la constitution de la fraction minérale sont idéalement caractérisées par leurs volumes et leurs formes. La texture des sols, en tant que critère de différenciation, est alors définie par la répartition numérique des particules élémentaires en fonction de leur géométrie (Musy & Soutter, 1991).
Par l’analyse granulométrique, on parvient à différencier par la taille les éléments minéraux du sol et à quantifier leur répartition pondérale, par des classes de diamètres prédéfinies (Musy & Soutter,1991). Ses classes sont souvent réparties par ordre de diamètre croissant de la manière suivante : les argiles (0-2 µm), les limons (2-50 µm), les sables (50-2000 µm) et les graviers (>2mm). Les proportions relatives en sables, limons et argiles définissent ainsi la texture du sol.
La structure du sol
La structure est la manière dont les éléments constituants du sol s’assemblent entre eux (Gaucher, 1968). Elle permet d’expliquer certains comportements du sol dont la texture à elle seule ne peut pas rendre compte. En effet, c’est la structure qui détermine la répartition dans l’espace de la matière solide et des vides dont certains sont occupés par de l’eau ; d’autres, par de l’air. Cette répartition conditionne l’ensemble des propriétés physiques et biochimiques du sol : aération et possibilité de respiration des racines et de l’ensemble de la biomasse, rétention par les forces capillaires d’une réserve d’eau utilisable par les plantes en période sèche, etc. (Duchaufour, 1997). Il convient néanmoins de noter que la structure ne dépend pas seulement de la fraction minérale. Elle dépend aussi en grande partie de la fraction organique du sol, surtout dans son rôle de liant.
La fraction organique
Quantitativement faible par rapport à la fraction minérale aussi bien en termes de poids que de volume, à l’exception des sols tourbeaux, la phase organique du sol n’en demeure pas moins un élément clé de la qualité des sols. Cette fraction est constituée d’un ensemble de substances essentiellement caractérisées de manière qualitative par leur nature chimique (Musy & Soutter, 1991). Elle englobe toute substance organique, vivante ou morte, fraîche ou décomposée, simple ou complexe. Elle peut être classée en deux compartiments : un compartiment vivant qui fournit environ 4% du stock de carbone total du sol et un compartiment inerte qui fournit plus de 96% de celui-ci (Theng, 1987).
La phase organique inerte du sol
Elle est formée de résidus, sécrétions et excrétions de plantes et d’animaux (Musy & Soutter, 1991). L’essentiel de la matière organique parvenant au sol est cependant d’origine végétale (Davet, 1996). Dans le sol, la matière organique fraîche, fraction organique peu transformée, d’origine végétale ou animale, s’oppose à l’humus, fraction organique colloïdale plus ou moins foncée, qui contracte des liens étroits avec l’argile et les oxydes libres (Duchaufour, 2001). C’est la transformation de la première forme qui aboutit à la formation de la seconde. Cette transformation se fait sous l’action de divers facteurs, surtout des êtres vivants.
La Matière organique vivante du sol
Le sol est un milieu vivant et c’est là une caractéristique essentielle qui le différencie d’une roche, où les êtres vivants ne sont présents qu’en surface, dans la croûte d’altération (Robert, 1996). Les organismes du sol interviennent en effet dans de nombreux processus et fonctions essentielles des sols, notamment dans la décomposition des débris végétaux et animaux, la transformation et le stockage des éléments nutritifs, l’infiltration de l’eau et les échanges de gaz, la formation et la stabilisation de la structure des sols, mais aussi la synthèse des substances humiques (Dick, 1997). Le sol est ainsi traversé par des flux d’énergie et de matière dont la régulation est en grande partie assurée par les communautés vivantes qui le colonisent (Chotte et al., 2001). La classification des organismes du sol selon leur taille est souvent adoptée, bien que n’ayant aucune valeur systémique (Swift et al., 1979). Elle permet de différencier trois ensembles: les organismes dont la taille est supérieure au centimètre (macrofaune), les organismes dont la taille est comprise entre deux cents micromètres et un centimètre (microfaune) et enfin les organismes microscopiques (micro-organismes). On ajoute à ces organismes un quatrième ensemble particulier, celui des organes souterrains des végétaux.
La macrofaune
Les organismes de la macrofaune sont principalement représentés par des invertébrés. Certains de ces organismes construisent des structures organo minérales de grandes tailles qui perdurent de longues périodes (de quelques mois à quelques années); ils développent, à des degrés divers, des relations mutualistes avec les micro-organismes dans leur tube digestif (rumen interne) et (ou) dans les structures qu’ils créent que l’on peut comparer à des rumens externes. Ces organismes comprennent principalement les termites, les vers de terre et les fourmis. En raison de l’impact de leur activité sur les caractéristiques du milieu, ces organismes sont aussi appelés les ingénieurs de l’écosystème (Jones et al., 1994).
La microfaune
Ce groupe comprend une faune très diverse, essentiellement composée de micro et de macro-arthropodes (myriapodes, isopodes) et de nématodes. Contrairement à la macrofaune, les structures qu’ils produisent sont uniquement organiques. Elles ont une durée de vie plus courte que celles qui sont issues de l’activité des macro organismes (Giller et al., 1997).
Les micro-organismes
Ce sont des acteurs clés des cycles biogéochimiques. et jouent un rôle très important dans le fonctionnement et la dynamique des écosystèmes. Ils constituent la biomasse microbienne du sol dans lequel on distingue les trois groupes taxonomiques suivants :
✦ Les bactéries
Elles sont responsables de la plupart des transformations dans le cycle de l’azote (Paul & Clark, 1989) : ammonification (large éventail de bactéries), oxydation de l’ammonium en nitrite (Nitrosomonas), oxydation des nitrites en nitrates (Nitrobacter), réduction des nitrites en nitrates (Clostridium), dénitrification (Pseudomonas), fixation libre de l’azote moléculaire (N2) (Azotobacter) ou par symbiose (Rhizobium). Le rôle des bactéries dans les cycles du carbone, du phosphore et du soufre est moins spécialisé, mais reste important.
✦ Les champignons
Ils sont présents dans le sol à l’état de mycéliums et d’organes de propagation ou de conservation que l’on peut désigner sous le nom de « spores » (Dommergues & Mangenot, 1970). Leur rôle dans le cycle de l’azote est peu spectaculaire : certaines espèces sont douées d’une faible activité fixatrice, leur pouvoir ammonifiant paraît inférieur à celui des bactéries dans les conditions naturelles où les champignons semblent plutôt participer à l’organisation de l’azote qu’à sa minéralisation (Dommergues & Mangenot, 1970). Ceci correspond à leurs activités synthétiques plus élevées que celles des bactéries et à leur répartition particulière. En effet, leur rôle essentiel se trouve probablement dans la minéralisation du carbone organique, en particulier des sources les plus complexes. Ils possèdent parfois, à un degré extraordinaire, l’aptitude à dégrader de grandes quantités de matières organiques en se contentant de faibles quantités d’azote. Ceci explique leur prépondérance dans les sols pauvres, les débris végétaux frais, surtout les plantes âgées où le rapport C/N peut atteindre des valeurs considérables (Dommergues & Mangenot, 1970).
✦ Les actinomycètes
Ce sont des Eubactéries Gram positives à structure végétative de type mycélien (Dommergues & Mangenot, 1970). Ces micro-organismes présentent ainsi des similitudes à la fois avec les Eubactéries et avec les champignons. Représentées par les genres Nocordia et Streptreptomyces, leurs densités est en général 3 à 15 fois plus faibles que celle des autres bactéries. Ils se distinguent dans le sol par leur aptitude à dégrader les substances organiques peu biodégradables par les champignons et les autres bactéries ; mais aussi par leur aptitude à produire des substances probiotiques, antibiotiques ou toxiques (Dommergues & Mangenot, 1970).
|
Table des matières
INTRODUCTION
Ière PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
Chapitre I : LE SOL
I. La phase solide du sol
I.1. La fraction minérale
I.1.1. La texture du sol
I.1.2. La structure du sol
I.2. La fraction organique
I.2.1. La phase organique inerte du sol
I.2.2. La Matière organique vivante du sol
a) La macrofaune
b) La microfaune
c) Les micro-organismes
d) Les organes souterrains des végétaux
II. La phase liquide du sol
III. La phase gazeuse du sol
Chapitre II : LES RESIDUS VEGETAUX
I. Composition biochimique des résidus végétaux
I.1. La cellulose
I.2. L’hémicellulose
I.3. La lignine
I.4. Les composés phénoliques
II- Décomposition des résidus végétaux
II.1. La minéralisation
II.2. L’humification
II.3. Facteurs influençant la décomposition des résidus végétaux
II.3.1. Facteurs physiques
a) L’humidité du sol
b) La température et le pH
c) Propriétés physiques des sols : nature des argiles
d) Statut minéral du sol
II.3.2. La qualité des résidus végétaux
a) La nature des résidus végétaux
b) La composition biochimique des résidus végétaux
Chapitre III: Problématique de la fertilité des sols au Sénégal
I. Caractéristiques des sols du Sénégal
II. Impact des modes de gestion sur l’évolution des caractéristiques des sol
II.1. Les systèmes à faibles intrants
II.2. Les systèmes intensifs
III. Cas particulier des sols cultivés dans la zone périurbaine des Niayes
III.1. Les contraintes foncières
III.2. La dégradation des sols
III.2.1. La réduction du couvert végétal
III.2.2. L’érosion éolienne
III.2.3. La salinisation et l’acidification des terres cultivées
III.2.4. Les pratiques d’irrigation
a) Les eaux de surface
b) Les eaux souterraines
c) Les eaux usées
IIème PARTIE : METHODOLOGIE
Chapitre IV
I. Présentation du site d’étude : La Niaye de Pikine
I.1. Le cadre physique
I.1.1. Le climat
1.1.2. Les sols
1.1.3. La végétation
1.1.4. L’hydrologie
1.2. Cadre socio-économique
II. Matériels utilisés
II.1. Matériel biologique
II.1.1. Casuarina equisetifolia
II.1.2. Arachis hypogaea L
II.2. Les eaux d’irrigation
II.3. Les sols étudiés
III. Dispositif expérimental
IV. Méthode d’échantillonnage
V. Méthodes d’analyse
V.1. Analyse de la composition biochimique des résidus végétaux
V.1.1. Van Soest
V.1.2. Mesure du carbone et de l’azote
V.2. Analyses des sols
V.2.1. Analyses chimiques
a) Mesure de la salinité
b) Mesure de la capacité d’échange cationique
c) Mesure du pH
d) Dosage du carbone et l’azote organiques
e) Dosage de l’azote minéral du sol (NH4+ , NO3-)
V.2.2. Mesure de la biomasse microbienne du sol
V.2.3. Mesure du Potentiel de minéralisation du carbone
V.3. Mesure des paramètres agromorphologiques
V.3.1. Hauteur des plantes
V.3.2. Nombre de branches secondaires
V.3.3. Densité des plantes par parcelle
V.3.4. Rendement en fruits
V.4. Analyses statistiques
IIIème PARTIE : RESULTATS ET DISCUSSION
Chapitre V : RESULTATS
I. Caractéristiques biochimiques des résidus végétaux
I.1. Caractérisation des résidus végétaux
I.2. Evolution des composantes biochimiques des résidus végétaux étudiés au coursd du temps
I.2.1. Teneurs en fibres, en matières solubles et en matières minérales
I.2.2. Evolution des teneurs en carbone et azote
I.2.3. Evolution du rapport lignine/azote au cours du temps
II. Caractéristiques chimiques des sols avant et après culture
III. Evolution de la biomasse microbienne totale du sol au cours du temps
IV. Evolution de l’azote minéral du sol au cours du temps
V. Evolution du potentiel de minéralisation du carbone au cours du temps
VI. Corrélation entre la biomasse microbienne du sol et le potentiel de minéralisation du carbone
VII. Coefficients de régression entre les composants biochimiques des litières et les caractéristiques du sol
VIII. Paramètres agromorphologiques
VIII.1. Hauteur des plantes
VIII.2. Nombre de branches secondaires
VIII.3. Densité des plantes
VIII.4. Rendements en fruits
Chapitre VI : DISCUSSION
I. Effet de la qualité des résidus végétaux sur les processus de décomposition
II. Impact de la qualité des résidus végétaux sur les propriétés chimiques du sol
III. Effet de la qualité des résidus végétaux sur la disponibilité de l’azote minéral et les propriétés microbiologiques du sol
IV. Production végétale : effet de la qualité des litières
CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Références bibliographiques
ANNEXES