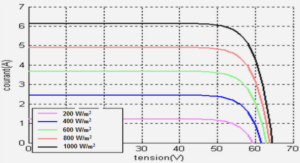Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Occupation actuelle des sols
Une analyse du recouvrement des sols et des cultures du bassin versant de la Pallu a été effectuée à partir des données des CLC de 1990, 2000 et 2012 et des RPG allant de 2010 à 2016 (Figure 10). pourcent du bassin versant est occupé par des zones à usages agricoles (terres arables, cultures, prairies, vignobles) dont 81 % comprend des surfaces ayant besoin d’être irriguées artificiellement. 20 % de cette surface est utilisée pour la culture céréalière, qui domine l’occupation des sols du bassin versant de la Pallu. Les proportions des autres cultures sont réparties équitablement, à raison de 10 % chacune. Il est toutefois important de remarquer que le maïs (grain et ensilage) constitue la moitié des céréales cultivées alors que la nature des sols n’y est pas favorable (voir I.4 Pédologie).
Les sols du bassin versant de la Pallu sont également utilisés pour la culture du melon, du tabac et de l’échalion (variété d’oignon). Le melon se sème entre mars et juin pour une récolte entre juillet et octobre. Son irrigation doit se faire en continu et au goutte à goutte pour éviter le développement de maladies sur ses feuilles comme l’oidium ou le mildiou9. Le tabac étant une plante tropicale, il nécessite une irrigation régulière durant sa croissance qui peut durer de fin mars à steptembre (Marcel 1961), c’est le même cas pour le maïs qui lui se plante en avril pour être récolté entre août et septembre10.I.5.1.Occupation actuelle des sols.
Enfin, l’échalion se plante entre février et avril pour être récolté entre août et octobre11. Les périodes de croissance de ces plantes sur le bassin versant de la Pallu se déroulent toutes pendant la saison estivale. De plus, ces quatre types de cultures nécessitent une irrigation constante durant leur croissance (Figure 11). Cela impacte la ressource en eau disponible du bassin versant pour soutenir la Pallu en période d’étiage.
En revanche, la valeur ajoutée représenté par ces cultures est très importante. En effet, l’échalion est vendu au prix de 10 000 euros par hectares. Une fois les frais de production déduits, cela représente un bénéfice brut de 6 980€/ha. Le gain économique du melon est de 15 000€/ha et de 2 500€/ha pour le tabac. Enfin, le maïs d’ensilage (ou de fourrage) permet de gagner entre 292 et 4 318€/ha en fonction de son futur usage (Annexe 1 et 2).
Le bassin versant de la Pallu est majoritairement agricole (92%), les plantations céréalières sont majoritaires et le maïs en constitue plus de la moitié alors que sa culture est jugée comme incompatible avec les sols de la Pallu.
Les cultures d’échalion, melon et tabac sont également présentes sur son bassin versant et consomment beaucoup d’eau durant toute la période estivale affaiblissant encore une fois son équilibre naturel déjà fragile.
Les valeurs ajoutées de ces quatre grand types de culture gourmandes en eau sont très importants ce qui peut expliquer le choix de leur développement sur le bassin versant de la Pallu malgré son contexte hydrogéologique fragile.
Le développement de ces cultures est récent. En effet, elles nécessitent des apports en eau réguliers et importants pendant la période estivale impliquant des systèmes de pompages et de drainage efficaces. Il serait donc intéressant d’observer l’état du bassin versant de la Pallu avant l’arrivée de ces nouvelles méthodes de culture.
La Pallu il y a 200 ans
Le cours d’eau de la Pallu possède un tracé général qui n’a pas beaucoup changé en 200 ans comme le montrent les cartes de Cassini et de l’Etat-major réalisées entre 1800 et 1866 (Figure 12). En revanche, ces deux cartes donnent des informations complémentaires.
La carte de Cassini (en bas à droite sur la figure 12) montre que la rivière possédait 14 moulins sur tout son linéaire avec une présence plus forte en aval qu’en amont. Les moulins ayant besoin d’une quantité importante d’eau pour fonctionner, cela indique que la Pallu possédait certainement un débit important une bonne partie de l’année. La Liaigue (affluent de la Pallu situé au Sud-Ouest du bassin versant) est représentée en trait discontinu laissant supposer que l’eau de cet affluent s’infiltre dans le sol sur sa partie aval et n’alimente pas la Pallu en surface. Cette eau souterraine peut donc servir à alimenter des nappes ou la rivière en aval par résurgence artésienne.
La carte de l’Etat-major (en haut à gauche sur la figure 12) indique que la majorité des zones voisines au cours d’eau étaient des marais souvent en eau (Légende de la Carte de l’Etat-major de France 1820). Elles étaient donc humides une grande partie de l’année conduisant les habitants à créer de nombreux fossés pour évacuer plus facilement l’eau et établir des cultures dans ces zones rendues fertiles par les alluvions. Ceux-ci sont représentés par des traits bleus foncés sur la figure 12 en haut à droite.
Usages sur le bassin versant de la Pallu
Le bassin versant de la Pallu étant majoritairement agricole, chaque agriculteur possède des systèmes de pompage pour irriguer quotidiennement ses cultures. Les données de prélèvements transmises par l’agence de l’eau Loire Bretagne ont permis de quantifier les volumes d’eau utilisés chaque années sur les 29 communes du bassin versant.
D’après les données de 2016 qui sont les plus récentes, il existe 128 points de prélèvements. La grande majorité d’entre eux pompent l’eau des aquifères du bassin versant, principalement celui du Dogger. Des points de prélèvement à même le cours d’eau, en sources et dans sa nappe alluviale sont localisés au Sud de Vendeuvre-du-Poitou même s’ils sont moins nombreux que les pompages en nappe profonde (Figure 13). Les piezomètres installés sur le bassin versant sont tous localisés sur la partie Sud de la Pallu au niveau de la nappe du Dogger. Ils ne doivent donc pas permettre de décrire avec précision l’état des nappes du Crétacé et du Jurassique supérieur au Nord.
Sur le volet quantitatif ce sont bien les prélèvements en nappes souterraines qui représentent les plus grand volumes d’eau prélevés chaque année (97 % en moyenne). Ceux-ci ont eu tendance à augmenter entre 1999 et 2016, remplaçant petit à petit tous les autres types de prélèvements (Figure 14).
Une forte variation des quantités d’eau prélevées est observable pour les années 2003, 2004 et 2005. En effet celles-ci ont été décrites comme un enchainement d’années de plus en plus sèches dans la région Poitou-Charentes12. Deux hypothèses peuvent alors être formulées pour expliquer ces grandes variations.
En 2003, la sècheresse s’est étendue de mars à août. Ces mois étant les périodes de semis et de croissance de la plupart des cultures, l’eau souterraine du bassin versant a été majoritairement prélevée atteignant sa valeur maximale. En 2004, c’est le mois de juin qui fut très sec et là encore l’eau des nappes a été prélevée abondamment sauf que l’impact de la sècheresse de 2003 était présent même s’il n’a pas encore impacté le volume d’eau disponible. 2005 a été la pire année de sècheresse de la région avec 500mm de précipitations en seulement une année. La nappe du Dogger devait être épuisée par les années 2003 et 2004 et comme son rechargement est très lent sur le bassin versant de la Pallu (voir I.3.Hydrogéologie), sa ressource en eau ne s’était pas reconstituée. Les nappes du Nord la Pallu ne stockant pas beaucoup l’eau également, les prélèvements ont du être réduits au strict minimum pour leur laisser le temps de se recharger. La seconde hypothèse est que la sècheresse de 2005 était tellement importante que la majorité des cultures du bassin versant ont été détruites dès le début des semis. Leur irrigation n’étant plus nécessaire, les prélèvements en eau sont restés très faibles.
Pour savoir quelle hypothèse est la plus probable une étude des rendements agricoles de la Vienne a été effectuée entre 2002 et 2006 pour le maïs qui est une culture estivale nécessitant une irrigation régulière. Les rendements moyens durant ces trois années ne varient pas fortement malgré les sècheresses (Annexe 3).
Une réduction des prélèvements suite à un appauvrissement trop important de l’eau des nappes de la Pallu est donc plus probable.
La rivière de la Pallu
Il a été observé dans la partie I.5.2 la Pallu il y a 200 ans, que cette rivière était une ancienne zone de marais composée de nombreux fossés. Son lit devait être peu profond avec une faible pente et l’eau devait donc se répandre facilement sur ses zones d’expansion latérale. Une carte des cours d’eau de la région de la Vienne datant de 1950 indique que sa profondeur était de 1 mètre pour 4 mètres de large en moyenne ce qui confirme l’hypothèse de son caractère marécageux (FDAAPPMA 86). La végétation aquatique devait pouvoir se développer abondamment sur sa section grâce à cette faible profondeur d’eau.
La Pallu actuelle est un cours d’eau très rectiligne avec des berges abruptes et une profondeur pouvant aller jusqu’à 4 mètres. Elle alterne entre des zones de radiers possédant une pente forte et des vitesses d’écoulements élevées sur quelques mètres (Figure 17 A) et des zones plates ou l’eau est très opaque et s’écoule lentement sur plusieurs centaines de mètres entrainant un dépôt progressif des matières fines (Figure 17 B).
Figure 17: Photographies de la Pallu à Blaslay (A) et à Vendeuvre-du-Poitou (B) (Charles CALVET)
Les radiers possèdent un substrat graveleux et sont des lieux de frais utilisables par les truites fario et ses espèces accompagnatrices (Annexe 6). Les zones de dépôt sont des lieux de décantation de la matière organique où le colmatage peut s’étendre sur plusieurs mètres au-dessus des sédiments graveleux de la rivière. Ces zones sont hostiles au développement de la vie aquatique de la Pallu.
Des observations sur le terrain ont montrées que ces zones de radiers sont situées majoritairement derrière des ouvrages hydrauliques comme des ponts. En effet, ceux-ci créent un seuil qui augmente artificiellement la pente et donc la vitesse des écoulements ce qui a pour effet de nettoyer le fond de la rivière de ses matières fines. C’est plusieurs mètres après ces seuils que les zones de dépôt ont été observées.
Relation entre la nappe alluviale et la rivière
Avant ce changement de morphologie, les eaux excédentaires hivernales de surface (pluies, crues) et souterraines devaient remplir la nappe alluviale entourant la Pallu. L’eau était ensuite restituée en été quand la rivière souffrait du manque d’eau et permettait ainsi d’avoir un débit acceptable pour la survie des espèces aquatique (Figure 18).
Travaux à réaliser
La première chose à faire serait une prospection sur le terrain pour observer la topographie de la zone. En effet, si le canal de la Pallu est trop encaissé dans le sol ou au même niveau que le lit de la Pallu le projet de restauration sera inefficace. L’eau excédentaire du canal ne pourra pas se répandre sur la zone centrale et s’infiltrer. Il est donc nécessaire d’avoir la hauteur du canal supérieure à celle du lit de la Pallu. Un rehaussement artificiel de la ligne d’eau peut être envisageable par une recharge granulométrique et la mise en place de banquettes. La mise en charge du canal pourrait également être améliorée par un abaissement de son fond.
Une observation de la zone d’infiltration sera aussi à faire pour évaluer sa forme. Si celle-ci est en forme de cuvette comprise entre deux bourrelets de curage peu de travaux seront nécessaires. En revanche, si sa forme est bombée, une extraction de sédiments sera nécessaire.
Dans tous les cas il faudra donner à cette zone une pente progressive orientée vers le lit de la Pallu afin que les eaux de crues hivernales pénètrent dans le canal puis débordent sur la prairie centrale. La pente devra être stoppée par le bord de berge de la Pallu permettant à l’eau de s’infiltrer dans le sol et d’alimenter la rivière par écoulement gravitaire. Pour favoriser l’écoulement du canal de la Pallu vers la rivière en passant par la prairie centrale, les bourrelets de curages pourraient être réduits. (Figure 23).
Bilan des compétences acquises durant ce stage
La réalisation d’un diagnostic complet de bassin versant a renforcé plusieurs compétences qui ont déjà eu l’occasion d’être mobilisées dans le cadre du projet de chantier école réalisé en quatrième année d’Ingénierie des Milieux Aquatiques.
En revanche, le contexte professionnel que j’expérimente grâce à ce stage est différent de celui exercé durant l’élaboration des projets de chantier école. La mission dont je suis chargé me demande de rédiger un dossier d’argumentation à partir des données du diagnostic.
Cela m’a permis d’apprendre à extraire et synthétiser l’essentiel des informations d’une quantité importante de documents et de les rendre compréhensibles pour tous sans atténuer leur valeur scientifique.
Pour mettre ces informations en valeur, j’utilise des logiciels de tableur et de cartographie. Ma volonté a été de maitriser le logiciel QGis dès le début de mon stage afin d’être polyvalent dans mon futur travail. Je serais également amené à utiliser le logiciel de HEC-RAS permettant de modéliser différents scénarios d’écoulement sur une rivière. Ce qui est à mes yeux indispensable pour ma carrière professionnelle.
En parallèle de ma mission principale, j’ai également eu la chance de diversifier mes compétences techniques et naturalistes en participant aux différentes missions de la fédération de pêche (Pêches électrique, IBGN, sauvetages piscicoles,…) et en réalisant une formation complète sur l’identification des reptiles de la région Ile de France organisée par l’Agence Régionale de Biodiversité.
Je suis donc pleinement satisfait de ce stage au sein de la FDAAPPMA 86 car il m’apporte les compétences professionnelles dont j’ai besoin pour mon futur métier tout en me permettant de diversifier mes compétences personnelles. J’ai ainsi pu être sélectionné pour effectuer un contrat de professionnalisation lors de ma cinquième année d’ingénierie sur un sujet de restauration hydromorphologique. Cela me prépare donc à exercer le métier d’ingénieur écologue spécialisé dans la restauration écologique.
|
Table des matières
Contexte du stage
I. Evolution de la Pallu et de son bassin versant
I.1. Hydrographie et localisation
I.2. Géologie
I.3. Hydrogéologie
I.4. Pédologie
I.5. Evolution de l’occupation du sol
I.5.1. Occupation actuelle des sols
I.5.2. La Pallu il y a 200 ans
I.6. Usages sur le bassin versant de la Pallu
I.6.1. Irrigation
I.6.2. Eau potable
I.6.3. La politique actuelle
I.6.4. Rejets
I.7. Morphologie
I.7.1. La rivière de la Pallu
I.7.2. Relation entre la nappe alluviale et la rivière
I.8. Biologie
I.9. Conclusion du diagnostic
II. Exemple du projet de restauration de la zone humide en aval de Blaslay
II.1. Choix de la zone
II.2. Travaux à réaliser
II.3. Autres projets possibles
III. Conclusion : scénarios et futures hypothèses possibles
III.1. Scénario 1 : La Pallu est une rivière possédant un fort potentiel écologique et des actions peuvent être réalisées pour préserver son milieu aquatique
III.2. Scénario 2 : La Pallu est trop dégradée pour permettre des travaux de sauvegarde de sa biodiversité aquatique et de son eau
III.3. Bilan des compétences acquises durant ce stage
Bibliographie
Télécharger le rapport complet