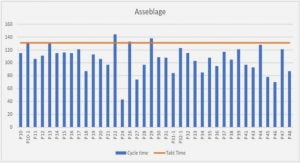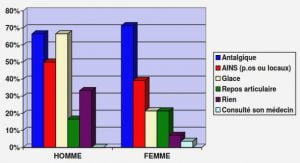Historique de la formation des Sages-Femmes en France
Le métier de sage-femme a été confronté à de nombreuses mutations. Leurs compétences sont en constante évolution, à l’image de la formation qui a également énormément évolué depuis des centaines d’années. Pour mieux comprendre où nous en sommes aujourd’hui, nous allons faire un tour d’horizon de la formation des sages-femmes en France au travers des siècles.
Avant le 17ème siècle, une transmission du savoir à l’oral Au début du 17ème siècle, les écrits sont très rares sur le sujet et le savoir est empirique, directement tiré de l’expérience des accoucheuses, qui n’ont pour la plupart que peu de connaissances scientifiques. Elles tirent leur savoir en général de leurs propres accouchements et peuvent être désignées matrones si elles ont déjà assisté plusieurs femmes en couches. C’est ainsi qu’elles se forment et ainsi qu’elles le transmettent à leurs filles. (2)
Madame Louise Bourgeois « Mon art gisait plus en expérience qu’en science ». Louise Bourgeois(1563-1636)(3), notamment célèbre pour avoir été la sage-femme personnelle de la reine Catherine de Médicis, est la première sage-femme à avoir écrit au sujet de l’obstétrique. En 1609, elle publiera Observations, stérilités, pertes de fruits et en 1626 Instructions à ma fille qui serviront de base à l’apprentissage des futures sages-femmes, avec pour objectif de préserver la vie des femmes et des nouveaux nés . Les divers ouvrages qu’elle fera paraître seront rédigés grâce à sa pratique personnelle. Elle formera sur le terrain sa fille, qui aspirait à devenir sage-femme, en la faisant pratiquer. Louise Bourgeois prône la collaboration entre médecins et sages-femmes. Dans ses ouvrages elle aborde des sujets obstétricaux et pédiatriques et évoque aussi la relation avec la parturiente qui « doit être douce ». (2,4)
L’Hôtel Dieu et l’office des accouchées A l’office des accouchées de l’Hôtel Dieu, la maitresse sage-femme s’occupait seule des « femmes grosses ». Elle se chargeait de les examiner, de faire les accouchements, de baptiser les nouveau-nés et cætera. A partir de 1630, devant la charge de travail croissante, il est décidé d’accueillir une apprentisse pour une formation de trois mois. Les apprentisses étaient sélectionnées par la maitresse sage-femme et devaient répondre à certains critères : être mariées, posséder un certificat de bonnes vies et mœurs, être de religion catholique faisait également partie des exigences et enfin elle ne devaient pas être étrangères. Le nombre d’accouchements augmentant, le nombre d’apprentisses admises ira jusqu’à quatre mais pas au-delà pour que la formation reste de grande qualité et qu’elles puissent pratiquer suffisamment. A la fin des trois mois, elles étaient reçues devant un jury de chirurgiens pour passer un examen et valider ou non leur statut de sage-femme. La pratique régulière des élèves, faisait de l’Hôtel Dieu, un lieu de formation d’exception.(5,6)
La formation des sages-femmes par Angélique le Boursier du Coudray(1712-1789) Fatiguée des matrones qui exerçaient dans les campagnes sans les compétences requises pour faire accoucher les femmes en toute sécurité, Angélique-Marguerite du Coudray s’est lancée en 1759, avec l’autorisation de Louis XV qui la désigna professeur d’obstétrique, dans un tour de France. Son but était d’apporter son savoir aux femmes, à l’aide d’un mannequin tout à fait novateur sur lequel les élèves pouvaient s’entrainer aux accouchement (pendant deux mois de formation) et de son « Abrégé de l’art des accouchements ». On dit qu’elle forma environ 5000 sages-femmes ainsi que des médecins demandeurs en 25ans. Grâce à son initiative, elle fit considérablement reculer la mortalité maternelle et infantile. (2,4,7)
L’instruction des sages-femmes du 19ème siècle à nos jours.
L’école de l’hospice de la maternité. L’ébranlement de la société française, provoqué par la Révolution, amena la Loi du 19 ventôse an XI (10 mars 1803), régissant l’organisation de la profession médicale, pour contrôler la formation des médecins, chirurgiens et officiers de santé. Elle fait suite et concorde avec la création de l’école de l’Hospice de la Maternité de Paris le II messidor an X (21 juin 1802).(8) Le fonctionnement de cette école modifia l’atmosphère familiale de l’office des accouchées de l’Hôtel Dieu où les apprentisses étaient peu nombreuses. L’effectif passa de quatre élèves à une centaine. De plus, l’enseignement n’est plus donné exclusivement par la Sage-femme en chef (MarieLouise La Chapelle), mais aussi par le chirurgien-accoucheur en chef (Jean-Louis Baudelocque), toujours avec la clinique comme pilier de l’instruction. La durée de la formation initialement prévue de six mois, se trouvait le plus souvent doublée par les élèves qui volontairement voulaient allonger leur temps de formation. En effet, c’est à l’école que leur pratique clinique est la plus importante. Les élèves les plus expérimentées avaient aussi pour mission de former les plus novices au lit du patient, élément, que nous retrouvons encore actuellement notamment dans les maternités écoles. (7) A l’issue de la formation, les sages-femmes formées à l’école de la maternité étaient qualifiées de sages-femmes de première classe, tandis que les autres, formées dans les écoles départementales avaient un grade de seconde classe. Cette distinction entre les deux niveaux pris fin en 1916 et le diplôme devint unique, avec un passage en 1917 à deux années de formation et l’élaboration d’un programme officiel.
Un allongement progressif de la durée des études La loi du 24 avril 1944 marqua le passage à une formation en trois ans, avec une année commune avec les étudiants infirmiers, et posa le principe d’alternance des études entre théorie, pratique et stage. Près de 30 ans plus tard, l’arrêté du 23 mai 1973 sépara ces deux corps de métier. Par un décret de 1985, la formation s’allongea à quatre années d’études et un arrêté de septembre 2001 restructura le programme des études de sages-femmes, en gardant toujours un enseignement clinique supérieur à l’enseignement théorique. La sage-femme clinicienne aurait donc tout autant d’importance, que les sages-femmes enseignantes dans l’apprentissage des étudiants sages-femmes. C’est en 2003 que la formation passa à sa durée actuelle de cinq ans, avec un nouveau mode de recrutement des étudiants. En effet si jusqu’à cet instant l’obtention seule du baccalauréat suffisait à entrer à l’école de sage-femme, il faut à partir de 2003 se présenter à la première année du Premier cycle des études médicales (PCEM1) et être classé en rang utile pour pouvoir y accéder. (2,9)
Etat des lieux de la formation en 2018 L’organisation actuelle de la formation des sages-femmes, est régie par un arrêté d’octobre 2009, qui la construit de la façon suivante :
– La PCEM1 est remplacée par la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES). Celle-ci permet aux étudiants inscrits, de choisir vers quelle filière ils désirent s’orienter (médecine, pharmacie, odontologie ou maïeutique) à l’issue du concours, à condition qu’ils soient classés en rang utile dans le numerus clausus de la filière correspondante. (10)
– Les études de sages-femmes comprennent deux cycles. A l’issue du premier, les étudiants reçoivent le diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, correspondant à un grade Licence. Le second cycle des études est reformé en 2013 et confère au Diplôme d’état de sage-femme un grade master.
– Le diplôme d’état de sage-femme est attribué, d’après l’article 21 de l’arrêté du 11 mars 2013, aux étudiants ayant validé l’ensemble des enseignements et des stages correspondants aux deux cycles de formation, validé le certificat de synthèse clinique et thérapeutique et soutenu leur mémoire avec succès. (11) Cet historique du métier de sage-femme, nous fait prendre conscience que jusqu’à la mise en place des premières écoles, transmettre le savoir était un acte qui tenait une place très importante dans l’activité des sages-femmes du 18ème -19ème. Elles désiraient en formant de vrais professionnels, palier à la mortalité maternelle et infantile mais aussi se protéger elles-mêmes des attaques dont elles pouvaient être la cible par les corps de médecins-chirurgiens. Aujourd’hui encore ces deux objectifs sont toujours d’actualité avec le poids du médico-légal qui pèsent sur les professionnels de santé. D’après Charles Boelen (12), l’éducation médicale représente une stratégie de santé publique, qui aurait un impact sur la santé de la population. Il serait donc impératif de former les futurs professionnels en prenant en compte les besoins de santé de la société.
L’ange gardien du couple, des femmes et des nouveau-nés
L’Organisation mondiale de la santé définit une sage-femme comme suit : « Une personne qui a suivi un programme de formation reconnu dans son pays, a réussi avec succès les études afférentes et a acquis les qualifications nécessaires pour être reconnue ou licenciée en tant que sage-femme. Elle doit être en mesure de donner la supervision, les soins et les conseils à la femme enceinte, en travail et en période post-partum, d’aider lors d’accouchement sous sa responsabilité et prodiguer des soins aux nouveau-nés et aux nourrissons[…]Elle joue un rôle important en éducation sanitaire, non seulement pour les patientes, mais pour la famille et la préparation au rôle de parents. ». Cette définition détaille les missions médicales de notre profession, envers la femme enceinte, son suivi en pré-per et post-natal et la prise en charge du nouveau-né. Elle doit avoir la capacité de gérer une situation pathologique dans l’urgence, jusqu’à l’arrivée du médecin. Le Conseil National de l’ordre des sages-femmes prône la place de la sage-femme comme premier recours auprès des femmes en bonne santé. Afin de mener à bien ces nombreuses missions, les maïeuticiens doivent bénéficier d’une solide formation théorique et pratique. Or nous avons vu au début de ce travail que le savoir des sages-femmes, depuis des siècles, se transmet par les pairs et bien que la formation ait énormément évolué, pour s’introduire de plus en plus vers l’universitarisation, ce rôle de transmission est encore présent de nos jours.
Les diverses théories de la motivation
A l’heure actuelle, il n’y a pas d’accord pour une définition unique de la motivation, la question se pose du « pourquoi » et du « comment » d’un comportement. Vallerand et Thill la définissent comme « le construit hypothétique utilisé afin de décrire les forces internes ou externes produisant le déclenchement, la direction et la persistance du comportement ». La motivation est souvent assimilée à « l’envie de ». A travers cette définition nous réalisons que l’envie ne constitue qu’une des nombreuses forces pouvant déclencher le comportement. (22) Au fil de l’histoire, de nombreuses théories motivationnelles se sont succédées (22,23) :
– L’hédonisme (XVIIIème siècle) postule que le comportement des individus vise à privilégier les actions source de plaisir et à éviter celles qui génèrent de la frustration ou de l’insatisfaction.
– Les approches biologiques de McDougall au XXème siècle ont associé la motivation aux instincts. Autrement dit, aux comportements innés, biologiquement préétablis et essentiels à la survie.
– Les approches béhavioristes s’opposent aux approches biologiques. On parle de conditionnement qui dit que nos conduites sont dictées par l’expérience des conséquences qu’elles ont provoquées et qui rendent plus ou moins probable que le comportement se produise à nouveau. Ici la recherche de la satisfaction est la conséquence a posteriori de stimuli externes produisant un renforcement négatif ou positif sur les comportements.
Un vécu conditionné par le lieu de stage
La moitié des interrogées déclarent que le lieu de stage a eu un impact sur leur vécu. Pour les sept sages-femmes suivantes : SF.F -G -I-J-K-O-P-C, il y a un réel contraste entre les maternités périphériques et la maternité école. Toutes sont d’accord pour dire que le souvenir est beaucoup moins bon en Centre Hospitalier Universitaire (CHU) : « Je n’ai que les souvenirs de la mater où j’ai été le plus formée : la mater école, où c’était de l’exigence, parfois un peu de la peur aussi. Des souvenirs où tu ne te sens pas considérée[…] tu es l’étudiante et tu te tais! » (SF.G) « J’ai adoré en périphérie mais au CHU, je trouve qu’on ne te laissait pas faire énormément de choses, tu faisais le larbin, tu n’es pas du tout valorisée en tant que future collègue »(SF.P)
La Motivation
Dans la première partie, nous avons présenté deux types de motivation, la motivation extrinsèque et la motivation intrinsèque. Entre ces deux extrêmes, il existe différentes régulations qui sont en fonction de leur degré d’autodétermination proches ou éloignées de la motivation intrinsèque. Nous préciserons que selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales, l’autodétermination correspond au fait de fixer par soi-même ses choix et ses actes. D’après l’approche de Deci et Ryan (22), nous distinguerons pour la motivation extrinsèque, dans un ordre croissant d’autodétermination :
La régulation externe : La motivation est sous la dépendance totale de récompenses et de sanctions, le sujet répond à une demande qui lui est extérieure.
La régulation introjectée : L’individu va agir en fonction des représentations qu’il se fait de l’action à effectuer. Il s’agit dans ce cas de répondre à des pressions internes qui réguleront l’image que l’individu se fait de lui-même.
La régulation identifiée : Il va agir parce qu’il pense que son action est importante pour lui, l’action sera perçue comme émanant directement de lui.
La régulation intégrée : L’individu va effectuer des actions pour s’accomplir, pour devenir ce qu’il souhaite être.
|
Table des matières
Introduction
1. Historique de la formation des Sages-Femmes en France
1.1. Avant le 17ème siècle, une transmission du savoir à l’oral
1.2. Madame Louise Bourgeois « Mon art gisait plus en expérience qu’en science »
1.3. L’Hôtel Dieu et l’office des accouchées
1.4. La formation des sages-femmes par Angélique le Boursier du Coudray(1712- 1789)
1.5. L’instruction des sages-femmes du 19ème siècle à nos jours
1.5.1. L’école de l’hospice de la maternité
1.5.2. Un allongement progressif de la durée des études
1.5.3. Etat des lieux de la formation en 2018
2. Accompagnement et transmission de l’art d’accoucher
2.1. Sage-femme : une profession à deux versants
2.1.1. L’ange gardien du couple, des femmes et des nouveau-nés
2.1.2. Garante des futures générations de sages-femmes
2.2. L’instruction des étudiants
2.2.1. La performance de l’élève
2.2.2. L’accompagnement
2.2.2.1. Le compagnonnage
3. La motivation et ses concepts
3.1. Les diverses théories de la motivation
3.2. La motivation sous toutes ses formes
4. Méthodologie
4.1. Objectifs, problématique et axes de recherche
4.2. Type et outil de la recherche
4.3. Population étudiée, recrutement et entretiens
4.3.1. Critères d’inclusion
4.3.2. Critères d’exclusion
4.3.3. Modalités d’entretiens
5. Présentation des résultats
5.1. Informations générales relatives aux sages-femmes interrogées
5.2. Le binôme sage-femme/ étudiant sage-femme
5.2.2.1. Un lien particulier
5.2.2.2. Futurs collègues ou étudiants ?
5.2.2.3. Le niveau de l’étudiant
5.2.2.4. Conserver une certaine distance avec l’étudiant
5.3. La transmission sur le terrain
5.3.1. Un rôle important à jouer pour les sages-femmes
5.3.2. Une mission qui reste agréable
5.3.3. Mais qui peut être vécue comme un travail supplémentaire
5.3.4. Une technique d’encadrement propre à chacune
5.3.5. Un versant connu du métier ?
5.3.6. Une difficulté différente selon le niveau de l’étudiant
5.4. La motivation des sages-femmes à encadrer les étudiants
5.4.1. Un devoir de la sage-femme
5.4.2. Une tâche imposée
5.4.3. Former la relève
5.4.4. Une forme de bienveillance
5.4.5. Transmettre son art, sa passion
5.4.6. Une rôle valorisant
5.4.7. Leur apprendre simplement
5.4.8. L’étudiant : une valeur ajoutée
5.5. Souvenir de la formation
5.5.1. Un vécu compliqué
5.5.2. Un souvenir agréable
5.5.3. Un vécu conditionné par le lieu de stage
5.5.4. Mais aussi par le personnel encadrant
5.6. Amélioration avec l’expérience
5.6.1. Une distance qui s’installe avec les étudiants
5.6.2. Une prise d’assurance dans la pratique
5.6.3. Une première expérience lors du stage préprofessionnel
5.7. Influence du niveau de la maternité
5.7.1. L’impact du nombre d’étudiants
5.7.2. Un manque de temps dû à l’activité
5.7.3. L’environnement
5.8. La gestion de l’étudiant dans une situation d’urgence
6. Les points forts et limites de l’étude
6.1. Limites et biais
6.2. Points forts
7. Analyse des résultats et discussion
7.1. La Motivation
7.3. L’expérience comme outil d’amélioration
7.4. Influence du niveau de la maternité
7.5. Les difficultés de la transmission dans l’urgence
8. Ouverture et propositions
8.1. Développer les maîtres de stage dans notre profession
8.2. Création de fiche mission/ d’un guide pratique de la sage-femme accompagnatrice
8.3. Retarder l’encadrement des étudiants par les sages-femmes jeunes diplômées
8.4. Auto-évaluation et formation
Conclusion
Bibliographie
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet