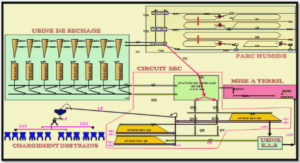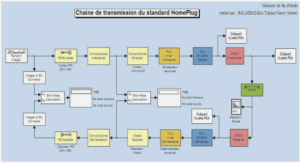Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le structuralisme linguistique :
Il est notoire qu’une définition exacte du structuralisme se verrait fragmentée par la multiplicité des significations de plus en plus divergentes que revêtirent les « structures » en question. Prenons le parti d’une simplification qui leurs reconnait un idéal d’intelligibilité commun dont le prix à payer représente une violence d’explicitation propre à chacune des hypothèses structuralistes. Cette violence associe le choix nécessaire d’une perspective explicative ou descriptive du système (la surestimation des éléments particuliers élus dans le giron de cette perspective aux détriments d’autres éléments efficients), et la rigidité qu’implique l’instauration explicite d’une mécanique intérieure aux modèles.
Déjà au XVIIIe siècle, les grammairiens de Port-Royal enseignent que la construction de la phrase imite l’ordre nécessaire de la pensée. La pensée s’extériorise par le langage, il faut donc que le langage reproduise à l’identique l’organisation de la pensée. Le langage fournit alors une image fidèle de la structure de la pensée, et met en rapport une pensée implicite et son double explicite dans le langage. On voit qu’avant même la percée théorique du célèbre Ferdinand de Saussure, à la fin du XIXe siècle, les « grammaires générales » de Port-Royal semblent avoir été à l’origine du structuralisme linguistique. Ainsi, comme l’écrit l’historien du langage Oswald Ducrot(3) : « La linguistique du début du XIXe siècle possédait donc un concept de structure, ou encore de « système » (les deux mots reviennent sans cesse dans les textes de cette époque) assez proche de la notion utilisée aujourd’hui ».
Le mérite du pionnier unanimement attribué à Saussure dans la première moitié du XXe siècle est alors à pondérer en rapport avec la frénésie qui s’empara des penseurs continentaux autour des études structuralistes.
Toutefois, de par un prestige promptement acquis, le structuralisme de la linguistique saussurienne, qui se concentre dans la notion de rapport signifié/signifiant, a profondément infiltré les modèles psychiatriques de l’époque.
Le concept saussurien de « signe »(4) implique qu’il existe un lien conventionnel entre le signifiant d’un mot (le vocable qui le constitue) et le signifié qu’il désigne (alternativement la chose réelle ou l’idée de cette chose, ambiguïté problématique que l’on retrouve dans l’oeuvre de Saussure lui-même(5)). Il est important de bien noter que ce sont les mots qui représentent les unités élémentaires de ce système sémiotique. Ferdinand de Saussure est considéré comme le père du structuralisme car son modèle sémiotique décrit la structure synchronique du langage comme un système dans lequel les signifiants, les éléments du code linguistique, renvoient à des signifiés, les choses ou plutôt leurs concepts, selon un schéma d’ensemble concernant la langue toute entière. A savoir que le sens d’un mot recouvre toutes les nuances que ne signifient pas d’autres mots sémantiquement proches. C’est-à-dire que la signification exacte d’un signifiant est circonscrite et bornée par l’ensemble des autres signifiants qui constituent ce que Saussure appelle sa « série associative », « expression que l’on transforme souvent en « paradigme », c’est l’ensemble des mots qui, du fait de leur ressemblance, limitent un signe, et sont par suite indispensables pour sa détermination ». De cette façon, l’addition d’un nouveau mot à la langue déplace les frontières sémantiques qui caractérisent et distinguent les mots déjà existants. « Dans l’élément présupposer le système, cela constitue, selon Oswald Ducrot, l’apport propre de Saussure au structuralisme linguistique ». Ducrot poursuit, « si chaque signe ne peut être défini, fond et forme, que par opposition à ceux qui constituent son paradigme, il est indissociable d’eux, et cela dès le début de la recherche linguistique. Les liens qui les unissent ne leur sont pas surajoutés. Si l’on trouve par exemple apprentissage et éducation dans le paradigme d’enseignement, ce n’est pas parce qu’on a jugé commode ou satisfaisant de les mettre dans la même catégorie, c’est qu’on ne peut pas établir le sens du dernier sans se référer aux premiers… La saisie de l’élément présuppose déjà son intégration dans le système »(3). Nous tâcherons de nous souvenir de cette remarque quand viendra l’heure de décrire les modèles herméneutiques du langage et leurs rapports aux champs sémantiques.
Mais il faut pour l’instant préciser qu’un tel système se définit par rapport à une entité abstraire qui est la langue, et donc indépendamment de l’usage pragmatique du langage. Car c’est sur cet aspect que le saussurianisme s’avèrera limité. Et c’est pourtant ce point même que développe la glossématique de Hjelmslev qui tentera une description systématique de la combinatoire du langage en affirmant son indépendance totale par rapport à l’ordre des choses. Dans la doctrine de Hjelmslev, qui offre par ailleurs un surplus salvateur de dynamisme aux modèles de la linguistique, la structure du langage est proche d’une structure mathématique, en ce sens qu’une structure mathématique est valable indépendamment des objets auxquels elle s’applique. « La structure – c’est là la caractéristique nouvelle apportée par la glossématique dans l’histoire du structuralisme – est désormais séparable de ce qu’elle structure ».
Une alternative à la systématisation autarcique hjemslevienne est proposée en France par la linguistique d’Émile Benveniste qui tendra à mettre en avant l’aspect sémantique du langage (le sens qui émerge d’une phrase pour convenir à un certain contexte de parole et combler une certaine intention de signification), mais également par la philosophie du langage anglo-saxonne qui n’a pas réellement fait le détour par Saussure, mais s’inspire plutôt de la linguistique de Peirce dont l’idée du sens est d’emblée moins statique. La linguistique européenne suivra par la suite l’évolution du structuralisme, initiée par Marcel Mauss et Claude Lévi-Strauss dans la sociologie, vers des modèles plus dynamiques et plus anthropologiques. Le structuralisme linguistique moderne tentera même la modélisation intégrative du sens et de la forme, à ceci près que ce seront à chaque fois les lois de la forme qui régiront les exploits du sens.
Cependant, le manque de dynamisme du structuralisme linguistique a déjà profondément pénétré les modèles psychopathologiques conçus en France et en Allemagne, et s’y décline en deux niveaux d’implications.
A un niveau général, le rapport de causalité entre un signifiant patent et un signifié latent a orienté la quête étiologique de la psychiatrie vers la recherche de causes invisibles et occultes (les signifiés) en mesure d’expliquer les symptômes exprimés manifestement par les patients (les signifiants). Ce modèle explicatif est tout aussi bien celui de la psychanalyse, qui incrimine des complexes inconscients, que celui des théories neurobiologiques visant des lésions organiques fonctionnelles ou substantielles. Berrios cite trois conséquences néfastes à cette approche : « Il va sans dire que cette dépendance à un insaisissable signifié a eu des conséquences négatives pour la compréhension des symptômes mentaux, entre autres : 1) leur signification n’a jamais été prise au sérieux, 2) ils n’ont jamais été considérés comme faisant partie intégrante de représentations culturelles plus larges de la maladie ; et 3) le processus de « formation des symptômes » a été considéré comme appartenant à la physiopathologie et non à la culture ». Mais une quatrième conséquence nous semble être d’une plus grave importance. La recherche d’un rapport direct et nécessaire entre un phénomène patent et sa cause latente oblige le chercheur à concevoir ce rapport sur un plan exclusivement synchronique. C’est-à-dire qu’à chaque conséquence il faut présupposer une cause co-existante. Une telle approche nous interdit de concevoir le rapport de cause à effet de manière dynamique, historique et diachronique.
Dans un sens plus spécifique, l’influence immense qu’a eu le saussurianisme sur la culture philosophique occidentale a incité les penseurs de la fin du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle à penser leurs propres modèles du langage et de la psyché conformément à la structure signifiant/signifié. On reconnaît facilement ce modèle dans la Métapsychologie de Freud(6), ce dernier expliquant le mécanisme de la psychose par un blocage dans l’explicitation du signifié inconscient en signifiant discursif. Il est, de surcroît, délibérément prôné par Lacan(7) dans son séminaire sur les psychoses. Mais en règle générale, presque toute la psychopathologie a appliqué le principe qui fait du mot une unité autonome du langage dans laquelle la signification se condense, et ce jusqu’à nos jours, puisque les modèles d’études cognitivistes inspirés, non sans la détériorer, de la philosophie analytique anglo-saxonne continuent de reproduire les défauts et les écueils qui caractérisent le structuralisme linguistique de la première époque. Nous développerons plus amplement ce point dans le corps de notre exposé, autour d’une analyse des travaux publiés récemment sur la question des troubles du langage dans la schizophrénie, et des échelles de mesure des FTD (Formal Tought Disorder).
D’autre part, le structuralisme qui préside à l’entreprise explicative de la psychiatrie la charge d’une prétention à recouvrir totalement le champ des réalités qu’elle exploite. Cette prétention à la totalité est inhérente à la notion de structure, du fait que chaque élément renvoie par nécessité à l’ensemble du système qui l’inclus. Toutefois, les travaux de Kurt Gödel ont bien fait la preuve que l’endoconsistance d’un système logique ne pouvait être atteinte que par son dépassement en un système de niveau supérieur. Il s’ensuit que, dans le cadre de la logique, les limites de la prétention à la totalité s’apparentent aux présuppositions que nous avons le souci de démasquer au sein de la nosographie psychiatrique. Piaget écrit : « un système de logique constitue bien une totalité fermée quant à l’ensemble des théorèmes qu’il démontre, mais ce n’est là qu’une totalité relative, car le système reste ouvert par le haut quant aux théorèmes qu’il ne démontre pas (notamment les indécidables à cause des limites de la formalisation) et ouvert par le bas, car les notions et axiomes de départ recouvrent un monde d’éléments implicites »(8). En assumant une transposition du propos de Piaget sur le système que constitue le paradigme des savoirs psychiatriques, disons qu’il est ouvert par le haut sur l’ensemble des phénomènes qu’il n’est pas encore en mesure d’expliquer, et par le bas sur les influences implicites parmi lesquelles nous tâchons d’isoler celles qui relèvent spécifiquement de la linguistique.
Classifications et théories :
L’entreprise classificatrice autour de laquelle s’est construite la pratique médicale illustre parfaitement les modalités d’influence des présupposés théoriques sur la pratique(9). La classification consiste à trier des entités naturelles ou artificielles définies par des concepts. Ces concepts délimitent les objets des classifications et déterminent leur intégration à telle ou telle classe. Toute classification repose donc sur une taxinomie, c’est-à-dire sur une théorie des concepts de tri. « Alors, bien qu’il soit possible pour quiconque de prétendre que sa classification est vierge de théorie (le DSM IV a déjà été présenté comme une liste a-théorique), le fait est qu’aucun classificateur ne peut éviter d’assumer la théorie de ces concepts »(1). C’est ce qu’a décrit Lantéri-Laura, dans le cadre propre à la psychiatrie, comme « les références non-cliniques » des classifications(10), à savoir les objectifs et les hypothèses théoriques qui les définissent concurremment aux données purement biologiques auxquelles elles prétendent s’appliquer. Comme l’illustre bien l’oeuvre de Michel Foucault(11), l’essor de la taxinomie au cours du XVIIe siècle a servi le quadrillage de la nature et la classification des minéraux, des plantes et des espèces animales ; elle avait pour vocation de saisir intégralement la totalité de la nature dans ses catégories, et il persiste dans toute entreprise classificatoire la prétention de cette exhaustivité. Mais cette taxinomie n’opère pas aussi efficacement sur des objets naturels dont l’ontologie est stable que sur des entités abstraites, symboliques ou complexes, ontologiquement fugaces par définition. En fait, dans la sphère des sciences humaines, toute dénomination relève d’un acte spéculatif risqué. Quelle est alors le degré de validité d’une taxinomie appliquée à la matière clinique de la psychiatrie ?
Et puisqu’ils furent définis comme des objets « hybrides », pouvons-nous encore prétendre à une saisie catégorique des objets psychiatriques ? Comme il nous faut coûte que coûte répondre « oui », afin que l’entreprise de la psychopathologie descriptive demeure légitime, la tâche consistant à discerner les limites épistémologiques de cette entreprise taxinomique devient inévitable.
Il s’agit alors d’identifier les importations théoriques ayant participé de la formation de la psychopathologie descriptive telle qu’elle est appliquée aujourd’hui. C’est le coûteux labeur des historiens de la psychiatrie et nous ne prétendons pas joindre notre travail à leur oeuvre. La tâche de l’historien l’engage à une exhaustivité des sources dont nous ne saurions nous lester. Notre travail tentera de se limiter à une investigation de certains modèles psychiatriques disponibles pour étayer l’idée selon laquelle la psychiatrie bénéficierait d’acquérir une connaissance plus claire des théories linguistiques qui la fondent, mais aussi de l’intégration de théories du langage plus récentes qui permettraient le développement de nouveaux modèles, plus complexes mais peut-être plus exacts, des troubles mentaux.
Mieux encore, et conformément à une entraide souhaitable des différentes disciplines, nous pensons que la psychiatrie descriptive peut constituer une abondante source d’informations pour la linguistique, la psychologie et la philosophie, et que les longues observations de situations discursives inédites, contenues dans les livres de psychiatrie classique, recèlent des trésors d’enseignements pour les chercheurs en science du langage.
Nous tenterons de prouver ces quelques points, autour de situations cliniques, en nous astreignant à l’analyse des notions d’intuition et de prolixité du discours dans la sphère des troubles attenants à la paranoïa. Non seulement cela permettra de recentrer notre recherche et de l’étayer sur des points précis, mais davantage, l’apparente cohérence et l’intégrité formelle présumée de la pensée des paranoïaques nous permettra d’identifier plus clairement des altérations subtiles dans le cours de la pensée et l’exercice du langage. Il faudra alors préalablement rappeler ce qu’implique la notion ambiguë et discutée de trouble paranoïaque à travers une revue historique des conceptions ayant successivement prévalues.
Origines de la psychopathologie descriptive :
Celui qui n’est pas lui-même historien doit accorder sa confiance à l’histoire telle qu’elle est rapportée par d’autres. En raison de l’estime que nous lui vouons et de notre familiarité avec son oeuvre, nous continuerons à nous fier à German E. Berrios concernant le processus historique de formation de la psychopathologie descriptive. On ne saurait surestimer l’importance et l’absolue nécessité de son travail étant donnée la précarité de nos certitudes.
« La Psychopathologie descriptive, écrit Berrios, est définie comme un langage stable, garanti par l’implication de postulats, d’une grammaire, d’un vocabulaire et de règles d’application qui lui sont propres ». Elle s’est construite sur près de cent ans pendant une des périodes les plus foisonnantes intellectuellement, et donc en parallèle de nombreuses autres disciplines en cours de floraison. Sa création, ayant commencé vers 1820, s’inspire de la sémiologie médicale « elle-même influencée par la théorie linguistique des signes ».
La création des asiles, au début du XIXe siècle a impliqué l’obligation, pour les gestionnaires de ces établissements, de fournir des descriptions écrites des états mentaux des patients. Les journaux de bord cliniques d’avant 1830 s’avèrent pauvres en descriptions cliniques ; « les premiers médecins d’asile ont dû à la fois improviser et emprunter ». Ce n’est que quelques années plus tard que la sémiologie du XIXe siècle se voudra « analytique et picturale, traitant les symptômes comme des unités d’analyse distinctes et supposant que le même symptôme puisse être observé dans différentes formes de folie ». C’est alors la disponibilité de théories psychologiques, tels que la Psychologie des facultés qui s’est confrontée à l’Associationnisme, qui a permis la construction, en France puis en Allemagne, des modèles de l’esprit et du comportement de la psychopathologie descriptive.
L’importation précoce en France de la philosophie écossaise, et avec elle du concept de faculté psychologique pourrait expliquer le caractère liminaire de la psychopathologie française. Les écossais s’étant eux-mêmes inspirés de l’oeuvre de Christian Wolff, « père de la psychologie », qui considère les « facultés » comme des capacités mentales plus ou moins indépendantes, similaires aux fonctions physiologiques. Cette conception fonctionnaliste de l’esprit a entre autres conduit à la naissance de la « cranéologie », rebaptisée « phrénologie » par Spurzheim, qui n’est autre qu’une forme anatomisée de la psychologie des facultés.
Or si la phrénologie semble aujourd’hui désuète, il est important de se rendre compte que la vision modulaire de l’esprit prônée par le phrénologue Franz Joseph Gall demeure à ce jour valable dans le domaine de la neuro-imagerie, et que « la psychologie des facultés est demeurée l’une des thématiques privilégiées de la recherche au XIXe siècle, inspirant les travaux sur les localisations cérébrales »(1).
Par ailleurs, comme le décrit Paul Bercherie(12), Pinel « recommande sans cesse d’utiliser, autant que faire se peut, le travail des psychologues et en particulier de Locke et Condillac » et aurait écrit une partie de son traité, celle qui constitue l’« ancêtre de tous les chapitres de sémiologie des traités ultérieurs », en rapport direct avec les facultés mentales. Ainsi, la première classification psychiatrique viable du XIXe siècle distingue des catégories de troubles mentaux délirants, émotionnels et volitionnels, qui deviendront ultérieurement nos groupes actuels de schizophrénie, de troubles thymiques et de troubles de la personnalité. Ces notions que nous voudrions originales et élémentaires sont en réalité issues de l’accumulation de plusieurs couches théoriques, et c’est pourquoi elles ont à s’en justifier.
Langage de la psychopathologie – Psychopathologie du langage :
Le langage de la psychopathologie descriptive a prospéré, et particulièrement en France, par la description des contenus de la conscience, les aliénistes cherchant de nouvelles sources d’information clinique. Moreau de Tours et son livre, La Psychologie morbide(13), a joué un rôle majeur dans la légitimation des informations subjectives collectées dans le cadre du dialogue avec les patients.
Dans cette perspective, le rapport que suppose le clinicien entre les dires du patient et son vécu est essentiel à la compréhension des troubles du patient. Or ce rapport entre le langage et la pensée s’avère être d’une complexité primordiale qui le place au centre même des préoccupations d’une philosophie anthropologique. Le linguiste soviétique Saumjan a ainsi pu dire au sujet des relations entre le langage et la pensée qu’il s’agissait « d’un des problèmes philosophiques les plus profonds et les plus ardus qui se posent actuellement ».
Mais, aussi profonde que soit la nébuleuse dans laquelle nous entraînerait une tentative pour résoudre ce rapport, sa présupposition est nécessaire (et nécessairement teinté de tout un cortège d’apports théoriques disparates), puisque, nous dit Charles Blondel, « l’expression verbale nous engage immédiatement, à reconstituer la pensée dont elle est issue, et nous introduit par conséquent en pleine subjectivité et en pleine conjoncture, puisque nous ne pouvons naturellement opérer cette reconstitution qu’à l’aide de notre propre pensée et en supposant, derrière les mots que nous entendons, quelque chose qui, peu ou prou, lui ressemble. Si défiante que nous fassions notre intervention, elle devient ici radicalement nécessaire et par là ouvre définitivement pour nous l’ère des dangers et des incertitudes »(14).
Par ce processus, le clinicien introduit les modèles desquels procède sa propre pensée dans ce qu’il prétend décrire comme la pensée du patient, et avec ces modèles, il importe les préjugés théoriques qui sont les siens en tentant de concevoir, à partir de la parole du patient, une idée de ce que pourrait être la pensée morbide. Or dans cette reconstruction, et puisqu’il est évident que la pensée propre de l’autre demeure à jamais ineffable, ce seront précisément ces préjugés théoriques qui prendront le dessus et qui constitueront l’armature d’un édifice descriptif adjugé, non sans iniquité, au patient.
A cet égard, le modèle du symptôme développé par l’école de Cambridge nous semble important à étudier, puisqu’il tente de s’inscrire en faux contre cette réduction qui voudrait établir un rapport trop direct et trop évident entre une lésion organique (ou psychique), un vécu pathologique et l’expression de ce vécu par les malades.
Ce modèle de formation des symptômes s’avère fortement inspiré de la Conscience Morbide de Charles Blondel (14). Dans cet ouvrage, Blondel s’appuie sur certaines assertions psychologiques de Bergson pour montrer comment le langage, étant le langage de la société, ne peut traduire les sentiments individuels qu’en les trahissant. « Nous croyons avoir analysé notre sentiment, écrit Bergson ; nous lui avons substitué en réalité une juxtaposition d’états inertes, traduisibles en mots, et qui constituent chacun l’élément commun, le résidu par conséquent impersonnel, des impressions ressenties dans un cas donné par la société entière »(15).
Dans le cadre du modèle de Cambridge, le risque est que deux patients puissent décrire le même sentiment de deux manières différentes. Ce sentiment original et indéterminé est baptisé « la soupe primordiale »(1), il correspond à l’expérience inédite du patient. Or « pour exprimer un symptôme, les sujets doivent d’abord discriminer l’expérience en question. Puisqu’il est peu probable que les êtres humains soient également dotés d’une fonction mentale dédiée à l’identification des expériences anormales de novo, au cours des premiers stades de la maladie, le patient aura du mal à gérer ces expériences. La perplexité initiale sera suivie d’un effort pour cataloguer la nouvelle expérience selon les catégories déjà disponibles. Cette activité sera régie par des éléments de la personnalité, l’éducation, l’imagination, les capacités d’adaptation, les aspects socioculturels, etc. »(1).
Il serait également possible que deux soupes primordiales distinctes, peut-être issues de deux lésions organiques différentes, aboutissent à l’expression du même symptôme. Si la plupart des patients que nous sommes amenés à voir dans la pratique s’accordent à dire qu’ils se sentent « angoissés », il est fort probable que leurs vécus diffèrent les uns des autres, que leurs expériences de vie et que leurs acquisitions intellectuelles nuancent leurs impressions intimes. Ce ne sont que les maux de la culture environnante qu’ils peuvent convenir de ressentir, et à travers eux, nos propres mots. « C’est ainsi que s’il s’agit d’une émotion déprimante, écrit Blondel, un Français de nos jours, après l’avoir fragmentée en les éléments conceptuels dont elle paraît à sa conscience réfléchie être la somme, suivant leur nombre, leur nature et leur valeur, est invité à concevoir et conçoit, en effet, son état comme de la mélancolie, de la tristesse, du chagrin, de la douleur, de l’inquiétude, de l’angoisse ou de l’anxiété »(14).
Cela signifie que l’on ne peut pas considérer un symptôme qui serait décrit par un patient, sans préjuger du processus de médiation qui transforme son vécu en discours ; mais aussi, nous l’envisagerons plus loin, des conséquences de ce processus sur le vécu en question. Ne pas prendre en compte les complexités dynamiques du processus par lequel le langage crée de la signification à partir de la pensée, ce n’est qu’opter pour un certain modèle du langage (le plus réducteur qui soit). Il nous faut admettre que toute entreprise psychopathologique repose, qu’elle le veuille ou non, sur un modèle linguistique sous-jacent.
Éclaircissement du champ d’étude et Méthode de travail :
Ce que nous chercherons à discriminer dans les aprioris théoriques engagés dans la fondation de la taxinomie psychiatrique, nous l’avons qualifié de structuraliste. Cela implique quelques précisions : le structuralisme représente un ensemble disparate et inégal de modèles théoriques ayant en commun un idéal d’intelligibilité dans la description des objets de leurs différentes juridictions conformément à l’organisation formelle, ou aux modèles de transformation, des unités élémentaires constitutives des structures.
Comme nous l’avons mentionné plus haut, une première forme de structuralisme est née des efforts linguistiques pour décrire holistiquement le langage comme un système de signes. Formalisme et statisme sont les deux caractéristiques principales de la linguistique structuraliste. Le formalisme est entièrement assumé dans l’intention de représenter le langage comme un système autonome, indépendant de son appropriation par les sujets parlants ; le statisme est inhérent à la perspective synchronique (anti-diachronique) de la linguistique saussurienne. C’est vers ces deux aspects que pointe la critique épistémologique que nous portons à l’encontre du savoir psychiatrique, nous les désignerons comme les caractéristiques d’un structuralisme primaire. Ce que Pierre Bourdieu considère comme une application rapide et trop hâtive des principes de Saussure.
Bien sûr, les mouvements structuralistes épousèrent ultérieurement la voie de la complexité. La morphogénèse structurelle de René Thom n’est plus mue par la même dynamique que la linguistique développée par le cercle de Prague. Il y aurait des bénéfices certains à ce que la recherche psychiatrique se penche sur la théorie des catastrophes pour tenter de décrire de manière historique le développement d’un trouble de la pensée ou d’un délire. Toute tendance structuraliste, tout idéal d’intelligibilité, n’est évidemment pas à bannir.
Le formalisme de la phénoménologie :
La notion de structure est originellement dédiée à la description d’objets du monde extérieur ou de notions abstraites, elle est introduite en psychiatrie par Minkowski et sert dès lors à qualifier une sorte d’organisation fondamentale présidant à l’existence des individus ; depuis, les psychanalystes parlent ouvertement de structures psychotiques et de structures névrotiques. Il nous semble qu’il y ait pourtant quelque chose de foncièrement réducteur dans cette manière de décrire les individus en termes de structures.
Par ailleurs, l’infiltration du structuralisme primaire dans le langage de la psychopathologie est dénoncée par Jean Piaget dans les intentions de la psychologie Gestaltiste : « La Gestalt représente un type de structures qui plaît à un certain nombre de structuralistes dont l’idéal, implicite ou avoué, consiste à chercher des structures qu’ils puissent considérer comme pures, parce qu’ils les voudraient sans histoire et a fortiori sans genèse, sans fonctions et sans relations avec le sujet »(8). La phénoménologie psychiatrique, ou du moins celle que présente Georges Charbonneau dans son Introduction à la psychopathologie phénoménologique(29,30) et qui se définit elle-même comme une science du contenant, partage certains de ces torts.
La psychopathologie phénoménologique fait d’emblée la distinction entre la manifestation de la « structure d’expérience » et son contenu thématique. « Cette manifestation est une reconnaissance des formes : des formes sont identifiées c’est-à-dire isolées de leurs contenus et des données de sensations dont elles émergent ». Dans le même sens, Andrew Sims, cité par German Berrios(1), écrit : « Comme la chaîne et la trame, la forme et le contenu sont essentiellement différents mais inextricablement liés. La forme d’une expérience psychique est la description de sa structure en termes phénoménologiques, par exemple, d’un délire. Vu sous cet angle, le contenu est la coloration de l’expérience. […] Le patient ne s’intéresse qu’au contenu […] le médecin s’intéresse à la fois à la forme et au contenu, mais en tant que phénoménologue, uniquement à la forme, en l’occurrence la fausse croyance d’être poursuivi ».
Cette phénoménologie fait d’abord la distinction du contenu et de la forme du contenant puis se définit elle-même par rapport à cette distinction. Mais, comme le constate clairement Lacan à l’orée de son épopée psychanalytique(31), « toute distinction entre des structures ou formes de la vie mentale et les contenus qui les rempliraient, repose sur des hypothèses métaphysiques incertaines et fragiles ».
Alors, même si Jaspers précise que « le contenu, cependant, modifie le mode dans lequel les phénomènes sont vécus ; il leur donne leur poids par rapport à la vie psychique totale et indique la manière dont ils sont conçus et interprétés », la psychopathologie phénoménologique ne parvient plus, et ce malgré un effort herméneutique pour réintégrer le sens à la forme, à combler la scission sur laquelle elle a prospéré.
Par exemple, quand Georges Charbonneau fait appel à la philosophie de Paul Ricoeur, ainsi qu’aux « structures de champs » et aux « identités » que l’individu est amené à inventer pour préserver à tout prix les structures de son expérience, Charbonneau ne parvient pas à s’acquitter du fait qu’il est avant tout question chez Ricoeur de « champs sémantiques » pensés à partir de son analyse de la philosophie analytique anglo-saxonne et donc, fondamentalement, des mouvements du sens (du contenu).
« L’épochè phénoménologique suspend les contenus de la réalité pour mettre à jour la forme de cette réalité ». Ainsi la psychopathologie phénoménologique se place du côté d’un prépsychologique qui « prépare l’accueil des contenus de conscience, l’élaboration du thème, etc. ». Elle affirme que « ce qui est pathologique n’est pas le thème en lui-même mais la façon de l’engager, de l’habiter, d’y adhérer, de le désinvestir ou de ne pas pouvoir le désinvestir… »(30). Il arrive donc que Bachelard lui-même – lui qui désigne magnifiquement la parole comme le « devenir immédiat du psychisme humain », et le langage comme un « mode d’existence » qui « ajoute à la vie »(32) –, et c’est un comble, voit son imagination interprétée par la phénoménologie indépendamment du langage qui l’évoque, et selon la seule perspective corporelle de ses orientations spatiales. Ce n’est pourtant que par la poésie des images que les livres de Bachelard touchent juste, et non pas conformément aux réalités sémantico-kinétiques qu’ils explorent ; le lecteur fidèle ne saurait s’y tromper.
Déjà les travaux de Durkheim et Lévy-Bruhl assènent un premier coup à la vocation explicative illégitime du topos (sans logos) de la phénoménologie, en démontrant l’influence des croyances de la communauté sur la pensée individuelle de ses membres et jusque sur leurs perceptions sensibles. Lévy-Bruhl écrit : « Quoi de plus individuel, en apparence, que la perception sensible ? Nous avons reconnu, cependant, à quel point la perception sensible des primitifs était enveloppée d’éléments mystiques qui ne peuvent s’en distinguer, et qui sont, à n’en pas douter, de nature collective. Il en est de même pour la plupart des émotions éprouvées, pour la plupart des mouvements accomplis presque instinctivement, à la vue de tel ou tel objet, même banal. Dans ces sociétés, autant et plus peut-être que dans la nôtre, toute la vie mentale de l’individu est profondément socialisée ». Où chercher les croyances collectives d’une société si ce n’est dans le langage que ses membres ont en commun ? Et où se cacheraient ces « éléments mystiques » si ce n’est dans le symbolisme des mots(21) ? Il ne peut y avoir de primauté explicative, et encore moins ontologique, du contenant sur le contenu, car il existe un « symbolisme constituant » qui agit sur le cadre formel de l’expérience en le liant inextricablement à la signification de cette même expérience et, en fin de course, à des symboles garants de cette signification.
Nous y reviendrons, cette intrication irréductible du sens et de la forme étant particulièrement prégnante sur les théories de la « métaphore vive » que développe Paul Ricoeur. Nous tâcherons, pour l’instant, de préciser l’objet psychiatrique de notre inquisition, d’abord en explorant les études traitant généralement des troubles du langage et de la psychose, puis en nous penchant sur les différentes échelles conçues afin de chiffrer ces troubles, et finalement en tentant de nous accorder sur la définition des troubles paranoïaques que nous étudierons plus particulièrement et sur l’intérêt d’aborder spécifiquement le discours, prétendument intègre, du paranoïaque.
L’auberge de Procuste :
Les anomalies du langage, souvent manifestes, des patients atteints de troubles psychotiques, sont hétérogènes et difficiles à catégoriser. M. A. Covington et ses associés, qui effectuèrent en 2005 une revue de la littérature portant sur les conceptualisations linguistiques de la schizophrénie, distinguent les troubles de la pensée (thought disorder) et les troubles du discours, la schizophasie (33).
Les modèles linguistiques de la psychose :
Une des premières études tentant de définir les troubles du langage schizophrène à partir de la linguistique est menée par Chaika en 1974(34) et utilise une terminologie linguistique usuelle dans les années 1970. Ses observations lui permettent alors d’isoler six types d’anomalies découlant d’une incapacité à « appliquer les règles qui organisent les éléments linguistiques, tels que les phonèmes, les mots et les phrases pour former les structures significatives correspondantes, à savoir les mots, les phrases et le discours »(34). Covington(33) réduit à quatre le nombre de ces anomalies et les recense conformément aux théories analytiques du langage en vogue :
1) Une incapacité à produire un objet lexical, ou un mot, approprié et correspondant à l’intention sémantique originale.
2) Une tendance des malades à se laisser distraire par le son ou la sensorialité des mots, de manière à ce que leur discours ne soit plus qu’une suite de mots associés par assonances ou par analogie. Cet aspect du langage schizophrène fut décrit précédemment par Jacques Lacan, à l’aide d’une terminologie saussurienne, comme un manquement dans le lien symbolique entre les signifiants et les signifiés auxquels ils réfèrent, conduisant à des associations inappropriées entre signifiants, c’est la libération de la « chaîne des signifiants »(7).
3) Des déraillements, voire des pannes, de la syntaxe ou du discours, proches de ce qui est décrit comme le « fading » et les barrages.
4) Un défaut de prise de conscience quant au caractère anormal et à l’étrangeté du langage énoncé, ce que l’on retrouve également dans certaines formes d’aphasies.
Il est intéressant, par rapport aux discussions qui suivront, de noter que les théories linguistiques relativement modernes sur lesquels s’appuie Elaine Chaika lui permettent de décrire des troubles attenants au langage du patient sur le plan du discours, et de la phrase, elle n’est donc pas limitée par la relation de binarité signifiant/signifié caractéristique du mot. Cependant, son travail ne pénètre que peu les mécanismes explicatifs des anomalies du langage constatées et aboutit à un recensement descriptif, formel, hétérogène et désolidarisé des différentes anomalies.
Ce qui est problématique avec cette manière de procéder à l’investigation des troubles du langage, c’est que, ayant discriminé, à partir du langage tel qu’il est énoncé (ou disons exécuté), différentes fonctions responsables de l’exécution du langage, le modèle explicatif qui cherchera, a posteriori, à regrouper ces différentes anomalies autour d’un trouble originel, est d’emblée situé au niveau des fonctions exécutives et n’a d’autres alternatives que d’incriminer une notion exécutive vague et malléable pour réussir la synthèse de son modèle.
Quand dans une publication ultérieure(35), Chaika cherche à identifier un trouble fondamental du discours schizophrène, elle aboutit alors à la « perte du contrôle volontaire » sur les processus à l’origine de la parole. Concept général et synthétique proche de la perte de la main mise sur le cours de la pensée, symptôme de premier rang décrit par Schneider(36), et en certains points inspiré du petit automatisme mental de Gaëtan de Clérambault. D’autres chercheurs concluent à des atteintes de la mémoire de travail ou de l’attention (idée que l’on trouvait déjà chez Esquirol et qui fut reprise par ses disciples Moreau de Tours et Baillarger(12)).
Il arrive même que des études édifient des hypothèses vagues sur la baisse du fonctionnement du langage basées sur des concepts normatifs artificiellement pondérés comme la bizarrerie des réponses, évaluée en tant que BIT (Bizarre Idiosyncratic Verbalisations(37)) par une échelle à quatre degrés allant de « réponse sans bizarrerie » à « réponse très bizarre »(38).
La plupart des études de la littérature psychiatrique contemporaine sur le sujet se recoupent autour de la définition et de l’investigation des troubles de la pensée (souvent nommés TD pour « Thought Disorder ») qui sont reconnus comme des facteurs de mauvais pronostic chez les individus souffrant de troubles psychotiques et comme des facteurs de risque chez les individus considérés à haut-risque de développer une schizophrénie(39). Ces TD demeurant malgré tout difficiles à définir(33) puisqu’ils regroupent, non-exhaustivement, des troubles touchant la pauvreté du contenu du discours, la perte de but, les associations syllabiques par rapprochements phoniques, la continuité logique entre les phrases, etc.
Une revue systématique récente(40) met en avant la disparité de ces définitions, et des constatations cliniques qui en découlent, à travers l’analyse de trente-sept études d’imagerie fonctionnelle portant sur les TD et publiées entre janvier 1990 et août 2016.
Cette hétérogénéité se reconnaît avant tout dans la variété des dénominations successives désignant des phénomènes similaires(41,42). On parle alternativement de schizophasie(43), des troubles structurels de la parole de Chaika(44), de parole ou de pensée désorganisées(45), d’un relâchement des associations(46), de raisonnements bizarres ou idiosyncrasiques(37), de troubles de la pensée formelle, dits « FTD » pour Formal Thought Disorder(47) ou de troubles de la pensée, du langage et de la communication(48).
Une autre revue systématique(49) publiée elle aussi en 2018 montre que les FTD sont liés à des dysfonctionnement à la fois fonctionnels et structuraux dans les régions cérébrales du langage. Toutefois, il faut constater que les auteurs se contentent d’inclure les études basées sur des mesures cliniques des FTD sans en questionner la nature.
En somme, ce qu’ont en commun les études recensées, c’est de déduire les TD, les troubles de la pensée, de l’analyse qualitative et quantitative des paroles énoncées par les patients : « les TD décrivent généralement l’existence d’une pensée désorganisée ou appauvrie, que l’on suppose sur la base d’anormalités dans la quantité et la forme du discours tel qu’il est produit, et qui aboutit à une détérioration de la communication »(40). L’incrimination des fonctions exécutives n’a alors rien d’étonnant puisque les fonctions toutes entières sont considérées et évaluées postérieurement à leur exécution. En réalité, ce qui est décrit comme un trouble de la pensée correspond à un trouble du langage énoncé. Chaika(35,44) refuse de présumer d’un trouble sous-jacent de la pensée et se contente de décrire des troubles structurels de la parole ; troubles par lesquels elle définit néanmoins la pathologie psychotique, ce qui revient au même. Mais quels sont ces troubles du langage ? Quelle est leur réalité ontologique ? Les troubles du langage n’ont que la réalité de leurs définitions, et n’existent que relativement aux théories linguistiques dont sont issues ces définitions.
|
Table des matières
I. Abord linguistique et historique des modèles en psychiatrie
1) Introduction générale
2) Le structuralisme linguistique
3) Classifications et théories
4) Origines de la psychopathologie descriptive
5) Langage de la psychopathologie – Psychopathologie du langage
II. Éclaircissement du champ d’étude et Méthode de travail
1) Le formalisme de la phénoménologie
a. L’auberge de Procuste
1) Les modèles linguistiques de la psychose
2) Échelles de mesure et recueil de données
b. La paranoïa
1) La monomanie d’Esquirol – la querelle de frontière avec la justice – les influences artificielles de la nosographie
2) Ernest-Charles Lasègue – Valentin Magnan
3) Richard Von Krafft-Ebing – Emil Kraepelin
4) Le groupe de la Salpêtrière – Jules Séglas
5) François Leuret – Sérieux et Capgras
6) Ernst Kretschmer
7) La paranoïa dans la nosographie d’aujourd’hui
III. Études de Cas
1) Le délire de Madame K, un incident fatal.
2) L’intuition de Monsieur P
3) X, l’érudition morbide
IV. Analyse des données
1) Introduction à l’herméneutique
2) L’intuition
3) Le discours paranoïaque
V. Hypothèses psychopathologiques et spéculations théoriques
VI. Conclusions
Télécharger le rapport complet