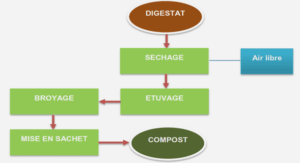Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Interpréter les corrélations chronologiques.
Quelle que soit l’échelle de temps considérée, la pénurie et la violence semblent affecter simultanément l’est du Tchad. Des razzias et famines des siècles précoloniaux, à la concomitance dans les années 1960 à 1980 de la guerre civile et de la sécheresse, la région porte le double sceau de la pénurie et de la guerre, comme si, dans l’environnement aride qui la caractérise, la lutte pour les ressources justifiait celle des hommes entre eux. Cette perception est à l’origine de ce qu’on pourrait appeler une tradition littéraire qui, du XIXe siècle à la fin du XXe, lie le caractère guerrier des habitants à l’âpreté du milieu où ils vivent. La lutte pour la survie dans un environnement hostile, où les ressources sont rares, expliquerait l’individualisme et, selon les auteurs, la force ou la bassesse morales d’hommes pour lesquels la guerre est un état normal, et le pillage, le vol ou le meurtre, un mode de vie.
Une perception qui n’est pas l’apanage du Tchad, ni même de l’Afrique. Pour André Bernand, la violence dans la Grèce antique s’ancre de la même façon dans un « pays rude », dans lequel les « actes sauvages relevaient d’une lutte pour la vie qui n’épargnait ni les individus, ni les familles, ni les cités ». L’homme grec affronte seul son destin. L’esprit de vengeance l’habite, « le crime répond au crime ». Les institutions démocratiques sont impuissantes à freiner la violence et finalement, « vivre, c’était vaincre, la vigueur menant à la victoire »1.
De tels accents émaillent les descriptions qui sont faites des sociétés du nord du Tchad. Le nomadisme est le caractère commun de groupes que Jean Chapelle inclut dans l’ensemble toubou*. Que lit-on sur ces Toubous* depuis le XIXe siècle ? Pour Nachtigal, premier européen à explorer le Tibesti, ce sont des « montagnards mal famés », des malandrins » qui exercent « violences et déprédations » sur les routes entre Fezzan, Ouaddaï et Bornou. Ils sont certes vigoureux et agiles – « nul peuple d’Afrique ne supporte mieux la fatigue, la faim et la soif ». Mais « les immenses difficultés qui les environnent de toutes parts » sont responsables de « la pauvreté de leurs sentiments moraux ». Ils ne connaissent que le profit, s’adonnent au mensonge, au vol, au meurtre. « C’est à celui qui fera le plus de tort au prochain ». Il faut bien survivre dans un milieu ingrat : « Cette âpreté égoïste au gain est le fait de tous les peuples non civilisés dont la nature a traité le pays en marâtre »2.
Un siècle plus tard, les analyses ont peu changé, même si les jugements moraux sont plus nuancés. Dans un ouvrage qui leur est entièrement consacré, Jean Chapelle a décrit les qualités guerrières des Toubous* : « Leur résistance à la fatigue, à la faim et à la soif est, en effet, extraordinaire et supérieure à celle de tous les autres nomades. […]. Les raids qu’ils accomplissent, avec des provisions insignifiantes d’eau et de dattes, dépassent certainement les exploits analogues des autres Sahariens, et ne sont limités que par la résistance de leur monture »3. La société toubou* érige la violence en valeur : « Aussi l’activité combattante prime-t-elle toutes les autres en valeur. A ses yeux, aux yeux de sa femme, de ses enfants et des gens qui l’entourent, l’homme est ˝homme˝ par le port des armes et par son adresse à les manier »4.
Comme Jean Chapelle, Louis Caron fut officier et administrateur du Borkou-Ennedi-Tibesti. Il se sentit confronté à une violence qu’il interprète ainsi : « …je me retrouvai, imprégné de tradition paysanne et romaine, et armé de probité candide, au cœur d’une société nomade que l’adaptation à un milieu hostile à l’homme avait fait éclater jusqu’au niveau de l’individu, et où la violence était toujours sous-jacente ». Dans ce contexte la paix française » n’était qu’une « paix trompeuse », juste une parenthèse dans une histoire tumultueuse, inapte à venir à bout des nombreux litiges survenant entre des nomades sans Dieu ni loi1.
Catherine Baroin s’inscrit dans la lignée de ce déterminisme environnemental de la violence : « Il n’est pas exclu de supposer que le caractère guerrier de ces sociétés pastorales soit une conséquence de leur économie ». Mais ce n’est pas tant la rareté des ressources qui est en cause que la vulnérabilité de l’élevage extensif en milieu aride. Une surveillance difficile à exercer, du bétail facile à voler : les pasteurs n’auraient d’autre choix que de se protéger par la violence, l’intimidation et les représailles armées2.
Robert Buijtenhuijs a repris ces arguments pour analyser le rôle joué par les Toubous* dans la rébellion du FROLINAT à partir des années 1960. Des razzias précoloniales à la guérilla contemporaine, les Toubous* semblent condamnés à la violence : « Par leur esprit guerrier et par leur mode de vie traditionnel aussi, les Toubou* sont en quelque sorte ˝prédestinés˝ à la guerre de guérilla moderne ». La guerre n’est-elle pas par conséquent inévitable ? « On peut donc en conclure que les combattants toubou* ne font que poursuivre leur mode de vie traditionnel en partant en dissidence »3.
Quelles sont les implications d’un tel discours ? Si l’on considère comme Jean Chapelle que les Zaghawa et les Bideyat, groupes d’origine de l’actuel président tchadien, peuvent être rattachés à l’ensemble toubou*, les dirigeants du pays depuis 1979 appartiennent tous à cet ensemble4. La violence ouverte ou latente que connaît le Tchad depuis cette date n’apparaît-elle pas alors normale, c’est-à-dire justifiée par le caractère foncièrement guerrier d’une société ? Des « guérilleros-nés »5 peuvent-ils faire autre chose que la guerre ?
En écrivant l’apologie d’Idriss Déby, le journaliste Pierre Darcourt poursuit dans la même veine. Les « hommes de fer » combattent les coalisés du GUNT dans l’est du Tchad au début des années 1980 : « Idriss et ses hommes de poudre vivent et circulent dans des déserts de pierre, légers et presque invisibles comme des djinns. Ils supportent sans faiblir la sécheresse de l’air, les températures extrêmes (…) et les brusques refroidissements nocturnes… ». Une vision romantique de la guerre qui masque la barbarie et les exactions qui l’accompagnent, un mythe qui fait du guerrier un héros et de la guerre une épopée : « …Idriss Déby a une démarche et une fierté de seigneur. […] il a toute la superbe et la nonchalance des grands nomades du nord, surgis du désert ». « Fiers et prêts à la mort, [ses hommes et lui] ont la gaieté des gens courageux »1.
La même tradition littéraire n’omet pas de décrire les autres peuples de l’est du Tchad : ils sont le reflet inversé de ceux du nord, producteurs sédentaires (ou presque) et non plus nomades pilleurs, aussi « civilisés », pacifiques et accueillants que les autres sont barbares », violents et inhospitaliers. Les Kodoï, tribu maba au centre du territoire et de l’histoire de l’empire du Ouaddaï, suscitent la sympathie de Nachtigal : « …il n’est pas dans leurs habitudes d’être activement querelleurs, et de fait ils sont probablement considérés comme le meilleur des peuples du Ouaddaï ; ils sont qui plus est religieux, et leur hospitalité et leur sollicitude envers les membres pauvres de leur tribu sont bien connues. Le mensonge, l’échec pour garder leur mot et le vol sont étrangers à leur nature »2. Un siècle plus tard, Buijtenhuijs confirme le jugement : les habitants du centre-est du Tchad, ces paysans et éleveurs plus ou moins sédentaires, ont un mode de vie traditionnel que tout oppose à celui des guérilleros du nord. C’est pourquoi leur rôle dans la guerre civile tchadienne est infiniment moindre que celui des Toubous*3.
L’interprétation qui fait de l’environnement le déterminant de la violence présente deux dangers. En premier lieu, elle occulte le fait que si le milieu influence l’homme, c’est par la médiation d’une culture dont les normes et les valeurs ne sont pas déterminées par la nature mais construites socialement. Elle fait fi également de la liberté individuelle et des changements qui modèlent les valeurs et les comportements.
En second lieu, elle s’impose comme interprétation des violences contemporaines, pas seulement pour les auteurs cités ci-dessus, mais pour les acteurs de la vie sociale et politique tchadienne. Tout se passe comme si les malversations de l’Etat aujourd’hui s’expliquaient par la violence congénitale des détenteurs du pouvoir, un « atavisme de guerre et de rapine »4. Du déterminisme environnemental au déterminisme ethnique de la violence, il n’y a qu’un pas, allégrement franchi. La clé de lecture est simple : les ressortissants du nord sont violents parce que leur environnement les a rendus ainsi ; ils gouvernent donc par la violence. Un raccourci qui n’est pas sans conséquence dans le rapport conflictuel que les groupes ethniques tchadiens entretiennent entre eux.
Au début, le partage.
Quand une vague de violences « interethniques » frappe à son tour l’est du Tchad en octobre 2006, obligeant des milliers de villageois à se réfugier dans le camp de Goz Amir, les travailleurs humanitaires s’empressent de noter « l’agréable surprise » qu’ils trouvent dans ce camp : des réfugiés soudanais ayant commencé à dresser des listes de Tchadiens déplacés pour qu’ils bénéficient eux aussi des distributions de nourriture : les Soudanais se sont souvenus que « de nombreux Tchadiens nouvellement déplacés [les] avaient eux-mêmes accueillis quand ils ont fui le Darfour »1…
Les organisations humanitaires ne manquent jamais une occasion de rappeler la solidarité qui fut celle des populations locales envers les réfugiés soudanais pendant les mois qui précédèrent l’arrivée de l’aide. Leitmotiv heureux dans un contexte de désolation et de violence, et conforme à l’idée que les Occidentaux se font de la solidarité africaine. Ces Africains », chefs traditionnels ou autorités administratives, ne tiennent pas à les décevoir et rappellent à l’envi la charge que ces nouveaux venus ont représenté pour les communautés proches de la frontière. Une façon de dire leur respect des usages de l’accueil, et d’appeler à leur tour à l’aide.
En août 2006, le SECADEV, présent de longue date dans la région, donne la parole au chef de canton de Guergné, autour de la localité frontalière d’Adré : « Mon canton a été le premier à accueillir les réfugiés au tout début de leur arrivée massive depuis le Darfour Nous avons partager nos terres, nos ressources, notre pain pour les aider ». Car l’arrivée des organisations internationales ne fut pas immédiate, alors que l’ONG nationale fit ce qu’elle put, avec ses moyens limités : « Dès le début, avant même l’arrivée du HCR et des organisations internationales, le SECADEV était avec nous pour les aider… »2.
Il y eut effectivement un décalage entre les premières mises en garde sur la gravité de ce qu’il se passait et le début de la réponse humanitaire. Lorsque les premiers réfugiés franchirent la frontière en avril 2003, c’est un représentant du HCR en poste dans le sud du Tchad pour l’accueil de réfugiés centrafricains qui alerta l’agence sur la situation à l’est du pays. Le HCR dépêcha alors sur place une mission avec peu de moyens. Celle-ci fit le constat que les réfugiés n’étaient pas aussi nombreux qu’annoncé, pensa la crise contenue et se retira3. les ressources des Tchadiens qui accueillaient des réfugiés à Tiné et à Birak n’allaient pas suffire compte tenu de l’ampleur de l’afflux, et que « toutes les conditions [étaient] réunies pour que la situation se détériore rapidement ». Le 29 septembre, le centre de santé ouvert quatre jours plus tôt à Tiné avait déjà identifié 20 enfants souffrant de malnutrition sévère. MSF prévenait que beaucoup d’autres Soudanais n’étaient pas secourus entre Bahaï et Adré1. Ceux de Bahaï ne le seraient toujours pas à la mi-mars 2004.
Le HCR revint à Abéché en décembre 2003. En janvier 2004, il procéda à deux distributions de vivres sur la frontière : 500 tonnes de nourriture du PAM allèrent à 36 847 bénéficiaires2. Au moment où des estimations raisonnables évaluaient le nombre des réfugiés 110 000, l’insuffisance des stocks obligeait à procéder à des distributions « ciblées » sur les personnes « vulnérables » (enfants, femmes enceintes), provoquant des troubles non maîtrisés par les ONG. A l’ouverture du premier camp le 17 janvier 2004, le PAM déclarait disposer de 13 000 tonnes de vivres permettant de nourrir 60 000 personnes pendant un an. Des demandes d’aide supplémentaires étaient en cours. La machine humanitaire venait de se mettre en marche.
Il avait bien fallu jusqu’à cette date que les réfugiés trouvent eux-mêmes des moyens de subsistances. Leur fortune était diverse.
Birak, petit village du Dar Tama, à 6 kilomètres à l’ouest de la frontière, reçoit des réfugiés à partir du 7 août 2003. Quand nous les rencontrons en mars 2004, ils sont entre 10 et 20 000, selon les estimations, dans la sous-préfecture. Certains sont d’ethnies jebel et erenga. Ils sont agriculteurs et parlent la langue tama du milieu qui les accueille. Ils sont arrivés huit mois plus tôt après avoir parcouru à pied les 60 kilomètres qui les séparent de Birak. Leurs témoignages révèlent une constante du comportement des réfugiés – mais n’est-ce pas plutôt, comme on l’a vu, la manifestation de la capacité d’adaptation des peuples sahéliens ? – : la mise en œuvre de plusieurs stratégies à la fois, pour garantir la survie et la cohésion du groupe.
Le chef de canton a donné des terres aux réfugiés jebel et erenga afin qu’ils cultivent en saison des pluies. Ceux-ci ont construit des maisons de paille de mil regroupées en quartiers qui correspondent aux différents villages de provenance des réfugiés : les structures sociales sont reproduites, les chefs traditionnels conservent leur autorité. Les personnes présentes à Birak font le lien avec les autres membres dispersés de la famille : les femmes et les enfants ont accepté de rejoindre le camp de Kounoungou, près de Guéréda, où ils bénéficient de l’assistance humanitaire. Des hommes ont accompagné le bétail jusqu’à la mare de Sineyt, à une dizaine de kilomètres au sud de Birak. Enfin les liens avec le Soudan ne sont pas rompus. Des vieillards ou des malades, incapables de supporter l’exode, y sont restés, certains cachés dans des grottes. Les réfugiés traversent fréquemment la frontière la nuit, pour leur porter secours, ou pour aller chercher des vivres ou des biens dans leurs villages abandonnés.
Mais d’autres groupes de réfugiés, à Birak, semblent connaître une situation plus précaire. Ils survivent en faisant des briques, ou en vendant de la paille ou du bois pour acheter leur nourriture sur le marché. On ne leur a pas alloué de terres, et en saison des pluies, ils devront quitter le gôz* sur lequel ils sont installés.
Il est difficile de mesurer exactement l’impact de la présence des réfugiés sur les disponibilités alimentaires à Birak. Le sous-préfet insiste sur le fait que la population locale a beaucoup donné : « les greniers sont vides », et tous, réfugiés et autochtones, ont besoin d’une aide. Mais le marché est approvisionné, et plusieurs témoignages font état d’une bonne récolte dans les villages frontaliers du Soudan, qui continue d’arriver dans le canton.
De source humanitaire, avant l’arrivée de l’aide, la population locale a effectivement partagé ses vivres avec les réfugiés. Mais quand les distributions alimentaires ont commencé, en janvier 2004, des Tchadiens ont accaparé les trois quarts des quantités distribuées. S’agit-il des autorités ? De commerçants ? Quoi qu’il en soit, seuls les réfugiés soudanais ayant des parents tchadiens ont eu accès à l’aide. Il en résulte de grandes inégalités de situation, parmi les réfugiés comme parmi les autochtones.
En ville aussi, le sort des réfugiés est plus ou moins heureux.
Tiné-Tchad » n’est séparée de « Tiné-Soudan » que par le Ouadi… Tiné. Du Tchad, on entend les bombardements de l’armée soudanaise contre la rébellion du Darfour. A partir de novembre 2003, la CNAR (Commission Nationale d’Accueil et de Réinsertion des Réfugiés) recense l’arrivée de 300 réfugiés par jour en moyenne. Ce sont essentiellement des femmes et des enfants, les hommes s’étant engagés dans la rébellion ou ayant trouvé la mort en couvrant leur famille. En mars 2004, Tiné-Soudan est totalement désertée par ses habitants, et occupée par des militaires soudanais et des janjawid*, qui font face à des soldats tchadiens campant dans la vallée du ouadi*.
L’on peut distinguer à Tiné-Tchad trois « catégories » de réfugiés, qui bénéficient inégalement de la solidarité du milieu local. Ceux qui viennent de Tiné-soudan s’installent en ville et y restent, dans la concession de proches ou dans des constructions précaires qui s’insèrent dans les trous du tissu urbain. Peu importe l’inconfort de leur situation, ils représentent une élite urbaine qui refuse le déplacement vers les camps. D’autres réfugiés, venus de loin, parviennent fatigués à Tiné-Tchad. Ils n’y ont pas de parents. Pris en charge par les organisations humanitaires, ils sont emmenés vers le camp de Touloum, près d’Iriba, qui est encore un « camp de transit » (sans tentes) malgré les 5000 personnes qu’il compte déjà en mars 2004. Entre ces deux groupes, une troisième catégorie de réfugiés vit dispersée à la périphérie de Tiné-Tchad, pour tenter de tirer parti des opportunités de la ville et des maigres ressources de la brousse.
Plus au nord, les conditions d’accueil des réfugiés sont encore plus défavorables. Depuis le récent redécoupage administratif, Bahaï est le chef-lieu de l’Ennedi Est. La région est aride, mais elle accueille pourtant de nombreux réfugiés dès 2003. La fermeture de la frontière entre Tiné et Koulbous, en raison des combats au Darfour, les incite à entrer par le nord. Selon le préfet de Bahaï, ils sont 60 000 dans la zone en mars 2004. Beaucoup sont installés autour de la ville et dans le lit des ouadis*. Le plus souvent ils construisent un enclos de branchages morts autour d’un arbre, sans toit. Femmes, enfants et vieillards souffrent du dénuement et du froid. Beaucoup cherchent à s’employer en ville et proposent leurs services pour faire du ménage, de la lessive, ou bien vendent du bois. Les plus aisés louent des chambres en ville. En attendant de l’aide, le préfet et le sous-préfet ont organisé une collecte et une distribution de vivres. Mais c’est tout ce que la région semble pouvoir faire, avant que les premières livraisons de vivres ne commencent le 18 mars 2004, puis que n’ouvre le camp d’Ouré Cassoni, en juin.
Des potentialités du milieu va dépendre la réussite de l’implantation des communautés réfugiées. A Goz Beida, une expatriée qui connaît bien la région qualifie de « déportation humanitaire » le transfert des réfugiés de la frontière vers les camps, tant il est vrai que ceux-ci semblent à même de créer leurs propres moyens de subsistance, dans le sud du Ouaddaï. Dans le nord en revanche, la présence des réfugiés accroît les pénuries et les conflits pour les ressources ; l’aide y est à la fois indispensable et source de nouvelles tensions.
Les limites de la solidarité.
La solidarité des populations hôtes est donc à la mesure de ce qu’elles peuvent donner. Il y a le langage diplomatique des autorités locales qui fait plaisir aux ONG : « Les réfugiés sont nos étrangers, ce sont nos frères, nous sommes comme eux, nous partageons leurs problèmes… » et puis il y a les contraintes économiques et environnementales de la région d’accueil, et les barrières ethniques.
Parce que je viens d’un pays où la citoyenneté transcende l’origine régionale des individus, je ne peux m’empêcher de juger avec suspicion le fait que soit mentionnée sur la fiche individuelle de recensement des réfugiés leur origine ethnique. Renseignement essentiel pourtant, dans une région où l’identité ethnique conditionne si fortement la relation à l’autre. Pas plus que les autochtones les réfugiés ne se perçoivent comme un groupe homogène. La distinction entre « Arabes agresseurs » et « Africains victimes » ne suffit pas à souder ces derniers, qui entretiennent entre eux, au Tchad comme au Soudan, des antagonismes non éteints. Ainsi au Soudan, entre l’indépendance et 1990, les conflits entre groupes ethniques n’ont pas seulement opposés des groupes ayant une identité arabe à d’autres ayant une identité non arabe. Dans les années 1970 et 1980, les Zaghawa se sont opposés aux Bergid, aux For et aux Gimir, tous agriculteurs non arabes. Différents groupes arabes se sont combattus. Même, des groupes arabes se sont alliés à des groupes non arabes pour combattre d’autres groupes arabes1. Qu’il y ait dans le conflit actuel des groupes fortement arabisés mais non arabes, comme les Tama et les Gimir, rangés dans le camp « arabe », n’est donc pas surprenant, quand bien même à l’encontre des interprétations simplistes. Au Tchad, les contentieux interethniques compliquent dès le début l’installation des réfugiés. Peu après l’ouverture du camp de Kounoungou, près de Guéréda, en pays tama, les autorités font savoir au HCR qu’elles ne souhaitent pas que les réfugiés en provenance de Tiné, des Zaghawa, soient hébergés à Kounoungou : la cohabitation des Zaghawa et des Tama risque de poser problème. Les réfugiés zaghawa doivent être dirigés vers d’autres camps plus au nord… en pays zaghawa. Le HCR contacte le sultan du Dar Tama pour lui demander d’assurer une médiation entre les réfugiés et la population locale. Sont alors redoutés à la fois des troubles entre réfugiés de groupes ethniques différents dans les camps, des conflits entre des réfugiés et des populations autochtones depuis longtemps antagonistes, voire même, des affrontement entre camps de réfugiés.
Le jugement porté à l’encontre de la communauté zaghawa est la conséquence d’une tradition dévoyée. Le vol de chameaux est considéré par les Zaghawa et les Bideyat comme un exploit que doivent accomplir les jeunes hommes avant de se marier. Mais ce qui doit se pratiquer sans violence dans la tradition semble avoir pris, depuis l’accession des Zaghawa au pouvoir au Tchad, une autre dimension. Les Tama autour de Guéréda, les Massalit de la région d’Adré, ont été dépouillés de tous leurs chameaux. L’impunité dont bénéficient les auteurs de ces vols exaspère les communautés qui en sont victimes.
C’est la raison pour laquelle le déplacement des camps du nord de 200 à 300 kilomètres vers le sud, préconisé par une étude environnementale menée par le HCR en mars 2004, est une option inenvisageable1. Les réfugiés sont transférés dans des camps situés à la même latitude que leur zone de provenance, pour éviter, autant que possible, certains « mélanges » ethniques.
Ces précautions sont lourdes de complications ultérieures. L’accueil des réfugiés soudanais par les populations du Ouaddaï est loin d’aller de soi parce que leur perception du conflit du Darfour est conditionnée par la situation politique interne. Les discours tenus par de nombreux Tchadiens « non zaghawa » sont totalement dépourvus de compassion à l’égard des réfugiés zaghawa, parce que la rébellion du Darfour apparaît comme essentiellement zaghawa et soutenue par un pouvoir tchadien de plus en plus considéré comme illégitime. L’accaparement de la richesse et des postes à responsabilité par les proches d’Idriss Déby, les exactions commises en toute impunité que l’on attribue – parfois hâtivement – aux membres de son groupe, conduisent certains à considérer que les Zaghawa du Soudan sont les fauteurs de troubles et les seuls responsables de leur propre malheur. Pour un militaire originaire du sud du Tchad et en poste à Adré, « il faut que le gouvernement soudanais vienne à bout des rebelles. Leurs revendications [concernant le partage de la rente pétrolière] sont excessives. Ils risquent d’amener le désordre au Tchad ». A Abéché, un Maba originaire du lieu tient ces propos : « La rébellion zaghawa nous arrange car elle affaiblit le régime zaghawa du Tchad » tandis qu’un Arabe tchadien trouve « la riposte des Arabes du Soudan […] légitime face à l’agression des Zaghawa ». Dès le début du conflit, le constat est fait par les Tchadiens puis repris par les observateurs étrangers d’une différence entre une « zone nord », de Bahaï à Adré, où déborde la lutte politique entre la rébellion zaghawa et le gouvernement soudanais, et une « zone sud », d’Adré à Tissi, dont les réfugiés (Massalit, Dadjo, For…) sont considérés comme les victimes d’affrontements plus traditionnels entre agriculteurs et éleveurs, exploités ou non par la rébellion.
Le capital de sympathie dont bénéficient les réfugiés soudanais en arrivant au Tchad est donc très inégal. Le terrain n’est pas neutre, mais saturé d’antagonismes et de préjugés, propices à des mobilisations de tous bords et à de nouvelles confrontations.
Cependant, que les clivages ethniques imposent des limites à la solidarité entre populations locales et réfugiés ne signifie pas pour autant que cette solidarité est complète dans les zones ethniquement homogènes. Ce qui se passe dans la région d’Iriba en mai-juin 2005 corrobore toutes les théories néo-malthusiennes : dans un contexte de pénurie sévère, la parenté ethnique ne préserve d’aucun conflit.
A Iriba en juin 2005, donc, les autorités locales sont aussi excédées que les responsables humanitaires. « La prison est pleine de réfugiés », confie le préfet alors en poste, tandis que le représentant d’une agence onusienne n’a pas de mots assez durs pour qualifier ces derniers. La plupart des réfugiés sont « frères » de leurs hôtes zaghawa, pourtant les conflits pour l’accès aux ressources se multiplient entre eux. Tous les facteurs sont réunis pour que la tension soit à son comble. Le vocabulaire d’Homer-Dixon est ici pertinent, dans une situation exemplaire de « conflits environnementaux ».
La saison des pluies 2004 a été très mauvaise à Iriba, on l’a déjà dit. Une quantité de précipitations inférieure à la moitié de la moyenne « normale », des pluies très mal réparties : les récoltes ont été faibles, les pâturages très insuffisants. Tout le grand bétail est au sud, mais pour les hommes encore présents dans la région, la soudure est difficile. Cette diminution de la quantité des ressources due à l’irrégularité climatique, c’est la « supply-induced scarcity » d’Homer-Dixon. Mais la voilà renforcée par une « demand-induced scarcity » : à partir de juillet 2003, l’arrivée des réfugiés soudanais accroît considérablement la demande de ressources. Jusqu’en janvier 2004, soit pendant sept mois, ceux-ci restent entièrement à la charge des populations locales. En juin 2005, la population du département de Kobé a presque doublé : il y a alors 61 000 habitants et 55 000 réfugiés, la proportion réfugiés/habitants la plus élevée de tout l’est du Tchad.
Sédentariser dans le désert.
Camp de Touloum, région d’Iriba, 15 mars 2004. Un vent de poussière aveuglant balaie les pentes arides sur lesquelles 5000 réfugiés ont construit des abris de fortune. Des bâches ont été fournies par le HCR, mais pas de tentes : le camp n’est encore qu’un « camp de transit ». L’ONG Norvegian Church Aid, spécialisée dans l’approvisionnement en eau des camps de réfugiés, n’a pas donné son feu vert pour une installation durable du camp de Touloum : les disponibilités en eau sont incertaines. Alors, les réfugiés s’occupent à tresser des seccos de paille de mil pour clôturer leurs abris ; une fillette lave un bébé dans un fond d’eau sombre ; des femmes reviennent de la brousse chargées de bois. Dans le camp et autour déjà, des souches d’arbres témoignent du déboisement. Le 21 mai, Touloum accueille 17 787 réfugiés…
Conformément à son mandat, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) se charge de la protection des populations soudanaises qui fuient la guerre du Darfour. La reconnaissance de leur statut de réfugiés est à la fois collective et temporaire. La mission du HCR est double : mettre ces réfugiés en sécurité, en les « relocalisant » dans des camps situés à plus de 50 kilomètres de la frontière tchado-soudanaise, et leur porter assistance.
Ces objectifs se heurtent à des contraintes majeures dont les effets cumulés compliquent sérieusement la situation : la localisation des camps est déterminée, on l’a vu, par des considérations « ethno-politiques » qui rendent leur déplacement problématique, voire impossible. Le choix du milieu naturel d’accueil ne se pose donc pas ; or, dans la plupart des cas, il est particulièrement inadapté à la forme fixe et concentrée que prend l’hébergement dans des camps. En novembre 2006, il y a 218 000 réfugiés soudanais pris en charge par le HCR dans les régions du Ouaddaï et du Wadi Fira. Cela représente une augmentation d’un quart de la population totale des deux régions. Sur ces 218 000 réfugiés, 185 000, soit 85 %, sont hébergés dans les 10 camps situés au nord de la ligne Am Dam-Adré1, autrement dit en milieu sahélien, voire sahélo-saharien dans le cas des deux camps les plus septentrionaux. Deux autres camps sont situés en « zone sud », selon la terminologie adoptée par les organisations humanitaires, c’est-à-dire dans le département du Sila.
La « zone nord », constituée par le département de Kobé, regroupe à elle seule en novembre 2004 36 % de l’ensemble des réfugiés. A cette date, le nombre des réfugiés dans ce département (72 460) est presque égal au nombre de ses habitants (72 928)1.
Ces chiffres ne rendent pas encore bien compte de ce que peut être la perception par les populations locales de cet afflux de réfugiés : les habitants des quelques petits villages posés dans le désert qui jouxtent les camps se trouvent soudain à côté de « villes » de plusieurs milliers d’habitants. Dans un environnement fragile, aux ressources rares et temporaires, la perturbation est considérable.
Depuis l’installation des premiers réfugiés en janvier 2004 jusqu’à aujourd’hui, le problème de la disponibilité des ressources naturelles – l’eau, le bois, les pâturages, les terres cultivables – constitue une préoccupation constante des organisations humanitaires. « Le manque d’eau est la plus grande contrainte pesant sur nos opérations pour aider les réfugiés au Tchad », déclare un porte-parole du HCR en juillet 20042. Dans l’est du pays, les ressources en eau sont aléatoires. Ou plutôt, elles sont mal connues des ONG en charge de l’approvisionnement en eau des camps, qui reçoivent dans cette mission une aide inégale des populations locales. Les incertitudes sur les disponibilités en eau expliquent les nombreuses hésitations qui précèdent la localisation d’un camp, les variations dans l’estimation de sa capacité d’accueil3, et les délais pour transformer un camp de transit temporaire en camp durable. Ce délai fait partie de la procédure normale d’installation des camps, mais dans l’est du Tchad, il est parfois très long.
Le camp d’Am Nabak, au sud d’Iriba, est d’abord un settlement où s’installent spontanément des réfugiés en provenance des villes soudanaises de l’autre côté de la frontière. Il n’y a pas d’eau sur place, il est donc impossible d’en faire un camp durable. Am Nabak devient donc un camp de transit… et l’est toujours, plus de quatre ans après son ouverture. Pas de tentes là non plus, donc, mais des bâches sur des murs de terre. Finalement une solution est trouvée pour assurer l’approvisionnement en eau : elle est apportée d’Iriba par des camions-citernes d’une contenance de 20 000 litres, qui font en moyenne huit voyages par jour. Pour le bois, « les réfugiés se débrouillent », mais avec quelles conséquences ! Il est toujours prévu de déplacer Am Nabak, dont la sécurité, à une vingtaine de kilomètres de la frontière, est en permanence menacée. Mais les réfugiés, fortement politisés, refusent ce transfert ; de même que sur les sites pressentis pour accueillir un nouveau camp, les « populations hôtes » expriment leur peu d’empressement à les accueillir1.
Le HCR s’est donné des moyens technologiques importants pour prospecter la région en vue de trouver de nouvelles ressources aquifères. En 2008, l’agence dispose d’une étude hydrogéologique approfondie sur tout l’est du Tchad. Mais cette information n’est pas toujours utilisée par les partenaires du HCR opérant dans les domaines de l’eau et de l’assainissement. De même, les acteurs humanitaires coopèrent peu avec les administrations (comme la direction de l’hydraulique à Abéché) ou les structures de projets susceptibles de détenir des données sur l’eau. Dans certains camps, la pénurie d’eau demeure récurrente. A Touloum, en mars 2006, les réfugiés ne recevaient que 6,62 litres par personne et par jour, au lieu des 15 litres correspondant à la norme2. A Iridimi en 2008, moins de 8 litres.
Une étude menée pour le service d’aide humanitaire de la commission européenne (ECHO) remet cependant en question l’utilisation de la norme Sphère consistant à vouloir fournir 15 litres d’eau potable par jour à chaque personne, dans un contexte où une partie de cette eau risque d’être consommée par le bétail, utilisée pour la production de briques ou l’agriculture. Fournir aux réfugiés moins d’eau potable et plus d’eau brute répondrait davantage aux besoins, à moindre coût3.
Il faut aussi chaque année gérer aussi l’excès d’eau de la saison des pluies. Lors de l’installation du camp de Kounoungou, les Tchadiens constataient avec amusement que les experts » de l’humanitaire avaient disposé les tentes sur le parcours de ruissellement des eaux de pluie. Le PAM, dont les convois pour approvisionner cette région enclavée partent de Douala ou de Benghazi – un voyage de 2800 kilomètres dont 1700 à travers le Sahara – doit en outre « prépositionner » des vivres pour plusieurs mois dans des rub-halls (grandes tentes servant d’entrepôts de stockage) à proximité des camps quand les pistes sont rendues impraticables par les crues des ouadis*4. En août et septembre 2004, l’armée française, présente à N’Djamena et Abéché dans le cadre du dispositif Epervier, consent à utiliser des avions C160 Transall pour acheminer 200 tonnes de vivres (750 tonnes de fret au total) vers les camps. L’opération est baptisée « Dorca », du nom d’une petite gazelle du désert. Elle n’est reconduite que ponctuellement en juin 2007 vers Goz Beïda1.
Des commencements dans l’urgence.
Avant les grandes sécheresses des années 1980, les interventions humanitaires dans l’est du Tchad sont des réponses d’urgence à des crises ponctuelles. Livraisons de vivres en 1959, et de nouveau en 1966 alors que la famine menace au Ouaddaï et au Soudan. L’aide d’urgence présente déjà les travers qu’on lui connaît depuis :
Pour palier à un début de famine, des C 130 Hercules de l’U.S. Army avait livré au cours des deuxième et troisième trimestres [1966] du mil à Abéché. Par manque de connaissance des coutumes et us du Tchad, les Américains avaient livré du mil rouge (sorgho) lequel (…) n’est pas consommé par les populations musulmanes du Nord. (…) Le sorgho avait dû être bradé, faute d’acheteur et le club hippique avait pu, à bas prix, se constituer une réserve de nourriture destinée aux chevaux du club »1.
Les institutions internationales prennent bientôt la relève de l’aide bilatérale. En 1967, le PAM conduit sa première opération d’urgence au Tchad2. Mais c’est à partir de 1981 que l’intervention des agences de l’ONU prend de l’ampleur. En mars, une mission est chargée d’évaluer les besoins humanitaires « résultant de la guerre civile et de la sécheresse »3. Une campagne d’aide d’urgence en 1982-1983 se traduit par la livraison de 24 000 tonnes d’aide alimentaire au Tchad4. A Abéché, un centre régional est créé pour prendre en charge la logistique nécessaire à la distribution des vivres. En novembre 1984, « la sécheresse est décrite comme la pire enregistrée depuis un siècle »5, et l’aide alimentaire explose : alors que le déficit céréalier est estimé par la FAO à 280 000 tonnes au terme de la récolte de 1984, 168 000 tonnes de céréales sont livrées au Tchad entre le 1er novembre 1984 et le 1er octobre 1985. A cette date 105 000 tonnes ont été distribuées. Hélas, note le rapport de l’UNDRO, l’arrivée tardive des vivres fait coïncider les programmes de distribution avec l’offre des premières récoltes sur les marchés ». Par conséquent : « Mesures à l’étude pour réduire effets néfastes de l’aide alimentaire sur commercialisation des produits locaux »6…
Ce qui apparaît clairement dans la description des interventions des années 1980, c’est que le lien y est déjà fait entre l’urgence et le développement, les institutions internationales se chargeant des deux. Ce « contiguum urgence-développement » – le fait de mener conjointement des actions d’urgence et de développement – résulte de deux évidences : « Le mal-développement précède et prépare les crises, crises qui ne peuvent, elles, jamais être résolues sans l’adoption de solutions durables »1. Dans un Tchad anéanti par la guerre civile, tout est à reconstruire. Dés 1981, outre les distributions alimentaires, des interventions sont envisagées dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage et des transports. En novembre 1983, le gouvernement tchadien lance un appel pour financer des « projets de développement agricole d’urgence » pour reconstruire et réparer des puits et des barrages dans les préfectures du Lac, du Kanem et du Ouaddaï2. En avril 1984, les projets Vivres Contre Travail du PAM prennent leur essor dans la région Ouaddaï-Biltine3, et un tiers de l’aide distribuée dans le cadre du programme d’urgence de 1984-1985 va sous cette forme VCT à des communautés engagées dans des projets de développement. Pour l’acheminement des vivres, des infrastructures sont construites : un pont sur le Logone en 1985, des routes d’accès, des radiers4. Tous les acteurs étrangers de l’aide sont déjà là : agences onusiennes, ONG, partenaires bilatéraux, entrepreneurs. Les organisations internationales conduisent des missions d’évaluation et informent les donateurs sur la situation du pays. Elles ne le quitteront plus.
Elles ne sont pas les seules à être convaincues de la nécessité de conjuguer aide d’urgence et développement.
Dans les années 1960, le père Faure, jésuite, occupe la mission catholique d’Abéché et assiste aux balbutiements de l’aide d’urgence. Vingt ans plus tard, à N’Djamena, il est à l’origine du Secours catholique diocésain qui tâche de venir en aide aux déplacés de la guerre civile. En 1984, l’association prend le nom de Secours Catholique pour le Développement (SECADEV) et s’engage dans des projets de plus long terme : aux victimes de la sécheresse, le SECADEV distribue non seulement des vivres, mais des semences qui permettent d’assurer l’avenir. Puis il tente d’amener les communautés à prendre elles-mêmes leur destin en main, par le biais d’organisations paysannes avec lesquelles il définit des projets échelonnés sur deux ou trois ans. A l’agriculture viennent s’ajouter d’autres secteurs d’intervention : élevage, hydraulique, bâtiment, environnement, octroi de crédits, actions pour la promotion des femmes. Au Ouaddaï le SECADEV bénéficie d’une considération spéciale, qui tient à la fois à l’ancienneté de sa présence et à son caractère véritablement national : quoiqu’initié par la hiérarchie catholique, il intervient aussi en milieu musulman, et son recrutement est multiconfessionnel.
Dès avant sa reconversion dans la prise en charge des camps des réfugiés à partir de 2003, l’ONG souffre pourtant de deux maux qui réduisent significativement son impact. Le premier est l’insécurité qui prévaut à l’est du Tchad, et qui se traduit par l’impossibilité de mener à leur terme certains projets. Le second concerne les moyens dont dispose le SECADEV : en tant que membre du réseau Caritas, il bénéficie du soutien financier de partenaires internationaux. Ce soutien est insuffisant compte tenu des moyens nécessaires pour couvrir une vaste zone d’intervention, selon les responsables de l’association, à laquelle ses partenaires reprochent des coûts de fonctionnement trop élevés, des méthodes de gestion inadaptées, des projets qui ne correspondent plus aux priorités des institutions internationales1.
L’évolution de l’intervention humanitaire dans l’est du Tchad n’est pas différente de ce qu’elle a été partout ailleurs : elle se manifeste par le passage d’une réponse ponctuelle à des crises espacées dans le temps, à la présence permanente d’institutions internationales qui couvrent tous les domaines : à l’instauration, en somme, d’un « régime humanitaire international », c’est-à-dire d’un système disposant de ses propres acteurs, établissant ses propres règles et principes d’action, et dont les structures identifient les besoins et se chargent d’établir des stratégies de réponse ; une « gouvernance sans gouvernement », pourvoyeuse de services sociaux à l’échelle mondiale. Pour ces acteurs internationaux, le problème n’est plus de trouver les moyens de financer telle opération d’urgence, mais de définir des projets qui permettront de dépenser le montant quasi constant des fonds disponibles2. Sur le terrain, cela donne lieu à une accumulation d’interventions dont le bien-fondé est la plupart du temps sujet à caution.
De l’irréalisme de certains « projets ».
Abougoudam, musée du développement. Dans ce village au sud d’Abéché, chef-lieu d’une « sous-préfecture nomade », le responsable du service de l’Elevage – boucher à ses heures, car il faut bien vivre – occupe en 2004 avec sa famille un curieux bâtiment : récent mais déjà détourné de la fonction pour laquelle il a été construit, équipé d’éviers et d’installations sanitaires non reliés à un réseau d’eau et par les tuyaux desquels des grenouilles remontent en saison des pluies, pourvu de prises de courant et de ventilateurs hors d’usage faute d’électricité. Un laboratoire vétérinaire fantôme, sans personnel, sans matériel et sans activité. Qu’espéraient les bailleurs en finançant cette structure moderne dans un village sans eau et sans électricité ? Il est vrai qu’à son dernier passage, le Président « a promis un château d’eau ». En attendant, sur place, personne n’est capable de dire de quel projet fait partie la construction du laboratoire1. On croît seulement savoir que celle-ci a donné lieu à certains détournements…
Le village en a vu d’autres. En 1951, l’administration coloniale y crée un centre d’élevage porcin, destiné à améliorer les performances des espèces locales par croisement avec des porcs de race limousine. L’initiative se solde par un échec, notamment parce qu’on est là en pays musulman. Le centre ferme au bout de quatre ans2. On tente par la suite d’élever à Abougoudam des moutons astrakans ; c’est un nouvel échec3.
De ces expériences il ne reste aujourd’hui que des ruines. Pourtant l’on persévère dans la volonté de faire de ce village un centre de recherche en matière d’élevage : le projet PASET (Projet d’Appui aux Systèmes d’Elevage Pastoral)4 qui démarre en 2004 envisage de réhabiliter la ferme d’Abougoudam5. D’autres « projets » visent à promouvoir le développement de cette sous-préfecture et des villages voisins : la coopération allemande y intervient depuis plus de dix ans, sous une forme qui sera étudiée plus loin.
L’impression que la majorité des projets financés au Tchad profite au nord sous-peuplé et aride6 ne résiste pas à l’analyse en ce qui concerne le secteur rural : sur 52 projets en cours en 2006 dans ce secteur, 14 seulement concernent exclusivement les régions dites du nord », lesquelles comprennent aussi le centre du pays. Aucun projet de gestion des ressources naturelles n’intervient dans cette zone. Seule l’agriculture y est favorisée : huit projets y sont en cours dans ce domaine, sur un total de 12.
|
Table des matières
PREMIERE PARTIE : PENURIES
Chapitre I : Vivre avec la faim
1. Une pénurie structurelle
A. De l’expérience de la faim aux alertes à la famine
B. Ce qui dit l’histoire : la récurrence des pénuries
2. La part des explications néo-malthusiennes
A. Surpopulation ou sous-peuplement ?
B. La mesure de la dégradation environnementale
C. Un système plus complexe
3. Vers un déterminisme de la violence ?
A. Interpréter les corrélations chronologiques
B. Une géographie de l’adaptation
C. La variable clé est sociopolitique
Chapitre II : La guerre du Darfour et l’aggravation des tensions
1. « Les réfugiés sont nos frères
A. La parenté ethnique
B. Au début, le partage
C. Les limites de la solidarité
2. Le désastre environnemental
A. Des réfugiés environnementaux ?
B. Sédentariser dans le désert
C. Mesures d’impact et tentatives de restauration
3. Nourrir les gens, nourrir les haines
A. Quand l’aide déstabilise la société
B. 5 % pour les populations locale
C. L’extension du conflit
Chapitre III : Sortir de l’insécurité alimentaire
1. L’humanitaire entre urgence et développement
A. Des commencements dans l’urgence
B. De l’irréalisme de certains « projets »
C. Les conditions d’un impact positif
2. L’utopie de la participation communautaire
A. Les concepts d’intervention de la coopération allemande
B. Une inégale participation
C. La stratégie HIMO
3. De la sécurité à la sécurité alimentaire
A. De l’intérêt des pénuries, ou les dessous de l’économie céréalière
B. Sécuriser l’économie
C. La demande d’Etat
Conclusion de la première partie
DEUXIEME PARTIE : ELOIGNEMENTS
Chapitre IV : Le « Far Est » tchadien
1. Marginalisation et recentrage
A. Les enclavements concentrique
B. Marges du territoire, marges du pouvoir
C. Des liens centrifuges
2. La frontière
A. Darfour, Ouaddaï : une histoire partagée.
B. Insoumission aux confins
C. Le prétexte de la « darfourisation »
3. Hors-les-lois
A. Exactions quotidienne
B. Gniguilim 1993 : les évènements et leur mémoir
C. Les malversations de l’Etat zaghawa
Chapitre V : Les carences de l’administration
1. Le règne du vide
A. Une sous-administration ancienne
B. La décentralisation en dépit du bon sens
C. Sédentariser l’Etat ?
2. La « kermesse du désordre » n’est pas terminée
A. La démoralisation de la fonction publique
B. Les hiérarchies parallèles
3. Le rôle ambigu des autorités traditionnelles.
A. Des intermédiaires ?
B. Un pouvoir sans moyens d’action
Chapitre VI : L’ « Etat hinterland »
1. L’arc des rébellions
A. L’immuable scénario
B. Les « pays amis » attisent le feu
C. Anatomie des affrontements
2. Quels enjeux ?
A. Le pouvoir
B. Quand le territoire devient un enjeu
C. La guerre construit-elle l’Etat ?
3. La dimension politique de la gestion du pétrole
A. « L’odeur du pétrole n’arrive pas jusqu’à l’est »
B. « Le peuple tchadien est maître de son pétrole » (I. Déby, 29/08/06)
Conclusion de la deuxième partie
TROISIEME PARTIE : AGRESSIONS
Chapitre VII : « Une rencontre sauvage » : le contact avec l’autre
A. Islamisation, arabisation
B. « Ils faisaient la guerre pour accumuler, et accumulaient pour faire la guerre
C. « Le passé glorieux des hommes debout »
2. Résistances à la colonisation française
A. La résistance militaire à la conquête.
B. 1917 : « summum de la confrontation »
C. Un « blocus psychologique collectif »
3. L’est au cœur d’une guerre de Trente ans
A. La rébellion commence à l’est.
B. « Chronique d’une déchirure ».
C. Des lendemains amers
Chapitre VIII : Les résistances culturelles
1. La confrontation Orient-Occident
A. Au-delà du contentieux linguistique
B. Un refus du développement ?
C. La tentation de l’irrationnel
2. Education : la double injonction
A. Un conflit de valeurs
B. Le double enseignement : réconciliation ou schizophrénie ?
3. La crise scolaire
A. Quand l’Education n’est pas « nationale »
B. Les présents et les absents
C. Violence à l’école, école de la violence
Chapitre IX : L’exigence de justice
1. La profondeur de la pauvreté
A. La calme désespérance des mères.
B. Accroissement de la richesse, accroissement des inégalités
C. Une gestion identique de la pénurie et de l’abondance.
2. Rompre avec la vengeance
A. Les identités meurtrières.
B. Faut-il « désethniciser » le Tchad ?
3. « Notre pays est un projet de pays ».
A. L’inachèvement de la démocratie.
B. Dans le creuset de la nation.
Conclusion de la troisième partie
Conclusion générale
Annexes
Bibliographie
Télécharger le rapport complet