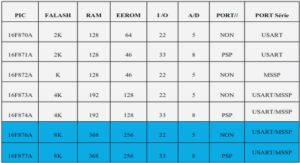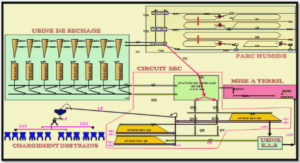Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
La conduite des entretiens : problèmes spécifiques liés aux types d’acteurs
Au-delà des aspects généraux que nous venons d’évoquer concernant la conduite et l’exploitation des entretiens, il en est d’autres q ui sont liés à certains types d’acteurs et qui méritent une analyse spécifique.
Tout d’abord, le cas des exploitants de ciné-club présentait plusieurs problèmes résultant à la fois du nombre d’établissements et de la nature des informations que nous souhaitions recueillir. La question du nombre posait d’entrée de jeu celle du choix des structures, de la taille de l’échantillon et de sa représentativitéNous. nous sommes appuyé sur la géographie urbaine en sélectionnant des établissements dans différents arrondissements, ce qui permettait de rendre compte d’une éventuelle diversité des situations, notamment liées aux dominantes ethniques de certains quartiers. Nous avons aussi fait le choix, sans doute contestable, de privilégier des ciné-clubs ayant une certaine importance en termes de jauge, donc fréquentés par un large public. Idéalement, nous aurions souhaité panacher davantage l’échantillon et y inclure de petites structures, mais cela ne pouvait se faire qu’aux dépens de la diversité géographique étant donné le temps dont nous disposions.
Avec ces gérants ou propriétaires de ciné-clubs, nous avons à dessein limité la souplesse de notre grille d’entretien car nous souhaitions constituer un corpus identique d’information pour tous les établissements. En recueillant ainsi individuellement les mêmes informations auprès des opérateurs eux-mêmes, nous pouvions croiser lesréponses, les recouper et construire ainsi un tableau global aussi fiable que le permettait la taille de l’échantillon. Dans la mesure où ces professionnels étaient les acteurs majeurs de notre étude, notre questionnement a été détaillé et cherchait, à travers les quelque 37 questions que nous leur avons posées, à atteindre plusieurs objectifs. Tout d’abord, nous voulions analyser ces établissements à la fois comme des entreprises culturelles du point de vue des investissements, du fonctionnement, des ressources humaines, mais nous cherchions aussi à m ettre à jour à travers les propos recueillis les maillons d’une filière d’approvisionnement, la circulation des supports, à repérer, en particulier, leurs logiques de programmation afin de mieux comprendre les caractéristiques de l’offre cinématographique proposée par ces établissements.
A travers quelques items portant sur la trajectoire personnelle de ces gestionnaires, nous avons cherché à répondre tout simplement à la question : comment devient-on gérant de ciné-club à N’Djaména, quelles sont les motivations, les projets, les ambitions de ces acteurs et quelle place occupe la dimension strictement culturelle dans leurs choix professionnels ? Cette préoccupation était visible dans notre dernière question : « A ton avis, quel rôle joues-tu dans la vie culturelle du pays ? »
Quelle validité peut-on accorder aux réponses que ousn avons obtenues ? Il faut garder en mémoire que le statut de chercheur est pratiquement inconnu de la plupart des membres de cette catégorie socio-professionnelle. Ce statut a donc dû être explicité, il a fallu lever toute ambiguïté concernant une possible identification comme agent du fisc ou d’un autre service administratif. La crainte d’une dénonciation restait présente et pouvait, selon le cas, peser sur la situation d’entretien. Par exemple, comment traiter le cas d’un commerçant ayant pignon sur rue mais exploitant par ailleurs un ciné-club clandestin dans la cour de sa concession le soir ?
Les entretiens se sont déroulés en général dans leslocaux mêmes où ces personnes exercent leur activité et tous ont accepté de nous répondreComme. il s’agissait pour l’essentiel de questions ne mettant pas en jeu des affects mais cherchant à établir des faits, les obstacles linguistiques étaient réduits, ce qui n’a pas étée lcas pour d’autres catégories d’acteurs. Ceci ne garantit évidemment pas l’absence de possibilité de distorsion dans les propos recueillis : des recettes ont pu être minorées par prudence, unecertaine fierté d’être choisi pour une étude universitaire a pu générer parfois des grossissements par lesquels le sujet exagérait son importance pour se mettre en valeur dans une stratégie de présentation de soi. Toutefois, les recoupements qu’autorisaient la multiplicité des questions et les comparaisons entre les entretiens nous font considérer les propos recueillis comme globalement fiables, sauf peut-être lorsque tous ces gestionnaires déclarent êtreen règle avec l’administration. Ces propos sont même d’une désarmante franchise lorsqu’il s’agit d’évoquer les sources piratées en matière de supports de diffusion. Dans d’autres contextes, nous aurions rencontré des stratégies d’évitement ou des silences. La franchise des propos est ici révélatrice d’un état d’esprit par rapport à la propriété intellectuelle. Pourquoi dissimuler ce qui est une pratique normale ?
Au plan méthodologique, le cas des responsables de centres religieux présentait de fortes analogies avec celui des ciné-clubs, tout simplement parce que notre questionnement était construit pour permettre une comparaison des deux types d’établissements. Toutefois, la dimension économique est ici estompée au profit desengagements idéologiques et religieux qui saturent le propos et font émerger en permanence un discours fondé sur le prosélytisme et l’auto-valorisation. Il ne nous semble pas que ce phénomène ait affecté la fiabilité des informations fournies ; il a été au contraire utilepour mettre au jour les logiques d’acteurs.
Pour ce qui concerne la dernière catégorie d’établissements que sont les centres culturels sous tutelle de l’Etat 11, nous avons été confrontés à une situation délicate en tant que chercheur. En effet, l’entretien avec le directeur de la structure a eu lieu après notre nomination par décret présidentiel à la tête de la division du cinéma auMinistère de la Culture. Il est clair que les réponses faites à nos questions étaient adressées àla fois au chercheur et au fonctionnaire du ministère, notamment pour tout ce qui concerne l’absence de moyens financiers et humains et le non versement de la dotation de fonctionnement. La réponse à la dernière question de l’entretien le montre à l’évidence ; elle porte sur le non versement de la subvention et c’est le cadre du ministère de tutelle qui est clairement interpellé.
Le cas des entretiens avec les spectateurs
C’est sans conteste sur ce terrain que le recueil d’information a été le plus délicat. Il n’existe à ce jour aucune étude concernant les pratiques culturelles des tchadiens, aucune recherche portant sur la sociologie des publics de la culture sur laquelle nous puissions nous appuyer. Il faut préciser d’emblée que notre démarche ne visaitaucunement à combler ce vide : les moyens dont nous disposions rendaient un tel objectif inenvisageable. La dimension quantitative inhérente à toute étude de sociologiedes publics nous a conduit à écarter cette direction de recherche. D’autre part, la question des liens entre les hiérarchies sociales et les hiérarchies culturelles se pose au Tchad en des termes spécifiques : quand bien même il le souhaiterait, il est difficile au chercheur de tenir compte des déterminismes sociaux dans une perspective bourdieusienne là où les études préalables sur les constituants majeurs de ces déterminismes font défaut. Ceci rend plus délicatel’exploration de la manière dont les goûts sont construits.
Plus modestement, nous avons donc cherché à poser quelques jalons à travers 20 entretiens dont les transcriptions portent les numéros 30 à 49 dans le volume d’annexes du présent travail. Ces entretiens sont d’une durée moyenne de 9 minutes avec une amplitude allant de 20 mn 37s à 2mn 57s 14. Discuter la représentativité de cet échantillonarp rapport aux publics des établissements diffusant des films à N’Djaména supposerait que nous soyons en mesure d’avoir une connaissance socio-démographique de ces publics. Ce n’est pas le cas. Il n’est donc pas utile de tenter une justification qui serait toute empirique. Nous pouvons juste faire état de quelques précautions méthodologiques destinées à pallier les plus grossières distorsions…ou à en prendre conscience. Ainsi nous avons conduit des entretiens à nombre égal dans les deux types d’établissements, mais sil’on considère la liste des professions déclarées par les sujets qui ont accepté le principe d’un entretien, il apparaît clairement que tous ont été scolarisés ; certains sont en cours d’études secondaires, d’autres diplômés. Or, comme le montre notre étude de ces établissements, toute empirique qu’elle est, une proportion non négligeable du public des ciné-clubsest soit analphabète soit a interrompu très tôt des études au niveau de l’enseignement primaire. Entamer des entretiens avec ce type de public posait des problèmes linguistiques d’une telle ampleur pour un résultat hélas prévisible que nous ne l’avons pas tenté. Ce travail aurait relevé d’une toute autre démarche impliquant d’autres modes de questionnement. Le cas du public féminin posait également un problème difficilement soluble pour deux raisons : d’une part la sous représentation des femmes parmi le public des ciné-clubs que nous évoquons dans notre analyse et d’autre part les codes de comportement liés à la société tchadienne qui ne permettent pas facilement à un homme de conduire un entretien avec une femme étrangère à safamille ou à son milieu. Et même si l’on a obtenu un accord de principe, cela ne présage en rien de la qualité de la relation de confiance ainsi établie comme en témoignent les deux entretiens avec des sujets féminins (n°34, n°42). La transcription de l’entretien n°34 (2mn 57s) en particulier montre clairement la nature des résistances qu’une telle situation peut faire naître. Il s’agit d’une élève de terminale dont l’entretien est d’un vide tellement manifeste qu’il signale un blocage de la relation enquêteur enquêté, blocage indépassablensdales circonstances de l’enquête. Il s’agit peut-être d’un cas limite, mais il illustre la difficulté de recueillir des informations, notamment celles qui portent sur les affects, auprès d’un public féminin si on est un homme. Les circonstances dans lesquelles se sont déroulésces entretiens méritent qu’on s’y arrête. Ils se sont étalés sur plusieurs mois et nous avons souhaité qu’ils se déroulent dans l’environnement même du site de projection. Pour cequi concerne les centres culturels nous n’avons rencontré aucune difficulté particulière mais, là encore, la spécificité des ciné-clubs a pesé sur la conduite des entretiens.
Nous avons pensé que la « salle » elle-même, lieu abituellementh dévolu à la projection des films, serait certainement peu propice aux entretiens. C’est pour cette raison que nous avons souhaité interroger les publics à leur sortie. Cette option a été difficile à tenir dans la mesure où les rues de N’Djaména restent souvent sombres la nuit faute d’éclairage public ou en raison de délestages fréquents. Cette situation n’est guère favorable à la conduite d’un bon entretien. De plus en raison de l’insécurité qui règne dans la ville à la tombée de la nuit, il est arrivé que le public refuse de s’attarder à la sortie de la projection pour répondre à nos questions. Il nous a fallu souvent prendre des rendez-vous pour le lendemain de la projection. Les lieux où se sont déroulés les entretiens ont des noms évocateurs : «Espace vert », Mandog », «Gastronomie » ; il s’agit de bistrots qui nous permettaient de déployer des stratégies de convivialité et de lever quelques réticences. Evidemment, cela ne donne pas les mêmes résultats qu’un entretien conduit à la sortied’un ciné-club lorsque le spectateur est sous le coup de l’émotion et des sentiments suscité par le film qu’il vient de regarder et ces circonstances particulières ont sans doute eu une influence sur les réponses fournies par nos interlocuteurs, mais une fois encore la rigueur méthodologique a dû céder le pas aux contraintes du terrain.
Nous avons rencontré d’autres contraintes, beaucoup plus pénalisantes par rapport au contenu même des entretiens et à la qualité des données qu’ils nous ont permis d’obtenir. Il faut ici en rendre compte sachant que notre objectif était double : recueillir des informations sur des pratiques et faire s’exprimer les sujets sur leurs attachements à des lieux, à des genres, à des œuvres 15. Pour ce qui concerne les pratiques, le caractère factuel et direct des questions offrait peu de marge à l’incertitude et surtout à l’incompréhensio n. Un nombre important d’items visait ici à interroger des aspects très divers : des questions de fidélité à un établissement, d’exclusivité de fréquentation, mais aussi de fréquence et d’horaire en poursuivant systématiquement par une question destinée à permettre au sujet d’expliciter ses choix puisque notre démarche restait résolument qualitative. Nous avons aussi cherché à explorer les phénomènes de sociabilité associés à la pratique cinématographique : venez-vous seul ou accompagné ? Par qui ? Nous voulions par là tenter de comprendre com ment se construisait ce « voir ensemble » qui est le fondement même de la pratique cinématographique et quelle part prenaient les autres dans cette construction. Du « voir ensemble », nous sommes passés au « parler ensemble » en cherchant à repérer les moments, les formes et les termes du partage, si tant est qu’il ait lieu, autour des œuvres filmiques. De quo i parle-t-on, quand, avec qui? A travers cette interrogation, nous voulions savoir, finalement si le film était un objet de discours, et si ce discours se fondait sur l’objet filmique lui-même ou sur son référent supposé, autrement dit sur la « réalité » dont il était censé rendre compte. C’est le rapport entre la perception du réel et celle de sa représentation que cette explorationtentait de mettre au clair.
Un certain nombre de questions avaient pour objectif de nous permettre de retracer le parcours des publics en amont de la sortie au cinéma qui avait fait l’objet de l’entretien.
Comment, grâce à qui avaient-ils découvert l’établissement qu’ils fréquentaient régulièrement ? Et en élargissant encore notre perspective, nous avons tenté de mettre en parallèle des pratiques plus individuelles liées aux œuvres filmiques comme le visionnement de films à la maison en format DVD ou VHS et la pra tique télévisuelle même si nous sortions là du cadre strict de notre étude qui portait sur des pratiques collectives. Notons sur ce point qu’en écartant de nos entretiens la frange la plus socialement démunie des publics des ciné- clubs nous avons sans doute sur-représenté ces pratiques qui impliquent la possession d’un matériel trop coûteux pour ces populations.
Un point important de notre questionnement visait à retracer la circulation des sujets interrogés entre les deux types d’établissements qui leur étaient offerts à savoir les centres culturels et les ciné-clubs dans la mesure où il s’agissait de deux contextes extrêmement différents et d’univers filmiques profondément dissemblables. La faiblesse de l’échantillon ne permet sans doute pas de conclure mais en interrogeant systématiquement chaque sujet rencontré dans un type de lieu donné sur ses pratiques liées à l’autre type de lieu, nous avons pu esquisser quelques pistes. Nous aurions souhaité aller plus loin et pouvoir replacer la pratique cinématographique dans le champ plus large des pratiques culturelles, mais c’était l’objet d’un autre travail. Au hasard de quelques r elances, nous avons pu recueillir quelques réponses à des questions qui, sous des formes différentes, reflétaient la même interrogation : que faites-vous de votre temps libre quand vous n’êtes pas au cinéma ?
État des lieux des années 1960 à 1980
L’histoire sociale du cinéma et de ses publics est inséparable de l’histoire de la construction, de la transformation, du déplacement ou de la disparition de ses salles. Au fur et à mesure des évolutions urbaines, « le cinéma » a su se faire une place dans la cité à côté des autres bât iments à l’architecture institutionnellement signifiante que sont les mairies, les hôtels de ville, les théâtres (parfois, les cinémas s’y sont logés), lesécoles, les bibliothèques, les stades, les salles « polyvalentes », ou aujourd’hui, les centres commerciaux à la périphérie des villes. En définissant et en tentant de comprendre comment s’invente la « scène cinématographique » dans la cité, on éclaire simultanément les questions relatives à la diffusion, aux différents modes de consommation des films, mais aussi à l’évolution, à la présence et à la métamorphose de ses publics. »(Ethis, 2005 : 29)
C’est à la lumière de cette citation que nous aimerions commencer notre étude sur la situation des salles de cinéma en Afrique noire francophone. En effet, jusqu’à une période relativement récente, la « scène cinématographique » se confondait avec la salle de cinéma. Une salle de cinéma, au sens strict du terme, est un lieu obscur dans lequel on peut projeter des films même s’il fait jour à l’extérieur. C’est un lieu clusivementex réservé à cet usage, où un public se rassemble pour regarder un film et partager un moment d’émotion, de plaisir. C’est aussi, originellement, une salle équipée d’un projecteur 53 mm où l’expérience spectatorielle spécifique au cinéma peut avoir lieu. Si nous ne nous placions pas dans un contexte africain, il serait inutile de rappeler de telles évidences. Lescritères de cette définition revêtent pourtant ici une importance particulière. En effet, l’obscurité d’une salle permet une temporalité des séances que n’autorise pas un local ouvert, lequel ne peut fonctionner que lorsque le soleil se couche et est soumis aux intempéries. Le caractèredédié d’une salle de cinéma, à la fois en raison de son architecture et de son équipement technique, correspond à toute une dimension économique spécifique de la filière cinématographique : nombre de copies diffusées, durée de location, exclusivité… et c’est à ce titre qu’en pa rlant de la salle du cinéma Normandie au Tchad, le cinéaste Mahamat Saleh Haroun dira : Pour ceux qui n’étaient pas là dans les années 75 où j’étais adolescent, il fallait voir le dimanche à 10 heures, les séances qu’on appelait les séances de matinée. […] C’est quelque chose de formidable. […] Au Normandie, c’était le matin, il fait jour dehors et soudain vous êtes dans le noir et vous n’avez plus la notion de temps. Quand vous sortez vous dites, tiens il fait jour. Et c’est cette
magie là que les gens ne connaissent pas … » 19
C’est de la disparition de ces lieux physiques dans leur ensemble dans tous les pays de la zone francophone de l’Afrique sub-saharienne – territoire qui offre la plus grande similitude avec le Tchad – que nous parlerons dans ce chapitre et on voit déjà qu’il s’agit de bien autre chose que de simples bâtiments. Comme nous le verrons plus lo in, il ne faut pas confondre la disparition de ces lieux emblématiques avec une disparition de tous les lieux de projection d’œuvres cinématographiques, mais avant d’évoquer ces lieuxd’un autre type qui ont pris la place des cinémas, il faut s’interroger sur les raisons qui ont fait que ces « salles obscures », en tant que mode d’exploitation, ont disparu. Pour étudier ce phénomène, nous avons choisi comme date de départ 1960 qui marque l’accès à l’indépendancede ces États, dans la mesure où la fermeture de certaines de ces salles était liée à des choix politiques ou économiques des nouveaux dirigeants de certains pays. Il ne sera donc pas question ici d’étudier la situation des salles de cinéma en Afrique pendant la période coloniale, même si nous ne pouvons faire abstraction de cet héritage.
Nationalisation des salles et difficultés d’exploitation
l’exemple de la Haute Volta, plusieurs autres Éta ts ayant accédé à l’indépendance ont procédé à la nationalisation de leurs salles longtemps gérées par la COMACICO et la SECMA. En Guinée, la nationalisation s’était opéréeimmédiatement après l’accession du pays à l’indépendance en 1958. Au Mali, elle a eu lieu en 1971. Suite à une pression exercée en vain sur les deux sociétés de l’époque pour qu’ell s modernisent les salles, le gouvernement malien décida de les fermer à la fin de l’année 1970 et de les confier à l’Office Cinématographique du Mali (OCINAM), créé en 1962. onS but premier était : « de produire des films, de les distribuer, de distribuer aussi les films étrangers, afin de les exploiter dans des salles à nationaliser ou à construire » (Bachy, 1982 b : 11). On pourrait ainsi dire que le projet du Mali de prendre en main les affaires cinématographiques du pays était élaboré bien avant la création de l’OCINAM et que la question dela modernisation des salles n’était qu’un simple prétexte pour donner corps à cette volonté politique.
Affaiblies par la nationalisation successive des salles dans les États de l’Afrique noire francophone, la SECMA et la COMACICO furent obligées en 1972 de passer la main à une nouvelle société, la Société de Participations Cinématographiques Africaines (SOPACIA). Gérée par l’Union Générale Cinématographique (UGC)devenue Union Africaine de Cinéma (UAC) en 1980, elle a commencé à travailler en 1973 avec les fonds restants de films laissés par la SECMA et la COMACICO à Dakar, Abidjan et Dou ala. Cependant, au Sénégal, le refus de remettre les salles de la SECMA et la COMACICO à la nouvelle société fut à l’origine des désaccords entre l’État sénégalais et la SOPACIA. Pour résoudre ce problème, une société d’économie mixte dénommée Société Nationale de Distribution et d’Exploitation Cinématographique (SIDEC) a été créée en 1974. L’État sénégalais disposait d’une plus grande part de responsabilité dans la gestion de cette société.
En 1974, le Bénin nationalisa à son tour ses salles, mais les difficultés rencontrées par la Haute Volta en approvisionnement de films restèrent valables pour tous les autres États. Afin de faire face à ces difficultés, la SONAVOCI voltaïque, l’OCINAM du Mali et l’Office Béninois Cinématographique (OBECI) s’associèrent pour former un groupement d’achat des films. C’était un début de consortium. En avril 1972, face à la volonté d’africaniser le cinéma, plusieurs États membres de l’Organisation Commune A fricaine et Malgache (OCAM) réunis deux organes entièrement africains : le Consortium Inter-africain de Distribution Cinématographique (CIDC) et le Consortium Inter-africain de Production de Films (CIPROFILM) dont le siège était à Ouagadougou en Haute Volta. Devant cette volonté des Etats africains, l’UAC accepta en 1980 de revendre son titre au CIDC à condition que la France reste un des fournisseurs privilégiés. Pourla première fois, un marché commun de distribution de films en Afrique était réellement ontrôléc par les Africains. Le CIDC avait pour rôle de contrôler et d’alimenter le marché de ces Etats en films tout en cherchant à introduire des films africains à la diffusion et de reverser une partie des bénéfices au CIPROFILM. À son tour, le CIPROFILM devait aider à la production des futurs films. Cependant, cette initiative a vite rencontré de nombreuses difficultés.
La difficulté majeure du consortium était d’ordre inancierf. La plupart des Etats membres n’avaient pas fait les réformes sur les taxes cinématographiques nécessaires pour l’harmonisation d’un tel marché commun. Ils n’avaient pas n’ont plus honoré leurs cotisations au CIDC. Selon le directeur général du CIDC à l’époque, Inoussa OUSSEINI, alors qu’il était prévu un capital social de 300 millions de francs CFA, le total des acomptes reçus n’était que de 135 millions de francs CFA, moins de la moitié du capital requis (Armando Soba, 1993 : 480). Un autre phénomène devait rapidement apparaitre : l’absence de billetterie, ici évoquée pour la première fois, est endémique en Afrique et,on le verra, il perdure encore dans les salles qui projettent des films sous quelque nom qu’on les désigne. Cette pratique prive de revenus l’État et les structures d’aide à la créati on cinématographique. Elle prive aussi – hélas – les chercheurs de données chiffrées concernant lafréquentation des salles.
Malgré cette fragilité, la crise qui éclata en 1983entre les Etats membres du CIDC n’était pas d’ordre financier, mais portait sur un problème relatif au maintien ou à l’abandon d’une structure d’approvisionnement en films basée à Paris, qualifiée par certains de néocolonialiste ». En attendant le dénouement decette crise, les activités du CIDC étaient bloquées et il ne pouvait plus acheter de nouveaux films. Le marché de cinéma africain était ainsi ouvert à d’autres opportunités. C’est ainsi que s’était infiltrée la société suisse SOCOFILMS, inondant le marché africain de films américains jusque-là tenus à l’écart par la souveraineté française et africaine. Les cinéastes africains ont manifesté leur opposition à travers la Fédération Panafricaine de Cinéastes africains (FEPACI), mais la crise au sein du CIDC s’est prolongée et un désordre s’est installésur le marché de distribution de films en Afrique noire. On était en 1984. La dévaluation dufranc CFA vint réduire le pouvoir d’achat des Africains et porta ainsi un autre coup fatal au marché cinématographique dans les pays concernés. L’appât du gain aidant, une multiplicitéde fournisseurs s’installa, procurant des films au coup par coup, augmentant le nombre de copies à la demande. Le cinéma commença alors à souffrir d’un manque de plus en plus évident de salles et de véritables réseaux de distribution. Certains distributeurs africains comme Écrans Noirs au Cameroun, Distrifilms en Côte d’Ivoire, ou Kora Films au Mali tentèrent tant bien que mal de trouver une solution à cette situation. Plusieurs d’entre eux s’associèrent pour conjuguer leurs efforts, parallèlement à la mise en réseau des salles par les exploitants, mais ces derniers durent aussi faire face à l’éclosion des salles informelles qui, avec la mise sur le marché des vidéo projecteurs, commencèrent à projeter des films en vidéo dans lesquartiers populaires et les zones rurales.
Si ce type de diffusion, dont nous étudierons plus loin l’importance et les caractéristiques sur le territoire tchadien, a permis de donner un nouveau souffle à la diffusion du cinéma en Afrique, il a dans le même temps nui aux circuits raditionnels d’exploitation et de diffusion cinématographiques. En effet, ce circuit informel ’approvisionne par le canal de la piraterie qui instaure un nouveau type de marché cinématographique parallèle en Afrique noire. Des exploitants de salles se transforment alors en importateurs non réglementés. Des structures de diffusion se créent sans tenir compte des normes etdu droit. On peut dire qu’à partir de 1990, le phénomène des vidéo-clubs explose. Les salles decinéma traditionnelles ne peuvent se maintenir face à cette prolifération. Des exploitants jettent l’éponge. Ils ne peuvent supporter les charges car la fréquentation des salles diminue. Et même si certains exploitants privés tentent encore de tenir le coup en maintenant la fréquentation à des niveaux honorables, ils croulent sous le poids des taxes. Ce constat d’un exploitant camerounais est à ce titre emblématique :
Le problème est que, la salle étant pleine, il y a trop de taxes : on s’est retrouvé avec presque 67 % de taxes sur un ticket d’entrée qui est de 1000 FCFA (1,50 euro). C’est énorme. Pour l’électricité,on paie 100 %. Alors que certaines industries permettent d’avoir des aides au niveau de l’énergie. Pour un mois, je me retrouve avec presque 2 millions d’électricité. Donc quand vous faites le plein de la salle, vous avez beaucoup d’argent mais après déduction des charges, vous vous retrouvez avec à peine de qu oi payer le personnel. On ne dégage vraiment aucun bénéfice. Les gens ne comprennent pas qu’on puisse faire salle pleine et ne pas avoir d’argent. Mais attention, il y a trop d’impôts, de charges directes. »26
Barlet (Olivier), Les multiplexes seront les bienvenus à Ouaga , entretien avec Rodrigue Kaboré, [en ligne] http://www.africultures.com/php/index.php?nav=article&no=5960, consulté le 17 octobre 2009.
Il faut signaler que l’électricité est souvent aléatoire dans de nombreux pays d’Afrique noire. Il est fréquent que des villes entières ne soient pas éclairées la nuit. Cela constitue un autre handicap pour les exploitants. Les salles de cinémaméritent alors doublement leur appellation de salles « obscures ». Malgré ce flux discontinu d’énergie électrique, les facturations sont souvent élevées, arbitraires et on peut les considérer comme opaques.
Plus généralement, en ce qui concerne les taxes, ilest clair que ces Etats africains se soucient peu de promouvoir le secteur culturel par le biais d’allègements fiscaux, alors qu’on pourrait espérer qu’ils utilisent cette incitation pour lui permettre de s’épanouir. On mesure ainsi à quel point cette carence de l’État et cette politiq ue fiscale peu cohérente constituent un lourd handicap pour les exploitants. C’est souvent la taxation abusive qui est à l’origine du développement du commerce parallèle, de la fraude,de l’économie informelle en général. Pour parvenir à réaliser un maigre profit, beaucoup d’exploitants essaient de contourner ces taxes et tombent dans cette économie informelle qu’ils sont les premiers à dénoncer.
Dans ce cas de figure, il est difficile de combattre cette pratique et ses conséquences néfastes. En effet, on comprend aisément que ce mode de fonctionnement est totalement incompatible avec celui des circuits de distribution du secteur cinématographique officiel où les contrats de distribution et de location des copies 35 mm, pour ne prendre que ces deux exemples, n’autorisent pas ce genre d’arrangements.
L’autre phénomène marquant susceptible d’expliquer le déclin des salles de cinéma traditionnelles en Afrique est l’avènement de l’antenne parabolique et aujourd’hui la vulgarisation des chaînes satellitaires. Ce phénomène a rapproché les téléspectateurs africains du marché mondial de l’image grâce à la diffusion d es séries télévisées très prisées par les Africains. En Afrique, de nos jours, les séries télévisées telles que « Ma Famille », « Les Superflics », « Commissariat de tant pis », « Série à Koulbi » sont présentes dans de nombreux ménages urbains équipés de récepteurs. Elles se vendent facilement en supports VCD et sont diffusées assez régulièrement sur les haînesc de télévision africaines comme la RTB, Canal 2, RTI, 2STV, ou sur certaines chaînes françaises en direction de l’Afrique telles que TV5 Afrique et CFI27. Face à une telle offre de programmes des chaînes, les salles de cinéma ne pouvaient guère lutter. Il peut paraître surprenant à un lecteur occidental d’amalgamer, dans un propos sur le cinéma, ces séries télévisées et des œuvres filmiques au sens traditionnel du terme, comme si ces deux types de création étaient mis sur le même plan. Or, nous verrons plus loin au cours des entretiens menés avec des spectateurs africains sur leurs pratiques cinématographiques que cette distinction, majeure pour nous, est pour eux largement sans objet. Il s’agit dans ces deux cas d’une « histoire racontée en images ». Il y a donc bien concurrence et à l’avantage manifeste des séries télévisées. En somme, la désertion des salles de cinéma en Afrique noire par les spectateurs ne saurait se justifier uniquement par la cherté de la vie et le prix des places incompatible avec les revenus de la grande partie des Africains. Les causes sont diverses et complexes : taxes élevées, vulgarisation des chaînes satellitaires, manque de compétitivité, marché croissant des ciné/vidéo-clubs et des films piratés grâce à l’arrivée du DVD et du vidéo-projecteur. C’est cette conjonction de phénomènes qui a conduit à l’agonie des salles traditionnelles.
Initiatives nouvelles et projets de réhabilitation
Après plusieurs années de fermeture et suite au désir du public, sans doute, mais surtout des créateurs d’accéder à une image cinématographique éritable,v des projets et des initiatives de réhabilitation de salles et des formes alternatives de projection ont vu le jour en Afrique. Cependant, il faut noter que tous ces projets et initiatives ont des natures et des statuts différents. Pendant que certains cherchent à récupérer et à réhabiliter simplement des locaux en vue d’organiser des projections en vidéo, d’autres, grâce à des moyens importants, entreprennent des travaux de remise en état et d’équipement des salles en matériel de projection 35 mm, voire en numérique. Parmi ces initiatives, nous évoquerons celles du Burkina, du Gabon et du Cameroun, mais surtout, compte tenu de son ampleur et de sa médiatisation, celle « Des Cinémas pour l’Afrique» portée par le cinéaste Abderrahmane Sissoko. Bien avant cela, quelques projets alternatifs ont vu le jour à travers des structures de ciné clubs suite à l’arrivée sur le marché des appareils DVD, pour combler le vide laissé par la fermeture des salles de cinéma traditionnelles. Avant d’aborder, dans la partie réservée à la pratique du cinéma au Tchad, l’étude détaillée deesc structures alternatives que sont les ciné-clubs, il faut parler d’un type de cinéma expérimenté en Afrique de l’Ouest : le cinéma ambulant et étudier quelques initiatives et projetsde réhabilitation de salles de cinéma dans les autres Etats africains.
|
Table des matières
Chapitre 1 : L’objet et la méthode
1.1 La carence de données quantitatives
1.2 La conduite des entretiens : problèmes généraux
1.3 La conduite des entretiens : problèmes spécifiques liés aux types d’acteurs
1.4 Le cas des entretiens avec les spectateurs
1.5 De l’usage modéré du questionnaire
1.6 L’observation des pratiques et des comportements
Chapitre 2 : La mort lente des salles obscures : un phénomène endémique en Afrique noire
2.1 Etat des lieux des années 1960 à 1980
2.1.1 Nombre de salles
2.1.2 Distribution et exploitation
2.1.3 Programmation
2.1.4 Les prix d’entrée
2.1.5 Nationalisation des salles et difficultés d’exploitation
2.1.6 Fermeture et destinée des salles en Afrique noire
2.2 Initiatives nouvelles et projets de réhabilitation
2.2.1 Initiatives nouvelles : le cinéma autrement
2.2.2 Projets de réhabilitation
Chapitre 3 : La Spécificité tchadienne : 1960 – 1979
3.1 Abéché
3.2 Fort-Archambault (Sarh)
3.3 Moundou
3.4 Fort-Lamy (N’Djaména)
3.4.1 La ville européenne
3.4.2 La ville africaine
3.5 La guerre civile de 1979 et la fermeture des salles de cinéma
3.6 Le devenir des salles de cinéma au Tchad
3.7 Le cas du Normandie
3.7.1 Projet de réhabilitation
3.7.2 Inauguration officielle de la salle
3.7.3 Réouverture de la salle : source d’interrogations
3.7.4 Des mesures prévisionnelles
3.7.5 Politique de programmation
3.7.6 Fonctionnement de la salle
3.7.7 Rentabilité de la salle
Chapitre 4 : Les maisons de la culture : des salles de cinéma par substitution
4.1 L’Institut Français du Tchad : origine, statut et missions
4.1.1 Politique de programmation et place du cinéma à l’IFT
4.1.2 L’IFT : lieu de culture populaire ou élitiste ?
4.2 Les centres culturels religieux
4.2.1 La mission éducative
4.2.2 La place du cinéma
4.2.3 La programmation des films
4.2.4 Le SAVE
4.2.5 Thèmes abordés par les films diffusés
4.3 Le réseau de l’Etat : La Maison de la Culture Baba Moustapha
4.3.1 Origine, statut et missions
4.3.2 Programmation des activités culturelles : la place du cinéma
4.3.3 Le réseau des provinces
4.3.4 La place effective du cinéma dans ce qu’il reste du réseau
Chapitre 5 : La télévision, vecteur d’une culture cinématographique au Tchad ?
5.1 Télé Tchad
5.1.1 Equipements
5.1.2 Accès à Télé Tchad
5.1.3 Montée de Télé Tchad sur satellite
5.1.4 Télé Tchad : une programmation nationale
5.2 Canal Horizons
5.3 Quelques hypothèses sur des pratiques domestiques
Chapitre 6 : Vidéo-clubs et ciné-clubs : nouvelles formes de salles de cinéma au Tchad
6.1 Un certain regard sur un certain cinéma : « Lieux Saints »
6.2 Les mots et les choses
6.2.1 Vidéo-club
6.2.2 Ciné-club
6.3 Typologie des structures et évolution des technologies
6.4 Les ciné-clubs comme opérateurs économiques
6.4.1 Investissement initial : équipement, local et matériel
6.4.2 Frais de fonctionnement : local, personnel et achat de films
6.4.3 Ciné-clubs comme illustration du secteur informel au Tchad
6.4.4 Recettes : entrées, billetterie
6.5 Statut juridique des ciné-clubs
6.5.1 Autorisation d’exploitation et paiement de redevance à l’État
6.5.2 Procédures de contrôle selon les régimes
6.5.3 Opérations commando des agents de l’État
6.5.4 Impuissance des pouvoirs publics
6.6 Implantation géographique et nombre, symbolique des noms
6.6.1 Implantation géographique
6.6.2 Importance du phénomène : absence de maîtrise du nombre
6.6.3 Sens et symbolique des noms
6.7 Le métier d’exploitant de ciné-club
6.7.1 Parcours professionnel
6.7.2 Ambitions
6.8 Programmation et diffusion des films dans les ciné-clubs
6.8.1 Les tableaux d’affichage
6.8.2 Programmation : un abus de langage
6.8.3 Le 17 juillet 2009
6.9 Sources d’approvisionnement des ciné-clubs au Tchad
6.9.1 Circuits d’achat et prix du marché
6.9.2 Problème des sources piratées
6.9.3 Circuits de distribution embryonnaires
6.10 Construction de l’image des ciné-clubs
6.10.1 Les points de vue de la société
6.10.2 Le point de vue de l’État
6.10.3 Le point de vue des exploitants
6.10.4 Le regard des « professionnels de la profession »
Chapitre 7 : Construction d’une culture cinématographique au Tchad 284
7.1 Observation directe des pratiques sur les lieux
7.1.1 Avant la projection
7.1.2 Pendant la projection
7.1.3 Après la projection
7.2 Déterminants socioculturels des publics de cinéma au Tchad
7.2.1 Choix et arbitrages
7.2.2 Les sources d’information des spectateurs
7.2.3 La décision de sortie
7.3 Les implications de l’acte « d’aller au cinéma »
7.3.1 En termes d’effort
7.3.2 En termes de coût
7.3.3 En termes de rupture avec le quotidien et le milieu familial
7.4 Facteurs de sélection
7.4.1 La proximité
7.4.2 La qualité de diffusion
7.5 Modes et habitudes de fréquentation
7.5.1 Choix de l’horaire de projection
7.5.2 Haute fréquence et haute fidélité
7.6 La question du genre
7.7 L’attitude du public face à « son » cinéma
7.8 Une expérience spectatorielle spécifique
Conclusion
Bibliographie
Télécharger le rapport complet