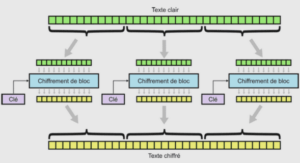La gestion du risque des catastrophes naturelles
De la prevention a la gestion des risques ?: une mise en place progressive
Les catastrophes naturelles defnies comme des evenements subis ≪ qui causent un bouleversement, pouvant entrainer des destructions, des morts, des desastres ≫1 , sont des phenomenes qui afectent la societe frequemment. La problematique centrale du sujet se concentre sur la maniere dont, d’une part, l’on peut se premunir de tels evenements et, d’autre part, sur la facon de luter contre l’eventualite d’une catastrophe. Jusqu’au XVIIIeme siecle, l’ensemble des desastres etait atribue a la colere divine. C’est la raison pour laquelle les societes anterieures n’ont pas cherche a reduire ces episodes catastrophiques, les chatiments divins etant vecus comme une punition contre laquelle les hommes n’ont aucun moyen de luter. Toutefois, un element declencheur entraine une refexion sur le sujet2, il s’agit du tremblement de terre de Lisbonne en 1755. A partir de cete date, les bouleversements d’ordre naturel ne sont plus uniquement justife par une colere divine. Les notions de catastrophes naturelles, de risque, de prevention, commencent a se dessiner, et ce, notamment grace aux travaux de Rousseau qui est vu comme le precurseur de notre concept actuel de catastrophes naturelles.3
Ces notions se sont par la suite afrmees notamment dans les annees 1970, notamment a travers la couverture mediatique, qui a rendu le risque plus omnipresent4, impliquant des tentatives de securisation accrues. Le XXeme siecle est egalement le siecle ou de nombreuses evolutions voient le jour, la mondialisation accelerant la difusion des innovations. Cete derniere a fait croitre indirectement le nombre de catastrophes ou, tout du moins, l’importance et l’ampleur du risque auquel sont confrontes les habitants des territoires concernes.
En outre, il s’est developpe durant ces dernieres decennies une forte litoralisation qui ne cesse d’aggraver la proximite des populations avec les zones inondables Tout ces elements ont fait qu’actuellement les sinistres sont a la fois plus nombreux et plus devastateurs. La multiplication des phenomenes naturels a permis le developpement d’une refexion collective plus importante autour de la prevention. Grace aux etudes de nombreux professionnels comme des historiens ou encore des scientifques (exemple ?: hydrologues), il est actuellement possible de retracer une histoire des catastrophes naturelles 5. Celleci permet de mieux comprendre comment et ou se deroulent les sinistres, par consequent la prevention en est amelioree, la connaissance et l’experience etant les clefs pour une meilleure securite et protection. On peut par ce biais garantir un monde plus sur aux generations futures. La prevention des catastrophes naturelles est devenue un element acquis et essentiel dans la recherche de la reduction des risques et pour l’accroissement du sentiment de securite. Cependant, la mise en place de programmes de preservation se revele considerablement complexe. En efet, malgre le fait que la securite face aux sinistres est actuellement au coeur des atentes des societes, il est difcile de prevoir un programme de prevention. La difculte principale pour elaborer un tel programme reside dans les politiques gouvernementales mises en place. En efet, l’integration des risques et de la prevention dans ces politiques est vue comme essentielle des les annees 1990. A cete periode, l’Organisation des Nations Unies (ONU) adopte la « Strategie internationale pour la prevention des catastrophes » en 19996.
Toutefois, malgre ces decisions, la mise en place de programme englobant les menaces ainsi que la facon de les reduire reste un sujet problematique. L’idee est de favoriser les partenariats pour elaborer une ≪ culture de resilience ≫7. Une autre raison, qui explique la difculte a metre en place des politiques publiques reside dans une certaine amnesie8. En efet, comme pour de nombreux evenements, les catastrophes naturelles ne sont presentes dans nos memoires que pendant un temps limite, ce qui se revele etre un obstacle a une bonne preparation. Afn de faciliter une meilleure anticipation, il y a des outils comme le Portail de la prevention des risques9. Ce site est ne de travaux collaboratifs entre diferents partenaires ?: Institut Francais des Formateurs Risques Majeurs et protection de l’Environnement (IFFO-RME), le ministere de l’ecologie, du developpement durable et de l’energie, le Haut Comite Francais pour la Defense Civile (HCFDC), ce qui donne de nombreuses informations afn de connaitre les risques qu’encourt tel ou tel departement, ou commune. Cete plate-forme met a disposition, entre autres, des cartes de risques et des textes fondateurs. On peut alors connaitre l’eventuelle vulnerabilite des territoires et organiser une meilleure gestion, notamment pour hierarchiser les espaces les plus a risque qu’il faudra potentiellement securiser ou evacuer en premier.
Un patrimoine en danger
Le fait est que lorsque l’on s’interesse au sujet des catastrophes naturelles, ou meme lorsque celles-ci se produisent, le patrimoine passe au second plan car l’aide aux victimes est toujours la premiere des priorites dans ces circonstances. On constate donc que le patrimoine n’est pas pris en compte dans les diverses etudes entreprises, cependant les biens culturels sont de plus en plus touches par les catastrophes30. Il est interessant de preciser qu’un atrait pour le patrimoine est apparu relativement tot et se concretise une premiere fois dans la convention de La Haye en 1954 qui s’interesse a la sauvegarde du patrimoine en cas de confits armes. Cete derniere n’est pas unique. La Convention pour le patrimoine de 1972 developpe egalement cete idee et introduit l’importance de la transmission aux generations futures, ainsi que la notion de la protection de la nature et de la preservation des biens culturels.
La Convention pour le patrimoine a ete reprise en 2003 et 2007, avec toujours ces aspects de sauvegarde du patrimoine mondial, de difusion et transmission. Il s’agit de preserver la ≪ valeur universelle exceptionnelle ≫31 de ce patrimoine vu comme une ≪ ferte nationale ≫32. Parallelement, se developpe un interet de protection face aux elements exterieurs. Des 1987, un colloque du Conseil de l’Europe ≪ La protection du patrimoine architectural contre les desastres naturels en Europe ≫ prend en compte ces idees. On a constate auparavant qu’il existe un probleme memoriel concernant les catastrophes naturelles. Il en est de meme concernant le patrimoine. Lorsque la catastrophe survient, l’opinion publique est tres sensible a la protection du patrimoine mais cet interet est ephemere. Les efets qu’ont les catastrophes sur le patrimoine s’estompent facilement des memoires. Hormis quelques exemples frappants tels que le tremblement de terre de Bam en Iran le 26 decembre 2003 qui, en plus de toutes les autres devastations ou pertes, detruisit la grande citadelle de Bam vieille de 2700 ans.
Ou encore le seisme et tsunami en 2004 a Galle au Sri Lanka qui causa aussi de nombreuses pertes au niveau du patrimoine. En 2005, a la conference mondiale sur la prevention des catastrophes, les Nations Unies elaborent une strategie intitulee ≪ la strategie internationale de prevention des catastrophes naturelles des Nations Unies ≫33 dans laquelle se trouvent des documents plaidants pour la cause de la protection du patrimoine culturel. Malheureusement, rares sont les institutions patrimoniales qui prevoient une strategie ayant pour but de limiter les risques malgre l’ineluctabilite de certains desastres. C’est le cas du changement climatique qui aura sur le long terme de lourds impacts sur le patrimoine naturel. L’ensemble du patrimoine peut etre touche. Afn de repondre au besoin de se premunir, des guides sur la gestion des risques pour le patrimoine mondial sont publies afn de ≪ renforcer les capacites et a faire mieux connaitre la Convention du patrimoine mondial ≫.34
Les manuels correspondants resultent de la collaboration du Centre international d’etudes pour la conservation et la restauration des biens culturels (ICCROM), du Centre du patrimoine mondial, du Conseil international des monuments et sites (ICOMOS) et de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Leur but est de faire prendre conscience au maximum des dangers qu’encourt le patrimoine. Pour le patrimoine documentaire, les deux sinistres principaux sont le feu et l’eau, dans la mesure ou ce sont ceux qui ont le plus d’efets, quel que soit le support materiel utilise.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : UNE POLITIQUE DE SAUVEGARDE POUR LES BIENS CULTURELS
1.La gestion du risque des catastrophes naturelles
1.1. De la prevention a la gestion des risques : une mise en place progressive
1.2. Qels risques E
1.3. Un patrimoine en danger
2.La conservation preventive
2.1. Une pratique en evolution
2.2. Les batiments d’archives
2.3. De la conservation preventive a la conservation curative
3.La confrontation aux sinistres
3.1. Manque d’anticipation : le probleme des plans de sauvegarde et d’urgence
3.2. Des preconisations theoriques et techniques
3.3 . Une sensibilisation des archivistes E
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Archivistique generale
La conservation preventive
Plans de prevention, plan d’urgence
ETAT DES SOURCES
Sources legales et reglementaires
Sources imprimees
Sources manuscrites et dactylographiees
Sources orales
DEUXIEME PARTIE : LES SERVICES D’ARCHIVES FACE AUX CATASTROPHES NATURELLES :LES ARCHIVES DE CHARENTE MARITIME, DE MEURTHE-ET-MOSELLE ET DU VAR
1.Un etat des lieux
1.1. Une reglementation en evolution
1.2. L’absence de plan de sauvegarde et d’urgence
2.La reaction face aux degats : de la theorie a la pratique
2.1. Les interventions : necessite d’adaptation
2.2. Le traitement des documents
2.3. Les ravages dans les batiments et sur les equipements
3.L’apres inondations : entre difcultes et posterite
3.1. La complexite de la reprise d’activite
3.2. La memoire des sinistres
3.3. L’accroissement de la sensibilisation sur la gestion des catastrophes naturelles
CONCLUSION
CONCLUSION GENERALE
ANNEXES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
INDEX DES TABLEAUX
TABLE DES ANNEXES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet