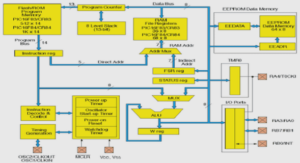Savoirs et transposition
Les enseignements professionnels sont différents des enseignements généraux puisqu’ils se destinent à l’acquisition de praxéologies et savoirs professionnels. Leur lieu d’enseignement est particulier également ; bien que l’école en soit toujours un lieu privilégié, des structures sont créées afin d’y diffuser ce type de praxéologies. Mais où sont décidés le choix de ces praxéologies et savoirs et par qui ou encore « comment “faire passer” dans un autre “ton institutionnel” sans “altérer” ? ou du moins, sans trop altérer, en contrôlant les altérations nécessairement imprimées. » (Chevallard, 1997). La question se pose d’autant dès lors qu’il s’agit de formation professionnelle. Dans la théorie de la transposition didactique Chevallard (1991) propose de repérer comme savoir de référence ce qu’il appelle « le savoir de ceux qui savent », autrement dit « le savoir savant ». Mais l’histoire des théories en didactique révèle que la notion de savoir savant ne va pas de soi en milieu professionnel, et que même la notion de savoir questionne dès lors qu’on tente de le repérer dans les gestes professionnels. C’est ainsi qu’avec le développement de la théorie anthropologique du didactique Chevallard introduit la notion de praxéologie. Le terme « savoir savant » est également abandonné par certains chercheurs en didactique au profit par exemple de celui de « savoir en acte » (Rogalski & Samurçay, 1994) ou encore de « savoir expert » (Johsua, 1997). Sans chercher ici à rentrer dans le débat touchant la recherche de notions utiles à nommer l’activité humaine en milieu professionnel (et ailleurs), retenons pour commencer que l’enseignement professionnel se définit par sa finalité socio-économique donc au regard de la société. Il vit nécessairement sous une contrainte temporelle puisque les besoins de la société bougent, évoluent. Nous rejoignons là l’idée développée dans la théorie de la transposition didactique et notamment reprise par Johsua dans l’étude qu’il fait des savoirs experts, qui explique qu’un savoir est considéré comme une référence par une société donnée, à un moment de son histoire. Autrement dit, ce sont les institutions qui décident qu’un savoir sera ou non une référence effective, selon des critères sociologiques. Nous nous rapprochons du « ton institutionnel » mentionné plus haut et surtout de la théorie de la transposition institutionnelle et didactique, nécessaire à assurer ce que Chevallard appelle « la vie des savoirs » qui doivent vivre loin de leur lieu de fabrication dès lors qu’ils doivent être enseignés ou encore utilisés dans telle ou telle institution (citons les mathématiques utilisées dans de nombreuses institutions). Martinand (1986) avait lui introduit la notion de pratique sociale de référence, à propos des savoirs de référence nécessaire à l’enseignement des sciences et de la technologie à l’école. Notons que pour les formations professionnelles la référence à « ceux qui savent », ou encore aux « pratiques sociales de référence » est essentielle car elle nous amène directement sur le lieu du travail, là où opèrent ceux qui savent le métier, indissociable de leur environnement professionnel. L’adjectif « savant » entraine nécessairement une interrogation à propos du « savoir à enseigner », particulièrement dans le cadre des formations professionnelles. Cette remarque nous renvoie directement à la noosphère, lieu où l’on pense et désigne, au sein du savoir savant, donc du savoir de ceux qui savent, ce qui est à enseigner. Cette notion, proposée par Chevallard (1991) qu’il qualifie lui-même de parodique, ne désigne pas une assemblée définie, mais une instance, dont la composition, l’importance et la reconnaissance varient d’une institution à l’autre, ayant un rôle de légitimation sociale, à la périphérie du système d’enseignement. La tâche de la noosphère consiste alors à désigner les savoirs à enseigner et leur renouvellement pour que le système didactique continue de fonctionner en lien avec les évolutions dans la société. Chevallard explique que le phénomène de vieillissement du savoir constitue le moteur du phénomène transpositif. Le savoir enseigné n’est alors plus regardé comme une simplification du savoir savant. En réalité, il est question « d’écologie » didactique des savoirs, concept introduit par Chevallard (1994) qui interroge les raisons et les conditions et contraintes de la présence de tels savoirs en tels lieux. Dans ce travail il est question de transposition didactique et de transposition institutionnelle dans la mesure où, particulièrement dans le cas des environnements carcéraux la première est fortement déterminée par la seconde. Ceci nous invite à préciser le sens donné en TAD à la notion d’institution, qui a une portée très large devant nous aider dans l’analyse et la compréhension du fonctionnement et des configurations complexes d’institutions dans le système pénitencier français.
Des citoyens et des prisonniers
Déjà en 1791, Talleyrand, dans son « rapport sur l’instruction publique » 3 pose cinq principes fondamentaux comme base de l’instruction visant à la rendre accessible à tous, sans distinction de fortune. Dans la même mouvance révolutionnaire, Condorcet, en 1792, dans son rapport sur l’organisation générale de l’Instruction publique, énonce ce qui peut être considéré comme une première ébauche de définition de la formation des adultes : Nous avons observé que l’instruction ne devait pas abandonner les individus au moment où ils sortent de l’école, qu’elle devait embrasser tous les âges ; et qu’il n’y en avait aucun où il ne fut plus utile et possible d’apprendre, et que cette seconde instruction est d’autant plus nécessaire, que celle de l’enfance a été resserrée dans des bornes plus étroites. Préserver la dignité humaine et instruire le peuple sont les pierres angulaires de cette nouvelle société. En cette époque de révolution, l’éducation du peuple ne s’énonce plus comme un vœu, mais comme un projet sociétal. C’est par ailleurs depuis les inspirations révolutionnaires que se sont vu exister le conservatoire national des arts et métiers, sous l’impulsion de l’abbé Henri Grégoire en 1794, et l’école centrale des travaux publics née la même année et rebaptisée un an plus tard « école polytechnique ». Il faut attendre le XIXe siècle, où nait le suffrage universel et construit la société industrielle, pour que ce projet se précise tant en termes de fondements idéologiques qu’en termes de pratiques. C’est en effet après la révolution de 1830 que se développent les initiatives tendant à favoriser l’éducation du peuple. L’industrialisation, les évolutions politiques avec le suffrage universel pour les hommes, les colonisations, appellent un progrès de l’instruction. Cette éducation se produit sous l’effet de conjonctures politiques et économiques et, par conséquent, est portée par des groupes sociaux divers. Les cours du ministère de l’instruction publique représentent le volet le plus important. Promulguée par la Loi Guizot, l’éducation des adultes se dispense dans les écoles, qui doivent posséder un cours d’adultes. Les ambitions sont claires : il s’agit de résorber l’illettrisme et l’éducation des adultes doit en tous points se caler sur les contenus de l’instruction élémentaire. Cependant, il est alors plus question de l’éducation du peuple, en général, les adultes ne constituant pas une catégorie clairement définie. Pour illustration, la loi du 22 février 1851 élaborée par l’Assemblée nationale de la Deuxième République crée le contrat d’apprentissage et fixe la durée de travail pour les apprentis de 12 à 14 ans et ceux de 14 à 16 ans. Il s’avère que le public est constitué de jeunes adultes, la tranche d’âge étant les 13-20 ans. Parallèlement à l’initiative étatique, des groupes divers organisent l’éducation du peuple sous le nom d’éducation populaire. Ces groupes se multiplient, sous l’influence d’une rivalité entre mouvements confessionnels et mouvements laïques. Même si le mouvement s’essouffle au début du XXe siècle, témoin de la difficile rencontre entre les intellectuels et le peuple par l’éducation, il n’en reste pas moins que combattre l’ignorance du peuple afin de ne pas mettre en péril les institutions républicaines (Carré & Caspar, 2007)– référence sera faite à l’affaire Dreyfus et ses dérives antisémites – témoigne du plein essor de l’éducation des adultes alors que l’instruction du condamné peine à s’installer dans le milieu carcéral. Même si dans les textes, on trouve des références à la prison depuis l’Antiquité, la plupart des historiens ne s’intéressent à son fonctionnement que depuis 1789. Il faut dire que pendant toute la période du droit monarchique, l’emprisonnement n’est pas une peine, mais un moment d’attente du jugement ou du châtiment. La période couvrant l’après-révolution jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale (1789-1944) voit naitre la conception moderne des prisons : la privation de liberté est reconnue comme peine à part entière. Comme l’indique un récent rapport : En 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen a posé les bases juridiques qui, aujourd’hui encore, fondent le système répressif français. Elle a affirmé la règle de la présomption d’innocence et le principe selon lequel la loi n’établit que des peines strictement et évidemment nécessaires. L’adoption en 1791 du premier Code pénal place en effet l’enfermement au centre du dispositif judiciaire, « les châtiments devaient corriger ou éliminer les coupables et dissuader ceux qui seraient tentés de les imiter. » (Rostaing, 1997, p. 32). « Les hommes de la Constituante » suppriment les châtiments corporels comme le marquage au fer rouge, le pilori ou le fouet, châtiments qui souvent précédaient la mort. D’ailleurs, c’est par la description du supplice de Robert François Damiens en 1757 que commence l’ouvrage Surveiller et punir (Foucault, 1993). La loi du Talion ne pouvant plus exister dans une société en pleine évolution, les penseurs des Lumières remettent en question l’expiation du mal par le mal : la société bascule vers une expiation de la faute par l’âme, la prison représente un châtiment de l’âme. Il est bien question du niveau de la société puisque c’est à travers les cahiers de doléances pour les états généraux de 1789 que le peuple demande l’adoucissement du système pénal. La Déclaration des droits de l’homme le stipule dans l’article 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », abrogeant toute souffrance physique si cette dernière n’est pas utile à la société. L’Article 2 du Code criminel révolutionnaire de 1791 entérine la suppression de la torture : « la peine de mort consistera dans la simple privation de la vie, sans qu’il puisse être jamais exercé aucune torture envers les condamnés ». « Tout condamné aura la tête tranchée » (Art. 3). En cette période révolutionnaire, la liberté est désignée comme le bien le plus précieux dont un individu sera privé s’il viole le contrat social. La prison, comme dit précédemment, devient le pivot de la sanction pénale. Il faut donc de nouveaux lieux d’enfermement et les autorités locales, dans un souci de moindres frais, se tournent vers des locaux existants : couvents, abbayes, châteaux, hôpitaux. Cependant, prévenus en condamnés partagent ces mêmes locaux et très rapidement, l’insalubrité, la promiscuité dont découlent de mauvaises conditions de vie s’installent si bien que certains détenus préfèrent les travaux forcés au sein des bagnes à l’emprisonnement (Petit, Faugeron, & Pierre, 2002). L’on assiste alors à la naissance des maisons centrales qui se différencient des maisons d’arrêt : les condamnés se séparent des prévenus. Centrales parce que sous la responsabilité de l’administration centrale du ministère de l’Intérieur, parce que financées par l’état central et enfin parce que placées au centre d’une circonscription à l’origine militaire (Febrer, 2009). C’est ainsi que « Les maisons centrales furent pendant longtemps de grandes manufactures textiles, avec des femmes à la filature, des hommes au tissage et des enfants qui rattachaient les fils » (Carlier, 2009, p. 9). Les entrepreneurs trouvent une maind’œuvre bon marché, surveillée gratuitement par les « gardiens », mais des abus vont rapidement voir le jour. L’archi- domination de l’entreprise traduit au quotidien l’impossibilité de mettre en œuvre une politique pénitentiaire cohérente, en accord avec les orientations réformatrices constamment affichées depuis 1791. Comme le souligne Foucault (1993), l’amendement du détenu ne passe pas seulement par le travail, bien que ce dernier en soit un moyen. L’instruction est indissociable de la préparation d’un délinquant à reprendre sa place dans la société. Mais comme l’évalue Perrot (1980), l’offre d’enseignement est alors de trois heures par semaine, l’école étant facultative et prise sur le temps de travail salarié du prisonnier. Malgré les bonnes intentions et les idées nouvelles tendant à rendre le détenu meilleur non seulement par la lecture et le calcul, mais aussi par des enseignements d’ordre moral, les soucis d’intimidation et d’expiation l’emportent sur l’amendement. Ainsi, la Révolution, la République, l’Empire, périodes sous lesquelles la sanction pénale fut rénovée, n’ont pas imposé l’idée de rachat qui reste étrangère à l’idéal laïc et la prison reste un lieu de punition.
La prison repensée vers l’instruction du prisonnier
C’est sous la Restauration que commence un grand projet de rénovation des prisons en même temps que l’amendement du prisonnier redevient l’objectif essentiel de la prison. Le travail, l’éducation religieuse et la morale en sont les pivots. Dés 1815, on trouve des écoles élémentaires dans les prisons. Cependant, elles ne sont pas confiées à des instituteurs, mais, rappelant que les philanthropes ont été l’un des rouages essentiels des prisons sous l’Ancien Régime, à des philosophes tels Benjamin Appert, mais aussi quelques aristocrates qui se réclament de la monarchie et du christianisme. Bénévoles, ils détestent les prisons et s’inscrivent dans une mission de charité des prisonniers. Autour de 1830, les philanthropes engagent « un processus d’hygiénisation des prisons et [s’inscrivent] dans la volonté politique de leur contrôle par la société civile » (Carlier, 2009, p. 10). Leur règne fut de courte durée et, passé 1830, le discours des doctrinaires (citons Guizot, Thiers, Rémusat ou encore Duchâtel) est sans appel : les prisons coutent cher et produisent épidémie, homosexualité et récidive. Précisons que les doctrinaires étaient sous la Restauration un groupe de royalistes qui espéraient réconcilier la monarchie avec la révolution. Pour enrayer la montée de ces trois fléaux, une conclusion s’impose : il faut supprimer les prisons. Alors, que faire des délinquants ? Les éloigner. C’est ainsi que les milieux politiques et juridiques privilégient le modèle anglais de transportation pénale : les prisonniers sont déportés à l’étranger, principalement en Angleterre, en Suisse, mais aussi aux États-Unis. Cependant, Charles Lucas, alors président du Conseil des inspecteurs généraux des services administratifs, préconise, lui, l’enfermement. C’est par ailleurs dans cette optique qu’il va s’intéresser au monde des prisons et proposer une réforme globale du système pénitentiaire. Au hasard de l’histoire, Tocqueville, alors magistrat, est envoyé en mission en Amérique pour y étudier les modèles carcéraux. Un concept, né de ce voyage, défend le système pennsylvanien où chaque détenu est isolé dans une cellule, 24 heures sur 24. Ce système s’oppose au modèle de la prison d’Auburn, système dans lequel les prisonniers vivent en commun le jour, en silence, et sont encellulés individuellement la nuit. Dans un souci d’éradication des trois fléaux (épidémie, homosexualité, récidive), c’est le modèle pennsylvanien qui fait l’objet d’un nouveau modèle de construction des prisons : la structure panoptique. Le principe, imaginé par Jeremy Bentham, philosophe anglais, repose sur une figure architecturale telle qu’à la périphérie un bâtiment en anneau ; au centre, une tour ; celle-ci est percée de larges fenêtres qui ouvrent sur la face intérieure de l’anneau ; le bâtiment périphérique est divisé en cellules, dont chacune traverse toute l’épaisseur du bâtiment ; elles ont deux fenêtres, l’une vers l’intérieur, correspondant aux fenêtres de la tour ; l’autre, donnant sur l’extérieur, permet à la lumière de traverser la cellule de part en part. Il suffit alors de placer un surveillant dans la tour centrale, et dans chaque cellule d’enfermer un fou, un malade, un condamné, un ouvrier, un écolier. (Foucault, 1993, p. 233). Ce modèle peut donc être mis en œuvre pour les hôpitaux, les écoles et les prisons. En réalité, si Bentham a mis en avant l’exemple de la prison, c’est parce qu’elle est censée assurer plusieurs fonctions : de contrôle, d’instruction et de réinsertion. Foucault attirera par ailleurs l’attention sur le modèle panoptique imaginé par celui que l’on considère comme le père de l’utilitarisme dans Surveiller et punir. Cependant, « au moment où l’utopie pénitentiaire fait confiance à la géométrie (…), elle s’intéresse peu à un système de surveillance panoptique, mais beaucoup plus à une organisation de l’espace qui (…) limiterait la récidive » (Petit et al., 2002, p. 53). Rattrapé par des réalités budgétaires, le modèle panoptique est abandonné au profit de constructions de formes variables dans la perspective de penser les droits de l’homme sous forme d’intégrité physique des détenus qu’il va s’agir d’assujettir à « de bonnes habitudes » par le travail, l’instruction ou la religion. Charles Lucas, dans De la réforme des prisons (1836), fait de l’instruction la base de sa théorie sur la réforme pénitentiaire. Selon lui, la question de l’emprisonnement est une question d’éducation, cette dernière pouvant à elle seule servir d’instrument pénitentiaire. C’est à ce titre que la circulaire (Rémusat, 1840), qui complète la loi Guizot de 1833, va déclencher le recrutement d’instituteurs en prison. Malgré cette bonne volonté motivée par des convictions humanistes, les premiers instituteurs ne sont recrutés que de façon marginale au point ou des années plus tard, « en 1868, on ne recense que 19 instituteurs laïques parmi les employés (…) et dans les prisons pour femmes ce sont toujours des religieuses qui dispensent l’instruction » (Febrer, 2009, p. 38). Le rapport établi en 1872 par le vicomte d’Haussonville9 renforce ce douloureux constat : il n’existe que 28 instituteurs pour l’ensemble de la France dont 21 internes dans les maisons centrales et seulement sept externes dans les 402 prisons départementales où la population pénale est en majorité analphabète. À Paris, pour 5 000 détenus, ils ne sont que deux. La réflexion – pourtant riche en ce milieu de XIXe siècle – sur le traitement des détenus, précisément en termes d’éducation, s’affaiblit et l’amendement du prisonnier à travers l’instruction n’est plus à l’ordre du jour. Plusieurs explications sont possibles. Comme le souligne Carlier (1997), historien spécialiste de l’administration pénitentiaire, l’instituteur en prison se trouve finalement principalement affecté au service du secrétariat des directeurs. Ainsi, il songe plutôt à faire carrière, utilisant son statut comme tremplin pour accéder à la fonction de directeur ou alors est résigné à « ne s’occuper que mécaniquement de sa tâche » (p. 115). Situation d’autant plus catastrophique que l’on sait que les personnes emprisonnées ne maitrisent ni la lecture, ni l’écriture, sont pauvres, que la voracité des entrepreneurs entraine qu’ils disposent de tout le temps des prisonniers et enfin que ces derniers manquent d’intérêt pour leur instruction. Cependant, il est probable que la raison se situe dans une tout autre logique. Ne serait-il pas question de ne pas favoriser l’intelligence du criminel par l’instruction afin de ne pas le rendre plus rusé et donc plus dangereux pour la société ? C’est l’argument avancé par l’historienne Michelle Perrot (2003) pour qui il existe une certaine volonté de limiter l’instruction des condamnés de la part des directions, hostiles à toute organisation d’un enseignement primaire dans les établissements. Perrot distingue, à l’égard de l’éducation, les classes supérieures dont l’intelligence est le but et le moyen, des classes inférieures pour qui il s’agit d’instruction professionnelle, morale ou religieuse, toute émancipation intellectuelle ne pouvant être réinvestie, faute de ressources et de possibilités d’accéder à toute forme de loisirs. Ainsi, seules les notions élémentaires de lecture, d’écriture et de calcul sont enseignées, avec parcimonie. C’est d’autant plus regrettable qu’à cette époque, 18% des femmes détenues seulement peuvent fréquenter l’école où elles apprennent les rudiments de la lecture, de l’écriture et du calcul, alors que 66% d’entre elles sont totalement illettrées. Chez les condamnés masculins, dont près de la moitié restent illettrés (44%), seuls 15% sont admis à l’école. Pour ceux-ci que l’on présente comme des privilégiés, les résultats scolaires ne peuvent être que décevants : ils reçoivent une heure d’enseignement journalier dans le meilleur des cas, après 12 à 14 heures de travail exténuant. La cause pénitentiaire fait débat entre criminologues et pénalistes. A contre-courant, Lombroso, médecin, avance que l’on nait criminel et que cela se soigne alors que Ferri, juriste et militant socialiste, estime que c’est la société inégalitaire qui est responsable de la production de la délinquance. Éclectique, du moins prétendant l’être, Tarde, sociologue et psychologue social, comprend très tôt l’aspect caricatural de la théorie lombrosienne, qui peut par ailleurs prêter à maintes dérives, et s’accorde à penser que le système d’appréhension développée par Ferri a une autre cohérence. Il s’opposera par la suite aux idées pénitentiaires positivistes de Ferri, qui entendaient substituer la peine-défense et la peine-éducation à la peine châtiment et appelaient de leurs vœux un régime pénitentiaire dans le sens de la rééducation du délinquant, appuyé sur deux principes essentiels… :1° la sériation des délinquants ; 2° L’orientation professionnels des délinquants (Carlier, 1989, p. 28) On le voit bien, la responsabilité du délinquant est remise en question et, par conséquent, l’idée de la prison qui châtie. La prison doit devenir un lieu de traitement plutôt que lieu de punition (Carlier, 2009). Il est certain que dans ce mélange de théories, la place de l’enseignement pose également question, particulièrement dans cette France républicaine qui a entamé un vaste programme d’instruction publique et qui ne veut pas laisser en dehors de ce combat idéologique les prisons
Insertion versus sécurité
Nous avons vu, particulièrement au regard de la réforme Amor, que cette thématique – la réinsertion – est initiée par les termes « amendement » et « reclassement social » du détenu. Par ce dernier terme, la commission Amor érige la réinsertion en principe majeur et dominateur de l’action pénitentiaire. Cependant, comme nous l’avons précisé, cette doctrine demeure à un stade… de doctrine et ne sera pas formalisée – immédiatement, du moins – en loi. Comme l’évalue Carlier (2009), seulement un quart des établissements bénéficieront des orientations de la réforme Amor, et un cinquième de la population carcérale. Il faudra attendre l’adoption du nouveau code pénal en 1958 pour trouver, deuxième alinéa de l’article 758, que le régime des établissements pénitentiaires « sera institué en vue de favoriser l’amendement des condamnés et leur reclassement social ». Une fois de plus, les circonstances de l’histoire vont influencer le climat pénitentiaire puisque la guerre d’Algérie aura pour conséquence un glissement de l’objectif de réinsertion vers plus d’autorité et de sécurité ce qui se traduit par la circulaire du 24 février 1960 adressée par le garde des Sceaux à l’administration pénitentiaire prescrivant le renforcement des mesures de sécurité. Plus tard, les mouvements de mai 68 eurent comme suite indirecte la construction d’une nouvelle critique des conditions de détention dénonçant particulièrement l’incapacité de la prison à améliorer le détenu, comme le prônait la réforme Amor. Ces critiques, portées par, entre autres, Foucault, ont pour conséquences des textes règlementaires laissant apparaitre le renforcement des aménagements de peine, alternatives à la peine d’emprisonnement. Dès lors, le gouvernement reconnait implicitement des lacunes de la prison à « refaire un homme normal dans un cadre anormal » (Seyler, 1980, p. 146). « la fonction réinsersive de la prison se voit en 1975 affaiblie (…) et la dimension sécuritaire de la prison trouve une nouvelle expression de sa prédominance à l’occasion de l’adoption de ce train de réforme » (Gontard, 2013, p. 47). Bien que dans une circulaire du 8 août 198524 l’administration pénitentiaire parle encore de « réinsertion sociale des personnes détenues », la loi du 22 juin 198725 dispose que le service public pénitentiaire favorise la réinsertion sociale des personnes qui lui sont confiées par l’autorité judiciaire (Article 1er). C’est la première fois que la notion de service public apparait et le premier article de cette loi fait prévaloir ce nouveau statut et reconnait le service public pénitentiaire comme acteur du maintien de l’ordre public avant de lui assigner sa mission de réinsertion. Cette hiérarchisation se retrouve formalisée à travers la Loi n°2004-204 du 9 mars 200426 qui modifie le code de procédure pénale dont l’Article 707 établit que « l’exécution des peines favorise, dans le respect des intérêts de la société et des droits des victimes, l’insertion ou la réinsertion des condamnés ainsi que la prévention de la récidive ». Ainsi, les missions de la peine de prison tendent vers la réinsertion sociale et la prévention de la récidive, avec pour contrainte majeure le respect des intérêts de la société, mais aussi des intérêts des victimes. Nous observons ici une nuance entre les objectifs de la peine qui doivent être « favorisés » et les contraintes de la peine qui doivent être « respectées ». Nous retrouvons cette différenciation sémantique dans la Loi qui établit la cadre de fonctionnement de l’institution carcérale qui nous semble la plus importante : la Loi du 24 novembre 2009 dite Loi pénitentiaire sur laquelle nous reviendrons plus précisément. Selon la réforme Amor, la signification d’insertion recouvre les termes d’amendement, de reclassement social, de réhabilitation ou encore de rééducation. La loi de 2009, qui se veut conforme aux règles pénitentiaires européennes, entretient ce flou sémantique de la réinsertion visant plus à prévenir la récidive qu’à l’idée de resocialisation de la personne. L’insertion, d’un point de vue juridique, n’est pas un droit pour les personnes détenues, bien qu’elle soit un devoir pour les pouvoirs publics. Le parcours d’exécution de la peine confère à la personne détenue un droit de réinsertion (et non un droit à la réinsertion), mais selon les efforts fournis par cette dernière. En effet, selon l’article 721-1 du code de procédure pénale, des réductions de peine sont possibles lorsque les détenus manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l’acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d’un enseignement ou d’une formation, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s’efforçant d’indemniser leurs victimes. Ainsi, la réinsertion sociale des personnes détenues est un devoir de conformité dont le manquement entraine une exclusion d’aménagement de peine. L’insertion des personnes détenues est soumise au fonctionnement carcéral et le droit lui-même constitue une limite. D’autres obstacles nous paraissent remarquables, notamment l’observation de la population pénale.
Contribuer à l’amélioration de la vie des détenus et du personnel pénitentiaire
Selon une note rédigée en 2005 par le Centre international pour l’étude sur les prisons (ICPS), il est avancé que « L’éducation peut contribuer à l’humanisation de la vie en prison […] et peut réduire les pressions négatives de la vie en prison » (International Centre for Prisons Studies, 2005, p. 7) tout autant qu’il est dans l’intérêt de la détention que de proposer des occupations telles le travail, l’éducation, les activités culturelles et sportives dans le but de réduire les risques de violence et de troubles. Ce double intérêt de l’éducation des détenus – pour eux-mêmes et pour les autorités pénitentiaires – est renforcé dans le rapport établi par le rapporteur spécial des Nations Unies qui, au-delà de préconiser des alternatives à l’enfermement, souligne que l’absence d’activités en détention alimente un sentiment d’infériorité et une baisse de motivation chez les détenus ce qui pourrait entrainer des difficultés pour l’administration pénitentiaire et les détenus euxmêmes.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : LA FORMATION EN PRISON ET AILLEURS
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 UNE QUESTION DE DIGNITE HUMAINE
1. La réalité historique à l’épreuve des idéologies
1.1. Des citoyens et des prisonniers
1.2. La prison repensée vers l’instruction du prisonnier
1.3. La formation du peuple s’accélère, la prison recule
1.4. Former le peuple, éduquer le prisonnier : un décalage
1.5. Le citoyen se forme, le prisonnier s’occupe
1.6. Le détenu est une personne « comme tout le monde »
2. Jeu de lois
2.1. La réinsertion : une utopie carcérale ?
2.2. Des principes aux textes de loi
3. Le pilotage de la formation professionnelle
3.1. Au sein des établissements
3.2. Le transfert de la formation professionnelle aux régions
3.3. Des conséquences possibles
4. L’environnement carcéral
4.1. La prison comme espace
4.2. La prison dans l’espace
4.3. La répartition de la population pénale
5. Panorama de la formation professionnelle
5.1. En dehors des murs
5.2. L’offre de formation en prison
CHAPITRE 2 LA FORMATION PROFESSIONNELLE : UN OBJET AMBIGU
1. La formation en prison : le parent pauvre des recherches
1.1. Éduquer les prisonniers : pour quoi faire ?
1.2. S’éduquer en prison : pour quoi faire ?
2. La formation professionnelle dans la société
2.1. Des enjeux économiques flous
2.2. Une deuxième chance ?
2.3. Un public adulte
2.4. De la fabrication des formations à la fabrication des professionnels
SYNTHESE DE LA PREMIERE PARTIE
DEUXIEME PARTIE : L’APPROCHE ANTHROPOLOGIQUE DU DIDACTIQUE
INTRODUCTION
CHAPITRE 3 DES CONDITIONS ET DES CONTRAINTES A DIFFERENTS NIVEAUX
1. Quelques notions
1.1. En parlant de niveau
1.2. La (et le) didactique
1.3. La théorie des rapports
2. Une multiplicité de facteurs
2.1. Question d’idéologies
2.2. Question d’institutions
2.3. Question de « disciplines »
2.4. Question de temps
2.5. Question de distance
3. La question des notions de savoir, apprendre, connaitre
3.1. Une approche épistémologique
3.2 Didactiquement parlant
CHAPITRE 4 POURQUOI ET COMMENT TEL SAVOIR EN TELLE INSTITUTION ?
1. D’un lieu à un autre
1.1. Ce qui se joue dans la société
1.2. Ce qui se joue en prison
2. La notion de praxéologie
2.1. Quoi ? Comment ? Pourquoi ? Au nom de quoi ?
2.2. Quels rapports avec les rapports ?
SYNTHESE DE LA DEUXIEME PARTIE
TROISIEME PARTIE : LA DEMARCHE METHODOLOGIQUE DE LA RECHERCHE
INTRODUCTION
CHAPITRE 5 DESCRIPTION DU DISPOSITIF
1. Les conditions et contraintes de notre recherche
2. Les entretiens
2.1. Grille d’entretiens
2.2. Prises de contact
2.3. Conduite des entretiens et transcriptions
2.4. Profils des formateurs interrogés et des formations
3. Les questionnaires
3.1 Premier groupe de population : les stagiaires
3.2. Deuxième groupe de population : l’administration pénitentiaire
CHAPITRE 6 RESULTATS DE L’ENQUETE
1. Les entretiens
1.1 Présentation des résultats
1.2 Synthèse des entretiens
2. Le questionnaire
2.1 Présentation des résultats
2.2 Synthèse du questionnaire
CHAPITRE 7 ANALYSE DES RESULTATS
1. Pourquoi la formation professionnelle en prison ?
1.1 Pour la prison et ses pensionnaires
1.2 Pour les formateurs
1.3 La « nature » de la formation professionnelle en prison
2. Le fonctionnement des systèmes didactiques
2.1 Des choses à et pour enseigner
2.2 Apprendre un métier
2.3 Des choses à créer
2.4 Adaptations ou créations ?
3. Les conditions et contraintes
3.1 Ce qui pèse sur le système didactique
3.2 Ce que génère le système didactique
En guise de synthèse : peut-on parler de formation professionnelle en prison ?
CHAPITRE 8 DISCUSSION, LIMITES ET PERSPECTIVES
1.Ce à quoi renvoie notre recherche
1.1 La formation professionnelle : pour quoi faire ?
1.2 Le sens de la formation professionnelle en prison
1.3. La formation professionnelle sert-elle les théories de la prison ?
2. Des limites à des perspectives
2.1 Des travers
2.2 … A des possibilités
CONCLUSION GÉNÉRALE
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet