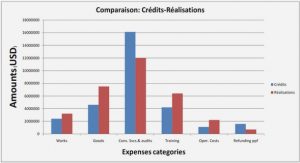La formation des assistantes sociales
L’histoire de la profession des assistantes sociales
Pour Bouffant et Guélamine, l’origine de la profession d’assistantes sociales se retrouve dans la convergence de plusieurs courants : « la tradition de l’assistance, portée notamment par le catholicisme social, les initiatives d’origine médicale et socio-médicale, les initiatives d’origine industrielle. » (Le Bouffant & Guélamine, 2009). Lentement, entre la fin du XIXᵉ siècle et le premier tiers du XXᵉ la profession se construit. À la fin du XIXᵉ siècle, ce sont des femmes issues de la bourgeoise, qui, animées de bonnes volontés, vont exercer le rôle d’assistantes sociales en offrant une aide charitable aux personnes pauvres et/ou malades (Le Bouffant & Guélamine, 2009). Au début du XXᵉ siècle, la question sociale se lie avec les pathologies contagieuses et les conditions matérielles et sociales des malades. Ainsi, les infirmières-visiteuses et les assistantes sociales vont seconder les médecins. Guérir et éduquer deviennent des priorités dans le courant médico-social (Le Bouffant & Guélamine, 2009).
C’est ainsi que les assistantes sociales sont entrées dans l’intimité des personnes, car cela « était jusque-là réservé aux médecins et aux dames de charité » (Le Bouffant & Guélamine, 2009). Le 23 octobre 1918, l’école d’études sociales pour femmes ouvre ses portes à Genève. Le but de cette école était de leur offrir la possibilité de suivre une formation professionnelle et d’avoir une activité indépendante. L’idée de former des femmes et de leur permettre une ouverture vers l’indépendance est innovante, mais le programme de l’époque reste familialiste (Cattin & Bolzman, 2008). Le fondateur de l’école, Hans Töndury-Giere, lors de l’assemblée générale extraordinaire à la fin 1918 disait d’ailleurs que son « ambition est de rendre les femmes plus aptes à remplir leurs devoirs dans la famille et dans la société » (Cattin & Bolzman, 2008 : 79). L’école s’ouvre en 1951 aux hommes même s’ils restent, aujourd’hui encore, minoritaires dans cette profession (Cattin & Bolzman, 2008).
De cette période, Bessin tire la conclusion suivante : « Historiquement, le travail social a socialisé la fonction maternelle exerçant un contrôle sur ce qui était de l’ordre du privé. En mettant la famille au centre de son intervention classique, il a aussi fait de la femme l’archétype de l’interlocutrice de l’assistante sociale. » (Bessin, 2008 : 359-360). Pour Bessin, les raisons liées à cette féminisation, en plus de l’histoire de la profession, sont les qualités demandées pour la pratiquer et qui sont dites féminines : « Ainsi, le fait que près de 90 % des travailleurs sociaux, tous métiers confondus, soient des femmes ne prête pas à discussion : « patientes », « dévouées », « généreuses », « douces », leurs compétences relationnelles les destineraient naturellement à ces métiers de valeurs et d’implication. » (Bessin, 2008 : 358).
La présentation de soi Goffman parle de la présentation de soi en comparant les interactions à des scènes de pièce théâtre et les individus à des acteurs en représentation. Ainsi une personne mise en présence d’une autre va tâcher d’obtenir des informations sur autrui ou mobilisera les informations déjà en sa possession. L’acteur face à autrui « […] s’inquiète de son statut économique, de l’idée qu’il se fait de lui-même, de ses dispositions à leur égard, de sa compétence, de son honnêteté, etc. » (Goffman, 1973 : 11). L’information est recherchée, car « elle contribue à définir la situation, en permettant aux autres de prévoir ce que leur partenaire attend d’eux et corrélativement ce qu’ils peuvent en attendre ». C’est ainsi qu’« ils savent comment agir de façon à obtenir la réponse désirée. » (Goffman, 1973 : 11). Pour que l’interaction se déroule sans heurt, « en présence d’autres personnes, on a en général de bonnes raisons de se mobiliser en vue de susciter chez elles l’impression qu’on a intérêt à susciter. » (Goffman, 1973 : 13-14).
Afin de permettre ces représentations, plusieurs éléments entrent en ligne de compte lors de la mise en scène : « la conviction de l’acteur », « la réalisation dramatique », « l’idéalisation », « la cohérence de l’expression », « la représentation frauduleuse », etc. Ainsi, l’acteur se crée une « façade » qui « n’est d’autre que l’appareillage symbolique, utilisé habituellement par l’acteur, à dessein ou non, durant sa représentation. » (Goffman, 1973 : 25). Cette façade est composée du « décor » qui est généralement un lieu avec une toile de fond contenant du mobilier, une décoration ou encore une disposition d’objet. La façade se compose également de la « façade personnelle » qui se confond avec l’acteur et qui l’accompagne partout. Elle comprend les signes distinctifs ou grades, les vêtements, le sexe, l’âge, la race, la taille, la physionomie, les attitudes, la rhétorique, les mimiques, les comportements, etc. Elle est, de fait, constituée de la « manière » et de « l’apparence ». Généralement, la manière et l’apparence se trouvent être congruentes (Goffman, 1973). Au-delà des éléments qui composent la présentation, il y a « la signification morale des comportements » qui impliquent « une foule de normes relatives à la politesse et à la bienséance » qui concernent « à la fois les relations sociales et la représentation de la tâche » et qui fait que la représentation est « enserrée dans un réseau de conventions morales ». (Goffman, 1973 : 236)
Le corps et ses apparences
Selon Pagès-Delon « Habits, cosmétiques, marquages divers, postures, attitudes, gestes se combinent de manière intentionnelle — ou pas — dans une logique de signification. » (Pagès-Delon, 1989 : 11). L’auteure considère les apparences corporelles et le corps comme un construit social qui révèle le système social dans lequel une personne évolue (Pagès-Delon, 1989). Guionnet et Neveu font état de normes différenciées de l’apparence corporelle pour les garçons et les filles et cela dès leurs apprentissages : « En toute société, la gestion des postures du corps est intériorisée depuis le plus jeune âge : une fille apprend à ne pas être « vulgaire » (ne pas écarter les jambes avec une jupe, ne pas cracher par terre, ne pas lâcher d’injures, ne pas siffler, etc.) et à « s’apprêter », se « faire belle ». Un garçon apprend à ne pas marcher comme une fille, mais avec une allure virile (grands pas, décidé, torse en avant, se tenant bien droit), à ne pas pleurer, à parler avec assurance, à uriner le plus loin possible, etc. » (Guionnet & Neveu, 2014 : 47). Pour Pagès-Delon, les apparences corporelles forment un code complexe et « C’est à partir de ce dernier, ou plus précisément de ce que les acteurs sociaux savent de celui-ci, qu’ils vont construire quotidiennement leur apparence et lire celle d’autrui ; le savoir social sur le code étant bien évidemment différentiel selon les appartenances socioculturelles et la position de l’acteur social dans l’espace social » (Pagès-Delon, 1989 : 10-11).
Les apparences corporelles regroupent les vêtements, les accessoires ou parures ainsi que l’hygiène corporelle et l’entretien (Pagès-Delon, 1989). Ainsi, l’apparence est « produite par des pratiques et des représentations, porteuses d’informations sur les acteurs, les apparences corporelles sont de ce fait supports de jugements sociaux. Le regard porté sur autrui et celui d’autrui sur soi sont simultanément interprétatifs et évaluatifs. » (Pagès-Delon, 1989 : 12). Des normes de construction et d’usage guident l’apparence de chaque personne : « […] nous pouvons constater que dans notre société, s’il existe bien des normes, celles-ci sont peu formalisées et institutionnalisées. […]. Or ces recettes semblent trouver un ancrage dans une représentation actuellement forte de la corporéité, dans une manière de penser le corporel dans notre système social : […] Ces recettes s’originant dans cette représentation générale du corporel et visant bien à la construction/transformation des apparences sont autant de prescriptions normatives : c’est en les mettant en oeuvre que l’acteur social parviendra à la production d’une apparence socialement conforme. » (Pagès-Delon, 1989 : 78 – 79).
Entre féminité et féminitude
La féminité n’est donc pas un état « naturel », mais une construction sociale et culturelle qui varie en fonction des latitudes et relève sous bien des aspects de la féminitude, comme la définit Schneuwly Purdie : « La féminitude désigne les attitudes intégrées, plus ou moins consciemment, par les femmes et qui conditionnent leurs façons d’être femme. La féminitude désigne ainsi autant les attributs physiques de la féminité, que les façons de s’exprimer, d’occuper l’espace public, de se mouvoir en société et aussi d’interagir avec les hommes. » (Schneuwly Purdie, 2016 : 14). Ainsi, en Suisse, les critères auxquels une femme doit se soumettre sont relativement contraignants : « elle devrait être active professionnellement, une mère attentive (à partir d’un certain âge), une épouse loyale, mais aussi une maîtresse enjouée. » Par ailleurs, et toujours selon Schneuwly Purdie « si l’émancipation de la femme en Occident s’est, en partie, développée par son droit à dévoiler son corps, ce même droit contribue également à sa sexualisation ; une sexualisation qui ne va pas de pair avec une réelle émancipation de toute forme de domination masculine. » (Schneuwly Purdie, 2016 : 14). Chollet montre que la féminité telle qu’elle s’exprime dans l’espace public est très univoque, « […] un seul type de femme s’impose donc : le plus souvent blanche, certes, mais aussi jeune, mince, sexy, apprêtée. » (Chollet, 2012 : 199).
La féminité va au-delà de la tenue et elle inclut et exclut certaines manières d’être : « Par ailleurs, la féminité façon arbre de Noël n’est pas promue comme une simple panoplie vestimentaire, mais comme un ensemble correspondant à une attitude : une manière d’être entièrement façonnée en fonction du regard et des attentes d’autrui. Elle exclut la force de caractère, l’indépendance, les projets propres. » (Chollet, 2012 : 201). En parlant de la féminité, et de la beauté, Chollet conclut : « À L’aune de leur situation réelle, la frivolité débilitante et la convoitise démente que l’on entretient chez elle apparaissent pour ce qu’elles sont : une oppression de plus. Dans une société où l’égalité serait effective, elles auraient le droit à un autre rôle que celui de vaches à lait ou de perroquets — ou d’otaries — du complexe mode-beauté. » (Chollet, 2012 : 105). De fait, la féminité est ce qui est vu comme une caractéristique des femmes fonctionnent comme un carcan, et deviennent une forme de féminitude qui n’est pas sans lien avec la servitude.
|
Table des matières
span style= »color: #ff0000; »>1. Introduction
1.1 Naissance d’une idée
1.2 Motivation
2. Un peu de théorie
2.1 Les assistantes sociales
2.1.1 L’histoire de la profession des assistantes sociales
2.1.2 La formation des assistantes sociales
2.2 Le genre
2.2.1 Qu’est-ce que le genre ?
2.3 Dominants et dominées
2.3.1 La domination masculine
2.4 Reproduction du genre
2.4.1 Doing gender
2.5 La présentation de soi
2.5.1 Le corps et ses apparences
2.6 La beauté, une affaire de femme
2.6.1 Entre féminité et féminitude
2.6.2 Corps de femme, embellissement corporel : un faux choix
2.7 Avancée en mixité au travail
2.7.1 Des assistants sociaux parmi des assistantes sociales
3. Problématisation
4. Méthodologie utilisée
4.1 Préparation des entretiens
4.2 Déroulement des entretiens
4.3 Analyse des entretiens
5. L’apparence corporelle des AS
5.1 L’habit fait le moine
5.2 Des normes implicites qui pèsent
6. Des bénéficiaires que l’on juge avec plus d’aménité
6.1 Les tenues des bénéficiaires
6.2 La négligence comme indicateur
6.3 Les tenues décalées : symboles des rapports sociaux
6.4 Influence des modèles médiatiques
7. Conclusion
7.1 Des tenues appropriées pour les AS et une apparence qui a moins d’importance pour les bénéficiaires
7.2 Pistes d’action et de recherches
7.3 Limite de l’analyse
8. Apports personnels et professionnels
8.1 À titre personnel
8.2 À titre professionnel
Références
Annexes
Grille d’entretien
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet