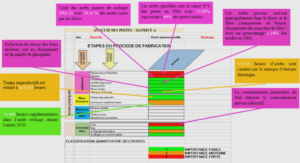La fertilisation des sols
La fertilisation du sol a pour but d’accroître durablement les productions agricoles. En Afrique où la fertilité des sols est généralement faible, Rabezandrina (1986) estime qu’au lieu de définir l’agriculture comme étant « l’art de tirer du sol le maximum de profit tout en maintenant sa fertilité, il faut plutôt la concevoir comme étant l’art de conserver la fertilité du sol pour en tirer le maximum de profit ». Il s’agit en fait de faire passer au second plan le profit immédiat qui jusqu’à présent a prévalu dans l’approche de fertilisation qui consiste le plus souvent à apporter uniquement au sol de l’engrais minéral à des doses donnant lieu à des bilans minéraux négatifs.
Les causes de la chute des rendements, en dehors de l’insuffisance et/ou de la mauvaise répartition de l’offre en eau sont le fait d’une fertilisation inappropriée pour des sols naturellement pauvres en matières organique et minérale. Les matières fertilisantes sont des produits destinés à assurer la nutrition des végétaux et à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques des sols. Elles comprennent les fertilisants minéraux ou organiques (engrais) et les amendements. Pour clarifier le vocabulaire utilisé par la suite, il est nécessaire de préciser leur signification. Les sols mis en valeur en Afrique de l’Ouest et au Niger en particulier, sont les sols ferrugineux et les sols ferralitiques. Compte tenu de leur minéralogie (dominée par la présence de quartz, de kaolinite, d’oxy-hydroxyde de fer et d’aluminium) et de leur texture souvent sableuse à sablo-argileuse, la matière organique joue un rôle fondamental dans leurs propriétés. La mise en culture de ces sols naturellement fragiles déclenche un processus rapide de dégradation de cette fertilité à travers lequel les éléments du complexe absorbant ou bases échangeables sont remplacés par des éléments minéraux plutôt toxiques (H+, Ab3+ et Mn2 +, Na+). L’acidification et/ou la salinisation sont des processus très courants de dégradation des sols. Un autre processus non moins préoccupant est la perte de substances traduisant la détérioration de la structure du sol à travers la destruction du complexe argilohumique. Ce phénomène résulte de l’effet des eaux de ruissellement mais aussi de la minéralisation des colloïdes organiques.
Effets des amendements organiques sur la fertilité du sol
Les amendements organiques sont des produits organiques dont la teneur en l’un des éléments majeurs (N, Pou K) est inférieure à 3 % de la matière brute(Leclerk, 1989). Les amendements organiques utilisés dans la fertilisation des sols sont de natures ou de formes diverses. La diversité serait liée à la nature et la qualité des substrats organiques apportés, à leurs effets sur les caractéristiques du sol mais aussi à leur aptitude à la biodégradabilité (Akroume, 1985; Lompo, 1997). On peut citer entre autres, le fumier et le compost qui sont les sources les plus fréquemment rencontrées en milieu paysan. Généralement, les différentes formes d’amendements organiques sont caractérisées par le rapport C/N, valeur qui exprime en fait le degré de richesse ou de disponibilité azotée (Oades et al., 1989) et la teneur en lignine ou en phénols. Il faut cependant noter que la teneur en lignine et en polyphénols est aussi importante pour déterminer la qualité d’une source organique; plus ces éléments sont en teneur importante, plus la décomposition est lente (Tian, 1998). La difficulté pour le maraîcher réside dans le manque de connaissance de l’amendement organique qu’il utilise. Leur rôle est donc avant tout d’amender un sol pour l’entretien ou la reconstitution du taux de l’humus. Les effets améliorateurs de ces substrats sur les propriétés chimiques, physiques, biologiques et les rendements des cultures ont été largement montrés (Pieri. 1989; Dakouo, 1991, Sedogo, 1993; Bonzi, 2002; Lompo, 2009; Hien 1990).L’apport d’amendement organique est un moyen sûr, rapide et efficace pour assurer un niveau de production minimale et permettre une valorisation correcte des engrais minéraux en présence de sols relativement épuisés. Il permet d’enrayer le processus de dégradation des sols cultivés dans la mesure où les phénomènes de surface sont eux aussi maîtrisés. Tout comme les engrais minéraux, les matières organiques fournissent beaucoup d’éléments nutritifs à la plante (Pieri, 1989; FAO, 1997). Les matières organiques, en particulier l’humus, augmentent la capacité du sol à fixer les éléments minéraux, ils améliorent la capacité de rétention de l’eau (hydrophile) et accroissent la capacité d’échange cationique (Maltas et al., 2011, Maltas et al., 2012). Des expérimentations de longue durée ont montré que des apports de fumier bien décomposé (C/N voisin de 10) permettent d’éviter, ou au moins de limiter l’acidification des sols, d’augmenter le niveau de rendements et de retrouver l’efficience des engrais (Delville, 1996; Pousset, 2000).
En Afrique, les sources traditionnelles de matières organiques (résidus de récoltes, fumiers, composts) ne peuvent répondre aux besoins de l’agriculture du fait de leurs quantités très limitées (Lompo, 1993; Mando et al., 2001; Mando, 2002), de leurs qualités médiocres(Breman et Sissoko, 1998, Vlaming et al., 2001) et de la difficulté de leur transportdans les champs nécessitent beaucoup de travail (Breman et Sissoko, 1998, Palm et al., 1997). Il faut aussi noter que la production de ressources organiques nécessite des investissements en engrais minéraux. Car sur des sols déjà déficients en nutriments, il est difficile de produire suffisamment de biomasse dont le recyclage pourrait permettre de couvrir les besoins des plantes.
Les engrais organiques
Les engrais organiques sont des produits organiques dont la teneur en l’un des éléments majeurs (N, P ou K) est supérieure à 3 % de la matière sèche du produit. En général, on se base sur la teneur en azote et on parle d’engrais organiques azotés. Ces produits sont destinés avant tout à compenser les exportations des cultures surtout en maraichage. Qualifiés souvent d’amendements organiques concentrés, tels que lestourteaux, les déchets d’abattoir, lesfarinesde poisson, leguano et les fientes de volailles, sont relativement riches enN, P et K.Les engrais organiques d’origine animale se présentent sous forme sèche ou liquide selon la manière dont ils sont stockés. Leur teneur en éléments minéraux dépend de l’espèce animale, des aliments consommés par les animaux et des modalités de stockage des déchets (El Hassani & Persoons, 1994) .
Cependant, il faut noter que de nombreuses études ont été menées sur certains de ces composés telsque la fiente de volaille; par contre le guano serait très peu voire méconnu du monde scientifique nigérien.Dans le cadre de notre travail nous nous intéresserons uniquement à l’étude du Guano des chauves-souris.
Effets des Amendements inorganiques sur la production et la fertilité du sol
Les engrais sont des substances, le plus souvent des mélanges d’éléments minéraux, destinées à apporter aux plantes des compléments d’éléments nutritifs, de façon à améliorer leur croissance, et à augmenter le rendement des cultures et la qualité des produits. En Afrique de l’Ouest, les bilans nutritifs sont généralement négatifs à cause de la maigre fertilité naturelle des sols et du faible niveau de fertilisation pour restituer les nutriments enlevés au sol (Batiano et al., 1998). Les systèmes de production agricole en Afrique au Sud du Sahara sont pour la plus part des types miniers, conduisant à de sévères déficits des budgets des éléments minéraux dans le sol (Stoorvogel et Smaling, 1990). Engénéral, les engrais minéraux sont faiblement utilisés compte tenu de leur coût assez élevé pour les petits producteurs (Sanchez et al., 1997). Selon Maatman et al., (2008), les quantités d’engrais minéraux utilisés en Afrique sont autour de 8 kg ha-lan-l, ce qui représente seulement 10% de la moyenne mondiale. De nombreuses études démontrent que l’utilisation judicieuse d’engrais minéraux conduit à une augmentation des rendements (Buerkert et al., 2001; Bationo et al., 1998,) à condition qu’aucun autre facteur de croissance (tels que l’eau et le rayonnement) ne devienne restrictif D’autre part, force est de constater que l’Afrique sub-Saharienne possède le plus faible taux de consommation en engrais au monde avec environ 8 kg nutriments ha/an (Bationo et al., 1998). L’application d’engrais minéraux est inférieure de 5 kg/ha/an dans la zone soudanosahélienne (Buerkert et al., 2001) et seulement 0,8 kg/ha/an au Niger (Sivakumar et Salaam, 1999). Les engrais importés sont chers et difficiles d’accès dans les campagnes. En outre, leur achat doit s’effectuer à la période de l’année où la plupart des paysans souffrent de problèmes de revenus (période de soudure). Les travaux de Pichot et al. (1981); Bado et al. (1991) sur l’efficacité des engrais minéraux ont montré que l’azote et le phosphore sont les deux premiers facteurs limitant les rendements. Les engrais possèdent un intérêt logistique avantageux comparés aux apports organiques: ils sont des formes concentrées de nutriments et peuvent être transportés facilement. Leur désavantage est que seuls, ils ne peuvent pas soutenir les rendements à long terme.
|
Table des matières
Introduction
Chapitre I. synthèse bibliographique
1.1 Fertilité des sols
1.1.1 La fertilité physique du sol
1.1.2 La fertilité chimique
1.1.3. La fertilité biologique
1.2 La fertilisation des sols
1.2.1 Effets des amendements organiques sur la fertilité du sol
1.2.2 Les engrais organiques
1.2.3 Effets des Amendements inorganiques sur la production et la fertilité du sol
1.3 Problématique de la fertilité des sols
1.4 Généralité sur le guano
1.4.1. La chauve-souris productrice du Guano
1.4.2 Le guano
1.4.3. Importance agronomique du guano dans la production de culture
1.4.4. Facteurs affectant la qualité du guano
1.5 Production de la laitue verte au Niger
1.5.1 Généralités sur la laitue
1.5.2 Importance de la culture de laitue au Niger
Chapitre II. Présentation de la zone d’étude
2.1 Localisation géographique
2.2. Milieu physique
2.2.1. Climat
2.2.1.1. Les précipitations
2.2.1.2. Les températures
2.2.1.3. Les vents
2.2.2. La végétation
2.2.3. Hydrographie
2.2.4. Les sols
2.3. Cadre humain
2.3.1. La population
2.3.2. L’agriculture
2.3.3. L’élevage
2.4 Caractéristiques des cuvettes
2.4.1 Sols des cuvettes
2.4.2 Végétation liée aux cuvettes
2.5 Présentation de la cuvette de Balla
Chapitre III: MATERIEL ET METHODES
3.1. MatérieL
Caractérisation du sol
3.2 Méthodes
3.2.1 Enquête
3.2.1.1 Déroulements de l’enquête
3.2.2 Dispositif experimental
3.2.3 Présentation du site de prélèvement et mode de prélèvement du guano
3.2.4 Traitement de la laitue verte (Maya)
3.2.5 Méthodes d’analyse des sols
3.2.5.1 Echantillonnage du soL
3.2.5.2 Les analyses physiques et chimiques du sol et des amendements organiques
3.2.6 Conduite de l’essai
3.2.7 Mesures et observations agronomiques
3.2.8 Analyse des données
Conclusion
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet