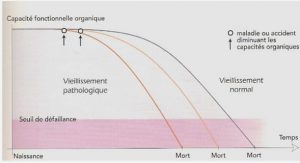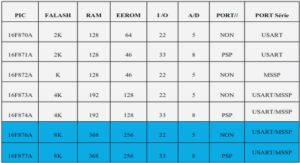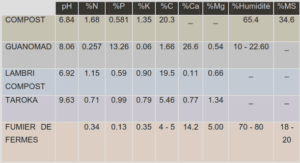Les gares périphériques : le parent pauvre de la recherche urbaine
Depuis quelques années, on assiste à une profusion de travaux scientifiques en France sur les gares ferroviaires. D’après le travail de recensement effectué par Nacima Baron et Ali Hasan, une trentaine de thèses relatives aux « gares et aux pôles d’échanges » étaient ainsi en cours ou récemment soutenues en 2016. Plusieurs programmes de recherche ayant pour objet ces mêmes installations socio-techniques ont par ailleurs été engagés au cours de la décennie passée, comme par exemple celui portant sur « Les Gares TGV et les dynamiques de renouvellement urbain » de la Plate-forme d’Observation des Projets et Stratégies Urbaines (POPSU) en 2009, le programme « Gare » de la chaire industrielle Econoving sur la période 2011-2016 , ou encore celui « Réinventer les gares au XXIe siècle » de la chaire « Gare » entre 2012 et 2017. Cette actualité témoigne d’une intensité particulière de ces objets à la charnière de certains milieux scientifiques et de certaines entreprises. Ce faisant, les regards portés sur ceux-ci se sont diversifiés, les questionnements se sont déplacés et les approches renouvelées, ce que les différents articles rassemblés dans le numéro de la revue Flux consacré aux « gares au miroir de l’urbain » illustrent par ailleurs (Baron, Roseau, 2016).Ainsi, en Histoire de l’art, certains chercheurs se sont récemment intéressés non plus seulement à l’architecture ferroviaire des grands édifices monumentaux, à la manière de Michel Ragon (1984) en France ou de Caroll L.V. Meeks aux Etats-Unis (1956), mais ont considéré des « mégastructures » de transports en interrogeant en particulier la dimension urbaine de ces grands équipements de la « mobilité » (Mazzoni, 2001 ; Tiry, 2008). En sociologie et en histoire urbaine, certains ont développé une approche de la gare comme microcosme social ou théâtre d’expérimentation d’usages et de modes de sociabilité inédits (Tillous, 2009 ; Sauget, 2009), venant ainsi apporter des éclairages nouveaux aux recherches d’inspiration interactionniste conduites en particulier par Isaac Joseph dans l’espace public de la gare du Nord (Joseph, 1995) et par Michel Kokoreff dans celui du métro parisien (Kokoreff, 2002), et à celles quasi encyclopédiques de la gare comme reflet des sociétés industrielles et post-industrielles (MacKenzie, Ricards, 1986). Dans le champ de l’urbanisme et de la géographie, les productions scientifiques abordant la gare suivant une approche spatiale se sont multipliées. Les mutations des gares et de leur environnement ont été largement étudiées, notamment dans le cadre de l’arrivée puis du développement du TGV (Cf. Ollivro, 1999 ; Barré, Ménerault, 2001 ; Ménerault, 2006 ; Terrin, 2011 ; Delaplace, 2012 ; Delage 2013 ; …), mais aussi sous l’effet de la montée des logiques immobilières au sein des entreprises ferroviaires (Adisson, 2015), et sous celui de l’ouverture à la concurrence du marché ferroviaire européen (Riot 2015). Enfin, de nouvelles directions de recherche sont aujourd’hui explorées, comme par exemple celle des processus de prise de décisions dans ces « lieux institutionnels originaux » (Richer, 2007), ou celle des expériences sensitives des individus qui pratiquent ces espaces (Tardieu, 2006). Si les gares ferroviaires font l’objet d’une profusion de travaux scientifiques qui en renouvellent la compréhension, force est de constater que ceux-ci se sont bien plus largement intéressés aux grandes gares centrales et de la grande vitesse qu’à celles des réseaux de proximité dans les zones urbaines et périurbaines. Dans la littérature scientifique française comme dans celle anglo-saxonne, leur rôle social et sociétal n’a été que peu interrogé, celles-ci étant bien plus largement affublées du statut de non-lieux, c’est-à-dire d’espaces « qui ne peuvent se définir ni comme identitaires, ni comme relationnels, ni comme historiques. » (Augé, 1992, p.100) Depuis quelques années, celles-ci constituent toutefois l’objet privilégié d’un certain nombre de travaux inscrits dans la mouvance du Transit Oriented Development. Ce courant a été développé en premier lieu aux États-Unis dans les années 1990 par l’architecte-urbaniste Peter Calthorpe. Ce dernier ambitionnait d’encourager le report modal vers les transports en commun en repensant l’aménagement urbain des zones résidentielles ou commerciales dans la région de Washington (Calthorpe, 1993). Plusieurs chercheurs ont prolongé son travail dans d’autres contextes territoriaux, et se sont en particulier intéressés aux quartiers de gare dans les régions métropolitaines à partir des notions de densité et d’accessibilité (Bertolini, Spit, 1998 ; Newman, Kenworthy, 2006 ; Curtis & al., 2009 ; L’Hostis & al., 2009 ; Grillet-Aubert, 2015 ; …). Cette montée en puissance des gares périphériques dans ce genre de travaux fonctionnalistes s’explique pour au moins deux raisons identifiées par Roelof Verhage et Aurélie Delage : « D’abord, le réseau est un élément hiérarchisé. À ce titre, il offre un support idéal pour la conception d’une ville polycentrique où, de surcroit, la proximité des gares peut s’avérer un élément supplémentaire de lutte contre le phénomène de congestion, liés à la prolifération des voitures dans les centres urbains [ …]. Ensuite, la disponibilité foncière autour des gares, que ce soit d’anciennes friches industrielles ou ferroviaire, représente souvent un gisement foncier potentiel intéressant, imbriqué dans le tissu urbain existant. » (Verhage, Delage, 2014, p.8) Mais plutôt que d’analyser les processus à l’œuvre ou d’interroger les dynamiques propres à ces espaces, les chercheurs inscrits dans ce courant cherchent surtout à construire un modèle vertueux de quartier de gare et à infléchir les politiques urbaines pour tendre vers la réalisation de celui-ci10. Par ailleurs, et compte tenu de leur grande influence dans les milieux des praticiens de la ville et des transports, ces travaux semblent participer directement à l’actualité des gares périphériques, et être ainsi parties prenantes du mouvement que j’entends étudier. De ce point de vue, ils constituent davantage des matériaux empiriques pour cette recherche qu’un champ théorique de référence pour mes travaux. Cette revue de la littérature ne saurait bien sûr prétendre à l’exhaustivité. Au regard de ces éléments, il apparaît néanmoins que les gares périphériques se présentent assez largement comme un impensé du foisonnement de travaux scientifiques actuellement menés sur les gares ferroviaires, à l’exception de ceux d’inspiration fonctionnaliste développés dans la mouvance du Transit Oriented Development. En cela, l’intérêt d’interroger ces objets pour eux-mêmes se trouve justifié. Mais dans le même temps, cette absence relative interdit de reprendre à mon compte certains concepts opératoires pour préciser mon objet de recherche. De ce fait, c’est bien plus par tâtonnements, par allersretours entre matériaux empiriques et questionnements théoriques, que j’ai progressivement précisé celui-ci.
L’imaginaire comme méta-récit
En première approche, l’imaginaire peut être appréhendé comme « le système formé par ces représentations imagées, leurs relations et les significations qu’elles revêtent par l’intermédiaire de leur rapprochement. » (Picon, 2001, p. 19) Suivant cette définition qu’en propose Antoine Picon, celui-ci s’esquisse au travers du jeu d’associations – ou au contraire d’éloignements – entre les images, les figures, les projections, qui sont véhiculées par des discours, des phrases, ou des propositions. Il est donc un mouvement en diagonal de ceux-ci, et a en cela quelques similitudes avec le concept foucaldien d’ « énoncé » (Foucault, 1969, p.109-120), que Nathalie Roseau mobilise d’ailleurs pour caractériser la consolidation de l’imaginaire de la ville aérienne comme « palimpseste de représentations » (Roseau, 2008, p. 26-27). Ce mouvement des représentations apparaît en particulier discernable à travers la narration qui peut être faite des objets ou des choses. Comme le souligne le politologue Alain Faure, la narration, ou « mise en récit », « ne dit pas l’objet, celui-ci est trop complexe. Elle raconte sa mise en scène. » (Faure, 2012) Or cette mise en scène, par le jeu de sélection et d’ordonnancement des images qu’elle opère, esquisse précisément une dimension imaginaire. Dans cette thèse, je m’intéresserai en ce sens à ces effets de mise en récit – ou méta-récits – des gares du « quotidien », afin de mettre à jour les systèmes agencés de représentations dans lesquels cette catégorie se trouve prise. Comme le souligne par ailleurs Pierre Musso, l’imaginaire, entendu comme système agencé de représentations, « ne se développe pas autour d’images libres, mais il leur impose une logique, une structuration. En effet, il peut être structuré parce qu’il a une logique propre (fut elle a-logique) et qu’on peut en déceler la « grammaire ». » (Musso, 2014, p.11) Plusieurs chercheurs ont, en ce sens, rapproché l’imaginaire des notions de « référentiel technique » (Picon, 1992), de « paradigme » (Guigueno, 2001), ou de « culture » (Marx, 2005)17. Sous cet angle, celui-ci se présente comme un ensemble de contenus mentaux qu’un groupe social plus ou moins étendu partagerait. Pour ce qui me concerne, les gares du « quotidien » s’apparentent bien plus largement à une catégorie précipitée, à un moment, par un nombre restreint d’acteurs nourrissant contextuellement des stratégies convergentes. Elles s’inscrivent en particulier dans une dimension bien plus courte que, par exemple, la Nation, dont la dimension imaginaire été mise en lumière par Benedict Anderson (2006). De ce fait, on aurait là plus affaire à « un projet ou à une attention commune » qu’à « une vision ou un imaginaire collectif. » (Flichy, 2001/5, p.55) Pour autant, à travers la mise en récit qui en est faite, celle-ci apparaît bien traversée de représentations. Dès lors, je chercherai dans cette thèse non pas tant à révéler un imaginaire des gares du « quotidien » qui serait propre à cette catégorie, mais plutôt à mettre en lumière la manière dont celle-ci se branche sur des imaginaires qui la précèdent. Si ce travail de dévoilement présente, en soi, le mérite de déconstruire le « naturel » dont cette catégorie peut a priori faire l’objet, il semble toutefois se doter d’une dimension heuristique autrement plus féconde dès lors qu’il est rapporté à ses effets. C’est pourquoi je m’attacherai par ailleurs à identifier les fonctions que joue cette catégorie chargée d’imaginaires à différents niveaux.
Un déficit chronique
À mesure que le trafic ferroviaire s’intensifie en région parisienne, les problèmes d’exploitation se multiplient, au point de déclencher des émeutes, comme celle du 3 janvier 1908 en gare Saint-Lazare où les voyageurs, déjà exaspérés par une succession d’incidents les semaines précédentes, s’en prennent au personnel et dégradent les lieux à la suite d’une panne de signalisation due au gel. Les compagnies sont forcées de réaliser d’importants travaux d’infrastructure pour notamment construire de nouvelles voies et augmenter le nombre de quais en gare : « Partout on creusait, on raccordait, on dédoublait, pour faire passer et arriver toujours plus de trains. » (Faure, 1993, p.13) Un nouveau matériel spécifique, plus capacitaire, ainsi que de nouvelles locomotives, plus puissantes, sont également mises en service. Toutes ces opérations représentent des investissements conséquents pour les compagnies, alors même que la rentabilité des services de « banlieue » s’avère particulièrement faible. En effet, un nombre important de véhicules n’est finalement utilisé que quelques heures par jour, et l’occupation des trains se révèle en moyenne peu élevée. Puisque toute l’infrastructure et l’exploitation sont dimensionnées par les heures de pointe, les services ferroviaires de « banlieue » se présentent comme « socialement utiles, mais économiquement nuls. » (Faure, 1993, p. 14) La part de la « banlieue » dans le déficit global des réseaux ferroviaires explose à partir de 1914. Pour le réseau de l’Ouest, il passe de 3,8% en 1913 à 14% en 1921, de 48% en 1924 à 76% en 1928 (Carrière, 1998, p.167). La Compagnie de l’Ouest, qui était celle avec le réseau de « banlieue » le plus étendu, est ainsi la première à être reprise par l’État, dès 1908. Par la suite, les administrateurs des autres compagnies n’hésitent pas à se débarrasser de certaines de leurs lignes particulièrement denses, comme par exemple les lignes de Sceaux et de Vincennes dont la « métropolitanisation » est proposée en 1921. Pour Dominique Larroque, le raisonnement des administrateurs suit alors la logique suivante : « le trafic de banlieue est structurellement déficitaire ; le déficit, c’est la promesse à terme d’une emprise plus forte, voire définitive de l’État ; la libre entreprise passe donc par l’abandon ou, à défaut, par le partage du fardeau de la banlieue. » (Larroque & al., 2002, p.94) Le transport de masse en « banlieue » se présente donc comme une activité largement subie par les compagnies, car contraire à leurs intérêts économiques et, in fine, à leur indépendance de gestion. Plusieurs lignes déficitaires sont en ce sens rachetées dès le début du XXe siècle par l’Administration des chemins de fer de l’État, faisant déjà de celui-ci un opérateur ferroviaire de premier plan. Compte tenu des difficultés financières toujours croissantes des compagnies, des négociations entre leurs actionnaires et le ministère des travaux publics sont engagées sous le Front populaire, en 1936. Celles-ci aboutissent à la reprise par l’État des compagnies du Nord, du PO, du PLM, et de l’Est, et à la création de la SNCF en 193851. Une certaine « banlieue » s’est ainsi imposée comme espace de peuplement aux compagnies de chemins de fer et, ce faisant, conduisit celles-ci à leur démantèlement. Les premières heures de la SNCF sont marquées par une compression du personnel, des réductions de parcours et le transfert sur route de nombreuses lignes ferroviaires. Dix mille kilomètres de voies sont ainsi fermés sur le réseau ferré national dans le cadre du chantier de la coordination rail-route engagé dès 1934 par le gouvernement Doumergue, dont le but était de « supprimer les doubles emplois et de répartir la clientèle des usagers. » (Larroque & al., 2002, p.168) Pour l’historien Georges Ribeill, la création de la SNCF marque « l’avènement de l’État-argentier qui, soucieux du redressement financier des chemins de fer, va s’avérer un État-patron sévère et malthusien. » (Ribeill, 1994, p.42) En Île-de-France, ce sont près de 500 kilomètres de lignes qui sont ainsi fermés (Cf. Figure 4). Ces fermetures s’accompagnent d’une diminution générale du trafic ferroviaire de « banlieue ». Avec la crise économique, le ralentissement de la croissance démographique et la concurrence naissante de la route, celui-ci passe de 356,8 millions de voyageurs au début de la décennie à 249 millions en 1938 (Carrière, 1998, p. 161). Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les destructions stratégiques et plus globalement les très mauvaises conditions de transports entrainent une renaissance forte du transport individuel. Les nombreuses destructions subies par le réseau ferroviaire francilien au moment de la Libération obligent la SNCF à reconstruire en urgence un certain nombre d’installations nécessaires à l’exploitation. Mais la période de l’après-guerre est surtout marquée par une relance sans précédent du chantier de la coordination et du transfert sur route, notamment dans le cadre d’un plan lancé par le gouvernement en 1954 « visant à fermer progressivement des lignes secondaires de chemin de fer, de manière à ramener le réseau à sa « longueur économique justifiée. » » (Finez, 2015, p.136) En Île-de-France, les fermetures de ligne, couplées à la concurrence accrue des autobus de la Société des transports de la région parisienne, se traduisent par une baisse continue du trafic jusqu’au milieu des années 1950. Pour Bernard Collardey, le réseau ferroviaire de « banlieue » au lendemain de la guerre apparaît en « hibernation » (Collardey, 1999, p.52).
|
Table des matières
Introduction générale
Chapitre 1. Une étude par l’imaginaire : éléments de cadrage
1.1. Les gares du « quotidien » comme objet de recherche
1.1.1. Les gares périphériques : le parent pauvre de la recherche urbaine
1.1.2. Les gares du « quotidien » : une construction politique
1.2. L’imaginaire comme cadre théorique
1.2.1. L’imaginaire comme méta-récit
1.2.2. L’imaginaire comme substance active du réel
1.3. Un corpus hétérogène
1.3.1. Des revues professionnelles
1.3.2. Des entretiens semi-directifs
1.3.3. Une étude de cas
1.4. Architecture de la thèse
Partie I. Archéologie
Chapitre 2. Les « banlieues » imposées au ferroviaire
2.1. L’amorce du lointain
2.1.1. Un succès bourgeois
2.1.2. Un anti-transport urbain
2.2. Une massification subie
2.2.1. Une nouvelle nécessité
2.2.2. Un déficit chronique
2.3. Un chantier imposé
2.3.1. L’intégration au RER
2.3.2. Une mission de service public
2.4. Une nécessaire conversion
2.4.1. Des propositions avortées
2.4.2. Un repositionnement stratégique
Conclusion du Chapitre 2
Chapitre 3. La gare de « banlieue » comme palimpseste de représentations
3.1. De la monumentalité : un enjeu de concurrence
3.2. De la technicité : un enjeu d’efficacité
3.2.1. Une composante du réseau ferré
3.2.2. Un modèle générique
3.2.3. Un système circulatoire
3.3. Des services : un enjeu de satisfaction « client »
3.3.1. Un espace habité
3.3.2. Une interface « clients »
3.3.3. Une complémentarité bord – sol
3.4. Les objets comme révélateurs de l’imaginaire
3.4.1. Le réseau comme figure structurante
3.4.2. Le « banlieusard » à domestiquer
Conclusion du Chapitre 3
Partie II. Cristallisation
Chapitre 4. L’urgence politique du « quotidien »
4.1. La catalyse du Grand Paris
4.1.1. Un contexte de tensions politiques
4.1.2. … Où se jouent des tractations ferroviaires
4.2. Les transports du « quotidien » contre le Grand Paris Express
4.2.1. Un contre-projet social
4.2.2. … Pour les oubliés du Grand Paris
4.3. Des gares pour donner à voir le réinvestissement dans le « quotidien »
4.3.1. Un sujet subalterne
4.3.2. Une opportunité de visibilité
Conclusion du Chapitre 4
Chapitre 5. La conversion des gares de « banlieue » au « quotidien »
5.1. Le lieu contre le réseau : controverse autour des gares de « banlieue »
5.1.1. La promotion du lieu
5.1.2. La résistance du réseau
5.1.3. Un compromis organisationnel
5.2. L’émancipation des gares du « quotidien »
5.2.1. Des « clients » modernes et compétents
5.2.2. Des commerces et services hors-sol
5.3. Un infléchissement des méthodes de travail
5.3.1. Une compréhension des objets renouvelée
5.3.2. De nouvelles perspectives de valorisation explorées
5.4. Une catégorie médiatrice entre imaginaires et pratiques : exemple de la valorisation des bâtiments-voyageurs de Mantes-la-Jolie
5.4.1. Une matière première des projets
5.4.2. Un redéploiement de la « banlieue »
Conclusion du Chapitre 5
Chapitre 6. La promesse urbaine des gares du « quotidien »
6.1. Les gares du « quotidien » au miroir des gares du Grand Paris Express
6.1.1. Les gares du Grand Paris Express comme virtualités de quartiers
6.1.2. Les gares du « quotidien » comme virtualités d’interactions
6.2. Une urbanité systémique
6.2.1. L’enjeu urbain des « projets de pôle » en question : l’exemple de Vernouillet – Verneuil
6.2.2. Des importunités locales
6.2.3. Des évidences métropolitaines
6.3. Des concentrés de services
6.3.1. Une pseudo-citadinité
6.3.2. Des clubs résidentiels
Conclusion du Chapitre 6
Conclusion générale
Une catégorie branchée sur des imaginaires
Une catégorie « frontière »
Un catalyseur d’imaginaires
Perspectives de recherche
Annexes
Télécharger le rapport complet