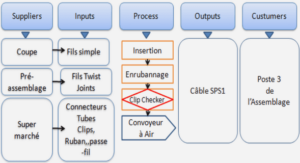Des initiatives pour accorder une plus large place à la confiance
Dans les formes d’organisation verticale typiques du début du XXème siècle, les individus se mettaient au service du système ; la délégation était à court terme dans un cadre clair limité, assortie de contrôles (Creed et Miles, 1996). Au mieux, l’organisation faisait confiance aux individus pour se placer dans un rapport de domination en trouvant leur intérêt à obéir (Bornarel, 2007). Face à cela, la possibilité de donner davantage de place aux salariés a été questionnée très rapidement, en deux grands courants. L’un a un ancrage politique avec des travaux autour de la démocratie industrielle dès les années 1960-70 puis la démocratie organisationnelle et la démocratie d’entreprise, avec une visée d’émancipation et d’impact social. Ce courant existe encore aujourd’hui (voir Esprit Presse, 2018 ; Hervé et Brière, 2011 ; Jardat, 2013 ; Segrestin et Hatchuel, 2012 pour des travaux français récents, ainsi que la synthèse plus large dans Picard, 2015). Le second courant a un ancrage économique et considère qu’une organisation est d’autant plus performante qu’elle est à l’écoute des besoins de ses salariés. Nos travaux s’inscrivent dans ce courant. Dès les années 1930 et les travaux pionniers de Mayo, puis avec le développement de l’Ecole des Relations Humaines dans les années 1950-60, apparaissent des voix qui indiquent la pertinence de capitaliser et de valoriser le facteur humain plutôt que de le discipliner et de le contrôler. On compte notamment McGregor et les théories X et Y, Herzberg et la motivation intrinsèque, Maslow et le besoin d’accomplissement, Lewin et la supériorité du leadership démocratique sur les leaderships « autoritaire » et « laissez-faire », ou encore Argyris et le management participatif. En parallèle se développent via l’institut Tavistock des travaux autour de la participation, avec des expérimentations d’autogestion dans les années 60-70, les équipes semiautonomes dès 1974 chez Volvo à Kalmar et les cercles de qualité dans les années 1980, les équipes projets, l’apprentissage organisationnel et l’empowerment dans les années 1990 (Picard, 2015). Les années 2000-10 voient se développer l’agilité (Charbonnier-Voirin, 2011 ; Dyer et Shafer, 2003) et l’entreprise libérée (Getz et Carney, 2012 ; Meissonnier, 2015). Cette dernière rend visible un courant plus large, dans lequel on retrouve par exemple le management renouvelé de Omar Aktouf (Aktouf, 2006), l’holacratie (Robertson, 2016), les entreprises humanistes (Lecomte, 2016), la sociodynamique et les entreprises holomorphes de Jean-Christian Fauvet (Jochem et Lefèvre, 2014), l’idée de pyramide inversée (Nayar et Sécheret, 2011) ou encore les entreprises opale (Laloux, 2014 ; Laloux et Appert, 2017). Ce courant questionne le regard posé sur les individus et la place à leur accorder dans les décisions et dans le fonctionnement de l’organisation et invite à « gérer autrement », non seulement en mettant au cœur du projet économique et social « le lien, l’écoute, le dialogue, la reconnaissance, l’attention, la confiance, l’initiative et un partage plus équitable » comme le prônaient depuis longtemps Follett, Polanyi et Perroux par exemple, mais aussi en inventant « de nouvelles pratiques qui vont permettre, dans le monde qui est le nôtre, de concrétiser d’une façon nouvelle ces principes qu’ils nous ont légués » (Chevrier, 2012). Ces approches prônant de nouvelles formes d’entreprise donnent une large place à la confiance. L’ouvrage sur les « entreprises humanistes » du psychologue positiviste Jacques Lecomte s’ouvre par exemple sur l’anecdote d’une entreprise en difficulté dont une des deux activités était largement déficitaire et devait être éliminée, selon les investisseurs, ce que le nouveau PDG a refusé. Une décennie plus tard, l’entreprise était florissante et leader de son secteur sur les deux activités. Le postulat à l’œuvre derrière ce redressement spectaculaire ? La sensibilité humaine du dirigeant et la confiance accordée à chacun des employés de l’entreprise, ainsi qu’un engagement en faveur de l’environnement. Un chapitre entier est ensuite dédié à la confiance en s’appuyant sur différents exemples comme Hewlett Packard, Favi, Semco, 3M et le ministère belge de la santé pour montrer la confiance à l’œuvre (Lecomte, 2016). Ces exemples se retrouvent dans le livre d’Isaac Getz et Brian Carney qui encourage à libérer les salariés pour faire le succès des entreprises (Getz et Carney, 2012). Si la confiance ne figure pas dans les thèmes clés de l’ouvrage initial, faire confiance est pourtant vu comme étant au cœur de ce nouveau fonctionnement, si l’on en croit Gilles Verrier et Nicolas Bourgeois (2016) dont le sous-titre de l’ouvrage demandant s’il faut libérer l’entreprise est « confiance, responsabilité et autonomie au travail ». La confiance est d’ailleurs apparue dans les ouvrages ultérieurs de Getz comme celui sur « l’entreprise libérée » (Getz, 2017). La confiance est également mentionnée à maintes reprises dans le livre de Frédéric Laloux (Laloux, 2014 ; Laloux et Appert, 2017) pour « réinventer les organisations ». Le sociologue des organisations François Dupuy (2015) en appelle lui aussi à la confiance, cette fois pour remédier à « la faillite de la pensée managériale » due à la non-confiance. Il lui dédie un chapitre et y revient pour conclure son ouvrage en indiquant que l’espoir de changement se trouve dans le fait que certaines entreprises, même si elles sont minoritaires, décident d’introduire plus de confiance dans les relations de travail et que la confiance émerge fortement dans la réflexion des entreprises. Autre exemple, Bernard Martin, Vincent Lenhardt et Bruno Jarrosson, (2017) invitent à « oser la confiance » à partir de l’expérience de B. Martin comme PDG du groupe Sulzer et de l’analyse de cette expérience par les des deux autres auteurs, consultants. Aujourd’hui, des entreprises comme la MAIF placent explicitement la confiance au cœur de leur fonctionnement. Lorsque la mutuelle a engagé une démarche de libération en 2014, son plan stratégique de 2015-2018 a été construit autour du thème de la confiance et la confiance figure de nouveau dans le plan 2019-2022, aux côtés du respect et du sens. La MAIF a même créé une chaire Confiance et Management avec l’université Paris Dauphine pour accompagner la démarche engagée au niveau de l’entreprise et notamment former leurs cadres. Le cabinet Deloitte a créé un Think Tank dont le slogan est « l’équation de la confiance ». Dernier exemple, le label « Great Place to Work© » considère que les « organisations où il fait bon travailler », qu’il récompense, sont celles où règne une « culture de confiance », en s’intéressant à la fois au point de vue des salariés et à celui de l’organisation. Selon ce classement, le premier critère pour les salariés est de faire confiance à leur management, assorti de la fierté du travail réalisé et de la convivialité des relations avec leurs collègues. Du point de vue de l’organisation, « c’est une entreprise où l’on atteint les objectifs assignés, avec des salariés qui donnent le meilleur d’eux-mêmes et travaillent ensemble comme une équipe ou une famille – le tout dans un climat de confiance ». Par-delà le vécu des salariés, une enquête TNS Sofres Confiance et Croissance de 2015 conclut que « seules les entreprises qui se développent à partir de la confiance de leurs salariés ont un espoir de croissance durable » (Bruna et Vernay, 2015).
Un concept mal défini qui reste à explorer
Si la confiance est mobilisée dans la littérature professionnelle et académique grand publique, comme nous l’avons mentionné précédemment, la notion n’y est pas définie. Les démonstrations ou argumentations passent de la confiance à l’absence de contrôle, à la liberté à l’autonomie, à la coopération, au droit à l’erreur, à l’absence de défiance, sans distinguer les notions les unes des autres. Le classement Great Place to Work ne précise pas dans ses communications ce qu’est la confiance, même si le site indique les cinq critères de confiance du point de vue du salarié et neuf leviers pour l’actionner du point de vue de l’organisation. Même le rapport que l’organisme a publié sur les organisations à confiance élevée ne dit pas ce qui est entendu par confiance (GPTW, 2016). L’enquête TNS Sofres interroge le niveau de confiance des cadres, qu’ils soient ou non managers, au sein d’entreprises implantées en France, publiques et privées, d’au moins 250 salariés, à partir d’indicateurs identifiés dans une enquête préalable, pourtant le terme n’est pas défini, même si l’étude est cosignée par une chercheuse. Les briques qui forment l’indice de confiance incluent la confiance entre pairs, la confiance dans les dirigeants et la confiance en soi et dans son avenir outre l’adhésion aux valeurs et l’image de l’entreprise, sans préciser ce qu’est la confiance à ces niveaux-là. Cette enquête permet de conclure que la confiance est multi-niveau, mais ne permet pas de savoir ce qu’est la confiance ellemême ni comment faire confiance. Pour les entreprises libérées, la confiance est implicitement assimilée à la suppression des contrôles et au changement de regard sur les individus, pour les considérer comme a priori ou potentiellement bons et altruistes. Dans le cas des entreprises humanistes de J. Lecomte, il est dit que la confiance n’est pas de la naïveté ni de la désinvolture ou du laxisme, mais il n’est pas précisé ce qu’elle est, bien qu’un chapitre entier lui soit dédié. François Dupuy consacre lui aussi un chapitre à la confiance, qu’il présente comme remède à l’échec de la coercition comme mode de management. Pourtant, lui non plus ne dit pas ce qu’est la confiance, hormis qu’elle est une alternative à la complexité de la multiplication des contrôles et qu’elle repose sur la prévisibilité. Deux ouvrages professionnels se démarquent, à savoir ceux de Hervé Sérieyx, qui sont dédiés à la confiance et à sa mise en œuvre et qui prennent la peinent d’explorer et expliciter ce qui est entendu par confiance en s’appuyant à la fois sur des expériences d’entreprises et sur quelques travaux académiques (Sérieyx, 2009 ; Sérieyx et Fallou, 2010). Toutefois, les études de terrain ne sont pas développées et la méthodologie n’est pas documentée. Même au niveau académique, la confiance organisationnelle – au sens de la confiance entre les individus et l’organisation qui les emploie, pour répondre aux enjeux que nous avons présentés ci- dessus – est aujourd’hui peu interrogée. D’une manière générale, la confiance est un sujet peu étudié dans la recherche française en gestion (Gratacap et al., 2011). Quelques numéros spéciaux de revues et ouvrages sont parus sur le sujet ces deux dernières décennies (nous y reviendrons dans la première partie de cette thèse), mais aucun des auteurs n’est spécialisé sur le sujet et aucune étude n’aborde la confiance individu-organisation. Lorsqu’elles concernent le niveau intra-organisationnel, les recherches se concentrent quasi exclusivement sur la confiance entre individus au sein d’une organisation ou sur la confiance entre individus et (top-)management, ce qui est respectivement le cas des thèses de Frédéric Bornarel (2004) et de Valérie Neveu (2004), sans prendre en compte l’organisation elle-même, même si Bornarel l’évoque. Le seul chercheur français à explorer la notion elle-même à partir d’études de terrain est ergonome et ses travaux ne sont pas entrés dans le champ de la gestion jusqu’à présent (Karsenty, 2013b, 2015a). Au niveau international, il existe une communauté de chercheurs dédiés à la confiance (regroupés notamment dans le réseau FINT, the First International Network on Trust) et un journal dédié (Journal of Trust Research). Pourtant, même à ce niveau, la notion-même de confiance organisationnelle est peu explorée empiriquement. Les études se concentrent sur les liens avec d’autres concepts ou sur les antécédents et dimensions et non sur ce qu’est la confiance elle-même. Les définitions les plus mobilisées en gestion assimilent la confiance à un état de vulnérabilité ou une volonté de se rendre vulnérable parce que l’autre a des caractéristiques jugées positives dans un contexte d’incertitude (Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Rousseau et al., 1998). Ces approches ne permettent pas de comprendre comment les individus atteignent cet état, comment ils passent des raisons de faire confiance au fait de se rendre vulnérable, comment ils font et refont confiance au fil du temps et des aléas qui surviennent immanquablement au cours des relations. Un certain nombre d’études s’intéressent à la façon dont l’organisation peut susciter de nouveau la confiance après une violation, en revanche on en sait très peu sur la façon de préserver la confiance au fil du temps et des alea rencontrés, à l’exception de l’étude toute récente de Gustafsson et al. (2020). De plus, les études sur la confiance organisationnelle ne s’intéressent qu’à ce que l’organisation peut faire pour créer, préserver ou restaurer la confiance mais ne prennent pas en compte l’interaction entre les individus et l’organisation et la dimension active du processus, qui a pourtant déjà été mise en lumière au niveau interpersonnel. Enfin, les études s’inscrivent la plupart du temps soit dans une approche psychologique se concentrant sur le niveau individuel, soit dans une perspective sociologique qui se focalise sur les dynamiques collectives, soit dans une perspective économique dépersonnalisée dans laquelle la confiance est vue comme un calcul rationnel. Rares sont les approches qui saisissent la complexité du phénomène en intégrant des perspectives différentes. Nous avons cherché une approche qui permette de comprendre la confiance comme suspension de l’incertitude, d’intégrer le caractère dynamique en changement permanent du processus de confiance, de prendre en compte l’aspect multi-niveau individus-organisation ainsi que la façon dont la confiance des individus dans l’organisation et celle de l’organisation dans les individus s’influencent voire se forgent mutuellement. Nous l’avons trouvée dans le cadre adopté par Möllering (2006) et Lumineau et Schilke (2018) qui font référence à l’embedded agency, dans lequel les organisations sont considérées comme des institutions (Zucker, 1983). L’idée d’agence est que les parties peuvent avoir des divergences d’intérêts, qu’il est nécessaire de prendre en compte pour les réduire. Dans la conception de Möllering et de Lumineau et Schilke, non seulement les organisations rendent possibles certaines actions et en contraignent d’autres, apportent des cadres pour que ses membres développent une compréhension commune des situations et orientent les perceptions et comportements des individus, mais elles changent aussi en fonction de la façon dont les individus se comportent, perçoivent les situations, leur donnent du sens, créent de nouvelles règles et modifient ainsi les cadres de référence et l’organisation, qui vont en retour influencer leur cognition et leur comportement. Cette approche de la confiance place la construction de sens au cœur du processus, le sensemaking de Karl Weick (Weick, 1995). L’organisation participe à ce processus particulièrement à travers la façon dont ses pratiques formelles et informelles influencent la façon de traiter des informations et prendre des décisions (Galbraith, 1974). Les individus y participent en injectant leurs propres croyances, cognitions et comportements, les écarts avec ceux de l’organisation les mettant sous tension, cette tension conduisant à faire évoluer les individus et l’organisation. Nous nous sommes inscrite dans cette perspective parce que nos résultats nous ont conduit à considérer la confiance en tant que suspension de l’incertitude comme un processus de construction de sens. Cet ancrage n’est pas le fruit d’une exploration théorique initiale mais la conséquence de notre immersion dans notre terrain, des allers-retours entre nos données d’observation, nos analyses, et différentes perspectives théoriques existantes nous permettant de développer notre approche théorique à partir du terrain.
De la réduction des risques à la suspension de l’incertitude
Nous venons de voir que le premier point commun des définitions de la confiance est la référence à des attentes positives, même si elles sont de nature et de portée différentes. Le deuxième point commun est une situation d’incertitude : il n’y a confiance que lorsque l’on n’est pas sûr de l’issue et/ou du comportement de l’autre. Nous allons voir dans cette partie comment la plupart des approches prennent cette incertitude comme un simple contexte et cherchent à la réduire. Alternativement, l’incertitude peut être considérée comme le cœur même de la confiance, ce qui ouvre de nouvelles perspectives. Comme nous l’avons vu dans l’introduction générale et comme les définitions du tableau 1 le montrent, la confiance s’inscrit dans un contexte d’incertitude, que cela passe par« la possibilité que les choses se passent mal même si elle est combinée à la croyance qu’elles ne se passeront pas (très) mal » (Nooteboom 2003b), la volonté de se rendre vulnérable même si un risque est encouru, dans une situation de non maîtrise et d’incapacité à contrôler l’autre (Lin, 2010 ; Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Rousseau et al., 1998 ; Schoorman, Mayer et Davis, 2007) ou encore d’opportunisme possible (Cummings et Bromiley, 1996). La confiance est associée à une situation dans laquelle le future est incertain et dans laquelle les conséquences d’une déception des attentes sont supérieures aux bénéfices de leur satisfaction (Deutsch, 1960). L’incertitude est inhérente au monde social, parce que l’autre n’est jamais complètement prévisible : il est impossible d’être sûr de ses intentions comme de son comportement futur, quel que soit son comportement passé et cette incertitude a augmenté avec le délitement des liens sociaux durables et l’intensification de l’interdépendance, comme indiqué au début de ce chapitre. A cette incertitude sociale s’ajoute une incertitude environnementale puisque le contexte change en permanence : réglementation, ressources, acteurs… Rares sont les auteurs, à l’instar de Karsenty (2013) et de Castelfranchi et Falcone (2000), qui prennent en compte ces facteurs externes en ne faisant pas reposer l’incertitude, comme les attentes, uniquement sur l’autre mais sur la situation plus largement. Que l’incertitude rende vulnérable et place dans une situation de danger, de risque, est posé comme postulat dans la plupart des définitions de la confiance et la confiance est vue comme une prise de risque. Or l’incertitude n’est pas synonyme de risque indique Laurent Bibard (2012). Le risque implique une issue négative évaluable alors que l’incertitude est au contraire imprévisible. Si l’incertitude est perçue comme un risque, cela conduit à se comporter en fonction d’un futur potentiellement dangereux qu’il faut anticiper et maîtriser. Si l’incertitude est acceptée avec son caractère imprévisible, il est possible de se comporter non pas en fonction d’un futur hypothétique mais en fonction de ce qui se joue au présent, en s’adaptant aux situations au fur et à mesure qu’elles se présentent (ibid). A l’heure actuelle, la première approche domine largement les recherches sur la confiance. Pour Shapiro, Sheppard et Cheraskin (1992) la confiance vient particulièrement de la fiabilité, du fait que l’autre va faire ce qu’on attend de lui. Pour Das et Teng (1998, 2001), il s’agit de rechercher la sécurité. Cette approche apparait de façon évidente dans les approche économiques qui cherchent à réduire le risque d’opportunisme et de divergence d’intérêts (Eisenhardt, 1989a ; Jensen et Meckling, 1976 ; Williamson, 1993). Cependant, l’incertitude est également vue comme un risque dans les approches en psychologie et psychosociologie qui dominent les recherches actuelles et qui reposent sur la notion de vulnérabilité et sur la recherche d’indicateurs montrant que l’autre est suffisamment digne de confiance pour prendre le risque (Davis, Schoorman et Donaldson, 1997 ; Mayer, Davis et Schoorman, 1995 ; Schoorman, Mayer et Davis, 2007). Or, la confiance existe aux limites du système, elle commence là où la prédictibilité s’arrête (Lewis et Weigert, 1985 ; Seligman, 2001). C’est justement la « suspension de la rationalité » (Möllering, 2001), le « saut de foi » (Lewis et Weigert, 1985 ; Möllering, 2006), qui caractérise la confiance. L’individu fait nécessairement des impasses, écarte des possibles, simplifie la représentation d’autrui pour faciliter sa tâche et garder sa santé mentale (Reitter et Ramanantsoa 2012 p.37). Même Arrow soulignait déjà qu’il y a une part de confiance dans toute transaction, ne serait-ce que parce que l’on donne l’argent avant d’avoir l’objet entre les mains, par exemple (Arrow, 1973). C’est cette acceptation de la part d’incertitude, si minime soit-elle, qui fait la confiance, suggère Möllering (Möllering, 2001, 2006). S’il y a suspension, saut, il y a action. Pourtant, la plupart des définitions considèrent la confiance comme un état, le fait d’avoir ou non confiance selon l’évaluation de la situation et/ou de l’autre et l’intention, sans parler d’action (Rousseau et al., 1998) ou en mentionnant que la volonté mène à l’action mais qu’elle n’en fait pas intrinsèquement partie (Mayer, Davis et Schoorman, 1995). D’autres considèrent que la confiance est un processus qui intègre l’ensemble de ces étapes (Castelfranchi et Falcone, 2000 ; Möllering, 2001 ; Skinner, Dietz et Weibel, 2014 ; Zand, 1972) et qu’il n’y a confiance que s’il y a passage à l’action : on peut en effet se mentir à soi-même et croire qu’on fait confiance alors que ce n’est pas le cas, par exemple en pratiquant le micro-management (Skinner, Dietz et Weibel, 2014). Pour Möllering (2006), la suspension de l’incertitude n’est pas l’action qui suit la formation d’attentes positives, permettant de passer des attentes à l’action de faire confiance. La suspension de l’incertitude est le cœur même du processus de confiance, qui rend possible la formation d’attentes positives. Aujourd’hui, les études sur la confiance expliquent comment réduire la part d’incertitude pour que le saut soit moins grand, mais n’expliquent pas le saut lui-même (Möllering, 2013). Etonnamment, les définitions dominantes de la confiance qui l’associent au risque et au danger ne correspondent pas à la définition de la confiance de l’Académie française (9ème édition) qui indique que la confiance est l’« espérance ferme que l’on place en quelqu’un, en quelque chose, la certitude de la loyauté d’autrui, le sentiment d’assurance que donne la foi en l’avenir ». La définition de Laurent Karsenty (2013), qui décrit la confiance comme le sentiment de sérénité qui émane de la relation à un acteur sur qui l’on se repose dans une situation donnée en espérant qu’il prendra soin de nos intérêts (p.19), va en ce sens en faisant état de sérénité et d’espoir. Elle fait figure d’exception. Or son approche prend en compte l’incertitude mais ne la considère pas comme un danger. Il ne s’agit pas d’être aveugle et de confondre foi et confiance en ignorant toute information factuelle sur l’autre et sur la situation, mais de reconnaitre la part d’incertitude restante, plus ou moins grande, et la suspendre en faisant « comme si » elle n’existait pas, au lieu de la subir (Karsenty, 2013a ; Lewis et Weigert, 1985 ; Möllering, 2006 ; Wicks, Berman et Jones, 1999). Ainsi, envisager l’incertitude et sa suspension comme le cœur de la confiance ouvre de nouvelles perspectives puisqu’il ne s’agit plus de comprendre comment la réduire mais comment l’accepter, comment faire le saut de suspension de l’incertitude.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PREMIERE PARTIE : ETAT DES LIEUX DE LA CONFIANCE ORGANISATIONNELLE ET ANCRAGE THEORIQUE
CHAPITRE 1 : ETAT DE L’ART – La confiance organisationnelle, d’un état résultant de déterminants à un processus dynamique
Introduction du chapitre 1
I. Vers une définition intégrative de la confiance organisationnelle
II. Les sources de la confiance organisationnelle
III. Le caractère dynamique de la confiance
Synthèse du chapitre 1
CHAPITRE 2 : CADRE THEORIQUE – La confiance organisationnelle, un processus de construction de sens
Introduction du chapitre 2
I. La confiance organisationnelle vue comme un processus
II. Faire confiance, une construction de sens
III. Un processus aux facettes multiples
IV. Des pratiques organisationnelles au service de la constructions de sens ?
Synthèse du chapitre 2
DEUXIEME PARTIE : UNE ETUDE EMPIRIQUE EN IMMERSION DANS UNE ENTREPRISE QUI FAIT CONFIANCE A PRIORI
CHAPITRE 3 : METHODOLOGIE – La construction d’une théorie ancrée à partir d’une étude de cas, un parcours à la fois rationnel et émotionnel
Introduction du chapitre 3
I. Stratégie de recherche : une production de théorie ancrée à partir d’un cas particulier
II. La recherche de terrain, une expérience de l’incertitude récurrente
III. Une collecte de données au long cours
IV. Analyse et théorisation, un processus itératif
Synthèse du chapitre 3
CHAPITRE 4 : SAMSARA – Un cabinet de conseil et services IT qui fonctionne sur la base de la confiance
Introduction du chapitre 4
I. Les inducteurs d’une « transformation » radicale
II. Des collaborateurs considérés a priori intègres, compétents et bienveillants
III. Une acceptation de l’incertitude élevée qui abolit la rigidité et les contrôles
IV. Des politiques RH qui s’adaptent à l’état d’esprit particulier
Synthèse du chapitre 4
CHAPITRE 5 : ENTRE REVE ET REALITE – Comment le fonctionnement fondé sur la confiance a priori inspire confiance… ou non
Introduction du chapitre 5
I. Un fonctionnement qui inspire confiance a priori
II. Effets secondaires des a priori positifs
III. Effets secondaires de l’acceptation de l’incertitude
Synthèse du chapitre 5
TROISIEME PARTIE : DIFFERENTES FAÇONS DE FAIRE CONFIANCE LIEES A DIFFERENTS TYPES DE CONSTRUCTION DE SENS AUX NIVEAUX INDIVIDUEL ET ORGANISATIONNEL
CHAPITRE 6 : FAIRE CONFIANCE A L’ORGANISATION – La confiance des individus dans l’organisation, un processus de construction de sens en quatre déclinaisons
Introduction du chapitre 6
I. Une façon de faire confiance à l’organisation liée à la façon de construire du sens à partir de situations
II. La part des individus dans les différentes constructions de sens
III. L’évolution de la confiance en SAMSARA selon les différents modes de construction de sens
Synthèse du chapitre 6
CHAPITRE 7 : UNE CONSTRUCTION DE SENS AMBIVALENTE – Les tensions d’un fonctionnement organisationnel associé à des modes de construction de sens différents
Introduction du chapitre 7
I. Des pratiques organisationnelles disparates illustrées par quatre exemples de prises de décisions stratégiques
II. Analyse des dispositifs de construction de sens associés aux différentes décisions et effets en termes de confiance
III. Un fonctionnement qui repose sur des croyances conflictuelles
Synthèse du chapitre 7
CHAPITRE 8 : DISCUSSION DES RESULTATS – Comment nos résultats questionnent et complètent les études actuelles de la confiance organisationnelle
Introduction du chapitre 8
I. Discussion du caractère complexe du processus de suspension de l’incertitude
II. Discussion du caractère cognitif et affectif du processus de construction de sens et de préservation de la confiance
III. Comparaison des quatres déclinaisons du processus avec les typologies existantes
Synthèse du chapitre 8
CHAPITRE 9 : DISCUSSION ORGANISATIONNELLE ET MANAGERIALE – Perspectives sur les entreprises libérées et préconisations pour développer et préserver la confiance
Introduction du chapitre 9
I. Faire confiance dans les entreprises (dé)libérées
II. Suggestions et préconisations pour développer et préserver la confiance
Synthèse du chapitre 9
CONCLUSION GENERALE : Apports de la thèse et pistes futures de recherche
Liste des illustrations
Liste des tableaux
Bibliographie
ANNEXES
Télécharger le rapport complet