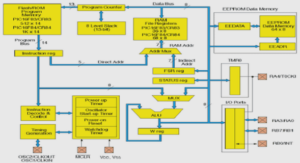Rappelons ici que notre travail s’intéresse aux enseignants débutants néo-titulaires, à l’entrée dans le métier. Plusieurs auteurs développent des problématiques liées à cette période délicate de la carrière. Parmi ces auteurs, Lanéelle et Pérez-Roux (2010) identifient la complexité à laquelle l’enseignant débutant doit faire face, pour se construire professionnellement, être reconnu, dans des contextes souvent instables et difficiles: « après une titularisation supposant une reconnaissance des compétences à concevoir, conduire, évaluer, réguler les apprentissages des élèves, l’entrée dans le métier suppose une adaptation des contenus radicale et souvent coûteuse, mais cette fois avec un accompagnement minimal » (p.2). La construction identitaire de l’enseignant débutant passe par la reconnaissance d’autrui. Le fait d’être perçu comme un professionnel le rassure et l’engage à se professionnaliser (Pérez- Roux, 2012).
En classe, le débutant est confronté à la complexité de l’acte d’enseigner et doit mobiliser des compétences d’ordre multiples pour y faire face : technique et didactique, relationnel, pédagogique et social, vouées à être mobilisées dans les interactions en classe et dans la relation aux différents acteurs du système scolaire (Altet, 1996). Cependant, Piot (2008) relève que: ce n’est qu’au bout de deux à trois ans dans des situations assez stables que l’enseignant construit des routines d’action. Ces routines permettent de mettre en œuvre des unités d’action élémentaires tede les combiner pour orienter et réguler l’action en classe. » (p. 104).
Dans une perspective assez proche, Durand (1996) a hiérarchisé des préoccupations des enseignants et montré que les enseignants débutants ont beaucoup de mal à s’intéresser aux apprentissages des élèves dès lors qu’ils ne maîtrisent pas la classe. Mais c’est aussi au cours de ces premières années d’enseignement que les jeunes enseignants, confrontés à des contextes et des situations variées vont enrichir et diversifier leurs habitus professionnels. (Perrenoud, 2003).
C’est aussi au cours de cette période de connaissance progressive du monde enseignant, que le repérage d’un genre professionnel et la confrontation à différents styles pourront être générateurs de développement professionnel (Clot, 1999). Dans cette optique, il est possible d’envisager la construction professionnelle d’un enseignant entrant dans le métier, entre la perception qu’il a du genre professionnel et le style propre qu’il cherche à affirmer. Y. Clot et Faïta (2000), empruntent la notion de genre à Bakthine (1984) qui l’utilise pour penser l’activité langagière. Ces auteurs installent le genre entre le prescrit et le réel de l’activité. Ils parlent d’un prétravaillé » social, une mémoire et le définissent ainsi:« ce qui leur est commun et qui les réunit sous des conditions réelles de vie; ce qu’ils savent devoir faire grâce à une communauté d’évaluations présupposées, sans qu’il soit nécessaire de respécifier la tâche chaque fois qu’elle se présente. C’est comme “ un mot de passe ” connu seulement de ceux qui appartiennent au même horizon social et professionnel». (Ibid., p.11). C’est un stock des mises en acte », « mise en mots », de « conceptualisations pragmatiques » prêtes à servir. (ibid., p.13). L’existence du genre peut être considérée comme une sorte de norme qui oriente finalement l’action commune d’une vie professionnelle et qui facilite l’exercice du métier. En ce sens, le genre professionnel du métier d’enseignant, ou du moins la représentation qu’il s’en fait peut constituer un repère pour l’enseignant débutant. Le style quant à lui, permet de penser la dimension subjective du métier :« chaque sujet interpose entre lui et le genre collectif qu’il mobilise ses propres retouches du genre. Le style peut donc être défini comme une métamorphose du genre en cours d’action » (ibid., p. 15). Le style est une variation du genre. C’est la manière dont chaque acteur s’empare du genre.
Le concept d’action instrumentée
Nous nous appuierons ici sur les travaux de Rabardel (1995) qui, dans la lignée épistémologique de Vygotski, considère que toute activité humaine est instrumentée et qu’elle peut l’être par la médiation d’instruments techniques, ou psychologiques. La définition qu’il propose de l’instrument, fait apparaître clairement la part du cognitif dans l’utilisation d’un outil technique. Pour lui, l’instrument ne peut être réduit à l’idée d’artefact, celui-ci désignant toute chose ayant subi une transformation, même minime par l’homme. Il s’agit d’un « objet matériel fabriqué» en vue de servir à une action. Cette appellation se veut suffisamment neutre pour qu’il n’y ait pas de confusion avec la notion d’outil ou d’instrument. En effet, avant de devenir instrument, le dispositif physique ou l’outil technique qui sert à l’action, est donc un artefact » fabriqué par l’humain. Il s’inscrit dans des activités finalisées et se transforme en un instrument en situation, c’est-à-dire, lorsque l’homme l’adapte à son activité. L’artefact a donc bien, dès le départ, un statut social, mais c’est l’instrument qui constitue le médiateur entre le sujet et l’objet de son action. C’est ce que Rabardel nomme la « Genèse instrumentale », qui correspond à l’appropriation de l’artefact par le sujet pour en faire un instrument.
L’instrument est en fait composé de l’artefact dans toutes ses composantes et du schème qui accompagne la situation. Pour expliquer les processus à l’œuvre dans l’utilisation d’un artefact en situation, Rabardel s’appuie sur le concept de catachrèse, qui dans le champ de la technologie désigne le détournement d’un objet vers une fonction pour laquelle il n’a pas été conçu à l’origine. Par extension les catachrèses peuvent être considérées comme des indices témoignant du fait que les utilisateurs participent à la conception des usages des artefacts, notamment de la partie de l’instrument que sont les schèmes d’utilisation. « L’existence des catachrèses témoigne de l’institution par le sujet de moyens adaptés en vue des fins qu’il poursuit, de l’élaboration d’instruments destinés à être insérés dans son activité en fonction de ses objectifs ». (p.109) L’instrument est donc un moyen de l’action transformatrice lorsque les fonctions attribuées par le sujet sont orientées vers la transformation de l’objet. Dans ce cas, la médiation est de nature pragmatique et par le biais de variables ou d’entrées auxquelles il attribue de nouvelles fonctions, l’utilisateur prend le contrôle du système et l’instrumentalise selon ses besoins.
Mais c’est aussi en agissant que l’utilisateur prend connaissance de l’objet et lui attribue, dans une médiation, cette fois, épistémique, des fonctions instrumentales orientées vers cette connaissance.
C’est de ce rapport dialectique que naît la « genèse instrumentale » qui signifie l’existence d’un processus plus ou moins long, et toujours en développement, composé de deux mouvements : l’instrumentalisation, définie comme« un processus d’enrichissement des propriétés de l’artefact par le sujet » Ce processus désigne donc le mouvement du sujet vers l’artefact et comprend la reconnaissance et la création de fonctions de l’artefact. Par le biais de ce processus, l’utilisateur prend appui sur les caractéristiques intrinsèques de l’artefact et leur attribue, momentanément ou durablement, un statut en fonction de l’objectif qu’il poursuit au cours de la situation ;
l’instrumentation, qui est liée à la découverte progressive des propriétés intrinsèques de l’artefact, laquelle s’accompagne de l’accommodation de schèmes. Ce processus désigne cette fois un mouvement de l’artefact vers le sujet dont la transformation des schèmes associés à l’artefact, induit une signification nouvelle de l’instrument.
Penser le langage comme un instrument
Poussant plus avant les perspectives ouvertes par Vygotski, Rabardel (1999) propose une théorie élargie de l’action instrumentée où le langage peut être à la fois instrument psychologique et instrument technique. Sa théorie ne se limite pas à un type d’instrument en particulier, qu’il soit psychologique ou technique. Il propose au contraire de caractériser leur proximité et leur différence et de rendre compte de la manière dont les instruments se constituent pour le sujet, dans sa relation aux artefacts inscrits dans l’histoire et la culture dans laquelle il vit.
Il y a dans l’artefact un caractère stable, immuable. Une clé anglaise, demeure une clé anglaise, conçue dans un but précis, même lorsque son utilisateur l’emploi à des fins détournées. S’agissant des instruments psychologiques, le signe apparaît comme un artefact et la signification d’un mot reste stable et ne change pas d’un dictionnaire à l’autre. Mais la distinction établie par Vygotski entre signification et sens, est ici très importante. Elle met en évidence le fait que signification ne contribue qu’en partie seulement au sens du mot, car celui-ci est très variable en fonction de la situation. Cet artefact spécifique qu’est le mot joue un rôle primordial dans les médiations vis-à-vis de soi et des autres. Il est à la fois outil de formation des concepts et instrument de réalisation de la pensée. On peut rapprocher cette idée des actes de langages (Austin, 1970) où la dimension illocutoire confère à la parole l’accomplissement d’un acte, le langage ayant alors pour fonction de transformer des réalités externes. Or, à quoi sert le langage de l’enseignant sinon à transformer l’élève et le faire progresser ? Il est donc un des instruments majeurs de l’activité de l’enseignant, qui choisit ses mots, reformule, s’adresse untel plutôt qu’à un autre, explicite, commente son action, toujours dans un but précis d’apprentissage. En classe, ces actes de langage naissent des interactions maître/élèves au sein, nous l’avons vu précédemment d’un co-activité. A la suite des travaux de Piot (2011), nous croisons la didactique professionnelle avec la pragmatique du langage dont la théorie linguistique interactionniste (Kerbrat-Orecchioni, 2011) rapproche les différents courants.
Comprendre la théorie linguistique interactionniste
Rechercher ce qui organise l’activité au sein des interactions langagières nécessite de comprendre comment fonctionnent les interactions spécifiquement portées par le langage. Les travaux en linguistique sont nombreux et complexes pour qui n’est pas linguiste.
Aussi, dans la lignée de notre choix historico-culturel, nous avons voulu enrichir notre cadre principal : la didactique professionnelle, par la pragmatique du langage et plus particulièrement, par l’apport de la théorie interactionniste linguistique développée dans les travaux de Kerbrat- Orecchioni (2011), dont l’approche éclectique, loin d’opposer les différents paradigmes, les croise, afin que naissent de ces options théoriques complémentaires, les nécessités permettant de comprendre et de décrire de façon satisfaisante le récit conversationnel. Avant de préciser le cadre méthodologique qu’elle propose, nous ferons un tour d’horizon des théories relatives à la pragmatique du langage et à l’épistémologie d’une théorie linguistique interactionniste.
Ainsi, loin de prétendre à l’exhausivité, nous allons, dans la sous-partie qui suit, présenter quelques référents théoriques de nature à nous éclairer sur le fonctionnement du discours et le jeu des interactions entre différentsinteractants.
La pragmatique du langage
La pragmatique postule que le langage permet d’exprimer ses pensées, de transmettre des informations, mais également d’agir sur le monde. La pragmatique, dans son origine philosophique, prend naissance dans la théorie des actes de langage (Austin, 1970, Searles, 1972). C’est une notion centrale de l’analyse des interactions langagières. Austin (1970), part du constat que de nombreuses phrases ne sont pas formulées pour décrire la réalité, mais pour la modifier. Elles cherchent à changer le monde. On parle alors d’un énoncé performatif, par contraste à un énoncé constatif, lequel est soi vrai, soit faux. Il admet que toute phrase complète, en usage, correspond à l’accomplissement d’au moins un acte de langage, celui ci ayant une intention communicative : l’acte locutionnaire est celui que l’on accomplit par le simple fait de dire quelque chose, ce qui correspond au simple fait de parler ; l’acte illocutionnaire est celui que l’on accomplit en disant quelque chose, c’est le fait d’avoir l’intention de provoquer une réaction d’autrui ; l’acte perlocutionnaire est celui que l’on accomplit par le fait de dire quelque chose, il s’agit de la réaction effectivement provoquée chez autrui.
La force illocutoire est particulièrement intéressante dans l’analyse des interactions verbales entre individus, chacun ayant pour but de provoquer une réaction chez l’autre. C’est le cas des interventions de l’enseignant qui ont pour vocation de provoquer chez les élèves une activité cognitive, des réponses, des questionnements, de l’argumentation, de la réflexion sur un l’heure actuelle, les tentatives de formalisation de la théorie des actes de langage s’appuient principalement sur les travaux de Searles (1972), lequel, poursuivant les travaux d’Austin, s’est largement concentré sur la forceillocutoire, au sein d’une théorie de l’action plus large. Selon lui, tout énoncé contient deux parties inséparables : une proposition ou contenu propositionnel, et une force illocutoire qui lui donne sa valeur d’acte de langage. Les deux dimensions essentielles sont les intentions et les conventions. On peut alors voir les actes de langage et les phrases par lesquelles ils sont accomplis comme un moyen conventionnel pour exprimer et réaliser des intentions. Sa contribution essentielle consiste à distinguer, dans une phrase, ce qui relève de l’acte illocutionnaire lui-même, qu’il nomme « marqueur de force illocutionnaire » et ce qui relève du contenu de l’acte et qu’il appelle « marqueur de contenu propositionnel ». Searles ne croit pas beaucoup aux actes perlocutionnaires et s’intéresse très peu aux actes locutionnaires. Il développe sa propre taxinomie des différents types d’actes de langage, en s’appuyant sur certains critères et dégage cinq classes majeures d’actes de langage :
les assertifs (assertion, affirmation…) ; les mots s’ajustent au monde ;
les directifs (ordre, demande, conseil…) ; le monde s’ajuste aux mots ;
les promissifs (promesse, offre, invitation…) ; le monde s’ajuste aux mots ;
les expressifs (félicitation, remerciement…) ; pas de direction d’ajustement ;
les déclaratifs(déclaration de guerre, nomination, baptême…) ; direction d’ajustement double (mots – monde / monde – mots).
Nous rapprochons cette idée de la parole de l’enseignant comme instrument pour accomplir des gestes professionnels, en lien avec des intentions pédagogiques et didactiques lui permettant de faire entrer les élèves dans une situation d’apprentissage. Cette idée nous amène à rapprocher la pragmatique de la dimension cognitive contenue dans toute activité, en nous appuyant sur les travaux de Reboul et Moeschler (1998).
La pragmatique cognitive
Comme le soulignent Reboul et Moeschler (1998), les théories d’Austin et Searles sont basées sur le rejet de «l’illusion descriptive » de l’école générative (Chomsky, 1986) qui place le langage sur le plan de la description de la réalité. Ils ont ouvert la voie d’une pragmatique orientée sur l’influence et les conséquences du langage sur le contexte. Cependant, ces auteurs soulignent également que la théorie des actes de langage n’est pas une théorie cognitive. Il existe un autre point de vue de la pragmatique, celui d’une pragmatique qui s’occupe, à l’inverse, de l’influence du contexte sur le langage. Cette vision s’inscrit dans le courant pragmatique cognitiviste qui voit dans le langage, d’abord un moyen pour décrire la réalité, insistant sur la sousdétermination- langagière et sur l’importance de processus inférentiels dans l’interprétation des énoncés.Dans l’optique de cette nouvelle approche,
Reboul et Moscheler se réfèrent à la théorie de la pertinence de Sperber& Wilson (1982). Celle-ci postule que le but central de la communication humaine est de reconnaître, grâce à un effort coopératif, l’intention communicative de l’interlocuteur, ce qui remet en cause un certain nombre des principes sous-jacents à la théorie des actes de langage, et l’intérêt des classifications proposées par Austin et par Searle. Ils remarquent, à juste titre, que si la détermination d’une force locutionnaire précise est tout à la fois possible et nécessaire, dans de nombreux autres cas, elle est très difficile, pour ne pas dire impossible, et ne paraît pas indispensable à l’interprétation d’un énoncé. Leur suggestion est de réduire drastiquement les classes d’actes de langage à trois classes qui peuvent être repérées linguistiquement, à savoir les actes de « dire que », de « dire de » et de « demander si » :
les actes de « dire que » correspondent globalement aux phrases déclaratives et notamment aux assertions, aux promesses, aux prédictions… ;
les actes de « dire de » correspondent globalement aux phrases impératives, aux ordres, aux conseils… ;
les actes de « demander si » correspondent aux phrases interrogatives et plus généralement aux questions et aux demandes d’information.
Cette théorie de la pertinence est le choix théorique défendu par Reboul Moescheler, comme théorie pragmatique de référence. Elle a été introduite par les travaux de Grice (1979),
philosophe, pour qui le langage répondrait à un principe d’économie ne visant à dire que ce qui est pertinent. Il propose des maximes qui sont supposées être respectées par les interlocuteurs, dont « la maxime de relation » qui postule qu’on parle à propos, en relation avec ses propres énoncés précédents et ceux des autres. Cette maxime est fondatrice de la théorie de la pertinence. Il distingue également deux formes de communication : le sens naturel et le sens non naturel. Un signe signifie de lui-même lorsque sa seule production a du sens et façon non naturelle lorsqu’il est le résultat d’une convention. En ce sens, Grice est un des premiers à développer la théorie inférentielle, au premier plan d’une conception de la communication où l’inférence est incontournable et qui implique que le signe prend sens lorsque, combiné avec le contexte, un interlocuteur peut inférer le sens de ce dernier. Devant les multiples sens accessibles d’un énoncé, un locuteur va sélectionner celui qui engendrera un maximum d’effets face à un minimum d’effort. Grice est donc le premier à donner à la pragmatique une orientation cognitive, en développant un concept très important; celui d’implicature. Il établit une différence entre ce qui est dit (signification linguistique conventionnelle de la phrase) et ce qui est transmis (l’interprétation de l’énoncé). C’est à cette différence que correspond le concept d’implicature, ce faisant, Grice introduit au sein des recherches sur le langage, la notion d’implicite, au moment où la pragmatique interroge les relations entre la signification explicite d’une phrase et l’implicite d’un énoncé. La notion d’implicite, nous la retrouvons dans les travaux de Bakthine (1984) et dans ceux de Ducrot (1972) qui ont développé les idées de dialogisme et de polyphonie, que nous pensons nécessaires à la compréhension de ce qui se joue au sein d’un discours.
Le dialogisme, de Bakthine à Ducrot
La théorie dialogique de Bakhtine est puisée dans des œuvres littéraires, en particulier celles de Dostoïevski, qu’il analyse pour rendre compte de l’esthétique romanesque.
Pour lui, le sens naît des interactions verbales en situation de dialogue où les mots peuvent être traversés de sens divers. Le dialogisme introduit ainsi l’idée d’une existence implicite de plusieurs voix dans les discours qui n’émergent que dans un processus d’interaction entre une conscience individuelle et une autre. Parlant de l’énoncé comme un maillon dans une chaîne, il dit : « Un énoncé est tourné non seulement vers son objet,mais aussi vers le discours d’autrui portant sur cet objet. La plus légère allusion à l’énoncé d’autrui donne à la parole un tour dialogique que nul thème constitué purement par l’objet ne saurait lui donner » (p.302). Pour Bakthine, même s’il est d’apparence dialogale, tout texte est dialogique et plusieurs voix s’y entrecroisent, implicitement ou explicitement, manifestation de la présence d’autrui dans le discours. Il distingue ainsi deux types de dialogisme qui construisent le dialogue : un dialogisme fait des énoncés réalisés ou virtuels quil’on précédé, absorbant ainsi « le discours d’autrui » et intégrant la culture du domaine dans lequel il intervient ; un dialogisme en tant que réponse aux discours antérieurs ou ceux à venir, qui touche ici davantage à la dimension interactionnelle.
Nous retiendrons ici que le locuteur construit son discours à partir du discours de l’autre et la formule très imagée de Bakthine: « les harmoniques dialogiques » lesquelles « remplissent un énoncé et il faut en tenir compte si l’on veut comprendre jusqu’au bout le style de l’énoncé.» (ibid., p. 300).
En France, à peu près à la même époque, le linguiste Ducrot (1972) avançait des idées comparables, en développant le concept de présupposition. Pour lui, les locuteurs doivent partager les mêmes croyances pour que certaines expressions linguistiques soient utilisées de manière appropriée. Il pose ainsi au centre des recherches linguistiques sémantiques du discours, l’implicite, que l’on retrouve dans la notion de polyphonie, notion qui demeure une pièce maîtresse de sa contribution.
Reprenant ainsi l’idée de dialogisme, le concept de polyphonie défendu par O. Ducrot est définie par une activité énonciative comme fruit de plusieurs voix, plusieurs points de vue, repose sur trois thèses :
la distinction entre le sujet parlant et le locuteur ;
certains énoncés présentent plusieurs points de vue ;
le sens de l’énoncé attribue au locuteur différentes attitudes considérées comme des degrés d’adhésion ou de non-adhésion.
Il établit ainsi une distinction fondamentale entre le sujet parlant, celui qui s’exprime dans la réalité, le locuteur, responsable de l’énoncé et l’énonciateur, porteur d’un point de vue.
Dans le contexte de la classe, le discours est éminemment polyphonique dans la rencontre de points de vue divergents et mis en scène dans un discours entre l’enseignant et ses élèves. Ce discours, piloté de manière propre à chaque enseignant, naît des différentes interactions et ne se limite pas à la seule succession des énoncés. Dans la lignée des travaux de Ducrot, Rabatel (2004) analyse les postures énonciatives en situation didactique. Cet auteur montre que le discours entre enseignant et élèves est fait de déséquilibres interactionnels et cognitifs, dans une co-construction de savoirs. Il met ainsi en relation l’étayage de l’enseignant et le processus interactionnel, fait de situations consensuelles ou dissensuelles. C’est en partie dans ce processus que se manifestent les savoir-agir-langagiers des enseignants. Nous développons plus précisément ce point un peu plus loin, au paragraphe 3.3.Mais avant d’envisager le discours dans un contexte didactique, nous nous appuyons sur les travaux de Kerbrat-Orecchioni (2011) pour d’abord en saisir le fonctionnement dans un contexte interactif.
Le fonctionnement du discours-en-interaction
Kerbrat-Orecchioni (2011) consacre ses recherches aux interactions verbales, objet qu’elle a choisi de désigner par « discours-en-interaction ». Il s’agit d’en explorer le fonctionnement et elle choisit pour cela une approche dite « éclectique» qu’elle oppose aux chercheurs et chercheuses qui préfèrent, tout aussi légitimement revendiquerl’appartenance à un courant déterminé. Aux polémiques stériles, elle préfère«Concilier ce qui est conciliable, et voir le pari que l’on peut tirer du croisement de propositions provenant de paradigmes différents.» (ibid., p.21). De tous les courants qu’elle convoque pour analyser le discours-en-interaction, il en est un qu’elle considère comme le plus important, c’est l’analyse conversationnelle dont nous donnons un aperçu ci-dessous à partir des écrits de Kerbrat-Orecchioni.