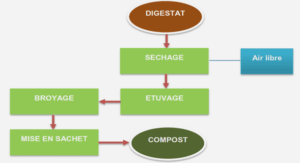Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
L’évolution des outils numériques dans les organisations
Au regard des définitions proposées, nous constatons que l’évolution des outils numériques et leur mise en oeuvre au sein des organisations répond à une problématique d’ordre économique. Leur présence s’est fait ressentir dans les années 50 avec l’automatisation puis s’est développée avec l’introduction des progiciels de gestion intégrés et enfin s’est décentralisée au niveau individuel avec la démocratisation d’internet (Klein et al., 2012). Nous sommes arrivés à la virtualisation des systèmes d’information avec le « cloud computing », autrement dit l’informatique dans les nuages (Klein et al., 2012, page 19). Le déploiement des technologies d’information et de communication correspond aux choix stratégiques et organisationnels des entreprises, stratégies en lien avec les configurations organisationnelles leur permettant de répondre à la financiarisation de l’économie. Ce qui répond concrètement aux objectifs de rationalisation, de qualité, de transparence, de traçabilité, d’augmentation de la flexibilité. Peu importe la forme de l’outil, que ce soit une boîte mail électronique, une base de données, ce que recherche avant tout une organisation, ce sont les services rendus par ces technologies, répondant aux objectifs ci-dessus. Par exemple, une base de données, permettra à toutes les filiales de sortir le même format de reporting répondant ainsi à un autre objectif celui de la qualité mais également de la transparence et de la traçabilité. Avec l’arrivée du « cloud computing », les outils sont mobiles, ne subissent plus la contrainte du lieu physique et offre la possibilité d’accès aux données via des plateformes ou des logiciels d’application à tout moment et à n’importe quel endroit. Nous ne pouvons que constater la démultiplication des outils et leur niveau de complexification, ce qui n’est pas sans effet sur le travail (Klein et al., 2012).
L’utilité des technologies dans les organisations
L’évolution des outils numériques renvoie à la dimension d’utilité pour les organisations. Selon Bidet-Mayer T. et al., (2016) : « Nous assisterons à une disparition progressive de nombreux postes peu qualifiés et à l’émergence de nouvelles tâches nécessitant des compétences spécifiques ». Autrement dit, le numérique ne vient pas remplacer le travail, il va remodeler les contours de celui-ci, engager de nouvelles formes de coopération sur le marché de l’emploi, offrir aux salariés, aux équipes au sein des organisations la possibilité de s’autoréguler, leur permettre de gagner en autonomie et en responsabilités. Selon une récente étude de l’OCDE (Organisation de coopération et de Développement Economique), « les conséquences les plus importantes de l’automatisation et de la numérisation de l’industrie ne seront pas liées aux emplois détruits mais aux changements dans la nature des emplois, les robots ne remplacent pas des métiers mais des tâches ». Les métiers évoluent, les besoins en compétences se modifient. Les tâches manuelles se complexifient, le travail devient plus intellectuel, plus diversifié. Les entreprises n’ont pas en 2017 abandonné le modèle taylorien. On retrouve dans plusieurs entreprises à dimension internationale une grande division du travail conformément au modèle bureaucratique défini par Mintzberg (1982,1986). Et pour autant, comme l’indique Bouillon (2015) ce modèle s’est enrichit, l’entreprise est devenue une « organisation – processus ». Cela correspond : « à une représentation de l’organisation centrée sur des flux continus d’activités allant d’un prestataire vers un destinataire, client, usager ou bénéficiaire [….] il englobe les techniques, outils et méthodes supposés permettre de parvenir à cet objectif ». Ce modèle d’organisation ne concerne pas que le secteur tertiaire, aujourd’hui les entreprises démontrent des tendances à l’isomorphisme mimétique (DiMaggio, Powell, 1983). Elles recherchent à modéliser des fonctionnements, permettant de passer de l’input à l’output. L’objectif étant de modéliser numériquement des processus collaboratifs, des process humains et que ces systèmes d’informations aient la capacité d’articuler les activités collectives des salariés. Si la mise en place d’outils numériques au sein des entreprises est considérée comme le moyen de répondre à la concurrence, aux enjeux commerciaux, aux enjeux de rentabilité, remplacer des tâches répétitives sans valeur ajoutée par une application numérique permet aux salariés de libérer leur temps sur des sujets où le numérique ne peut pas encore intervenir (l’outil n’étant pas paramétré pour des situations incertaines et complexes). Le numérique permet également de déplacer l’utilisation sur le client en le responsabilisant et en le rendant autonome. L’entreprise se libère ainsi de certaines contraintes assez subtilement en surfant sur la tendance qu’ont les consommateurs aujourd’hui à rechercher seuls des informations, à participer et à construire leur produit, leur achat (Bouillon, 2015). En interne, le risque pour une organisation étant de déployer une multitude de progiciels de gestion intégrés demandant aux salariés de naviguer entre plusieurs interfaces. Les salariés dans le cadre de leur travail font preuve de régulation autonome face à l’augmentation des formalisations, des procédures à suivre, des process, des outils à utiliser, face de fait aux différentes injonctions paradoxales que peuvent produire l’utilisation de plusieurs outils numériques. Bidet et al. (2017) évoquent quant à la multi-activité la nécessité de s’adapter, de s’organiser et de gérer les différentes interfaces. Il s’agit de sélectionner, de hiérarchiser l’urgent de l’important, d’être en capacité d’avoir une réflexivité de l’usage des outils et de son temps. Ce qui revient pour un individu à choisir parfois le visible à l’invisible, traiter inconsciemment une tâche répondant aux besoins de son organisation et ainsi pour obtenir une reconnaissance de sa hiérarchie, sélectionner le travail nourrissant certains indicateurs (prenant différentes formes telles que les ratios, statistiques, tableaux de bord). Certains indicateurs auront plus d’impacts et de poids dans la vie d’une organisation que d’autres. Il s’agit des indicateurs prégnants. Ces derniers ont une symbolique particulière de par leur visibilité. Cette visibilité impacte les attitudes et les comportements des individus en situation de travail ; ils tendent à normer, à exprimer une règle à suivre, apportent une tendance de la performance de l’entreprise, ils modélisent et quantifient un évènement (Boussard, 2001). La question que l’on peut se poser est de savoir si représenter une organisation par un ou des indicateurs n’est pas réducteur ? et d’ajouter à cela que sans interprétation par un individu, ils ne peuvent capturer réellement une réalité. Pour que ces indicateurs prégnants puissent mobiliser les individus autour d’un objectif commun, ils doivent être portés par des acteurs légitimes au sein de l’organisation. Une autre limite soulevée par Gode-Sanchez (2007) quant à l’introduction de nouvelles technologies ou de leur utilisation consiste à dire que même si la technologie permet de réduire les coûts (coûts de coordination, Williamson, 1975), les nouvelles technologies peuvent également modifier les formes de coordination au sein des entreprises allant jusqu’à en créer de nouvelles.
L’image du travail
La définition du travail et de l’activité du travail que nous avons tenté d’apporter renvoie à l’image mécaniste du travail que nous avons tous dans notre subconscient, l’image de Charlot, image mécaniste du travail. Cette image fait référence au travail taylorisé. Au XXIème siècle, la montée de l’automatisation dans les organisations a fait se substituer les capacités motrices des individus aux capacités d’adaptation. Le travail est devenu collectif, mobile, technique, poreux et hétérogène dans l’espace-temps, en réseaux. Autrement dit, le travail s’articule, s’organise, s’ajuste, se pilote à distance, utilise différentes interfaces (Favereau et al., 2016, page 103). L’activité du travail a certes évolué dans un sens, s’est enrichie et pourtant avec la numérisation des tâches s’est à nouveau prescrite et contrôlée, parcellisée. Dans un contexte de financiarisation accrue, les organisations ont cherché et cherchent toujours à rationaliser leur production, à réduire leurs coûts et imposent une dictature du chiffre. La gestion moderne des ressources humaines repose sur « quatre piliers que sont (Favereau et al., 2016, page 49) :
▪ Garder la responsabilité de la fixation des objectifs.
▪ Déléguer la responsabilité des moyens pour les atteindre à chaque salarié individuellement,
▪ Individualiser la rémunération selon sa performance.
▪ Le tout dans un contexte de reporting systématique grâce aux outils numériques ».
L’évolution des organisations conduit à l’évolution de l’activité du travail se traduisant par une vision comptable et communicationnelle. Ce constat nous amène à étudier comment les pratiques des outils numériques dessinent de nouvelles frontières au travail ainsi que leurs effets sur les individus en cherchant à identifier les perceptions de ces derniers.
Nouvelles frontières – nouvelles pratiques de travail
Le numérique impacte les différents aspects de la vie et notamment la vie sociale dans la manière d‘utiliser de nouveaux services (Barlatier, 2016). En effet, nous assistons à une reconfiguration des espaces de vie professionnelle et de vie personnelle, mais également de vie économique avec les nouveaux modes d’interaction générant : « de nouvelles manières de créer, de s’organiser, de gérer l’innovation et d’en capturer la valeur » (Ibid.). Autrement dit, le numérique s’invite dans toutes les étapes d’un échange social, d’une construction d’un service, d’une recherche de sources de financements jusqu’à la capitalisation de la connaissance au sein des organisations. Pour gérer ces opportunités offertes par le numérique, les entreprises se sont alignées sur l’utilisation du numérique des consommateurs hors sphère professionnelle en proposant des services connectés, des objets à l’utilisation de plus en plus complexe. L’essence même du numérique se base sur l’ubiquité et son prix. Devant le développement permanent, et les modifications des usages, les entreprises sont confrontées et quelque peu malmenées face aux besoins réguliers d’adapter leurs produits face à la concurrence et aux besoins émergents. En interne, cela remet en question également le fonctionnement des organisations, des relations entre les services pour répondre à ces demandes. Selon Barlatier (2015) et Ben Mahmoujouini (2015), l’usage du numérique se concentre autour de trois familles :
▪ Les outils favorisant la mobilisation des communautés ou des réseaux (internes – externes).
▪ Les outils favorisant l’intrapreneuriat.
▪ Les outils de conception et de prototypage permettant de réduire les couts.
Ces familles peuvent avoir pour effets de remettre en question les configurations organisationnelles des entreprises et notamment les formes d’ambidextrie retenues par ces dernières (structurelle, contextuelle ou de réseaux). Nous pourrions également pousser la réflexion et l’étude jusqu’aux échanges que peuvent avoir les firmes entre elles sur un marché et en quoi le numérique et notamment son développement (investissement en R&D) peut venir reconsidérer les droits de propriété intellectuelle. Peut-être s’agit-il d’une occasion pour les organisations de mettre en place des espaces sociaux temporaires, une reconfiguration des collaborations, un nouveau paysage, de nouvelles frontières, de nouvelles pratiques… Pour De Vaujany et al. (2016), le travail se transforme via l’introduction et l’utilisation du numérique. La crise économique actuelle participe également à la reconfiguration des pratiques de travail telles que nous les connaissons. Que ce soit les jeunes à leur entrée sur le marché du travail ou les séniors ou bien encore les salariés licenciés, la question de l’entrepreneuriat se pose. Nul n’est sans connaitre la dualité que rencontrent les salariés sur le marché de l’emploi entre les formes de contrat CDI ou CDD. De Vaujany et al. (2016) analysent les pratiques de travail à trois niveaux : Source : DE VAUJANY F.X., BOHAS A., FABBRI J., LANIRAY P., (2016), « Nouvelles pratiques de travail : la fin du clivage salariat-entrepreneuriat ? », Rapport de recherche 1, Group on Collaborative Spaces, page 8.
Ces trois niveaux permettent de comprendre comment un individu (1er niveau) de par son statut professionnel peut impacter une communauté (2ème niveau) et ainsi agir sur des transformations d’ordre sociétales (3ème niveau). De manière générale, nous entendons tous parler de dichotomie entre le statut salarié et le statut indépendant. Qu’en est-il ? On associe souvent le statut d’entrepreneur à une aventure, un risque, de la précarité et le statut de salarié à un statut social, une stabilité, une sécurité et un rattachement hiérarchique. Pour faire face à la crise économique de 2008, nombreux sont ceux qui ont cumulé plusieurs activités et notamment associés les statuts (salarié et indépendant), ils sont nommés les « slashers ». Ces travailleurs alternent leur activité de salarié et d’entrepreneur dans le temps.
Cette boucle répond aux besoins de nouvelles compétences attendues sur le marché que l’entrepreneuriat permet d’acquérir et notamment pour les jeunes diplômés sans autre expérience que les stages, avec la capacité à gérer des projets, la capacité à mesurer des risques, la capacité à surmonter la solitude de la création d’entreprise. Ces compétences étant par la suite vendues sur le marché du travail sous la forme de statut salarié. Egalement, cette boucle représente la carrière d’individus qui rencontrent l’ennui au travail. L’ennui étant provoqué par l’institutionnalisation extrême des procédures, la conformité recherchée, ne laissant plus la place à la créativité, à l’expression personnelle. La numérisation des organisations a entrainé le nomadisme et la mobilité des salariés mais également la cohabitation de ces deux statuts, une organisation emploie des salariés mais également manage des indépendants sur des missions ponctuelles. De fait, nous assistons à l’émergence de nouveaux espaces de travail issus de la numérisation où se rencontrent des individus appartenant à ces deux statuts. Ce sont les communautés de travail. Ces communautés ont la particularité de recréer des « cocons familials ». De Vaujany et al. (2016, page 14) ont recueilli les définitions suivantes de ces communautés : « un groupe de personnes qui s’aident mutuellement, une atmosphère amicale, une aide mutuelle ». Les participants y recherchent des échanges plus qu’un espace-lieu ou un espace-technologique.
Si les organisations intègrent aussi bien des indépendants que des salariés sous contrat, cela pose la question des pratiques managériales.
Dans une organisation où l’ensemble du personnel se situe sur un même site, on retrouve un management type top-down, dans une organisation ayant introduit les outils numériques et les mobilités des salariés sur différents sites, on retrouve plutôt une posture de manager – chef de projet et aujourd’hui le manager tend à devenir un community manager avec ce que cela subodore : « un souci d’horizontalité, une animation de don – contre-don, un rejet de la posture hiérarchique, un facilitateur plutôt qu’un ordonnateur ». L’enjeu du community manager réside dans la gestion et la cohabitation des deux statuts au sein de l’organisation, et la maitrise de ses interactions se produisant dans des systèmes ouverts et fluctuants. Ces communautés, ces lieux (fab-lab, hackers, coworking, incubateurs), peuvent être un moyen de réguler les pratiques de travail.
Le travail numérique ? Du crowdworking au crowdsourcing
Nous avons souhaité investigué les notions de travail numérique au travers des anglicismes suivants « crowdworking » et « crowsourcing ». Le « crowdworking », autrement dit, un travail qui se réalise via internet à partir de plateformes numériques. A partir de ces supports, des individus sont en relation soit avec d’autres individus ou des organisations et échangent un produit ou service contre une rémunération (Baudry et al., 2016). L’introduction des outils numériques dans les organisations a pour objectif premier de réduire les coûts (coûts de coordination et d’organisation notamment). Le crowdworking ou dit autrement l’externalisation ouverte du travail permet l’accès à du micro-travail comme le fait Amazon Mechanical Turk (AMT) avec les « Turkers » ou l’accès à des missions à faible valeur ajoutée est demandée. De fait, les plateformes numériques se divisent en deux segments, segments ne faisant pas appel aux mêmes statuts et relations avec l’entreprise offreuse de travail. Là où le crowdworking apporte une rupture quant aux modèles traditionnels, c’est dans la mise en relation des individus avec d’autres individus et pas seulement des organisations avec d’autres organisations. Nous pourrions faire le parallèle avec un retour à l’artisanat où chaque individu spécialisé dans un domaine va proposer ses services à un autre individu, à ceci près qu’avec internet, le terrain de jeu ne se veut plus territorialisé mais mondialisé. Dans ces conditions, la question se pose pour les organisations de « make or buy » (Coase, 1937) ? Est-il préférable pour une entreprise de trouver ses inputs en interne ou de faire appel au marché ? Le travail via les plateformes numériques fait appel par définition à la foule, le « crowdsourcing ». Faire appel au plus grand nombre pour une entreprise afin de disposer des compétences voulues à un moment donné (cazal et al., 2016). Cette forme de travail répond à de nouveaux besoins, que ce soit de la flexibilité pour les entreprises mais également de la liberté et de l’autonomie pour ceux qui répondent à l’offre de travail des entreprises. Le crowdsourcing trouve son origine dans le domaine de l’innovation, quand il s’agit de faire appel à l’externe, à des compétences extérieures à l’entreprise dans l’objectif de générer une valeur ajoutée. En externalisant le travail, l’organisation s’exempt de la relation d’emploi contractuel. La démocratisation du numérique offre la possibilité aux organisations d’avoir accès à des milliers de « human cloud », autrement dit de compétences et d’expertise dont elle ne pourrait disposer si elle devait passer par les dispositifs traditionnels de recrutement. La matérialisation de l’offre et de la demande passe par la plateforme numérique, qui au final reste moins onéreuse qu’une agence de travail temporaire. Dans son fonctionnement, le « human cloud » n’est pas relié contractuellement à la plateforme ni à l’organisation offreuse de travail. Les avantages pour une organisation résident principalement dans la dispense de frais de recrutement, de frais de formation, d’engagement contractuel sur le long terme et dans le bénéfice de ciblage de compétences à l’international. Notons que via les plateformes numériques, les individus se sentent libre de répondre à une demande, de créer à un moment choisi, libre également dans la mise en relation qui ne se fait pas comme dans un process classique de recrutement où le diplôme reste le signal prégnant (Théorie du signal, Spencer, 1973). Cazal et al. (2016) poussent leur analyse plus loin en questionnant le travail, « le travail serait-il libéré de l’emploi » ? Le crowdsourcing, le crowdworking reste inévitablement une rupture avec le modèle traditionnel. Seulement le travail est un construit social, c’est par le travail que l’on produit de la valeur, c’est par le travail que l’individu s’insère socialement.
Nous proposons dans ce contexte d’observer le travail à différentes échelles :
▪ Organisation.
▪ Management.
▪ Individus.
Le travail numérique et l’organisation : entre culture et sens
L’introduction des technologies au sein des organisations et notamment les technologies collaboratives ont été portées par les cabinets de consultants et les prestataires technologiques. Cela vient questionner les impacts de ces nouvelles technologies tant sur le management que sur les modes de coordination. L’introduction du numérique, des technologiques collaboratives répond à un besoin, aux nouvelles formes d’organisation des entreprises dites en réseau, structures moins hiérarchiques offrant une plus grande réactivité. La tendance aujourd’hui est de remplacer ou de juxtaposer les modèles classiques de configuration organisationnelle (Mintzberg, 1983) type bureaucratique vers des modèles de décentralisation de la coordination des activités (Tran, 2014, page 78). Boltanski et al. (2011, page 297) évoquent quant aux structures des organisations : « Le monde du travail ne connait plus alors que des instances individuelles connectées en réseau ». On les nomme également les entreprises « agiles » optant pour de nouvelles manières de travailler et de nouvelles configurations organisationnelles. L’utilisation des nouvelles technologies outre le partage d’informations, la capitalisation des connaissances, la communication synchrone fait émerger de nouveaux modes de travail plaçant ainsi les individus au coeur des interactions. Cela vient questionner les modèles classiques de management notamment sur le profil du manager, du périmètre d’encadrement, de la définition des populations à coordonner, des compétences inhérentes à l’évolution de ses fonctions. Autant d’interrogations auxquelles les entreprises doivent faire face et pour lesquelles s’impose le défi de former leur encadrement de proximité « aux techniques de gestion de l’intelligence collective (Tran, 2014, page 81) ». La réalité du terrain rappelle toute la complexité des apports des nouvelles technologies se heurtant d’une part à un modèle de management type bureaucratique, d’autre part « aux routines organisationnelles existantes » et enfin aux appropriations des TIC différents selon les individus. La pratique des TIC se traduit par un travail polychrone, une reconfiguration du temps, de l’espace, une ouverture et transparence entre les acteurs, une appartenance à des groupes aux liens faibles renvoyant au concept de « nomadisme collectif ». Ce qui interroge les règles de gouvernance qui doit repenser une culture d’entreprise, accepter de reconnaitre les limites de l’organisation en place et des compétences du management.
Le travail numérique et les individus
Nous proposons dans les paragraphes qui suivent de présenter le numérique toujours au travers du concept du travail mais au niveau individuel des salariés.
La compétence numérique
La notion de compétence a évolué, de la qualification nous sommes passés à un modèle de compétences, compétences situées, contextualisées. Seulement, dans un environnement de plus en plus numérisé, les entreprises recherchent des compétences techniques et des compétences comportementales. Selon Datchary (2011), les capacités attendues portent sur : « la capacité à travailler collectivement avec des outils numériques, à gérer les effets de la connexion permanente en termes de dispersion professionnelle ou les conflits entre temporalités professionnelles et extra-professionnelles ». La compétence numérique selon Bouillon (2015) regroupe : « l’ensemble des capacités nécessaires pour travailler individuellement et collectivement avec des technologies numériques d’information et de la communication, dans le domaine de la relation clients et dans de très nombreuses autres activités ». Le salarié compétent numériquement est à même de savoir naviguer avec différents outils, de prendre de la distance, de la hauteur face aux situations, de savoir à quel moment il peut déroger à une règle ou la suivre scrupuleusement tout en ayant en tête son objectif. Si l’individu est seul face à un ou des outils numériques, ou face à une situation dans une relation client, son rôle n’est plus seulement de mettre en application un outil mais d’interagir avec des outils et des clients. Implicitement l’individu en situation s’assure que le client devienne autonome dans l’utilisation d’une interface par exemple et veille à respecter la culture organisationnelle de son entreprise.
Entre accélération et intensité ?
Nous nous sommes intéressés à l’espace-temps en lien avec l’utilisation du numérique. Drevon (2014) reprend le thème de l’oeuvre de Rosa Hartmut (Sociologue allemand) sur la « Théorie critique » à savoir l’accélération sociale. Cette thématique comprend trois dimensions :
▪ L’innovation technique.
▪ Le changement social.
▪ Le rythme de vie.
Rosa Harmut (2013) définit l’accélération sociale comme « un changement de la société affectant la politique, l’art, la science, les relations professionnelles comme la vie domestique et l’éthique ». Il ajoute que les changements structurels et culturels sont plus rapides que la succession des générations. Force est de constater que le rythme de vie a évolué et qu’aujourd’hui les individus ressentent un sentiment d’urgence dans leur vie leur générant du stress. Avec l’évolution des technologies sont apparues les risques psychosociaux. C’est une situation paradoxale dans le sens où les avancées technologiques sont censées être conçues pour faire gagner du temps, gagner de l’autonomie et pour autant les individus manquent de temps. Drevon (2014) explique le phénomène « par le caractère auto-entretenu du processus d’accélération : les bouleversements de la production entraînent des changements sociaux qui accélèrent le rythme de vie, exigeant des progrès techniques ». Les technologies ont eu pour impact dans la vie sociale des individus de modifier les aspects culturels à savoir que les individus grâce aux outils technologiques comme les tablettes, internet, ont tendance à répondre à des besoins immédiats et ne plus consacrer de temps aux activités dit de long terme comme l’écriture ou la pensée. Dans le cadre de l’activité de travail, Bouton (2017) s’intéresse au vécu des individus dans leur rapport au temps et expose les différentes facettes de ce que l’on nomme aujourd’hui le travail dans l’urgence, l’intensité du travail, le travail dans des délais plus courts, les cadences, le rythme, les interruptions fréquentes. Il constate l’empressement des individus, un rapport au temps modifié par l’esprit du capitalisme, par la rationalité, par la performance demandée aux entreprises, par le gain et la productivité. Il évoque une ambiance générale d’urgence, de pression du temps qui se traduit dans l’économie, dans les actes quotidiens des individus dans les sphères professionnelles et personnelles. Les individus réagissent et agissent selon des structures, ces structures se retrouvent aussi bien dans les organisations qui compressent les délais pour gagner en productivité mais également dans leur vie personnelle via par exemple l’augmentation des prix de l’immobilier dans les centres des grandes villes qui ont tellement augmenté ayant pour conséquence un déversement des habitats des cadres dans les agglomérations augmentant ainsi le temps des transports et diminuant le temps de présence sur le lieu de travail. La variable productivité a eu pour effet au sein des organisations de demander plus de tâches à réaliser en moins de temps, de faire preuve : « de mobilité – de polyvalence – d’adaptabilité – de flexibilité – de réactivité ». Ces nouvelles aptitudes ou compétences sont la résultante également du déploiement des outils numériques au plus grand nombre permettant l’accès aux informations, aux interfaces de gestion à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit. On évoque l’hyper connexion, implicitement en équipant les individus de smartphones, d’ordinateurs portables, on espère offrir aux salariés un gain de temps. Cependant, on observe une dérive et un déversement du temps de travail sur la vie privée (en voiture, dans les transports en commun, sur le temps de repos, des vacances). Face aux discours d’une accélération des rythmes de vie, le remède serait le « slow time ». Bouton (2017, page 5) expose la différence entre urgence et vitesse. Selon l’auteur, l’urgence est reliée à la vitesse, « quand il y a urgence, il faut aller vite, accélérer. Parce qu’elle est toujours liée à un danger ou une menace plus ou moins explicite, l’urgence est vécue comme un stress, une souffrance, voire une violence (un vol de temps), alors que la vitesse et l’accélération sont dans bien des cas sources de confort ou de progrès ». Reste à savoir si tous les salariés sont en mesure de faire face et/ou ont la capacité de contraindre les structures de leur environnement de travail, d’identifier ceux qui disposent de la latitude nécessaire pour agir et non subir.
En faisant référence aux travaux de Rosa Hartmut, Bouton (2017) définit l’accélération comme « un processus qui s’autonomise et entraine une crise du temps politique ». Autrement dit, l’auteur fait référence au fait que la politique a un temps de retard face au monde du travail et à l’économie. Si on prend pour exemple le droit à la déconnexion qui est censé venir protéger les salariés des usages des outils numériques, ce droit fait partie du code du travail avec la Loi El Khomri, adoptée en juillet 2016. D’un côté, on négocie dans les entreprises de plus de cinquante salariés le droit à la déconnexion et d’un autre côté, la loi « El Khomri » offre la possibilité d’étendre le temps de travail hebdomadaire des salariés.
Pour conclure sur le phénomène d’intensité, le rythme augmente parce que l’outil permet de répondre instantanément, parce que les individus ont accès à n’importe quel moment et à n’importe quel endroit aux informations, cela conduit naturellement en interne, entre collègues à des échanges écrits (le nombre d’emails internes étant plus important qu’en externe) à imposer des cadences toujours plus fortes.
L’intensité se mesure implicitement dans la connexion en permanence, cela a généré une « culture de l’immédiateté » et de la connexion permanente démontrant les capacités de réactivité des individus et leur engagement, leur présence, révélateur des politiques de gestion souvent préconisées par des tiers intervenants (Klein et al., 2012).
Entre appropriation et usages ?
Après avoir exposé la définition de la compétence numérique et des dimensions d’espace-temps, se pose la question de la mise en scène, de savoir expliquer, de savoir donner du sens et de faire en sorte que les salariés s’approprient l’outil numérique. Pour ce faire, il faut que l’organisation ait construit au préalable une narration autour de la démarche (comme évoqué dans la partie en lien avec l’organisation et le story -telling), construit une modélisation des comportements, des situations types, une acceptabilité, ait mis en récit pour que les salariés puissent se projeter et s’approprier la démarche. Cela permet de rassurer les salariés qui y verront du sens, mais surtout des scénarios auxquels ils pourront se référer en situation. Quant à l’usage, Millerand (1998) le définit de la manière suivante : « l’usage renvoie à l’utilisation d’un média ou d’une technologie, repérable et analysable à travers des pratiques et des représentations spécifiques ; l’usage devient « social » dès qu’il est possible d’en saisir – parce qu’il est stabilisé – les conditions sociales d’émergence et, en retour d’établir les modalités selon lesquelles il participe de la définition des identités sociales des sujets ». L’auteur propose d’étudier en trois phases l’usage des TIC :
▪ Dans une première phase, l’auteur fait référence au « déterminisme technologique » qui renvoie aux impacts de la technologie sur le social, postulant que la technologie dispose d’une autonomie et transforme la société selon les attendus des concepteurs.
▪ Dans une deuxième phase, la technologie passe « entre les mains » des individus et peut avoir une utilisation différente de l’attendu du concepteur.
▪ Dans une troisième phase, les chercheurs s’accordent à dire que « le quotidien joue un rôle considérable dans la formation des usages et donc dans l’appropriation des technologies ». Autrement dit, en prenant en compte le quotidien dans l’usage que fait un individu de la technologie, on prend en compte les tendances sociales de la société en général qui influent sur le mode de vie des individus. Millerand (1998) définit l’objet technique comme « un outil conduisant à une conception de l’usage comme une utilisation plus ou moins fonctionnelle et performante ». En d’autres termes, les attendus de l’usage de l’objet technique, de la technologie vont porter sur le contenu à savoir l’offre de services attachée à l’offre technique (l’objet). Pour comprendre quels sont les usages de la technologie, l’auteur s’appuie sur trois paradigmes. Le premier paradigme auquel elle se réfère est le paradigme diffusionniste. Dans cette approche, on fait fi de la conception et on s’attache à la diffusion de la technologie, à identifier les individus qui vont l’adopter, et aux conséquences pratiques de l’adoption. En se référant aux travaux d’Everett Roggers (1962), professeur d’études en communication, Millerand (1998) reprend le modèle d’adoption caractérisé en cinq phases :
1. La connaissance (l’individu est exposé à l’innovation et acquiert quelques notions sur son fonctionnement).
2. La persuasion (l’individu amorce une prise de position au sujet de l’innovation).
3. La décision (l’individu s’engage dans ses activités lui permettant d’adopter ou de rejeter l’innovation).
4. L’implantation (l’individu utilise l’innovation au quotidien et l’évalue).
5. La confirmation (l’individu tente d’obtenir des informations venant renforcer son choix).
Ces cinq phases permettent à une organisation de suivre le taux d’adoption de la technologie. La finalité de ce courant de recherche est prescriptive et permet de décrire la circulation d’une innovation au sein d’une entreprise. Les biais de cette approche sont d’une part dans la non prise en compte de l’abandon de la technologie par un individu suite à la phase d’adoption et d’autre part dans la passivité des usagers face à la technologie effectuant un choix binaire (acceptation ou refus de la technologie).
Le deuxième paradigme auquel se réfère Millerand est l’approche de l’innovation, qui consiste en l’étude des processus d’innovation technique, soit au moment de la conception. Cette approche étudie les usages de la technologie en situation.
Et enfin, le troisième paradigme de référence de l’auteur est l’école de la traduction. Ici, est évoqué un « système socio-technique » où on cherche à identifier la dimension sociale de l’innovation et les interactions des acteurs qui participent à cette innovation. L’idée étant « qu’un système socio-technique se stabilise après qu’une série d’opérations de traduction, d’enrôlement, ou d’intéressement aboutisse à la constitution d’alliances et/ou d’oppositions entre divers acteurs ». Autrement dit, le processus d’innovation est une suite d’étapes où différents acteurs y sont en relation. Le biais dans cette approche est l’absence de prise en considération de la pratique pouvant influencer la technique.
Les caractéristiques du métier de consultant
Une des caractéristiques principales du métier de consultant relève de son appartenance à des sociétés où l’activité consiste à mobiliser, mettre à disposition des connaissances, une expertise spécifique, dans l’objectif de proposer des solutions aux clients (achat de prestation intellectuelle). L’activité de ce travail appartient aux métiers dits intellectuels. Il convient cependant d’essayer d’apporter une définition du métier avant de pouvoir en définir les contours. Trois aspects sont à considérer dans la définition : le travail dans le sens fonction de production, l’oeuvre en tant que création de connaissances, l’action vue comme le comportement de l’individu en société soit sa profession (Monnier-Senicourt, 2008). La profession de consultant comme toute profession fait référence à un collectif d’appartenance, des comportements communs, des normes, des représentations, amenant les individus à partager une identité commune. Le consultant en organisation ou transition professionnelle travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire où chaque individu de par sa formation est spécialisé dans un domaine. Le client choisit le consultant selon la réputation du diplôme obtenu. En effet, quand une entreprise décide de faire appel à un cabinet conseils, il s’avère qu’en interne elle ne dispose pas des connaissances et compétences pour résoudre la problématique. Aussi, l’organisation lance un appel d’offres auxquels les cabinets conseils répondent en y insérant les mini-cv (mini-biographies) des consultants intervenants. Ainsi, l’entreprise choisit selon ses propres critères le consultant avec qui elle souhaite travailler, interagir. Au-delà du choix sur cv, le consultant soutiendra à l’oral devant le comité de direction sa proposition commerciale. Une relation de confiance doit s’établir entre les différentes parties prenantes. L’organisation doit pouvoir être rassurée d’ouvrir ses portes et confier au consultant des données confidentielles. Ce constat établit nous fait nous poser cette question : comment un individu aussi spécialisé soit-il est en mesure de répondre à ces clients ? Une partie de la réponse réside dans la définition au préalable du cahier des charges. Et si « les conseils aboutissent à de vrais résultats, le consultant n’en sera pas le père, puisque ce sera le dirigeant qui sera félicité. Si les conseils n’aboutissent pas, il fera un coupable tout désigné » (Stern, 2014). Ainsi, les caractéristiques du métier de consultants s’articulent autour d’une expertise, de la reconnaissance du diplôme et des aptitudes dans la relation qu’il saura instaurer avec ses clients. Afin de mieux comprendre la fonction production et l’action du consultant en situation, nous avons souhaité approfondir les normes de management de projet et leurs applications en lien avec les systèmes d’information numérisés.
Le travail en mode projet des consultants
L’organisation du travail du consultant se caractérise par une forte division du travail, un travail en mode projets, utilisant différents progiciels afin de tracer l’activité mais également de capitaliser les connaissances dans une approche objectivante (modèle documentation). Le travail se réalisant en partie à l’extérieur de l’entreprise de rattachement, les consultants travaillent à distance et ont besoin d’accès à l’information en permanence. Ce travail nomade amène les organisations à rationaliser leurs actions en proposant des process, des standards à utiliser évitant la perte de temps. Le nomadisme va de pair avec un équipement matériel conséquent se traduisant par un téléphone portable, un ordinateur portable, un accès à distance aux interfaces des logiciels de travail, soit un développement d’outils de communication à disposition aussi bien des managers que des consultants. Ce qui réfère à la théorie du millefeuille dans l’usage des outils numériques, dit autrement un empilement, une superposition d’outils de communication (Kalika et al., 2007). La gestion de projets relève d’une déclinaison du logo gestionnaire de Boussard (2009), présenté dans le paragraphe précédent : La maitrise faisant référence au contrôle des activités en se dirigeant vers le but à atteindre ; La performance faisant référence aux ressources, aux délais à optimiser ; et enfin la rationalité regroupant toutes les actions et interactions devant être rationalisées. Ce logo gestionnaire est traduit dans un référentiel structurant le travail des consultants sous forme de bonnes pratiques à mettre en oeuvre (Bia Figueiredo et al., 2015). Les outils numériques rendent possible aujourd’hui la standardisation du travail intellectuel, ce qui vient questionner le sens même du métier de consultant si par définition ce dernier n’a plus à utiliser ses capacités de création et d’imagination. La réalité quotidienne de leur travail dépend donc des projets sur lesquels ils sont missionnés. En effet, ces projets sont traduits dans la pratique autour d’un système d’information. L’approche est contingente. Les interactions entre les acteurs d’un projet sont structurées par des normes et ces interactions agissent sur la structure de l’entreprise. « Le sens que les acteurs donnent aux normes est un élément majeur de leur appropriation », ce sens évolue selon les usages effectués, partagés dans leur communauté, (Bia Figueiredo et al., 2015). La question de l’expression de l’autonomie des consultants dans leurs pratiques, la manière dont les normes les structurent et la façon de mobiliser les normes dans les interactions font apparaitre les normes de management de projet comme des structures et des ressources. Cela sous-entend qu’elles fournissent des règles auxquelles les consultants peuvent se référer en situation (compte-rendu d’activité, temps à passer, respect des délais), pour faire sens dans leurs échanges, règles pour sanctionner également un comportement ou pour exercer un contrôle, et ressources ou moyens se traduisant par des logiciels, des tableaux de bord, référentiels expliquant quels méthodes et outils mobilisés dans la réalisation du projet. Pour justement permettre à l’expert de se concentrer sur sa valeur ajoutée, les tâches dites digitalisables ont été intégrées à des progiciels de gestion libérant du temps au consultant. Les référentiels sont rarement appliqués dans leur intégralité mais servent de guide, de boite à outils selon le contexte et le besoin du consultant. Le risque de la standardisation des pratiques de management via les SI réside bien dans la perte d’autonomie, de créativité, de libre arbitre, d’appauvrissement des pratiques, et de perte de rationalité réflexive. Et pour autant, l’unicité de chaque projet rend possible l’adaptation pour faire face à « l’impossibilité de l’universalité », (Bia Figueiredo et al., 2015). Les acteurs sont compétents et dotés de capacité réflexive (observer, comprendre et contrôler ce qu’ils font) et si dans la pratique l’écart entre le prescrit et le réel existe, les consultants font face en mobilisant leurs aptitudes de créativité. Le travail intellectuel se virtualise et implique de nouvelles compétences (Lund et al., 2013).
Les risques et tendances
Le rapport du centre d’analyse stratégique (2012) « L’impact des TIC sur les conditions de travail » fait ressortir cinq risques principaux des effets du numérique sur les conditions de travail :
▪ Une augmentation du rythme et de l’intensité du travail.
▪ Un renforcement du contrôle de l’activité pouvant réduire l’autonomie des salariés.
▪ Un affaiblissement des relations interpersonnelles et/ou des collectifs de travail.
▪ Le brouillage des frontières spatiales et temporelles entre travail et hors travail.
▪ Une surcharge informationnelle (Klein et al., 2012, page 4).
Les caractéristiques des impacts des technologies sur le contenu du travail présentent des tendances qui n’ont pas les mêmes proportions selon les organisations. Pour autant, on peut régulièrement lire et/ou entendre « la remise en cause des cadres traditionnels de l’espace et du temps de travail via notamment la mise en place du télétravail, la dématérialisation des tâches, les notions de transparence et de traçabilité exigées, l’abondance d’information à traiter, une augmentation de l’interactivité des individus, des échanges écrits de plus en plus nombreux » (Klein et al., 2012, page 12). Ces tendances peuvent impacter positivement ou négativement le travail, tout est question d’empilement et de cumul. Les enjeux qui gravitent autour de la mise en place des technologies au sein des organisations concernent l’amélioration des conditions de travail (enjeu social), l’augmentation du niveau de productivité (enjeu économique), et un dernier enjeu d’ordre sociétal via la mise en place du haut débit sur le territoire (Klein et al., 2012). Ces enjeux vont devenir les préoccupations des entreprises au regard du volume d’informations numérisées que leurs salariés traitent au quotidien et nous observons déjà un intérêt de certaines organisations face à ces sujets avec notamment la mise en place de groupe de travail pour réfléchir à la sécurité informatique, à la mise en place de charte de comportements en vue d’une maitrise des échanges emails par exemple (ibid).La représentation ci-dessous illustre les principaux impacts de l’introduction des nouvelles technologies dans les organisations dû à l’environnement international dans lequel elles naviguent.
La surcharge informationnelle et communicationnelle
Si d’une part, les outils technologiques ont eu pour effet de modifier le rapport au temps des individus dans leur vie privée comme dans leur vie professionnelle, que les politiques de gestion se sont saisies du numérique avec pour effet une intensification du rythme de travail, cela nous amène naturellement à un risque de surcharge informationnelle et communicationnelle. La pression temporelle alliée à une faible latitude de gestion, alliée également à l’abondance d’informations à traiter (un salarié est souvent face à des injonctions paradoxales et également face au traitement de données qui ne le concernent pas), induit un risque de stress chez l’individu. Le secteur tertiaire est particulièrement concerné par les risques des conditions de travail liés au numérique. La multiplication des échanges et des supports de communication fait que les individus hiérarchisent les tâches urgentes des tâches importantes. Les risques psychosociaux se traduisent dans ce secteur par des pertes de concentration, par de la fatigue, par une augmentation du sentiment de ne pas avoir les moyens de faire face, ainsi que de l’énervement et de l’irritation (Klein et al., 2012).
L’interrelation de l’évaluation – du contrôle – de l’autonomie
Les politiques de gestion se traduisent dans les pratiques managériales et ont pour effet d’utiliser les outils numériques pour d’une part évaluer le travail et d’autre part contrôler les activités des salariés au nom de la performance et des objectifs à atteindre (Klein et al., 2012). L’évaluation permet de mesurer une quantité afin d’en définir une valeur, valeur que l’on va comparer à d’autres valeurs afin d’agir, de prendre une décision quant au contexte ou la situation dans laquelle est mesurée cette dite valeur. Quand cette valeur concerne les individus, cela sous-entend d’avoir la possibilité de classer, de hiérarchiser soit des statuts soit des positions sociales. Dans les organisations actuelles, chaque salarié est évalué, bilan professionnel, entretien individuel annuel, entretien de seconde partie de carrière. Ces évaluations servent à vérifier l’engagement des individus dans leur entreprise mais également à vérifier l’atteinte de leurs objectifs, et permettent à une organisation de rendre compte des activités. Selon Dayan (2004), l’évaluation : « suppose de mesurer l’activité de travail sous la forme d’indicateurs. Ces indicateurs sont le fruit des entreprises, selon l’organisation. Ces indicateurs sont censés représentés ce que font les individus individuellement pour montrer leur contribution à la performance de l’entreprise ». C’est un modèle de gestion correspondant au modèle bureaucratique des grandes entreprises (Pichault et Nizet, 2000). Les critiques de l’évaluation portent principalement sur ce que De Gaulejac (2005) nomme « la quantophrénie », autrement dit la maladie de la mesure ; ce que Bourdieu (1964) considère comme le « fétichisme du chiffre ». Notons toutefois que l’évaluation a évolué au fil du temps et a également été modifiée dans le sens où d’un modèle de classification des postes, nous sommes passés à un modèle de compétences. En d’autres termes, d’une évaluation liée à la qualification ou au diplôme, nous sommes passés à un modèle individualisant où le salarié au-delà de son diplôme n’est plus seulement évalué sur son poste mais sur ses capacités à utiliser, mettre en oeuvre les différentes ressources à sa disposition.
Les enjeux pour les entreprises sont l’optimisation des flux clients et des procédures, la rationalisation pour mieux évaluer, la normalisation des interactions pour vendre plus. La normalisation passe par la standardisation des savoirs faire et des pratiques organisationnelles. Normaliser structure les activités au quotidien. Les résultats démontrent que la normalisation permet l’évaluation. Les évaluations sont internes quand elles font entrer en relation la hiérarchie et le salarié et sont externes quand il s’agit d’audit qualité, de normes, d’agrément, de questionnaires qualité ou de clients mystères. Mais peut-on parler d’industrialisation des services quand on ne vend pas de marchandises ? Gadrey (1994) indique que l’on peut évoquer l’industrialisation des services quand « le service entre dans un schéma de processus, quand « son mode d’organisation se mécanise, induisant un travail d’exécution réglé selon des procédés standardisés ». L’auteur ajoute également que le service s’industrialise quand « sont utilisés des critères industriels de jugement des performances ». La normalisation inscrit une logique de transformation des savoir-faire professionnels en savoir-faire organisationnels, met en place des procédures formelles que l’entreprise contrôle. Si on norme des emplois, on en vient à normer des relations avec les clients, les normes visent les tâches routinières et répétitives. En normant des interactions, on propose des codes, des postures, des process à suivre dans les relations ceci dans l’objectif de mieux exploiter la relation et de mieux placer d’autres produits pour vendre, gagner en rentabilité. Quand on normalise une activité, on décrit précisément les tâches à effectuer, selon sous-entend de pouvoir contrôler au mieux l’activité des individus, mais également de mesurer si le salarié s’investit dans son travail, mesurer l’engagement des individus. Normaliser, diviser le travail renforce le clivage entre les salariés, entre ceux que l’on peut utiliser comme variable d’ajustement selon la nature de la tâche et ceux que l’on va suivre, que l’on va former. Le contrôle, l’évaluation peut se faire en externe également via des questionnaires qualités mais également des audits qualités, des clients mystères. L’impact est direct, vise l’évaluation d’une entreprise, d’un établissement et peut fragiliser une performance collective.
Encore une fois, les nouvelles technologies sont pensées pour remplacer des tâches routinières, laissant ainsi du temps aux individus pour des tâches à valeur ajoutée. Autrement dit, utiliser un outil numérique dans le discours des organisations permet aux salariés de gagner en autonomie. En situation, les pratiques managériales issues des politiques de gestion, tendent à utiliser les outils numériques comme instrument de contrôle et de prescription (Klein et al., 2012). Cela se traduit par un contrôle des temps, chaque tâche ayant un temps prescrit, et ce dans un souci de rationalisation du travail, de standardisation des tâches permettant de répondre aux exigences des normes qualité. C’est la raison pour laquelle, les salariés ressentent une perte d’autonomie dans leur travail du fait du suivi en temps réel de leurs activités, des résultats (Klein et al., 2012). Le contexte, la configuration organisationnelle ainsi que les pratiques managériales expliquent l’usage des outils dans les organisations et les impacts négatifs inhérents pouvant déclencher selon les cas un sentiment de manque de confiance de la part de l’employeur. Dans le secteur de la relation clients, le métier repose à la base sur une personnalisation de la relation à autrui et pour autant en utilisant les progiciels de gestion qui prescrivent les tâches à effectuer, cela vient contredire le sens même du métier. Le mode opératoire ici vient se substituer à l’autonomie. On assiste à une injonction paradoxale dans le sens où pour gagner en performance, en visibilité face à la concurrence, on médiatise et communique sur la différence de service rendu/offert aux clients.
La coordination sous l’angle de la théorie de la structuration et ses limites
La théorie de la structuration (Giddens, 1984) permet à la recherche en sciences de gestion, d’analyser l’organisation et les interactions avec les individus dans un environnement en mouvement. Elle permet de ne pas considérer les structures comme fixes : « Les structures, ensemble de règles et de ressources, organisent les activités tout autant que les activités les organisent et leur donnent du sens et une finalité (Kechidi (2005, page 348) ».
Deux concepts sont au coeur de la théorie de Giddens (1984) : « la dualité de la structure » :
▪ 1er concept étant celui de l’action, Giddens (1984) considère les individus compétents, sachant ce qu’ils font, quand ils le font, maitrisant leurs actions dans le temps et dans l’espace. « S’ils maitrisent leurs actions et les comprennent, de par ce contrôle ils apprennent de leurs actions et modifient ainsi le processus de causalité ».
▪ 2ème concept étant celui de la structure : une structure est composée de règles et de ressources. Les acteurs dans une organisation utilisent ces règles et ces ressources dans leurs actions et interactions avec autrui ou la technologie. C’est une boucle dans le sens où la structure va contrôler ou orienter l’action d’un individu et cette dite action va impacter, agir sur la structure. Ainsi la structuration, qui pense l’action des individus, identifie le caractère récursif de leurs activités. Selon Giddens (1984), l’action humaine n’est pas déterminée et autonome, elle est inscrite dans un processus (Leclercq-Vandelannoitte, 2010, page 39) faisant référence à :
▪ Un contrôle réflexif : autrement dit un individu comprend et situe son action.
▪ Une rationalisation : autrement dit un individu sait expliquer son activité.
▪ Une motivation : autrement dit un individu a des désirs pour entrer en action.
SI la théorie de la structuration, de par sa dualité, permet dans ce sens d’analyser les dynamiques individuelles et collectives en essayant de définir ce qui les relie, par dualité seront entendus deux principes complémentaires dans les approches d’une organisation à savoir l’organisation vue comme une structure et l’organisation vue comme un processus. Cette théorie offre une grille de lecture quant aux comportements, aux interactions des individus dans un contexte spatio-temporel situé au travers de structures (structure des systèmes sociaux, composé de règles et de ressources façonnant les interactions sociales en trois dimensions : (Habitudes ; Normes ; Schémas d’interprétation).
Les individus s’appuient sur leurs connaissances (tacites ou explicites), sur les moyens à disposition et sur des normes pour agir. Ces trois dimensions permettent de comprendre leurs pratiques (Figure 1).
Positionnement épistémologique et méthodologie de recherche
Nous allons présenter le positionnement épistémologique ainsi que le choix de la méthodologie de recherche utilisée dans le cas de l’étude du cabinet altedia en Provence. Dans un premier temps, nous exposerons le paradigme épistémologique dans lequel s’inscrit notre procédé de recherche. Puis dans un deuxième temps, nous présenterons la méthodologie inhérente, justifiant le choix de l’étude de cas et de la collecte des données issues du terrain de recherche.
Le positionnement épistémologique
Pourquoi s’inscrire dans un paradigme ?
Etudier un objet de recherche doit s’inscrire dans un cadre de conception de la connaissance permettant de justifier des connaissances afin qu’elles soient reconnues par la communauté de recherche. Ce cadre se nomme un paradigme épistémologique, entendu par là un ensemble de croyances, de valeurs, de techniques qui sont partagées par la communauté de recherche (Avenier et al., 2012, p. 2). Les objectifs sont de pouvoir justifier de la validité et de la fiabilité des connaissances produites dans le cadre épistémologique dans lequel le chercheur s’inscrit selon ses affinités mais également selon l’objet de la recherche, s’appuyant ainsi sur des références existantes et offrant un cadre dans lequel l’enquêteur peut prendre du recul.
Le paradigme du réalisme critique
Dans le cadre de la rédaction du mémoire de fin d’année, nous accordons une importance à la présentation du positionnement épistémologique, à la justification des données afin de démontrer que les connaissances produites sont réfléchies et justifiées.
Un processus épistémique se construit autour d’un questionnement :
▪ Qu’est-ce que la connaissance ? cela renvoie au niveau ontologique.
▪ Comment cette connaissance est élaborée ? cela renvoie à un niveau épistémique.
▪ Quelle est la valeur de la connaissance produite ? cela renvoie à un niveau méthodologique. Ces éléments sont indispensables pour se situer et justifier de la pertinence du courant épistémologique dans lequel nous nous inscrivons au regard de l’objet de recherche et de la méthodologie de recherche que nous appliquerons. Le questionnement épistémologique ne s’arrête pas à la réflexion sur la méthodologie mais cherche à identifier comment seront justifiées les connaissances qui seront construites (Gavard-Perret et al., 2012). Un positionnement épistémologique fait référence aux convictions personnelles d’une personne, du chercheur mais s’appuie également sur la nature de la recherche. Dans le cadre de la rédaction de ce mémoire et de la nature de la recherche, nous avons hésité entre deux paradigmes que sont le constructivisme pragmatique (Le Moigne, 1995) et le réalisme critique (Tsoukas, 1989). Nous avons finalement choisi de nous appuyer et de nous inscrire dans le courant du réalisme critique dans le sens où l’hypothèse ontologique du courant de recherche constructivisme pragmatique ne se prononce pas sur l’existence d’un réel profond et que l’hypothèse épistémique de ce courant de recherche suppose que la réalité est dépendante de l’observateur. Or, au regard de la nature de la recherche à savoir l’étude de l’influence du numérique sur le travail, nous rejoignons les hypothèses associées au courant de recherche du réalisme critique dans le sens où l’objet numérique existe en tant que tel tout comme l’usage de l’objet sans que l’enquêteur de par sa présence vienne interférer dans l’existence de ces réalités. Avant de présenter plus en détail le courant de recherche du réalisme critique, nous avons souhaité apporté la définition de la réalité par Michel Callon (1986, page 185) « La réalité est un processus. Elle passe (comme on le dit d’un corps chimique) par des états successifs, se réalisant ou s’irréalisant en fonction des épreuves de force qui s’engagent ». Ce sont ces ordres de réalité et processus que nous souhaitons étudier dans le cadre de ce mémoire. Le réalisme critique est un courant représenté comme étant une extension du post-positivisme et présente des hypothèses d’ordre ontologique.
L’hypothèse ontologique de l’approche du réalisme critique considère que le réel en soi existe. Il est indépendant de l’attention qu’on lui porte et antérieur à l’attention qu’on peut lui porter. Le réel est stratifié en trois domaines (Bhaskar, 1998) :
▪ Réel profond : les mécanismes générateurs, les structures, les règles y résident.
▪ Réel actualisé : ce sont les actions provenant du réel profond.
▪ Réel empirique : il représente les perceptions humaines du réel actualisé.
Rapporté à notre étude, il s’agit pour nous d’étudier l’usage des outils numériques auprès des consultants au sein du réel empirique, de comprendre quels sont les mécanismes générateurs provoquant des usages, usages acceptés ou validés par le plus grand nombre venant ainsi influencer le contenu du travail voire le métier même du consultant.
Deux principes régissent le courant du réalisme critique (Gavard-Perret et al., 2012, page 33) :
▪ 1er principe d’intransivité : les mécanismes générateurs existent et oeuvrent indépendamment du fait qu’on les ait identifiés.
▪ 2ème principe de transfactualité : les mécanismes générateurs existent même quand cela ne se manifeste pas dans le réel empirique.
Ces mécanismes générateurs seront activés par des circonstances : intrinsèques (les mécanismes générateurs ont des règles internes de fonctionnement) ou extrinsèques (les mécanismes générateurs sont déclenchés dans certains contextes).
L’hypothèse épistémique de l’approche du réalisme critique aborde de la manière suivante le réel :
1. Le réel profond ne peut s’observer directement.
2. Le réel actualisé est observable.
3. Le réel empirique est connaissable.
Il s’agit d’identifier les mécanismes générateurs qui dans le principe d’intransitivité et de transfactualité existent même s’ils ne peuvent s’observer dans le réel empirique, de comprendre le mode d’activation de ces derniers (intrinsèques ou extrinsèques). Autrement dit, en rapport avec notre terrain, nous nous attacherons à identifier quelles sont les circonstances provoquant tel ou tel usage du numérique, également de comprendre quels sont les codes explicites ou tacites rattachés à cette profession entrainant un usage ou non usage du numérique.
Le raisonnement dans la méthodologie utilisée pour constituer des connaissances consistera en une approche abductive, en aller-retour entre trois strates que sont le réalisme profond, le réalisme actualisé et le réalisme empirique. En d’autre termes, le chercheur tente d’identifier « le mécanisme générateur qui rend la relation entre A et B intelligible » (Gavard-Perret et al., 2012, page 34). Selon les réalistes, les pouvoirs causaux comme par exemple en gestion (le souci d’efficience, le contrôle) appartenant à une structure agissent selon les relations de pouvoir dans l’organisation, selon les contextes. Ici, dans le cadre de l’étude de l’influence du numérique sur le travail rapporté à la profession de consultants, nous nous attacherons à observer quels sont les contextes, les relations de pouvoirs dans l’organisation en lien avec notre objet, le pouvoir de l’usage du numérique venant influencer les pratiques de travail. En essayant de définir quels sont les pouvoirs causaux, autrement dit les mécanismes générateurs, les chercheurs appartenant au courant du réalisme critique cherchent à montrer les tendances qui peuvent se manifester dans le réel empirique. Les mécanismes générateurs interagissent dans les organisations et ne produisent pas de résultats déterminés. Dans le processus, Bhaskar (1978) indique que la première étape consiste en la description des composantes (conceptualisation), puis la deuxième étape (empirie) en demandant aux acteurs pour quelles raisons les actions ont eu lieu. La recherche empirique permettra de démontrer la relation entre les interactions et les pouvoirs causaux selon les contingences (Tsoukas, 1989). Nous ne pouvons pas dans le cadre de notre étude certifier que tous les consultants auront le même usage du numérique dans leurs pratiques de travail.
Le raisonnement abductif semble approprié car il offre la possibilité d’émettre des conjectures sur les causes des phénomènes observés. Une fois les conjectures établies, elles sont mises à l’épreuve au travers la théorie via des tests empiriques. Ce raisonnement permet un aller-retour entre l’induction et la déduction. La déduction est un raisonnement indépendant de l’expérience, l’induction part d’un grand nombre de faits pour en tirer une loi générale. Aussi, l’abduction permet de compléter ces deux formes de raisonnement.
Les sciences de gestion étant pensées dans les sciences de l’artificiel (Simon, 1969) puisque l’objet d’étude est une création de l’homme et non une création de la nature. L’auteur développe l’idée selon laquelle certains chercheurs produisent des connaissances via des artefacts finalisés, insérés dans des contextes sociaux. Un artefact est un système crée par l’homme pour atteindre des objectifs et fonctionner dans un certain contexte. L’auteur ajoute que certaines sciences ne peuvent s’étudier dans les sciences de la nature car ce sont des sciences qui s’intéressent à l’évolution des artefacts dans leur contexte. Les sciences de l’artificiel en ce sens permettent de comprendre les systèmes dans lesquels on retrouve des régulations humaines, des intentions humaines et des régulations naturelles. Notre objet d’étude portant sur l’influence des usages du numérique sur le travail s’inscrit effectivement ce cadre, ayant pour objectif l’étude des usages du numérique auprès d’une population cible dans un contexte donné.
Pour les réalistes, l’explication tient dans le pouvoir causal accordé aux objets et non à un certain déterminisme. La question est de savoir si le pouvoir causal de l’objet se déclenche dans le réel ou l’empirie et selon quel contexte. Touskas (1989) ajoute à cela que des pouvoirs émergent quand les individus et les objets sont reliés entre eux et forment ainsi une structure, entendu par là qu’une structure est un ensemble de règles et de ressources agissant sur les interactions. « Ces règles forment l’interaction tout en se reproduisant dans ce processus d’interaction (Giddens, 1976, 1984, Manicas, 1980) ».
Dans le cadre de l’étude de l’influence du numérique sur le travail rapporté aux métiers des consultants, l’outil numérique en tant que tel dispose de propriétés intrinsèques puisque conçu pour une utilisation prédéfinie. Il nous revient d’étudier comment l’usage de l’outil selon le contexte, l’individu avec ses propres croyances, valeurs et perceptions vient modifier ou non la structure de son environnement jusqu’au contenu de son métier.
|
Table des matières
PARTIE 1 : THEORIE
1. LE NUMERIQUE ET SON EVOLUTION
1.1. La transformation numérique
1.2. Des TIC au Big Data
1.3. L’évolution des outils numériques dans les organisations
1.4. L’utilité des technologies dans les organisations
1.5. Les défis du numérique
2. LES CONTOURS DU TRAVAIL A L’ERE DU TOUT NUMERIQUE
2.1. Qu’est-ce que le travail ?
2.2. L’activité de travail
2.3. L’image du travail
2.4. Nouvelles frontières – nouvelles pratiques de travail
2.5. Le travail numérique ? Du crowdworking au crowdsourcing
2.6. Le travail et les différentes composantes de l’organisation à l’ère du numérique
2.6.1. Le travail numérique et l’organisation : entre culture et sens
2.6.2. Le travail numérique et les managers
2.6.3. Le travail numérique et les individus
2.6.3.1. La compétence numérique
2.6.3.2. Entre accélération et intensité ?
2.6.3.3. Entre appropriation et usages ?
3. LE TRAVAIL RELEVANT DES METIERS DU CONSEIL
3.1.1. Le champ d’interventions des consultants
3.1.2. Les caractéristiques du métier de consultant
3.1.3. Le travail en mode projet des consultants
4. LES EFFETS CONSTATES DU NUMERIQUE
4.1.1. Les risques et tendances
4.1.2. La surcharge informationnelle et communicationnelle
4.1.3. L’interrelation de l’évaluation – du contrôle – de l’autonomie
4.1.4. Et le stress « numérique » ?
5. DE LA THEORIE DE LA STRUCTURATION AUX APPORTS DE LA SOCIOMATERIALITE
5.1. Les approches déterministes
5.2. La coordination sous l’angle de la théorie de la structuration et ses limites
5.3. La technologie en pratique
5.4. Les apports de la sociomatérialité
PARTIE 2 : METHODOLOGIE ET TERRAIN DE RECHERCHE
6. POSITIONNEMENT EPISTEMOLOGIQUE ET METHODOLOGIE DE RECHERCHE
6.1. Le positionnement épistémologique
6.1.1. Pourquoi s’inscrire dans un paradigme ?
6.1.2. Le paradigme du réalisme critique
6.1.3. La justification des connaissances
7. LA METHODOLOGIE DE RECHERCHE – LE TERRAIN
7.1.1. L’étude de cas unique
7.1.2. La méthodologie de l’étude de cas
7.1.3. Le terrain : fiche d’identité Altedia
7.1.3.1. Contexte externe
7.1.3.2. Contexte interne
7.1.3.3. Le profil et les missions du consultant
7.1.3.4. Ma position sur le terrain
8. LA METHODE DE RECUEIL DES DONNEES
8.1.1. La relation entre : éléments conceptuels – processus méthodologique – terrain
8.1.2. La réalisation d’entretiens exploratoires
8.1.2.1. Les résultats des entretiens exploratoires en interne
8.1.2.2. Les résultats des entretiens exploratoires en externe
8.1.3. L’observation participante
8.1.4. La réalisation d’entretiens semi-directifs
8.1.5. La présentation du guide d’entretien
8.1.6. La sélection de l’échantillon
8.1.7. Le traitement des données : un codage sous Excel
PARTIE 3 : RESULTATS
9. LES RESULTATS
9.1. La prescription par les outils numériques : une organisation du travail autour des outils numériques
9.2. L’usage des outils numériques en situation
9.2.1. L’utilité des outils numériques : une approche contingente
9.2.2. Le travail rendu visible par le numérique
9.2.3. Le métier influe sur l’usage
9.2.4. Travail prescrit vs travail réel
9.3. Les mésusages : entre dysfonctionnements matériels et manque de formation
9.3.1. Un manque de pratiques
9.3.2. La compensation comme solution ?
9.4. Les effets constatés
9.4.1. De l’empilement au manque de coopération
9.4.2. Une perte de sens
10. SYNTHESE DES RESULTATS
CONCLUSION
11. TABLE DES ABREVIATIONS
12. TABLE DES ANNEXES
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet