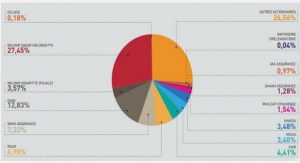Le droit moral de l’auteur
La notion de droit moral est le fruit d’une lente évolution jurisprudentielle et doctrinale, laquelle s’est étendue sur plus d’un siècle avant d’être systématisée par les premiers projets de loi de réforme de la propriété littéraire et artistique. Il s’agit, pour reprendre les termes de PLAISANT, l’un des rédacteurs de la première proposition de loi dont la finalité était d’assurer la protection du droit moral, de reconnaître que « si le créateur est libre de se dessaisir au gré des contrats du bénéfice de son œuvre, il ne lui est pas loisible de rompre le rapport spirituel qui s’établit entre sa personne et les expressions littéraires ou artistiques qui en demeurent le miroir permanent. L’intérêt qu’il doit sauvegarder à travers les vicissitudes de la publication, de l’exposition, du spectacle, de son œuvre est celui de sa propre personnalité. C’est un droit qui domine le négoce : il a le caractère moral». Pour ce faire, il était indispensable, non seulement d’introduire dans la lettre de la loi des dispositions protectrices de cet intérêt, mais encore d’en détailler le contenu, tâche que le législateur a accomplie par l’insertion d’un droit de retrait et de repentir ; droits que nous allons succinctement présenter ci-après. Le droit à la paternité de l’œuvre. Le premier alinéa de l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur jouit du droit au respect de son nom ». Cette prérogative communément désignée par la doctrine sous le nom de droit à la paternité ou droit de paternité, permet à l’auteur d’être reconnu comme « le père » de l’œuvre. Cela étant, ce dernier pourra exiger que son nom soit mentionné sur tout support la recueillant, ou au contraire recourir à l’usage d’un pseudonyme, voire rester dans l’anonymat. Par ailleurs, le droit de paternité est accordé à l’auteur sans considération du genre de l’œuvre, c’est-à-dire que celle-ci doit pouvoir, en tout état de cause, être attribuée à son créateur, son caractère artistique ou utilitaire important peu. Le droit de divulgation. Instauré par l’article L. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle, le droit de divulgation, confère à l’auteur la faculté de demeurer maître de dévoiler le fruit de son travail intellectuel au moment où il le juge opportun, et dans les conditions qu’il aura auparavant déterminées. Ce faisant, l’œuvre entrera « dans le circuit commercial », et pourra être exploitée. Le droit au respect de l’œuvre. Seconde prérogative énumérée par l’article L. 121-1 du Code de la propriété intellectuelle, le droit au respect de l’œuvre, va permettre à son auteur d’empêcher quiconque de la dénaturer, et de porter atteinte à son esprit ou à son intégrité « matérielle ». En effet, il est de jurisprudence constante « qu’il appartient à l’auteur de veiller à ce que son œuvre ne soit ni altérée, ni déformée dans sa forme ou dans son esprit». Toutefois, même si l’esprit de l’œuvre est protégé, le créateur devra, eu égard aux autorisations qu’il a données, ou bien lorsqu’il a cédé son droit d’adaptation, faire preuve de tolérance et accepter que celle-ci soit quelque peu modifiée. Le droit de retrait et de repentir. Illustration par excellence de la supériorité du droit moral sur les considérations d’ordre patrimonial, le droit de retrait et de repentir offre la possibilité à l’auteur ayant cédé son droit d’exploitation de revenir sur sa décision et de retirer l’œuvre de la circulation. Néanmoins, l’exercice de ce droit exige que son titulaire indemnise préalablement son cocontractant, et pour le cas où il envisagerait d’exploiter à nouveau son œuvre, lui accorde un droit de préférence « aux conditions originairement déterminées ». La notion et le contenu du droit moral étant circonscrites, il nous appartient désormais d’examiner ce que recouvre le terme de contractualisation.
La contractualisation
Si la loi est « présumée disposer, non sur des cas rares ou singuliers, mais sur ce qui se passe dans le cours ordinaire des choses», à l’inverse, le contrat est voué à régir « des rapports de droit ou des situations juridiques qui ont un contenu individuel ou concret». Dès lors, le contrat est habituellement « un acte d’exécution du Droit », lequel a pour fonction de permettre aux individus d’organiser leurs relations au sein du cadre légal. Cela dit, au-delà de cette fonction, le contrat peut, parfois, endosser un rôle normatif. Ce sera notamment le cas lorsque les parties souhaitent adapter la règle de droit à la particularité de leur situation et l’assouplir, ou encore combler les lacunes de la loi, voire pallier un vide légal. La contractualisation apparaît alors comme « un procédé de régulation qui implique la participation des acteurs privés à l’élaboration et à l’évolution du droit », sachant que cette participation s’effectuera soit à un niveau interne, soit à un niveau supérieur, le législateur ayant, dans cette situation précise, tendance à associer les « destinataires de la norme » à son élaboration. L’examen des pratiques contractuelles en matière de propriété littéraire et artistique montre que le droit moral n’échappe pas à ce phénomène de contractualisation, sans toutefois dépasser le stade du premier échelon85. Autrement dit, la contractualisation du droit moral n’interviendra qu’entre l’auteur de l’œuvre et le cessionnaire de ses droits, ou en présence d’une œuvre graphique et plastique, entre l’artiste et l’acquéreur de l’œuvre.
Les prémices de la notion de droit moral
Le droit de propriété, premier fondement du droit d’auteur. La problématique liée à la nature du droit d’auteur, notamment sur le fait de savoir s’il est un droit de propriété ou non, peut sembler étrangère à la « supériorité » du droit moral que les premiers théoriciens de la matière, accompagnés des philosophes, de la jurisprudence, et des auteurs eux-mêmes ont pu pressentir. Toutefois, à y regarder de plus près, nous pouvons remarquer que le concept de droit moral a germé dans l’esprit de la doctrine et des juges sur le modèle de la propriété, avant de s’en éloigner pour s’attacher à la personnalité de l’auteur. Dès l’Antiquité, et ce malgré l’absence de dispositions législatives réglementant la propriété littéraire et artistique, un droit de propriété n’en n’était pas moins reconnu au créateur d’une œuvre sur celle-ci. D’autre part, selon Madame DOCK, il serait inexact d’affirmer que la notion d’exploitation attachée à une œuvre faisait défaut, et que les poètes se contentaient seulement des honneurs sans vivre de leur plume. Les écrivains cédaient en effet leurs textes à des éditeurs afin que ces derniers les reproduisent, tandis que les dramaturges cédaient leur droit de représentation sur leurs pièces. Outre l’existence de ces deux droits patrimoniaux, il est établi que le droit moral n’était pas non plus ignoré sous l’Empire romain, les auteurs bénéficiant d’un droit de publication. Dès lors, ils étaient seuls maîtres de la divulgation de leurs ouvrages. En marge de cette prérogative, et même si aucune action ne leur était réservée, la seule sanction étant l’opprobre, les poètes revendiquaient haut et fort un droit de paternité sur leurs textes, et l’exerçaient en dénonçant publiquement les « voleurs de mots ». Pour s’en convaincre, il suffit d’examiner l’épître d’HORACE A Julius Florus, ainsi que plusieurs épigrammes de MARTIAL, lequel comparait ses écrits à ses enfants et leur usurpateur à un voleur d’enfant, ou encore les fameux vers de VIRGILE Sic vos non vobis . L’expression est empruntée à Michel Schneider in Michel SCHNEIDER, « Voleurs de mots : essai sur le plagiat, la psychanalyse et la pensée », Editions Gallimard, Collection connaissance de l’inconscient, Paris 1985. A la suite d’un spectacle donné par l’empereur Auguste interrompu par la pluie, Virgile avait tracé, de nuit, sur la porte du palais le distique suivant : « Il a plu toute la nuit, le matin recommencent les spectacles publics : Auguste partage avec Jupiter l’empire du monde. » Auguste, flatté, demanda à connaître l’identité de l’auteur de ces vers, Virgile ne se présentant pas, un poète du nom de Bathylle s’en attribua la paternité. Virgile ayant découvert le forfait de Bathylle rajouta les vers suivants : « De ces deux petits vers, Romains, je suis l’auteur, et cependant un autre en reçoit tout l’honneur », ainsi que le début des vers suivants « Sic vos non vobis ». Auguste souhaita que les vers fussent complétés, Bathylle, n’en étant pas l’auteur, fut incapable de les achever, ce que fit avec succès Virgile. V. HENNEQUIN, « Cours de littérature ancienne et moderne contenant un traité complet de poétique, extrait des meilleurs critiques et commentateurs », Edition Auguste Semen, Moscou 1821, Vol. 1,p. 111. Deux genres de propriété. Nous pouvons donc remarquer que la conscience d’intérêts extrapatrimoniaux attachés à l’œuvre, reflet de la personne de l’auteur, était présente sous l’Antiquité, ces intérêts ayant pour fondement le droit de propriété que l’auteur détenait sur son œuvre, et de surcroît malgré la cession de l’objet matériel. SENEQUE, en effet, reconnaissait volontiers que deux genres de propriété s’exerçaient sur une même œuvre. L’absence de législation ne peut, en conséquence, que nous conforter dans l’idée que le droit de l’auteur sur son œuvre était naturellement un droit de propriété, lequel n’appelait pas de développements particuliers, compte tenu du fait qu’aucun besoin social en la matière ne s’était fait sentir à cette époque. Les privilèges, justification du recours au droit de propriété. Au Moyen Age, la propriété de l’œuvre n’était pas non plus source de conflits, ceci s’expliquant par le fait que la plupart des ouvrages étaient soit reproduits dans les monastères ou les abbayes, soit écrits par des moines de manière anonyme. En outre, contrairement à ce que nous pourrions penser, la nature particulière des rapports entretenus entre l’auteur et son œuvre n’engendra pas de vifs débats lors de la naissance et du développement de l’imprimerie. Certes, des problèmes se posèrent, mais ils furent de nature économique, et concernèrent essentiellement la corporation des imprimeurs. En effet, le matériel étant onéreux, et les imprimeurs nombreux à avoir investi dans cette nouvelle invention, ces derniers sollicitèrent des privilèges royaux afin d’amortir celui-ci. Ces privilèges consistaient en une autorisation de détenir un monopole d’exploitation sur une œuvre. L’auteur vendait donc son manuscrit à un imprimeur qui en assurait la diffusion auprès du public. Il est à noter que ces cessions ne quittèrent pas « la sphère des conventions particulières» jusqu’au XVIIIème siècle, date à laquelle les créateurs commencèrent à réclamer la reconnaissance de leurs droits, ainsi que leur consécration législative. Toutefois, la qualité de propriétaire de l’auteur ne faisait aucun doute, et est affirmée par l’avocat MARION en 1586 dans son Plaidoyez second sur l’impression des œuvres de Sénèque, revues et annotées par Marc Antoine de Muret. Le fondement, idoine, en était le droit naturel. La justification du droit de l’auteur sur son œuvre par le droit de propriété servira ensuite de fondement pour l’élaboration des théories à l’origine du droit d’auteur, et notamment pour la défense des droits patrimoniaux. C’est ainsi que nous pouvons lire sous la plume des plus ardents défenseurs des droits de l’auteur qu’ « un manuscrit (…) est en la personne de l’auteur un bien qui lui est tellement propre, qu’il n’est pas plus permis de l’en dépouiller que de son argent, de ses meubles, ou d’une terre, parce que c’est le fruit de son travail qui lui est personnel », ou encore « S’il y a une propriété sacrée, incontestable, c’est celle d’un auteur sur son ouvrage ». De la défense des droits patrimoniaux à l’avènement du droit moral il n’y avait qu’un pas, celui-ci fut d’abord franchi timidement par les philosophes allemands KANT (1724-1804) et FICHTE (1762-1814), puis par la jurisprudence et la doctrine dans un second temps. Le pressentiment de la double nature du droit d’auteur. KANT et FICHTE, au cours de leurs études philosophiques, se sont en effet tous deux penchés sur la question de la contrefaçon ; ce qui les a donc tout naturellement conduits à une réflexion sur la nature du droit d’auteur. Dans deux articles intitulés pour l’un : De l’illégitimité de la reproduction des livres paru en 1785, et pour l’autre : Preuve de l’illégitimité de la reproduction des livres, un raisonnement et une parabole paru en 1791122, ces derniers démontrent que deux éléments sont présents dans un livre : l’un de nature « corporelle » et l’autre de nature « spirituelle ». De plus, l’élément de nature spirituelle se scinde à nouveau en deux parties et contient le « matériel » ou « contenu du livre » ainsi que la « forme des pensées », laquelle est inaliénable et appartient de façon exclusive et perpétuelle à son auteur, ce droit étant « un droit de propriété naturel et inné »123. Aussi celui-ci a-t-il « le droit d’exiger que chacun le reconnaisse pour auteur de son livre ». Toutefois, KANT semble être allé plus loin dans la réflexion sur la nature du droit de l’auteur, car selon lui, il est « un droit inné sur sa propre personne »125, et en tant que tel ne saurait être aliéné. En conséquence, l’auteur ne cède pas la propriété de son manuscrit à un éditeur, mais seulement le droit de « diffuser son discours au public »126. L’éditeur, ne sera jamais, en somme, que le mandataire de l’auteur. Par cette affirmation assimilant l’œuvre à la personne de l’auteur, KANT a donc été le premier à ouvrir la voie menant à la théorie du droit moral127. Néanmoins, il serait inexact de lui en attribuer la paternité pleine et entière dans la mesure où sa conception n’est pas suffisamment développée et comporte quelques lacunes. Parallèlement à l’analyse menée par les philosophes sur la nature du droit d’auteur, notamment quant à l’existence d’intérêts extrapatrimoniaux attachés à l’œuvre malgré sa cession, quelques décisions de justice allemandes du XVIème siècle reconnaissent ces mêmes intérêts à l’auteur en lui accordant un droit de publication129. Toutefois, il faudra attendre D’une part parce que KANT dénie au créateur d’une œuvre d’art un droit de paternité sur celle-ci : « Les œuvres d’art en tant que choses peuvent au contraire être imitées, prises en moulage d’après l’exemplaire qu’on en a légitimement acquis, et les copies qui en ont été faites peuvent être mises en circulation publique sans qu’il soit besoin du consentement de l’auteur original. (…) Car c’est une œuvre que toute personne qui entre en sa possession peut aliéner sans nommer une fois son auteur, par conséquent aussi imiter et utiliser en son propre nom comme sienne à fin de mise en circulation publique. », et d’autre part, parce que l’auteur ne dispose pas d’un droit au respect sur son œuvre : « Si toutefois on modifie le livre d’un autre (on l’abrège ou l’augmente, ou le transforme) de façon telle que l’on commettrait même une injustice si on le publiait maintenant sous le nom de l’auteur original, alors la réécriture au nom propre de l’éditeur n’est pas une contrefaçon et n’est donc pas interdite. » in KANT, Qu’est-ce qu’un livre ?., loc. cit.. pp. 130 et 132. V. également en ce sens A. LUCASSCHLOETTER, « Droit moral et droits de la personnalité, étude de droit comparé français-allemand », PUAM 2002, Tome 1, p. 43 : « Son jus personalissimum (…) ressemble fort à l’ancêtre de notre droit moral, ou du moins du droit de divulgation. Il ne s’agit en effet que du droit d’ « empêcher qu’un autre le fasse parler en public sans son autorisation ». Kant ne reconnaît à l’auteur ni la faculté d’exiger la mention de son nom, ni celle de s’opposer à des modifications de son œuvre. (…) On peut donc conclure, avec M. le Professeur Strömholm, que « le titre de précurseur doit … être décerné à Kant ; son droit au titre de fondateur d’une théorie du droit moral paraît (en revanche) plus douteux » ».Les limites du droit de propriété comme fondement du droit d’auteur. Les premières doctrines relatives au droit d’auteur, quant à elles, révèlent que sa justification par le seul droit de propriété ne constitue pas le fondement idéal, compte tenu de la nature dualiste de celuici. L’œuvre, en effet, n’est pas un bien comme un autre, car au-delà de sa matérialité, un lien indéfectible l’unira toujours à son créateur, de ce fait, cette dernière est rétive à toute appropriation absolue. C’est pourquoi les théoriciens, sans abandonner la référence au droit de propriété, ont cherché à ménager tant les intérêts des auteurs, que ceux de leurs cessionnaires en utilisant quelques subterfuges. La jurisprudence de la première moitié du XIXème siècle reflète bien cet état d’esprit, car tout en reconnaissant au cessionnaire un droit de propriété sur l’œuvre acquise, elle le limitera aussitôt en admettant que l’auteur dispose d’un droit de paternité ainsi que d’un droit au respect sur son œuvre, ces deux droits étant hors du champ contractuel lors de la vente initiale, à moins d’une stipulation contractuelle expresse et particulière, et ce, indépendamment de tout préjudice ou atteinte à son honneur ou à sa réputation artistique. De même, toute altération postérieure de l’œuvre ne saurait être envisagée par l’éditeur sans avoir recueilli, préalablement et par écrit, le consentement de son auteur. Cette position découle notamment d’une décision du Tribunal Civil de la Seine en date du 17 août 1814132. Dans cette affaire, les juges ont en effet estimé « qu’un ouvrage vendu par un auteur à un imprimeur ou à un libraire, et qui doit porter son nom, doit être imprimé dans l’état où il a été vendu et livré, si l’auteur l’exige, et s’il n’en a pas été autrement convenu, sauf les fautes de typographie s’il s’agit d’un ouvrage déjà imprimé, et les fautes d’orthographe s’il s’agit d’un manuscrit, (…), et de ne faire, pour le surplus, des changements que du consentement par écrit [de l’auteur] », même « s’il résulte qu’aucun de ces changements n’est considérable, susceptible d’altérer le fond de l’ouvrage, ni de causer aucun préjudice quelconque à son auteur ni à sa réputation littéraire ». La protection de la « réputation littéraire » de l’auteur. Cette décision appelle plusieurs remarques. En premier lieu, nous pouvons relever qu’il a été jugé que la propriété littéraire est d’un genre particulier. A ce titre, l’auteur ne se dépouille pas du droit de voir son nom apposé sur son œuvre, ni du droit de voir son ouvrage « imprimé dans l’état où il a été vendu et livré » au moment de la cession de son manuscrit. Cela ne signifie pas pour autant que le droit de paternité et le droit au respect sont inaliénables, mais que ceux-ci doivent faire l’objet d’un contrat spécial. Cette conception du droit de l’auteur sera confirmée à plusieurs reprises par plusieurs décisions ultérieures , la jurisprudence entérinant au reste ces cessions ; l’arrêt le plus emblématique en la matière ayant été rendu par la Cour d’appel de Paris dans l’affaire DUMAS c/ MAQUET le 14 novembre 1859, celle-ci ayant effectivement décidé que : « Le droit de mettre son nom sur des œuvres littéraires peut être valablement aliéné » 134 . En second lieu, nous pouvons noter que ce jugement fait référence à la « réputation littéraire » de l’auteur. Or, et même si en l’espèce la réputation de l’auteur n’est pas en cause, ce sera cette notion, entre autre, qui sera couramment utilisée jusqu’à l’avènement du droit moral tel que nous le connaissons aujourd’hui, pour protéger les intérêts extrapatrimoniaux de ce dernier. En effet, un jugement et un arrêt rendus l’un en 1850 par le Tribunal correctionnel de Paris, et l’autre par la Cour d’appel de Paris en 1856, reconnaissent que l’auteur dispose non seulement d’un intérêt pécuniaire, mais également d’un intérêt personnel sur ses œuvres, à savoir : sa réputation. L’exception des œuvres collectives. Il sera donc constant, par la suite, de retrouver dans la jurisprudence de la première partie du XIXème siècle, que l’auteur conserve un droit de propriété sur son œuvre malgré la cession de celle-ci, le tout ponctuellement émaillé de références à sa réputation et à son honneur. Toutefois, nous avons pu rencontrer une exception à l’endroit des œuvres collectives, notamment dans un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 12 janvier 1848, mettant en cause le sieur VERGNAUD, auteur d’une série d’articles insérés dans des traités. La cour, tout en relevant qu’ : « Il est de principe que l’auteur qui vend son ouvrage, même en toute propriété, conserve le droit d’exiger que nulle modification ne soit apportée dans sa rédaction, et qu’aucun nom ne soit ajouté ou substitué au sien » précise que « l’inventeur d’une collection de manuels » a « acheté la propriété la plus entière et la plus absolue des manuels dont il s’agit, sans qu’il en restât rien, notamment pour Vergnaud, pas même le droit de prendre part aux éditions et révisions ultérieures », et décide qu’« il résulte des faits de la cause et de la nature de l’entreprise à laquelle les travaux de Vergnaud étaient destinés, que les parties ont entendu attribuer à Roret le droit de disposer desdits ouvrages pour le plus grand intérêt de sa spéculation », confirmant ainsi le jugement rendu auparavant par le tribunal civil de la Seine. Cette exception admise en faveur des œuvres collectives, ne peut s’expliquer que par la particularité de l’opération, ainsi que par les enjeux économiques en question. L’éditeur en effet, devait demeurer libre de faire réviser ses manuels compte tenu de leur caractère pédagogique et des progrès scientifiques réalisés depuis, tout en conservant le choix de ses collaborateurs. Aussi, la cour a-t-elle jugé légitime que le premier auteur ne puisse exciper de son droit de propriété pour s’opposer à la mise à jour des manuels, et à leur réimpression sans son autorisation. L’œuvre non divulguée, « sanctuaire de la conscience » de l’auteur. Le caractère personnel du droit de l’auteur sur son œuvre s’est davantage révélé lorsque la jurisprudence a eu à trancher des litiges relatifs à la divulgation de l’œuvre. Dès 1828, à l’occasion de l’affaire VERGNE, la Cour de Paris a ainsi pu juger : « Qu’une œuvre musicale n’a d’existence et n’est saisissable qu’autant qu’elle a reçu une publication de son auteur ». Le commentateur de l’arrêt précise en premier lieu qu’« il s’agit de se prononcer sur un genre de propriété qui n’a point été encore appréciée par les tribunaux », et qualifie l’œuvre non divulguée de « chose qui n’est ni mobilière, ni immobilière » avant d’effectuer une analyse sur la nature même du droit d’auteur. Il ressort de celle-ci que la production de l’esprit est une « propriété inviolable », ce qui conduit l’auteur de la note à la qualifier de « propriété toute personnelle » en raison de la mise en forme de la pensée. Ce caractère personnel de l’œuvre de l’esprit est particulièrement mis en exergue car il s’agit d’une œuvre non divulguée, en conséquence la doctrine et la jurisprudence n’ont guère de difficultés pour saisir la nature de celle-ci, et reconnaissent volontiers que le manuscrit inédit est une « conversation de l’auteur avec lui-même », et donc est insaisissable. Les juges iront encore plus loin quelques années plus tard, lors de l’affaire LACORDAIRE, non seulement en confirmant le caractère personnel de l’œuvre non divulguée , mais encore en décidant que l’auteur a la faculté de « rester juge de l’opportunité de sa publication ». Au reste, il est intéressant de noter que la cour d’appel et le tribunal correctionnel de Lyon assimilent la violation du droit de divulgation à un acte de contrefaçon. Conclusion. Le constat que nous pouvons faire, à partir de l’examen de la jurisprudence et de la doctrine de cette première moitié du XIXème siècle, est que le droit moral en tant que tel reste encore ignoré. Toutefois, le recours à la notion de réputation de l’auteur ainsi que la reconnaissance en sa faveur d’un droit de divulgation discrétionnaire, vont peu à peu faire basculer le droit d’auteur du droit de propriété pur et simple vers une conception dualiste de celui-ci.
Le droit de propriété, fondement naturel du droit d’auteur
L’appropriation de l’idée par le travail. Les partisans de la thèse favorable au droit de propriété ont mis en avant le fait que si l’idée est en effet inappropriable au même titre que l’eau ou l’air, l’artiste de par son travail, a transformé cette « res communis en chose originale et personnelle » sur laquelle il détiendra un droit de propriété, celui-ci étant naturel et absolu. A l’argument de l’absence de perpétuité, ces derniers ont soutenu que même la propriété ordinaire était susceptible de limitations, l’article 544 du Code civil disposant en effet : « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements », ces limitations ne dénaturant en rien le droit lui-même. De ce fait, la limitation temporelle n’est pas un obstacle dirimant pour qualifier le droit de l’auteur sur son œuvre de droit de propriété. Par ailleurs, à l’argument de l’absence de jouissance exclusive, ceux-ci ont répondu que la possession des choses incorporelles se fait par l’exercice du droit, et ce conformément à la pensée de GAÏUS et de DOMAT. L’auteur étant incontestablement titulaire d’un droit d’exploitation sur son ouvrage, ce dernier dispose bien d’un véritable droit de propriété sur celui-ci.
Le droit de propriété, fondement inadapté du droit d’auteur
L’intérêt concurrent du public. Les détracteurs de la thèse favorable à un droit de propriété pur de l’auteur, démontrèrent que ce dernier, bien que titulaire d’un droit naturel de propriété en perd la jouissance exclusive par l’acte de publication, l’œuvre lui échappant pour appartenir concurremment à la société. Preuve en est l’intervention du législateur, qui par les lois de 1791 et 1793 a limité dans le temps les droits de l’auteur, définissant par là-même l’étendue du droit de chacun, auteur et public, et rejetant donc implicitement toute analogie entre droit d’auteur et droit de propriété ordinaire. Un droit de propriété de « nature particulière ». Les arguments de l’une ou l’autre de ces deux théories sont, à première vue séduisants, et nous pouvons comprendre que le recours au droit de propriété ait été proposé compte tenu de la prédilection de la doctrine pour celuici, ainsi que du contexte ayant présidé à la reconnaissance d’un droit de l’auteur sur son œuvre. Toutefois, certaines conséquences découlant de la vente du manuscrit par l’auteur à un éditeur montrent que le droit de propriété n’est pas le fondement idoine du droit d’auteur. Comment expliquer, en effet, qu’en cédant son œuvre le créateur ne se dépouille pas complètement de son droit, laissant son cocontractant dans l’impossibilité de disposer à sa guise de son acquisition à l’image d’un propriétaire ordinaire ? Par ailleurs, l’idée d’intérêt du public ou d’intérêt général lors de la divulgation de l’œuvre semble inconciliable avec les caractères de perpétuité et de transmissibilité propres au droit de propriété. Aussi, affirmer que le droit d’auteur est un droit de propriété, fut-il agrémenté du qualificatif de « nature particulière » , paraît impuissant à justifier les différences de régime entre propriété littéraire et artistique et propriété ordinaire. Quelques auteurs l’ont bien perçu, et ont de ce fait développé une théorie davantage centrée sur la personne du créateur
|
Table des matières
PREMIERE PARTIE : LA CONTRACTUALISATION A PRIORI IMPOSSIBLE DU DROIT MORAL
TITRE 1 : LA CONSECRATION LEGALE DE L’INALIENABILITE DU DROIT MORAL
CHAPITRE 1 : LE RATTACHEMENT DU DROIT MORAL A LA PERSONNALITE DE L’AUTEUR, FONDEMENT DE L’INALIENABILITE
CHAPITRE 2 : LES EFFETS DU RATTACHEMENT DU DROIT MORAL A LA PERSONNALITE DE L’AUTEUR
TITRE 2 : L’ATTENUATION INEVITABLE DE L’INALIENABILITE DU DROIT MORAL
CHAPITRE 1 : LES ATTENUATIONS D’ORIGINE LEGALE
CHAPITRE 2 : LES ATTENUATIONS D’ORIGINE PRETORIENNE
DEUXIEME PARTIE : LA CONTRACTUALISATION INDIRECTE DU DROIT MORAL
TITRE 1 : LA CONTRACTUALISATION DU DROIT MORAL PAR LES MECANISMES DU DROIT D’AUTEUR
CHAPITRE 1 : LES AMENAGEMENTS CONTRACTUELS DU DROIT MORAL AUTORISES PAR LA LOI
CHAPITRE 2 : LES AMENAGEMENTS CONTRACTUELS DU DROIT MORAL INDUITS PAR LA PRATIQUE
TITRE 2 : LA CONTRACTUALISATION DU DROIT MORAL PAR LES MECANISMES DU DROIT COMMUN
CHAPITRE 1 : LE DROIT COMMUN A L’EPREUVE DU DROIT MORAL
CHAPITRE 2 : LE DROIT COMMUN DES CONTRATS AU SECOURS DU DROIT MORAL
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet