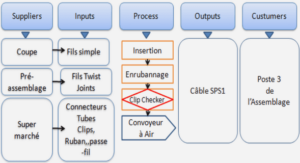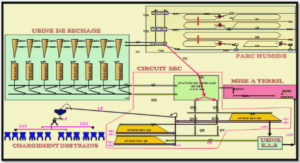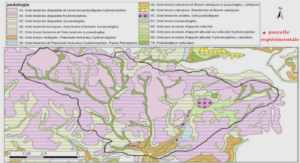Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
« Terrain » ou « territoire » de recherche ?
Ma présence répétée dans les mêmes lieux, aux côtés des mêmes personnes, a indéniablement contribué à m’inscrire dans un paysage social duquel j’étais pourtant a priori extérieur. Le territoire mapuche est ainsi devenu, pour moi, un véritable espace vécu. Voilà alors comment, par cette opération, je me suis finalement retrouvé non pas sur » mais « dans » ou, comme le propose Denis Retaillé, « au » terrain (Retaillé, 2010: 86) ! Aussi, bon gré mal gré, je suis devenu l’une des composantes d’un système d’interactions dans lequel je suis définitivement entré et que j’ai, par-là même, inévitablement contribué à modifier. Pour paraphraser C. Desbiens, je dirais que je suis en quelque sorte devenu à la fois le produit et le producteur du monde que j’ai cherché à comprendre (Desbiens, 2009: 2).
Je préférerai donc parler de territoire plutôt que de terrain de recherche. D’une part, parce qu’il n’y a pas de terrain en soi ou existant a priori comme donnée objective ou objet autonome fonctionnant indépendamment du chercheur (Collignon, 2010). D’autre part, parce que ce terrain est le lieu d’une rencontre dont les coordonnées résultent du croisement de l’ensemble des réponses données à des questions posées. En ce sens, et comme l’indique D. Retaillé, le terrain n’est « [qu’] un moment situé dans la construction de la connaissance […] » (Retaillé, 2010: 86). Or, ce moment est défini par une circonstance mettant en interaction les subjectivités respectives des acteurs en présence, soit, comme le souligne B. Collignon « […] une rencontre entre des personnes, des sujets, avec leurs affects et leur intelligence, leurs projets professionnels et personnels » (Collignon, 2010: 74). Plutôt que comme une construction, le terrain pourrait donc en fait être défini comme une co-construction associant un ensemble d’acteurs qui interagissent à partir de leur propre subjectivité et produisent un savoir dont le chercheur n’est en définitive que l’ordonnateur. Il ne faut donc jamais oublier que le chercheur, tout comme l’ensemble des acteurs avec lesquels il échange et entre en contact, « […] est avant tout un personnage typifié, genré, portant avec lui un ensemble de sous-entendus sur ses manières d’être et de penser » (Petit, 2010: 19). J’ajouterais même qu’il est culturé et que le regard qu’il porte sur le monde, calibré par une certaine normativité, sélectionne ce qu’il peut ou ce qu’il veut bien voir. Aussi, partant du fait que tout savoir se contextualise en fonction d’héritages que l’on se doit de reconnaître et d’assumer, il est important « [d’] exposer, pour soi-même et pour nos interlocuteurs, les bases ontologiques, références culturelles et systèmes de valeurs qui orientent à la fois nos questionnements tout comme notre manière de produire le savoir » (Desbiens, 2009: 2).
Si je devais donc exposer les bases ontologiques de mon propre territoire de recherche, je préciserais en premier lieu ma place de chercheur occidental dans une société ayant expérimenté, depuis maintenant plus d’un siècle, l’imposition de l’ordre colonial chilien. Cette précision revêt une importance capitale dans la mesure où cela me situe non seulement culturellement, mais aussi et surtout politiquement vis-à-vis de ceux avec qui j’ai été amené à échanger. Certes, j’ai parfois pu jouer de ma double appartenance identitaire, devenant tantôt chilien, tantôt français selon les contextes. Si cela m’a souvent facilité l’ouverture de certaines portes, cela ne m’a cependant pas extrait de mon rôle de chercheur occidental en terres autochtones.
Bien que chaleureusement traité la plupart du temps en tant que peñi17, je n’ai pourtant jamais cessé d’être un winka18 duquel, par expérience, les Mapuches ont appris
se méfier. Ce qui vient d’être dit mérite, me semble-t-il, davantage de précisions au vu des implications qui, d’un point de vue éthique, en découlent et des conséquences que cela peut avoir sur la définition d’une méthodologie de travail en contexte autochtone.
Ethique de travail et détour méthodologique
Pour s’en tenir ici à la réalité autochtone en Amérique Latine, notons que le processus de décolonisation amorcé à l’aube du XIXème siècle n’a pas été effectif pour Dans son sens premier, peñi signifie « frère » dans le sens de la parenté. Dans une définition plus large, il est employé dans des contextes exclusivement masculins, servant aux hommes pour s’adresser à d’autres hommes ou les désigner dans leurs interlocutions.
Le terme winka, chez les Mapuches, fait référence d’une manière générale aux non-Mapuches. Parfois, il est employé comme synonyme de Chilien. J’y reviendrai dans le cours de ce travail. Dans de telles circonstances, les demandes autochtones contemporaines font appel la récupération d’espaces de pouvoir rendant possible l’exercice d’un hypothétique statut d’autonomie. Il s’agit, en somme, pour les Amérindiens, de reprendre le contrôle de leur propre destin, dans la recherche d’une participation accrue et d’une plus grande représentativité sur le plan politique. Mais ce qui m’intéresse plus particulièrement ici, c’est le fait qu’un tel processus de colonisation ait été systématiquement accompagné de l’imposition de nouvelles instances de construction et de circulation des savoirs. L’Ecole, non seulement par le passé, mais jusqu’à nos jours, a été et continue d’être une institution clé dans tout processus de colonisation, fondamentalement en rapport au rôle que l’on cherche à lui imprimer dans la mise à plat et l’effacement des différences culturelles20.
Dans un contexte colonial quel qu’il soit, l’Ecole a effectivement pour rôle, non seulement d’éduquer, mais aussi et surtout de « civiliser » et force est de constater que, dans les programmes scolaires des pays latino-américains, les Amérindiens n’ont de place que dans un passé lointain, pré-hispannique, une histoire tantôt diabolisée, tantôt mythifiée, mais jamais en concordance avec leur réalité contemporaine. En ce sens, il est possible d’affirmer que c’est aux exigences de création d’un imaginaire national homogène dans lequel les cultures autochtones ne trouvent place que dans la limite de leur folklorisation, que répondent les programmes scolaires en Amérique Latine. L’Amérindien est ainsi évincé de l’imaginaire national et, avec lui, ses connaissances et systèmes de valeurs, marginalisés et relégués à la périphérie du savoir véhiculé dans les cercles formels de reproduction des élites intellectuelles.
Ce n’est donc pas un hasard si, parallèlement à ces demandes qui, sur le plan politique, visent le renversement d’un ordre colonial imposé depuis déjà quelques siècles, on assiste à l’émergence d’une intellectualité amérindienne qui, d’« en bas », revendique sa participation dans la construction des savoirs qui jouissent actuellement de reconnaissance formelle. C’est son rôle d’acteur dans la production des savoirs que revendique cette intellectualité, dans une volonté clairement affichée de dépasser la condition d’objet d’étude dans laquelle les sociétés amérindiennes ont été confinées au cours de l’histoire. C’est à cela que fait référence l’historien mapuche Sergio.
Caniuqueo21, lorsqu’il indique que « la science est une institution et, actuellement, les Mapuches nous la remettons en question en tant que seule et unique forme d’établir des connaissances. Dans notre cas, nous avons besoin d’institutions productrices de savoirs qui permettent de nous réaffirmer en tant que société » (Caniuqueo, 2005).
Mais, au-delà de leur condition d’objet d’étude, ce sont aussi et surtout les modalités de production des connaissances que remettent en cause les intellectuels amérindiens, dénonçant le caractère hégémonique des pratiques instaurées par le discours académique dominant. Aussi, ils questionnent la communauté scientifique et la placent dans une situation délicate. Au vu de leur complicité historique avec les processus de colonisation, les Sciences Humaines et Sociales (SHS) sont ainsi appelées
se réformer. Instrumentalisées dans une conjoncture où la connaissance de l’autre devait faciliter sa domination, les SHS ont érigé les sociétés autochtones en objet d’étude, en réponse à la reproduction de logiques de domination vérifiées sur le plan politique.
Traitées par l’Etat comme objets de développement, les sociétés autochtones ont aussi été traitées, jusqu’à présent, par l’Académie, en tant qu’objets d’étude. Or, c’est précisément cette position subalterne que les représentants autochtones se sont mis à questionner ces derniers temps. Cela s’est vérifié à peu près partout en Amérique, du nord au sud du continent. Au Chili, chez les Mapuches, mais également au Canada où B. Collignon observe :
[qu’] au tournant des années 1980, les autochtones (Amérindiens et Inuit) ont été les premiers à lancer un signal d’alarme à l’attention des chercheurs. Lassés de voir les chercheurs venir, séjourner-observer-interroger puis partir pour publier et très rarement revenir, ils disent haut et fort leur volonté de casser cette pratique et d’être pris enfin au sérieux. Ils se battent sur deux fronts : celui du savoir produit sur eux qui, éprouvent-ils, trop souvent ne reflète pas leur point de vue et les dépossède de leur propre culture, et celui de leur rétablissement dans l’intégrité de leur humanité. « Je n’aime pas être transformé en objet », disent-ils. Ils tiennent à rester des personnes, des sujets acteurs à part entière, non seulement de leur vie mais de la recherche qu’elle inspire et fait vivre » (Collignon, 2010: 71).
A la recherche du sujet : (Amér)Indiens, indigènes ou ethnies ?
Je différencie volontairement les termes « Amérindien » et « indigène », qui tendent trop souvent à être pris -par erreur- pour synonymes. S’ils entretiennent en effet une filiation commune, un lien de parenté que je tenterai de clarifier, ils ne signifient pourtant pas tout à fait la même chose et ne se réfèrent pas exactement aux mêmes réalités. Notons toutefois que le terme « indigène » pourra être substitué indifféremment par celui d’« autochtone » ou d’« aborigène », avec lesquels il partage un même sens étymologique : être originaire de là où l’on vit28.
L’illusion d’une rupture sémantique entre les trois termes se doit davantage à un usage linguistique par lequel la langue française s’est désormais emparée du vocable autochtone », tandis qu’« indigène » se décline sans difficultés tant en espagnol -indígena- qu’en anglais -indigenous (Bellier-a, 2006: 104)29. Si, de ce fait, ce dernier terme s’est très largement imposé en Amérique Latine, « aborigène » semble en revanche s’être relativement bien ancré dans le contexte australien. Accordons-nous donc sur le fait qu’il ne s’agit là que de différenciations résultant du contexte linguistique et/ou géographique d’usage.
Il existe néanmoins une autre catégorie identitaire qui, par-delà les contextes, semble s’inscrire en rupture vis-à-vis du cadre homogénéisant imposé par les précédentes classifications. Il s’agit de l’ethnie, dont nous verrons que la particularité est de vouloir resignifier la diversité culturelle niée tant à l’Amérindien qu’au triangle indigène / autochtone / aborigène. Quels rapports entretiennent donc entre eux tous ces personnages » ? Quelle filiation les relie ? Quelles différences les éloignent ? C’est à ces questions que j’essayerai de répondre dans les paragraphes qui suivent.
L’erreur géographique de Colomb
Ce n’est un secret pour personne ; c’est par équivocation que Christophe Colomb, croyant amarrer aux Indes, baptisa d’indiennes les populations du Nouveau Monde. L’Indien est donc à proprement parler une erreur géographique, raison pour laquelle je lui préfère le correctif « Amérindien », afin de rendre à ces groupes leur identité30. Le terme Amérindien fait en ce sens référence aux « Indiens d’Amérique » ; une justice sémantique qui ne permet toutefois pas de contourner un problème d’une tout autre nature, transversal aux deux terminologies : celui d’une définition en compréhension d’un ensemble dont l’hétérogénéité se voit transcendée et finalement annulée par l’attribution d’un dénominateur commun, relatif à une origine géographique partagée31.
Englober l’ensemble des populations autochtones du continent américain sous un même terme revient effectivement à effacer les distances culturelles parfois énormes qu’elles entretiennent entre elles. L’anthropologue mexicain Guillermo Bonfil (1972) note d’ailleurs à ce propos que « ceux qui se sentent Indiens en Amérique, ou sont considérés comme tels, forment un ensemble très divers, au sein duquel il est aisé de trouver des contrastes plus violents et des situations plus distantes entre elles que celles qui séparent certaines populations indigènes de leurs voisines rurales, qui ne s’inscrivent pas dans cette catégorie ». La catégorie d’Indien ne serait en somme qu’une construction.
Suivant le même ordre d’idées, Darcy Ribeiro livre un intéressant rapport de l’usage circonstanciel de la catégorie identitaire « caboclo » en Amazonie brésilienne :
Pour l’homme de la ville, le terme « caboclo » a le sens que nous lui donnons ici pour désigner la population néo-brésilienne de l’Amazonie, mais il s’en exclut lui-même. Pour ceux que les citadins appellent « caboclos », le terme s’applique à l’Indien civilisé, et ce dernier parvient à le transférer à l’Indien tribal attaché à sa culture originale et non encore inséré dans le système économique de la région » (Ribeiro, 1971: 322).
Afin de comprendre les enjeux d’un tel débat, un détour par les modalités de construction des identités s’avère nécessaire, et nous permettra non seulement de poser le problème en des termes plus concrets, mais aussi de l’entrevoir dans toute sa dimension. Partons donc d’une remarque simple mais fondamentale : l’identité passe d’abord par la différenciation, car pour pouvoir me prédiquer en tant qu’être il faut nécessairement que je prenne conscience de « ce que je suis », mais aussi de « ce que je ne suis pas ». La conscience de soi passe donc par l’altérité, c’est-à-dire dans un rapport dialectique à un autre, dont l’existence se voit conditionnée par la différence qu’il entretient avec moi. On ne peut être seul pour s’identifier, la présence d’un second est nécessaire et indispensable pour pouvoir se dire « nous ne sommes pas pareils ».
Mais l’identification a contrario par le seul établissement de distances ne suffit pourtant pas, car au-delà d’une différenciation, « dans un sens intransitif et parfois réflexif, et comprenant l’identité comme similarité, l’identification consiste à (s)’assimiler à quelque chose ou à quelqu’un et se traduit notamment pour l’individu comme pour le groupe par un sentiment d’appartenance commune, de partage et de cohésion sociales » (Le Bossé, 1999: 117). Pour s’identifier, il faut non seulement se différencier d’un second, mais aussi se reconnaître semblable à un troisième. Si la présence d’un second est indispensable, celle d’un troisième, jouant en quelque sorte un rôle d’arbitre, l’est donc tout autant.
C’est bien le principe de la trinité qui permet finalement de différencier deux êtres identiques d’un troisième : l’identique n’est reconnaissable qu’à la condition de la différence. S’identifier c’est donc se reconnaître, mais c’est aussi et d’abord se différencier. Exclusion et appartenance seraient les deux pôles antagoniques d’une dualité nécessaire à toute construction identitaire : « l’identité s’approche par ce qu’elle prend en compte comme par ce qu’elle néglige, par l’appartenance ou par l’exclusion » (ibid.: 117).
Revenons maintenant à nos préoccupations initiales. Quel(s) élément(s), au-delà d’une origine géographique commune, confère(nt) au groupe indien ou amérindien son unité et permet(tent), en même temps, de différencier ledit groupe du reste de l’humanité ? Un détour par les caractéristiques physiologiques d’abord, puis par les modes de vie des sociétés amérindiennes, nous mène aux mêmes conclusions. Aucun trait physique, ni élément issu de l’organisation sociale, économique, politique ou religeuse, ne résiste à l’exercice de l’identification (un exemple nous en a été fourni précédemment par l’exploration des différentes ontologies).
La prise en compte de telles caractéristiques ne permet en effet qu’une identification a contrario de l’ensemble amérindien, c’est-à-dire une définition de ce qu’il n’est pas (par exemple, que les ontologies amérindiennes ne relèvent pas du naturalisme). Les différents groupes de cet archipel entretiennent entre eux des distances telles que l’on se trouve dans l’impossibilité de fonder leur identité sur une unité autre que leur origine géographique. Celle-ci s’impose comme le seul élément donnant à la fois à cet ensemble sa cohésion interne, c’est-à-dire sa continuité, et permettant l’etablissement de barrières franches, c’est-à-dire de discontinuités avec l’extérieur.
Une catégorie du système colonial
C’est probablement aux travaux du Mexicain G. Bonfil que l’on doit les principales avancées dans la définition de la catégorie d’indigène en Amérique Latine. Il ne fait néanmoins pas de distinctions entre « Indien » et « indigène », qu’il prend pour synonymes, avouant ne voir là qu’une simple subtilité lexicale. Pourtant, s’il est effectivement possible d’affirmer que tous les (Amér)Indiens sont indigènes, l’opération contraire par inversement des termes ne peut abouttir : tous les indigènes, bien sûr, ne sont pas (Amér)Indiens ! Cette confusion ne limite cependant pas la portée des réflexions de G. Bonfil à la seule réalité américaine. Mais il faut pour cela en extraire le particularisme amérindien et mettre le doigt sur le caractère générique permettant de définir l’autochtonie.
C’est alors ailleurs que dans l’origine géographique qu’il faut aller chercher ce principe fédérateur, commun à tous les indigènes / autochtones, créant de la continuité vers l’intérieur et de la discontinuité vers l’extérieur. Attachons-nous donc pour cela à la lecture des travaux de G. Bonfil, qui considère que : […] la définition du terme Indien ne peut se baser sur l’analyse des particularités propres à chaque groupe ; les sociétés et les cultures dites indigènes présentent un spectre de variation et de contraste si ample qu’aucune définition à partir de leurs caractéristiques internes ne peut les incorporer en totalité, sous peine de perdre quelque valeur heuristique. La catégorie d’Indien, en effet, est une catégorie supraethnique qui n’indique aucun contenu spécifique des groupes qu’elle embrasse, mais une relation particulière entre eux et d’autres secteurs du système social global duquel les Indiens font partie. La catégorie d’Indien marque la condition de colonisé et fait nécessairement référence à la relation coloniale » (Bonfil, 1972).
Indien » et « indigène » sont bien employés ici indifférement, mais une nuance importante est apportée malgré tout en rapport à la définition que nous avons proposée précédemment. Bien plus que de revenir sur son caractère « supraethnique », et d’insister sur l’inconsistance de son hypothétique unité culturelle, G. Bonfil propose d’inscrire la catégorie « indigène » dans un cadre relationnel particulier : contrairement l’Indien, l’indigène ne s’identifie pas uniquement dans un rapport à une altérité reconnue et attestée -en tant que « non-Européen dans les Indes », comme le souligne F. Mires-, mais dans le type et la qualité du rapport établi à cette alterité -une relation de subordination dans un contexte colonial.
On dépasse là l’étroitesse du cadre géographique, pour se situer sur le vaste plan des rapports de force établis lors de l’entrée en contact d’au moins deux sociétés différentes. C’est en effet dans le champ socio-politique que l’on trouve le dénominateur commun de l’autochtonie, dont la définition en tant que catégorie sociale issue des rapports établis dans le contexte d’une société coloniale permet de transcender toutes les divergences contribuant à différencier l’ensemble des groupes la composant. Cette définition est opérationnelle car unificatrice. Elle pose sans équivoque l’identité indigène qui, quel que soit le contexte, l’origine géographique ou la réalité culturelle, se révèle être la même : « […] une catégorie supraethnique qui embrasse de façon indiscriminée une série de contingents d’une filiation historique variée, dont la seule référence commune est d’être vouée à occuper, dans l’ordre colonial, la position subordonnée qui revient au colonisé » (ibid.)32.
Si c’est la subordination à un ordre colonial qui fonde les bases de l’identité indigène, il n’y a donc pas de peuples qui soient indigènes « par nature », mais plutôt des peuples le devenant. Dire que l’on « devient » indigène implique alors qu’il s’agit d’une construction et qu’il n’y a pas de groupes indigènes sui generis, mais plutôt des groupes indigénisés convertis de facto en « peuples premiers / First Nations / pueblos originarios » par la venue de nouveaux arrivants. On peut parler, en ce sens, d’indigénisation tel un processus subi.
C’est ainsi que les sociétés amérindiennes seraient devenues indigènes à l’arrivée des Européens33. En entrant dans l’histoire européenne, elles perdirent le contrôle de la leur et se convertirent en un segment particulier des sociétés coloniales dépossédées de leur capacité de décision et de dessin de leur propre destin. Ainsi définie, l’autochtonie peut aisément s’exporter et s’appliquer dans d’autres « ailleurs ». La catégorie d’autochtone n’est pas propre aux seuls Amérindiens, raison pour laquelle on ne peut confondre les deux termes. Même si G. Bonfil n’en prend gère soin, affirmant qu’il ne s’agit là que de simples synonymes, il parvient tout de même à expliciter clairement que l’identité indigène ne se circonscrit pas à une origine géographique spécifique mais une position dans un système social aux dispositifs particuliers ; l’indigène occupe une place subordonnée dans une société coloniale.
|
Table des matières
Sommaire
Présentation
Introduction. Notes préliminaires d’une recherche en territoire amérindien
PARTIE A. Introduction à l’étude des territoires amérindiens en Amérique Latine
Introduction – Partie A
Chapitre I. De la colonisation et de ses implications géographiques
Chapitre II. Mondialisation et contemporanéité des territoires amérindiens
Conclusion – Partie A
PARTIE B. La construction d’un imaginaire géographique amérindien au Chili
Introduction – Partie B
Chapitre III. L’imposition d’un nouvel ordre spatial en pays mapuche
Chapitre IV. La géographie subversive du renversement postcolonial mapuche
Conclusion – Partie B
PARTIE C. En-deçà des discours : attention, un territoire peut en cacher un autre!
Introduction – Partie C
Chapitre V. Le conflit observé in situ : vous avez dit « territoire sacré » ?
Chapitre VI. Territoire ou territoires mapuche(s) ?
Chapitre VII. Migrations et mobilités contemporaines : un territoire en réseau ?
Conclusion – Partie C
Conclusion. Le territoire mapuche existe-t-il ?
Bibliographie
Télécharger le rapport complet