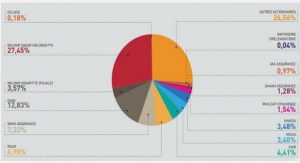La construction de la politique Alzheimer
Dans cette partie, nous tenterons de retranscrire le processus de construction de la politique Alzheimer. L’objectif est de souligner l’apparition tardive du problème Alzheimer en France et de comprendre les enjeux de sa problématisation. Dans cette quête de sens, différentes catégories d’acteurs se sont parfois affrontées, parfois rassemblées derrière des concepts et des idées fortes. Il s’agit, en étudiant ces concepts, de vérifier l’hypothèse émise en introduction selon laquelle la politique Alzheimer s’est greffée à la politique de la vieillesse dans le cadre de cette construction sémantique. Nous verrons enfin comment l’action croisée de certains acteurs a participé à une réelle prise de conscience à l’égard de cette nouvelle maladie pourtant découverte un siècle auparavant. Cette prise de conscience du problème Alzheimer, associée à une politisation, a contribué à la mise en œuvre d’une politique publique sans précédent.
La consécration particulièrement lente d’un problème public de première ampleur
Longtemps oubliée, les progrès réalisés par la recherche clinique permettent la « redécouverte » de la maladie d’Alzheimer et sa publicisation à l’étranger, mais pas en France (A). La construction du problème Alzheimer en France se cristallise autour du concept de « dépendance » et de son financement, contribuant notamment à promouvoir une vision médicalisée de la vieillesse (B). La montée en puissance du problème Alzheimer jusqu’à sa politisation décisive (C).
La redécouverte d’une maladie longtemps oubliée
Une découverte scientifique oubliée
Il serait avisé de considérer que la maladie d’Alzheimer est loin d’être une affection récente. Bien que personne n’ait de preuve tangible de cette éventualité, elle a pu sévir insidieusement parmi les hommes pour la simple raison qu’elle n’était pas identifiée. Pendant des siècles en effet, la société a marginalisé les déments et les fous, pouvant parfois conduire à un amalgame que nous savons erroné aujourd’hui . Au Moyen-Âge, les fous quittent l’espace social pour être enfermés dans les hospices. Ce « grand renfermement », selon l’expression de Michel Foucault, entraine une concentration des marginaux de la société, qu’ils soient déments ou fous, et pose les bases d’une confusion entre démence et folie.
Il faut attendre le début du XIXe siècle pour que la démence soit séparée du champ de l’aliénation mentale . Les différentes formes de démences sont tantôt considérées comme des affections autonomes, comme la démence vasculaire, tantôt comme le fruit du vieillissement naturel du cerveau dans le cas, par exemple, de la démence sénile. L’imbrication du champ psychiatrique et neurologique se retrouve toutefois au moment de la découverte de la maladie, par un psychiatre. En effet, les premières études biomédicales qui mènent à cette découverte sont réalisées en 1906 par Alois Alzheimer. Le psychiatre allemand en identifie les premiers symptômes, lorsqu’il étudie le cas d’une patiente admise à l’hôpital de Frankfort pour cause de démence sénile. La patiente, une femme de 51 ans du nom d’Auguste Deter, présentait des « troubles de la mémoire », un « mutisme », une « désorientation », des « troubles cognitifs et des troubles psychosociaux » . Au vu de l’âge relativement jeune de cette patiente, cette nouvelle affection semble indiquer l’existence d’une forme de présénilité atypique. A cette dernière, A. Alzheimer donne le nom de dégénérescence neuro-fibrillaire et décrit le cas étudié dans un article publié en 1907. Le nom de « démence sénile de type Alzheimer » serait donné quelques années plus tard par Emil Kraepelin, un autre psychiatre allemand à qui il est souvent attribué la paternité de la psychiatrie moderne.
Cependant, peu de recherches vont venir compléter l’étude de cette nouvelle forme de démence présénile qui va peu à peu tomber dans l’oubli. Elle soulève pourtant des interrogations, notamment en ce qui concerne l’âge de son apparition et sa relative similitude avec la démence sénile. A cet égard, lors d’une émission radio dans les studios de France Culture, le philosophe Fabrice Gzil explique que : « dans la démence sénile et dans la maladie d’Alzheimer présénile, on observe les mêmes modifications cérébrales (…) d’une manière assez curieuse en terme d’histoire des sciences, on a là un exemple d’oubli assez étrange. Alzheimer dit clairement que c’est la même maladie, une forme atypique simplement quand elle survient chez des sujets plus jeunes et pendant 70 ans on l’oublie. » . Il fait ensuite le constat d’une absence de transmission du savoir. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce constat. La mort d’Alois Alzheimer quelques années après cette découverte, et de manière générale, l’âge avancé des chercheurs ayant contribué aux premières études cliniques sont deux facteurs possibles de cette absence de transmission. La Première Guerre mondiale a sans doute également joué un rôle. Peut-on aussi y voir un cantonnement de la maladie d’Alzheimer au champ de la psychiatrie, comme conséquence de l’amalgame séculaire entre la démence et la folie. Enfin, nous pouvons ajouter la complexité apparente de la maladie d’Alzheimer et le manque de moyens techniques à disposition des chercheurs.
Le tournant des années 1970
En France, le problème de la vieillesse s’est constitué après la Seconde Guerre mondiale avec la création de la Sécurité sociale et du droit à la retraite. Cette reconnaissance du statut de retraité a pu coïncider avec une nouvelle manière, pour la médecine, d’appréhender la vieillesse dans sa relation à la société et non plus comme un objet d’étude clinique . Ainsi, alors que la politique vieillesse trouve ses principes fondateurs dès 1962 avec le rapport Laroque, la maladie d’Alzheimer, de son côté, ne constitue pas encore un problème public à ce moment. Autrement dit, elle ne constitue pas un problème auquel les pouvoirs publics se doivent de répondre.
Il faut attendre les années soixante-dix pour observer une véritable relance de la recherche permettant de repositionner la maladie d’Alzheimer sur le devant de la scène scientifique. Dans un premier temps, une corrélation très significative est établie entre la dégénérescence neuro-fibrillaire et le processus démentiel dans deux articles successivement publiés en 1968 et 1970 . En 1976, le neurologue américain Robert Katzman publie un article inquiétant sur la progression de la maladie aux États-Unis. Il montre qu’elle y représente la 4e cause de décès et que ses répercussions financières à venir sur les systèmes de santé sont alarmantes . En 1977, le premier congrès mondial sur la maladie d’Alzheimer et les autres démences séniles a lieu à Londres. Il constitue un tournant majeur dans la mesure où il permet de reconnaître que les manifestations cliniques et pathologiques de certaines démences séniles et de la démence sénile de type Alzheimer sont identiques. Pour Laëtitia Ngatcha-Ribert, ce congrès met fin à la dichotomie entre la présénilité et la sénilité dans le champ spécifique de la maladie d’Alzheimer . Dès lors, cette découverte conduit à concevoir la sénilité comme une affection distincte d’une part, et d’autre part, à engendrer une « désâgisation » de la maladie d’Alzheimer dont l’appellation spécifique était jusqu’à lors réservée aux personnes de moins de 60 ans . Bien que largement affaibli par cette découverte, le concept de démence sénile ne disparaît pas pour autant du paysage scientifique et médical. Cela tend, encore aujourd’hui, à complexifier sa distinction avec la maladie d’Alzheimer, lors du diagnostic par exemple.
Peu importe leur âge, les personnes atteintes d’une démence dite dégénérative sont désormais regroupées sous l’étendard de la maladie d’Alzheimer. L’intégration d’autres formes de démences dites apparentées, auparavant rassemblées dans cette catégorie très large des démences séniles, conduit à un accroissement significatif du nombre de personnes remplissant les mêmes critères cliniques. Même s’il faut attendre la fin des années quatrevingt pour disposer de données suffisamment fiables, la progression de son incidence et le spectre de la transition démographique permettent sa sortie de l’anonymat dans le champ de la recherche. Suite au congrès de Londres, émerge en effet un processus « d’Alzheimérisation de la grande vieillesse » . Selon Laëtitia Ngatcha-Ribert, « ce processus contribue à faire d’Alzheimer la forme la plus connue, la plus fréquente et la plus emblématique des démences ».
Une publicisation rapide à l’étranger mais tardive en France
Cependant, la publicisation, c’est à dire la reconnaissance par les pouvoirs publics et la société civile de la problématique Alzheimer, se fait dans un premier temps aux États-Unis, longtemps considérés comme référents en la matière. Au début des années quatre-vingt, Rita Hayworth révèle sa maladie au grand public et en devient le premier visage célèbre et en vie. La création de plusieurs associations américaines comme l’Alzheimer’s Disease and Related Disorders Association (ADRDA) en 1980, ou l’Alzheimer Disease International (ADI) en 1985, amorce une dynamique de levée de fonds à l’origine d’un véritable sursaut de la recherche . Un sursaut contribuant à accroître la reconnaissance du problème Alzheimer aux États-Unis et coïncidant avec une période d’amélioration des techniques et des outils de recherche. L’apparition de la microscopie, ou la coloration des coupes de tissu cérébral a, par exemple, permis une meilleure description de la maladie d’un point de vue clinique. Puis, c’est au milieu des années quatre-vingt que les deux lésions caractéristiques de la maladie d’Alzheimer sont identifiées de manière pérenne, et standardisées au niveau international. La déclaration de Ronald Reagan « J’entre aujourd’hui sur le chemin qui me mènera au crépuscule de la vie…», le 5 novembre 1994 facilite probablement l’acceptation de la maladie par l’opinion publique américaine. Laetitia Ngatcha-Ribert émet l’hypothèse suivant laquelle le prestige lié à son ancienne fonction de président a « rassuré voire déculpabilisé une partie de la population en ce sens que la maladie d’Alzheimer peut toucher des individus de toute envergure sans que leur intelligence ne soit en cause».
En France, en revanche, la maladie a plus de difficulté à sortir de l’ombre. Les progrès réalisés outre-Atlantique parviennent difficilement à s’imposer et la maladie d’Alzheimer est encore peu mentionnée sur la place publique, notamment par les médias. Laëtitia NgatchaRibert relève à cet égard que le nombre d’articles du journal Le Monde la mentionnant progresse lentement jusqu’au milieu des années quatre-vingt-dix (48 entre 1987 et 1991, 83 entre 1992 et 1996), moment de l’apparition des premières thérapeutiques . De plus, la maladie ne semble pas avoir de visage. La première révélation marquante en France, semble être celle d’Annie Girardot, qui la déclare en 2006. Cela illustre en partie la difficulté des malades et des familles françaises à témoigner de leur quotidien avec la maladie avant sa reconnaissance par les pouvoirs publics. Jusqu’à la fin des années quatre-vingt-dix, personne n’ose réellement témoigner de cette réalité, sans doute parce que le problème ne parvient pas à dépasser le cadre de la sphère privé. Enfin, l’importance médiatique des scandales sanitaires révélés dans les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix, comme celui du sang contaminé, de l’amiante, ou encore celui du nuage radioactif, a sans doute également joué un rôle dans cette absence de publicisation.
La construction française du problème Alzheimer
L’inintelligibilité de la problématique Alzheimer auprès des autorités publiques
Alors que la maladie d’Alzheimer est déjà bien connue à travers le monde, notamment aux États-Unis et en Grande Bretagne au regard de leur rôle prépondérant dans le domaine de la recherche, elle dispose, en France, d’une faible visibilité. Plus qu’une faible visibilité, il semble que l’inintelligibilité du problème Alzheimer ait pu ralentir sa montée en puissance.
Le rôle des pouvoirs publics dans cette absence de compréhension est à questionner ici car, avant de se saisir d’une question, faut-il d’abord la comprendre. La théorie des politiques publiques nous éclaire sur les éléments constitutifs de cette compréhension : le « problème doit être intégré et adapté aux logiques et normes de fonctionnement de l’appareil politicoadministratif (…) il doit être traduit par des procédures d’étiquetage dans le langage de l’action publique ». C’est effectivement cette capacité de traduction qui définit la compétence d’une autorité publique à comprendre un problème et à y répondre à l’aide de dispositifs adaptés. Outre le moyen de légitimation de son action, ces éléments théoriques éclairent deux phénomènes assez représentatifs de la lente et difficile construction du problème Alzheimer en France.
Il s’agit premièrement, de la difficulté pour les pouvoirs publics à mettre en œuvre un processus de traduction des connaissances dans le langage politique. Les connaissances sur la maladie et ses répercussions sur le moyen et long terme restent effectivement méconnues et complexes. La comparaison avec la montée en visibilité laborieuse du problème du sida démontre, qu’en présence d’une problématique inintelligible auprès du champ politique, sa mise à l’agenda est peu probable. Dans son article, Elizabeth Sheppard rappelle les travaux de Pierre Favre (1992) et Michel Setbon (1993) démontrant « l’émergence et l’inscription tardives du problème du sida sur l’agenda politique, à la suite de l’incapacité à qualifier et à expliquer la maladie lors de son apparition ». Les caractéristiques évolutives de la maladie d’Alzheimer participent également à son identification lente, dans la mesure où son apparition est insidieuse et son évolution imprévisible.
Le second phénomène est celui de l’étiquetage du problème dans le langage politicoadministratif. L’identification à une étiquette ou une catégorie comme moyen de simplification et de délimitation des contours du problème prend, dans le cas présent, le sens spécifique d’une maladie de « vieux ». La maladie d’Alzheimer est effectivement étiquetée comme une maladie de « vieux », non sans raison d’ailleurs, dans la mesure où la quasitotalité des PAMA a plus de soixante-cinq ans. Nous remarquons ici l’importance de l’amalgame entre vieillesse et maladie, un amalgame amené à persister dans ce processus de problématisation. Il ne s’agit plus d’ignorer la maladie des plus âgés sous prétexte d’une démence sénile, mais plutôt d’appréhender le problème Alzheimer comme étant lié à la vieillesse, de par la prégnance d’une certaine réalité statistique mais aussi de par la force d’un nouveau cadrage en plein essor.
La médicalisation de la vieillesse dépendante à l’origine d’un amalgame entre maladie et vieillesse
Dans son ouvrage Alzheimer : la construction sociale d’une maladie, Laëtitia Ngatcha-Ribert montre que la question de la vieillesse subit un processus de médicalisation parallèlement à la montée du problème Alzheimer, et à son appropriation par une nouvelle discipline du champ médical : la gériatrie . A partir des années quatre-vingt, la montée de cette conception médicalisée de la prise en charge de la vieillesse a poussé les gériatres à s’approprier le repérage et le suivi de certaines pathologies neurodégénératives comme Alzheimer, au détriment notamment des psychiatres. D’ailleurs, la crise et le retrait de la filière psychiatrique du champ des démences à cette période, posent aujourd’hui question à la lumière des débats sur le besoin d’accompagnement psychologique des malades. L’affirmation de la filière gériatrique autour du concept de « dépendance » conduit par la suite à renforcer cette approche médicalisée, l’érigeant presque au statut de référentiel . Un référentiel fournissant ses propres éléments de langage, à ce point que nous ne parlons plus d’invalides mais de personnes souffrant d’incapacités et, à ce titre, dépendantes de l’aide des autres. Or, Hélène Biraud explique comment le concept d’incapacité (et donc de dépendance), au départ pensé dans le champ de l’affection chronique, a été « détourné » et adapté par certains médecins français pour correspondre à la vision d’une vieillesse pensée sous un prisme médical . La première définition française de la « dépendance » est celle du rapport Arreckx en 1979 : « l’on entend ici par des « personnes âgées dépendantes » tout vieillard qui, victime d’atteintes à l’intégrité de ses données physiques ou psychiques, se trouve dans l’impossibilité de s’assumer pleinement, et par la même, doit avoir recours à une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ». La dépendance des personnes âgées devient alors le prisme par lequel les pouvoirs publics, encouragés par l’unification et la force du discours des gériatres, vont appréhender le problème Alzheimer.
En outre, cette période est celle d’un consensus sur la corrélation entre l’âge et la dépendance qui se résume en une équation simple : âge + maladie = dépendance + besoin d’aides. Selon Laëtitia Ngatcha-Ribert, « cette médicalisation de la vieillesse [catalysée par le concept de dépendance], a conduit à faire du malade d’Alzheimer l’archétype du vieillard ». Nous comprenons dès lors l’existence de deux amalgames au cours de cette période de construction : celui entre maladie et vieillesse de manière générale, et celui entre vieillesse et maladie d’Alzheimer plus particulièrement. Laëtitia Ngatcha-Ribert développe à l’égard du premier l’idée d’un « paradoxe gériatrique » puique « la maladie d’Alzheimer, bien que séparée très clairement de la vieillesse par la force de l’idéologie gérontologique selon laquelle la vieillesse est normale, est continuellement et répétitivement identifiée aux conséquences inévitables de la vieillesse : le déclin et la mort . » Elle va même plus loin pour le second, en affirmant que ce nouveau rapport entre âge et dépendance « a conduit à définir la maladie d’Alzheimer comme un problème lié à la dépendance, et celle-ci au grandâge et par là, à l’intégrer uniquement dans la politique à destination des personnes âgées. »
Par conséquent, il se dégage une distinction dans les modes de prise en charge, l’un pour les moins de soixante ans, rattaché au handicap, et l’autre pour les plus de soixante ans, rattaché à la politique de dépendance des personnes âgées. Le paradoxe est de taille, lorsque l’on sait que la maladie d’Alzheimer s’est « désâgisée » depuis la fin des années soixante-dix.
Le « tournant médical et gestionnaire » , comme nouveau facteur de la non-décision politique
Cette imbrication entre maladie et vieillesse est par ailleurs à l’origine d’un tournant dans la politique de la vieillesse. Alors que depuis 1962 l’idéologie du maintien à domicile s’impose comme une évidence et que de nombreux dispositifs allant dans ce sens se mettent en place, le « tournant médical et gestionnaire » du début des années quatre-vingt bouleverse la donne. Le sociologue Bernard Ennuyer écrit à ce propos que « le projet d’intégration des personnes âgées, symbolisé par cette politique de maintien à domicile, va s’infléchir dans une médicalisation de la vieillesse, renvoyant les personnes âgées qui « vieillissent mal » au rôle d’objet de soins et de faire valoir pour gériatres en mal de reconnaissance au sein du monde médical . » Le maintien à domicile passe donc d’une finalité éthique et sociale, celle de permettre aux personnes âgées de rester dans la société, à un rôle d’instrument à la disposition des pouvoirs publics pour gérer au mieux le « problème des personnes âgées ». Plus qu’une simple médicalisation de la vieillesse sans réel fondement idéologique (si ce n’est celui de certaines professions médicales), il faut y voir une tentative de penser la politique de la vieillesse en fonction d’un nouveau contexte économique et social. La crise engendrée par le premier choc pétrolier de 1973 amène effectivement son lot de désillusions quant à l’ambition des politiques sociales. Selon Bernard Ennuyer, la montée du chômage entraine même un télescopage des politiques vieillesse et de l’emploi, au point de déstabiliser le système de maintien à domicile mis en place depuis les années 1970, notamment au niveau des dispositifs d’aides ménagères . Le changement de perspective se confirme puisque, par la suite, les dispositifs mis en avant se focalisent sur la proposition et la gestion de prestations de services nouvellement créées à destination des personnes âgées.
D’autre part, la volonté de réduire les dépenses budgétaires détermine en grande partie l’évolution de la politique vieillesse et la construction du problème Alzheimer durant les années quatre-vingt-dix. L’affirmation du concept de dépendance s’opère dans ce contexte de restriction, comme en témoigne la multiplication de rapports publics sur la question. Ces nombreux rapports se cantonnent toutefois aux hautes sphères administratives et techniques. A travers le prisme de la dépendance, c’est surtout la question de son financement qui se pose.
Pour n’en citer qu’un, le rapport Braun n’envisage plus la question de la dépendance du point de vue de l’intégration des personnes âgées dans la société mais sous l’angle de son financement, dans la mesure où les situations de dépendance se prolongent grâce, notamment, aux avancées de la médecine . L’émergence de cette nouvelle conception va perdurer, et interdire une prise en compte plus globale de la maladie d’Alzheimer, notamment autour de la notion de handicap. D’ailleurs nous observons que la grande loi des années quatre -vingt-dix concernant la politique de la vieillesse dépendante reste celle de la création de la Prestation Spécifique Dépendance (PSD), remaniée quelques années plus tard. Enfin, il y a l’idée que les gouvernements successifs vont en quelque sorte différer le problème tout en réaffirmant son ampleur et la nécessité de le prendre en considération. En référence à cette « politique dépendance », Bruno Jobert parle d’une « non décision exemplaire » . Il explique que la problématique Alzheimer et la nécessité d’y répondre sont toutes deux reconnues par les pouvoirs publics, mais qu’ils sont dans l’incapacité de mettre en œuvre des solutions concrètes . Il détaille à cet égard les difficultés ayant menées à cette non décision : « faible visibilité », « déficit global d’expertise », « inadéquation du répertoire institutionnel », « prégnance des normes sociales en faveur d’une prise en charge familiale », « réticences à se lancer dans une politique dispendieuse dans un contexte de contrôle des dépenses publiques », « absence d’une fenêtre politique pour un problème qui n’est pas électoralement payant ».
Le concept de « dépendance au sentier », qui reconnaît « l’existence de mouvements cumulatifs cristallisant les systèmes d’action et les configurations institutionnelles propres à un sous-sous-système donné et déterminant un cheminement précis à l’action public » éclaire ici le poids antérieur de la politique de la vieillesse sur la construction du problème Alzheimer. De fait, le concept de dépendance des personnes âgées a joué un rôle d’entonnoir par lequel a filtré l’ensemble des nouvelles idées en la matière. L’adoption de ce sillon de pensée par les pouvoirs publics a sans aucun doute eu des répercussions nuisibles dans l’élaboration de la réponse au problème public qu’il représente aujourd’hui.
La montée en puissance du problème Alzheimer en France
La question du diagnostic et l’avènement des neurologues
Les années quatre-vingt-dix témoignent de la poursuite des progrès scientifiques en ce qui concerne la pathologie Alzheimer. Par exemple, son mécanisme de transmission génétique est mieux identifié, et de nouvelles connaissances viennent enrichir la compréhension de son évolution. Mais c’est surtout au niveau du diagnostic que se situent les véritables progrès, créant ainsi de nouvelles perspectives. L’identification de certains marqueurs biologiques mesurables a effectivement rendu possible une amélioration des tests de dépistage. Cette période est également caractérisée par la progression d’une vision plus organique de la maladie, due notamment à la propagation des connaissances concernant les lésions spécifiques du cerveau. La difficulté, en pratique, pour les médecins à reconnaître véritablement la maladie d’Alzheimer parmi d’autres affections démentielles ou neurodégénératives et l’absence de thérapeutique efficace, a pu parfois engendrer une « fuite devant le diagnostic » . Au même moment, le rôle d’une autre spécialité médicale s’affirme, la neurologie. La compétence clinique dont dispose les neurologues coïncide avec le besoin de certitude requis pour poser le diagnostic sans laisser de place au doute. Car l’annonce de ce diagnostic est d’une importance capitale, nous pouvons le deviner, au regard des représentations négatives de la maladie et de ce qu’elles impliquent à la fin des années quatrevingt-dix. « Suis-je fou », « suis-je vieux », « qu’est-ce qui ne va pas chez moi » ? Observons d’autre part que la poursuite des études sur les coupes du cerveau, les progrès de l’imagerie, ainsi que le développement de tests neuropsychologiques poussés sont toutes des améliorations scientifiques et médicales tendant à placer le neurologue au centre du processus d’annonce du diagnostic.
Dès lors, une répartition des rôles semble s’opérer entre les neurologues et les gériatres selon le découpage suivant. Les premiers sont responsables de l’ensemble du processus de dépistage et du diagnostic en procédant à l’évaluation des déficits cognitifs des PAMA. Depuis 1997, ils utilisent la grille d’évaluation Autonomie, Gérontologie, Groupes Iso-Ressources (AGGIR – Annexe 1) permettant, au terme de cette évaluation, de classer les personnes selon leur degré de dépendance. Un groupe iso-ressources (GIR) allant de 1 à 6 (Annexe 2) leur est attribué, le groupe 1 désignant le plus haut niveau de dépendance. Cette grille vient outiller ces nouveaux spécialistes du diagnostic et faire le lien avec le système de financement de la dépendance (que nous aborderons ensuite), les différentes autorités publiques en charge de la politique dépendance et les organismes d’assurance privée. De leur côté, les gériatres sont davantage tournés vers l’accompagnement long terme des PAMA en unités de soins. Ils ont vocation à y développer une réponse, dite globale , prenant en compte l’ensemble des besoins de la personne âgée, qu’ils soient sanitaires, sociaux, de court ou long terme ou liés à son environnement et son entourage. Ils peuvent, pour cela, s’appuyer sur l’ensemble des connaissances médicales et physiologiques acquises dans le domaine de la vieillesse, et rassemblées dans la discipline de la gérontologie. Le principe de la réponse globale constitue l’outil majeur de la spécialité gériatrique servant à la fois, à approfondir mais aussi à légitimer leur pratique.
En outre, la commercialisation en 1994 du premier médicament à destination des malades est souvent considérée comme un « véritable tournant », celui de « l’arrivée de la thérapeutique » . Le fait que plusieurs autres médicaments entrent sur le marché dans les années qui suivent montre bien l’intérêt de l’industrie pharmaceutique à l’égard des pathologies neurodégénératives. Bien qu’ils n’agissent seulement sur les symptômes liés à la maladie et non sur la maladie elle-même, ces nouveaux médicaments ont le mérite d’attirer l’attention des médecins concernés par leur prescription, et logiquement, de braquer les projecteurs du monde médical sur la maladie d’Alzheimer. Il faut dès lors observer que l’arrivée de la thérapeutique, doublée de la mise en place de la grille AGGIR, achèvent ensemble le processus de médicalisation de la personne âgée « démente » et dépendante, de manière générale, et plus particulièrement des PAMA. Laëtitia Ngatcha-Ribert écrit à ce propos : « Affirmer que c’est le cerveau qui est atteint dans la MA, fixer les troubles dans le registre de l’organique et être en mesure de proposer des thérapeutiques implique que cette maladie est dès lors entrée dans la sphère la plus légitime de la médecine ».
Un nouveau souffle dans la construction du problème
Durant les années quatre-vingt-dix, les malades et les aidants s’immiscent en nouvel acteur dans le processus de construction du problème Alzheimer, avec l’aide et l’implication de certains médecins spécialistes comme les gériatres. La médicalisation de la maladie a en effet engendré une dynamique de rapprochement entre des gériatres légitimés par leur pratique et des familles séduites par la force de leur discours. En termes plus pragmatiques, ils sont très accessibles pour des familles à la recherche d’un soutien provenant du monde médical, ou même simplement, de la possibilité d’échanger avec un professionnel étant à même de les comprendre. En outre, ce rapprochement s’opère autour de la défense d’une vision biomédicale de la pathologie Alzheimer, loin d’être généralisée au début des années quatre-vingt-dix. C’est précisément ce qu’incarne l’association France Alzheimer, la première association de malades en France, créée en 1985 par la gériatre Françoise Forette et René Gonon, son premier président. En tant qu’association de malades, elle a tout d’abord permis de générer puis d’alimenter les prémices d’une parole de malade, qu’elle soit directe ou relayée par son aidant. Comme nous l’évoquions précédemment, l’absence d’une véritable visibilité, et la difficile émergence d’une fenêtre politique pour agir ont, sans doute, généré chez les familles de malades le sentiment d’être oubliées ou relativement peu prises en compte. D’où la montée en parallèle d’une volonté d’en parler, de discuter des enjeux théoriques et pratiques qui régulent leur vie quotidienne, ce que les pouvoirs publics ne leur permettent pas encore de faire. France Alzheimer a en ce sens permis la création d’une véritable communauté de familles de malades, avec l’objectif très clair de faire connaître et reconnaître la maladie d’Alzheimer aux yeux des Français et des autorités publiques. Pour ce faire, l’association s’est appuyée sur la logique du nombre. En effet, « le nombre est le facteur qui donne son importance à chaque phénomène social ». Reconnue d’utilité publique en 1991 , elle s’est donc employée à faire croître le nombre de ses membres pour d’une part, améliorer sa visibilité, et d’autre part, gagner en légitimité au niveau politique de manière à pouvoir demander plus de moyens à l’échelle du système de santé. Cependant, la maladie d’Alzheimer n’est pas la seule affection chronique à laquelle les pouvoirs publics se doivent de répondre. Il est très probable que la place et la visibilité du sida et du cancer au même moment aient en quelque sorte éludé la problématique Alzheimer, comme le laisse entendre Laetitia Ngatcha-Ribert : « De manière récurrente, dans ce champ fortement concurrentiel, nombre de nos interlocuteurs ont émis l’hypothèse que la médiatisation dont le sida, mais aussi le cancer ou les myopathies, ont été l’objet a pu retarder ou occulter l’émergence et la montée en visibilité de la maladie d’Alzheimer en tant que pathologie à part entière ».
|
Table des matières
Sommaire
Introduction
1 ère partie : La construction de la politique Alzheimer
I. La consécration particulièrement lente d’un problème public de première ampleur
II. La politique Alzheimer à travers ses plans
Conclusion
2ème partie : Les acteurs de la politique Alzheimer
I. Le paysage institutionnel national
II. Le cas de deux acteurs locaux en Isère : le CCAS de Grenoble et le centre de jour Les Alpins
Conclusion
3ème partie : Les défis d’une politique encore en construction
I. La singularité de la maladie d’Alzheimer nous invite à poser le diagnostic d’une réponse ambitieuse mais inadapté
II. Des innovations en coulisse et les limites d’une politique encore en construction
Conclusion
Conclusion générale
Table des matières
Bibliographie sélective
Liste des Sigles
Liste des Annexes
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet