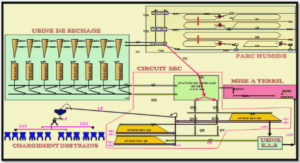Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les facteurs défavorables au peuplement
Plusieurs facteurs tels la distance existant entre le Portugal et le Cap-Vert (environ trois mille kilomètres) qui devait être parcourue par bateau à voile dans un voyage qui durait plusieurs semaines, les sévères conditions climatiques bien différentes de celles du Portugal (climat tropical sec qui rendrait pratiquement vaine toute tentative de rentabilisation de l’activité agricole en raison des très courtes périodes de pluie) et la quasi-inexistence de ressources naturelles n’encouragèrent pas les Portugais à s’installer sur l’archipel. En effet, l’agriculture et la pêche – les rares richesses que la nature pouvait offrir – n’étaient pas des activités économiques suffisamment intéressantes pour déclencher le peuplement de masse vu que leur exploitation exigeait des investissements importants tels que l’achat de zones d’exploration et de terres agricoles, le recrutement de main d’œuvre salariée ou alors l’achat d’esclaves.
Les quelques personnes qui décidèrent de tenter leur chance sur l’archipel finirent, très souvent, par mourir à cause des maladies tropicales qui y existaient. La présence européenne était donc faible pendant la deuxième moitié du XVe siècle en raison de toutes ces conditions qui n’étaient pas alléchantes pour les colons. Ceux qui souhaitaient vraiment s’y aventurer exigeaient des privilèges et des droits pour compenser les malheurs pouvant résulter de leur émigration.
Les facteurs favorables au peuplement
Si, d’un côté, les divers éléments cités ont provoqué le désintérêt des potentiels colons de l’archipel du Cap-Vert, d’un autre, un seul et important facteur le rendait intéressant pour la Couronne portugaise : sa position géographique, en face de la Guinée-Bissau, où depuis des années les Portugais essayaient de créer des liens commerciaux (pacifiques ou pas) avec les populations du littoral. En effet, les îles pouvaient constituer un excellent point d’escale pour les navires, mais aussi un véritable tremplin pour les incursions de reconnaissance et d’exploration de la bande côtière occidentale du continent africain et de l’atlantique sud.
La position géographique a ainsi joué un rôle très important dans l’avenir de l’archipel : si la Couronne portugaise n’a pas abandonné ce dernier, c’est surtout parce qu’il pouvait jouer un rôle central dans la découverte de nouvelles terres et d’endroits jusque-là méconnus et inexplorés et qui pourraient, bien entendu, enrichir le royaume portugais.
C’est à ce moment-là que la Couronne portugaise a pris des mesures pour encourager et renforcer le peuplement des îles : en raison des conditions défavorables à la colonisation, elle a décidé de concéder de nombreux avantages aux personnes qui souhaiteraient s’installer sur les îles. Dans la Charte de 1466, toute personne qui souhaitait émigrer au Cap-Vert bénéficierait de nombreux privilèges, tels que : des allègements fiscaux et commerciaux qui permettraient d’explorer le tout nouveau commerce avec la côte de la Guinée.
Attirés par la possibilité de faire fortune sur les îles, plusieurs colons s’y rendirent et certains finiraient même par s’y installer. C’est pour cette raison qu’à partir de 1466, peu à peu, le peuplement a pris plus de force et a été mené de façon plus régulière.
Les premières colonies
Les mesures adoptées par la Couronne connurent un tel succès que six ans après la première Charte elle décida d’en annuler une grande partie à travers une nouvelle, promulguée en 1472. Cette dernière imposait un grand nombre de restrictions commerciales à tous les commerçants qui exploraient le marché de la Guinée-Bissau. En réalité, l’objectif principal de la Charte de 1466 était de déclencher le peuplement de façon à avoir une population considérable sur l’île de Santiago. Étant donné que cet objectif avait été atteint, les mesures adoptées n’étaient plus nécessaires. C’est pourquoi le Roi du Portugal les a annulées, mais partiellement, de manière à ne pas compromettre la colonisation.
Vers la fin du XVe siècle, l’île de Santiago comptait déjà deux villages : Ribeira Grande et Alcatrazes. Le peuplement a commencé par cette île pour des raisons plus qu’évidentes. Parmi les dix îles qui composent l’archipel, elle était la moins défavorisée : c’était la plus grande, elle avait le meilleur port et comptait surtout de bonnes sources d’eau potable. Les îles de Santo Antão et São Nicolau possédaient également ce bien précieux, mais le fait qu’elles soient trop escarpées et encore l’inexistence d’un port les désavantageaient. En ce qui concerne le reste des îles, non seulement elles étaient beaucoup plus arides, mais l’eau potable était rare.
Pendant ce temps-là, l’île de Fogo, voisine de l’île de Santiago, commençait également à être peuplée. Elle était considérée comme moins prospère et plus défavorisée que l’île Santiago, mais se trouvait presque dans la même position géographique. Cela démontre que l’investissement fait par la Couronne n’était pas un échec et qu’il portait des fruits, puisque le peuplement atteignit l’île de Fogo.
Le commerce avec la côte de la Guinée a joué un rôle important dans le peuplement : les bateaux qui partaient commercer à cet endroit revenaient très souvent remplis d’esclaves qui contribuèrent, eux aussi, à peupler les îles. En effet, c’est de là-bas qu’arrivait une grande partie des populations qui peuplèrent l’archipel.
L’une des principales restrictions imposées par la Charte de 1472 était l’obligation de limiter le commerce uniquement aux produits locaux, originaires du Cap-Vert. Toutefois, cette restriction a eu un impact positif, car elle a poussé les colons à exploiter les ressources locales existantes, vu qu’ils n’avaient presque plus le droit de vendre à la Guinée des produits arrivés du Portugal. Cette mesure a également poussé les colons à se fixer sur le territoire fraîchement conquis.
Ribeira Grande : la première grande colonie capverdienne
Antonio da Noli a fait le choix d’installer la première colonie sur le sol capverdien dans une zone qu’il a nommée « Ribeira Grande »6 en raison de la grande rivière et de la vallée verdoyante qui y existaient. C’est sur les bords de cette même rivière qu’est donc né, quelques années plus tard, ce que l’on considère comme le premier village du Cap-Vert.
L’apparition de nouveaux villages à Santiago : Alcatrazes et Praia
Le village d’Alcatrazes a eu une courte existence. Établi à côté de Ribeira Grande, il possédait, comme ce dernier, une mairie et avait le statut de village. Cela veut dire que la population d’Alcatrazes était nombreuse. Situé dans une région rocheuse qui n’était pas apte à la pratique de l’agriculture ou d’une activité d’élevage, son développement dépendait exclusivement du commerce. Mais comme le port de Ribeira Grande était le centre commercial de l’île de Santiago, les conditions n’étaient pas propices à sa prospérité.
Pour fuir les frais de douane imposés à tous les navires qui arrivaient à Ribeira Grande, au cours de la deuxième décennie du XVIe siècle, un port clandestin a été construit non loin de Ribeira Grande, quand les colons ont commencé de peupler un plateau situé à côté d’une plage (plage de Sainte-Marie) qui offrait de bonnes conditions d’amarrage aux navires. Cet endroit, auquel le nom « Praia » (« plage » en portugais) a été attribué, acquérait peu à peu les conditions et les caractéristiques d’un village en raison de l’évasion progressive de la population de Ribeira Grande vers cette localité.
C’est l’apparition du village de Praia (en 1516) qui condamne le village d’Alcatrazes à la disparition. Au départ, Alcatrazes était le siège social de la capitania (capitainerie) du Nord (Ribeira Grande était le siège de celle du Sud). À partir de 1520, le siège social de la capitainerie du nord a été transféré à Praia, ce qui a rendu officiel l’abandon d’Alcatrazes. La mairie fut transférée à Praia et la population finit par migrer vers Ribeira Grande et Praia. Les raisons de ce changement n’ont pas pu être identifiées en raison des lacunes documentaires. Cependant, Albuquerque et al. (1991) estiment que la cause principale serait le port de Praia : il était devenu le meilleur existant sur toute l’île de Santiago. Les conditions maritimes, géographiques et économiques étaient si favorables à Praia que la possibilité de transférer la capitale de Ribeira Grande à Praia a été étudiée par la Couronne portugaise.
Cependant, le développement du village de Praia a été lent au cours du XVIe siècle, malgré les intéressantes caractéristiques dont il disposait. Ribeira Grande demeurait tout de même le cœur 23
de l’économie de l’île, étant le port le plus fréquenté par la navigation. Le principal élément qui jouait en faveur de ce nouveau centre populationnel était le statut de siège social de la capitainerie du nord. Dans le contexte de l’île, Praia jouait un rôle assez secondaire. Des statistiques rappelées par Albuquerque et al. (1991) montrent qu’en 1572 Praia était l’un des villages les moins peuplés au Cap-Vert.
Les autres colonies à l’intérieur de l’île de Santiago
Sur l’île de Santiago, les premières colonies s’installèrent sur le littoral. C’était le cas de Ribeira Grande et de Praia comme nous l’avons montré. Cependant, au fur et à mesure que le nombre d’habitants augmentait, de nouvelles colonies apparurent à l’intérieur de l’île où, quand il pleuvait suffisamment, les conditions pour la pratique de l’agriculture étaient satisfaisantes.
Pendant le premier siècle de peuplement, rares ou inexistantes sont les données concernant les populations qui vivaient sur l’île, à l’exception d’Alcatrazes et Praia. Des éléments plus concrets concernant ces populations apparaissent seulement à partir de 1572, selon Albuquerque et al. (1991). En revanche, il est possible d’en déduire que le peuplement de l’intérieur de Santiago a commencé très tôt, et cela est dû surtout à la Charte de 1472 : les colons étant obligés de ne marchander avec la côte guinéenne que des articles originaires du Cap-Vert, ils achetaient des propriétés situées vers l’intérieur de l’île qui seraient par la suite exploitées avec de la main d’œuvre esclave dans le but d’en tirer des produits (surtout agricoles et issus de l’élevage) qui entreraient dans les échanges commerciaux à Ribeira Grande dans un premier temps et sur la côte guinéenne dans un second temps.
Le cas des autres îles de l’archipel du Cap-Vert
Les autres îles de l’archipel du Cap-Vert (celles de Santo Antão, São Vicente, Santa Luzia, São Nicolau, Sal, Boavista, Maio et Brava) sont restées inhabitées depuis leur découverte jusqu’à la deuxième moitié du XVIe siècle. Mis à part cela, rien n’est connu à leur sujet pendant cette période-là.
Des indices du peuplement des îles de Santo Antão et de São Nicolau n’existent qu’à partir 1570. Leur peuplement tout de suite après les îles de Santiago et Fogo n’est pas surprenant. En effet, elles étaient les seules à posséder beaucoup de ressources en eau et un très grand potentiel au niveau de l’agriculture et de l’élevage. Or, pourquoi les colons ont-ils décidé de peupler d’abord l’île de Fogo qui possédait beaucoup moins de ressources que ces deux dernières ? C’est surtout pour des raisons d’accessibilité : elles se situaient loin de Ribeira Grande (environ deux cents kilomètres pour l’île de São Nicolau et presque trois cents kilomètres pour l’île de Santo Antão).
Le reste des îles n’a été peuplé qu’à partir du XVIIe siècle. Dans le but d’essayer de les valoriser, la Couronne portugaise y a introduit l’élevage d’animaux sur une large échelle, vu que la pratique de l’agriculture était presque impossible à cette époque, en raison du manque d’eau lié à la sécheresse dans laquelle elles étaient plongées. C’est pourquoi ces îles avaient le statut de simples pâturages pour les propriétaires de bétail.
L’île de São Vicente, dernière à être peuplée (seulement pendant la deuxième moitié du XIXe siècle), a connu un développement considérable lorsqu’a été installé dans la baie de Porto Grande un dépôt de charbon servant à ravitailler les bateaux sur la route de l’Atlantique. Des gens venant de Santo Antão et de São Nicolau s’y sont alors installés et le village de Mindelo a été fondé. En 1890, l’île comptait déjà quelque six mille six cents habitants. Avec l’expansion de la navigation à vapeur, plusieurs dépôts anglais de charbon y étaient en activité et des dizaines de bateaux s’arrêtaient au port de Mindelo pour s’approvisionner. L’île était devenue une escale obligatoire au milieu de l’océan Atlantique pour des navires du monde entier. Elle connut alors un tel essor que la possibilité de déménager la capitale du Cap-Vert de Ribeira Grande à Mindelo a été envisagée, mais cela n’a jamais abouti. Quelques dizaines d’années plus tard, avec l’apparition du moteur Diesel, les navires n’utilisèrent plus le charbon et le port de Mindelo a perdu ainsi son rôle prépondérant.
Jusqu’ici, nous avons présenté l’histoire du peuplement de l’archipel du Cap-Vert. Mis à part le village de Ribeira Grande, la dispersion était, en somme, une des principales caractéristiques des communautés existant au Cap-Vert. Le prochain sous-chapitre présentera plus de détails concernant la composition ethnique de la population qui s’est installée pendant la colonisation portugaise.
La composition ethnique de la société capverdienne pendant la colonisation
Des éléments originaires de deux zones géographiques assez distinctes contribuèrent à la formation de la société capverdienne : d’un côté les hommes « blancs européens » et de l’autre les hommes « noirs africains ». Dans ce sous-chapitre, nous présenterons l’identité ethnique des individus qui, libres ou forcés, se sont installés sur les îles de l’archipel.
Auparavant, il faut souligner que les informations concernant ce sujet sont très rares et concernent principalement les Portugais. C’est-à-dire que les renseignements sur les individus arrivés du continent africain sont presque inexistants et cela nous paraît assez évident : les Portugais détenaient le pouvoir à l’époque et ils étaient autonomes.
Le contingent européen
Selon Albuquerque et al. (1991), les premiers Portugais à arriver au Cap-Vert étaient originaires du nord et du sud du Portugal. Comme nous l’avons écrit dans le sous-chapitre précédent, ce sont les encouragements commerciaux accordés par la Couronne portugaise qui ont poussé les Portugais à partir à Santiago. Ces encouragements ont attiré, au départ, surtout des commerçants qui souhaitaient exploiter le commerce avec la Guinée et s’enrichir très rapidement. En raison de la Charte de 1472, ils se sont retrouvés dans l’obligation de réaliser des activités agricoles pour avoir des produits à vendre.
Bien entendu, la population portugaise n’était pas composée uniquement de commerçants. Au fur et à mesure que la société se structurait et que le nombre d’habitants augmentait, d’autres profils d’individus apparaissaient sur l’île de Santiago, notamment : des contrôleurs d’activités économiques qui se développaient sur les îles, des agents pour la gestion politico-administrative, pour l’assistance spirituelle, pour l’assistance sanitaire, des marins, des criminels, des professionnels de divers domaines, etc. Ainsi, la diversité était la caractéristique principale des Portugais qui partaient au Cap-Vert. Certains ne s’y déplaçaient que pour réaliser des missions et après leur séjour finissaient par retourner au royaume ; d’autres s’y fixaient durablement.
Mis à part les Portugais, d’autres individus d’origine européenne se trouvaient au Cap-Vert : il s’agissait des Génois qui accompagnèrent Antonio da Noli lors de son débarquement au Cap-Vert. Ils auraient laissé des héritiers au Cap-Vert vu que le nom de famille « Noli » était très fréquent pendant le XVIe siècle.
Il existait au Cap-Vert une forte présence de Castillans. C’était la première communauté d’Européens non portugais et ils bénéficiaient d’une bonne situation économique grâce à leur rôle actif dans le commerce avec la côte guinéenne. La Couronne portugaise essaya de les empêcher de marchander avec la Guinée vu que, en tant qu’étrangers, l’accès à cette région leur était interdit. Toutefois, comme ils étaient embauchés par les seigneurs portugais en tant que pilotes et maîtres de navires, ils avaient accès au marché et en profitaient.
En réalité, les Castillans étaient les principaux acheteurs d’esclaves au Cap-Vert. Comme ils ne pouvaient aller en acheter directement sur la côte guinéenne (vu que c’était le royaume portugais qui détenait le monopole de ce marché), ils se contentaient de s’en procurer à Santiago. Ce sont également les membres de cette communauté qui apportaient des biens pour la consommation au Cap-Vert.
Selon Albuquerque et al. (1991), des Juifs (probablement portugais) figuraient également parmi les hommes blancs sur les îles. Commerçants réputés, arrivés du royaume portugais, ils n’ont pas hésité à mener leur activité économique de prédilection. Leur présence n’a jamais été très 30 appréciée par les Portugais au Cap-Vert. Cela a même été à l’origine de tensions et de conflits.
La Couronne a tenté d’interdire leur fixation au Cap-Vert, mais ces tentatives ont été vaines.
En ce qui concerne la présence européenne au Cap-Vert, les Portugais étaient le groupe dominant, mais n’étaient pas les seuls hommes blancs. Étant donné qu’ils étaient tous impliqués dans les activités commerciales, la grande majorité des individus d’origine européenne se trouvaient fixés à Ribeira Grande et ne s’installaient presque pas dans des zones plus rurales à l’intérieur des îles. Albuquerque et al. (ibid.) soulignent que le nombre d’hommes blancs européens n’a jamais atteint de grandes proportions au Cap-Vert. La Charte de 1466 n’a pas attiré beaucoup de Portugais et, une partie d’entre eux utilisait l’île de Santiago comme point de passage en vue d’aller s’installer illégalement dans la côte guinéenne. En outre, la raréfaction des femmes blanches sur les îles a directement contribué au manque d’hommes blancs. Ces auteurs vont jusqu’à estimer qu’il s’agit de la principale raison pour laquelle les hommes blancs étaient si peu nombreux.
Le contingent africain et la traite d’esclaves dans la capitainerie du Cap-Vert
Contrairement aux hommes blancs européens qui arrivaient surtout du Portugal, les hommes noirs africains étaient beaucoup plus nombreux et leurs origines plus variées et plus difficiles à définir. En effet, ils arrivaient de la côte occidentale africaine, achetés souvent dans des marchés monopolisés par les Portugais. Il s’agissait d’êtres humains, kidnappés (fréquemment par des Européens ou bien par leur semblables10), privés de leur liberté et par la suite vendus comme des marchandises en tant qu’esclaves. Nous mettons l’accent sur cette idée de séquestration vu que les hommes noirs qui étaient enlevés pouvaient avoir profité de leur liberté avant cela. En d’autres termes, personne ne naît avec une étiquette « esclave » collée sur le front ; le devenir c’est un autre sujet ! Les marchés d’esclaves vendaient des prisonniers qui devenaient par la suite, après leur achat, des esclaves. Le trafic d’esclaves a explosé après la Charte de 1466 et ils constituaient la marchandise principale pour l’exportation vers les îles Canaries, l’Europe et les Antilles à partir des îles du Cap-Vert.
Pour ces raisons, les esclaves étaient le principal substrat humain qui est rentré dans le peuplement des îles. Duarte (1998) établit qu’en 1582, il existait sur les îles de Santiago et Fogo une centaine d’hommes blancs pour treize mille sept cents esclaves. Cette idée corrobore la position adoptée par Albuquerque et al. (1991) en ce qui concerne la faible présence d’hommes blancs sur les îles. De son côté, Quint (2008) confirme également cette hypothèse, mais écrit qu’à la fin du XVIe siècle, Santiago comptait environ 13 000 habitants dont 87,2% étaient des esclaves africains. Autrement dit, plus d’un millier d’hommes ou de femmes blancs vivaient sur cette île.
Si pour l’origine ethnique des Européens il est possible d’indiquer qu’il s’agissait de Portugais, Castillans et d’Italiens, en ce qui concerne les hommes africains, pendant le premier siècle de colonisation, il existe un profond « silence » documentaire. En effet, il n’existe pratiquement aucun document qui aborde les origines ethniques des nombreux esclaves qui ont débarqué dans les ports de Santiago. Dans la société esclavagiste dans laquelle s’insèrent ces faits, cela se comprend, dans la mesure où ces êtres humains étaient perçus comme de simples marchandises dont l’origine n’était pas importante. Le facteur essentiel était leur condition physique : la santé, l’âge, la taille, la corpulence, entre autres.
Ce qu’il est possible d’en déduire, c’est qu’en général, la presque totalité des esclaves qui sont passés par le Cap-Vert trouvaient leurs origines sur la côte guinéenne qui, comme nous le montre l’image ci-dessous, s’étendait du Sénégal jusqu’à la Sierra Leone.
La structure sociale de la société esclavagiste capverdienne
Pendant la période coloniale, la société capverdienne était composée de trois grands groupes sociaux bien distingués. Le premier était, bien entendu, constitué des blancs européens, le deuxième par des Africains libres et les noirs affranchis et le dernier par les esclaves. La structure de la société était pyramidale avec les blancs au sommet, les esclaves à la base et les africains libres au milieu. Cette classification était faite en fonction des droits des individus qui composaient la société.
Dans le groupe des hommes libres se trouvaient essentiellement les blancs, originaires principalement du Portugal et d’autres coins de l’Europe (en nette minorité). Malgré le nombre réduit d’Européens sur le sol capverdien en comparaison avec le nombre d’esclaves, ce sont eux qui détenaient le pouvoir et dominaient le reste des ethnies. Cependant, il existait une sous-hiérarchie à l’intérieur du groupe des blancs. C’est pourquoi il est difficile de les insérer tous dans la même couche sociale, vu que, quand les Portugais arrivaient au Cap-Vert, ils ne changeaient pas de statut social : un individu issu de la noblesse gardait son statut de noble et était traité en tant que tel ; c’était le même cas pour un individu issu de la classe moyenne basse. Ce sont les lois de l’époque, transplantées directement du Portugal, qui contribuaient à cette stratification sociale dans l’archipel. Cette distinction était également évidente au niveau de la justice (un noble n’aurait jamais eu les mêmes punitions qu’un plébéien pour un même crime commis) et au niveau des postes de gouvernance (occupés toujours par les nobles et la Couronne se chargeait de leur rapide ascension économique). Ce n’étaient pas les salaires perçus qui provoquaient l’enrichissement de ces individus, mais spécialement les fréquentes fraudes auxquelles ils avaient recours pour tirer de plus grands bénéfices, étant donné qu’ils occupaient des postes directement liées aux activités commerciales. Ainsi, ce sont les hauts fonctionnaires et les grands commerçants propriétaires qui constituaient l’oligarchie locale. Ces derniers accumulaient de grandes richesses grâce au trafic d’esclaves et à la production de coton.
En somme, le pouvoir économique était la principale valeur qui déterminait le statut social de chaque individu blanc dans la société insulaire. D’ailleurs, c’est pour cette raison que les fonctionnaires des institutions locales, les petits commerçants, les marins, les ouvriers, les mécaniciens, etc., qui avaient des revenus plus modestes, se plaçaient après les riches propriétaires et commerçants dans la hiérarchie sociale.
En dépit de cette sous-hiérarchie à l’intérieur de la communauté blanche, en termes de groupe, ils avaient des privilèges vis-à-vis des hommes africains libres ou affranchis. En effet, c’est le facteur « race » qui légalement empêchait ces hommes africains d’accéder à un meilleur statut social. Dans la base de la pyramide sociale, comme nous l’avons indiqué au début de ce sous-chapitre, se trouvaient les esclaves. Ces derniers constituaient la grande majorité de la population de l’archipel et pouvaient être considérés comme des colons, selon Albuquerque et al. (1991). Au sein de ce groupe, il n’existait aucune distinction sociale et ses membres n’avaient aucun droit. Même la mobilité sociale leur était interdite. La seule différentiation possible consistait en la manière dont les propriétaires de ces mêmes esclaves les utilisaient (à l’intérieur de la maison pour les tâches ménagères, dans les champs, dans les ateliers comme ouvriers, etc.) ou alors dans la manière dont les seigneurs interagissaient avec les esclaves. En effet, l’esclavage au Cap-Vert était partiellement domestique, vu que les esclaves et leurs propriétaires tissaient, dans certains cas, des liens étroits entre eux. C’est pourquoi la distinction entre les esclaves ruraux et les esclaves domestiques est pertinente. Arrivés continuellement sur l’archipel en provenance de la côte guinéenne, certains esclaves y faisaient de très courts séjours en attendant des acheteurs qui les emmèneraient vers des pays plus lointains. Ceux qui étaient destinés à la « consommation » locale avaient pour destination finale les champs agricoles dans la plupart des cas.
Les esclaves affranchis ou les affranchis tout simplement, figuraient entre les esclaves africains et les hommes blancs européens dans la hiérarchie. Situés au milieu de la pyramide sociale, ils bénéficiaient de la liberté qui leur avait été accordée par leurs anciens propriétaires. Dans cette même couche sociale se trouvaient également les hommes africains nés dans la condition de libres » parce que leurs parents bénéficiaient déjà de cette condition et aussi les hommes métis. Ce terme, issu du latin classique « mixtus », désignait les individus issus des couples mixtes (père blanc européen et mère noire africaine en général). Ils étaient à l’origine de l’élément créole apparu dans l’archipel pendant la colonisation. Nous y reviendrons dans les prochains chapitres. Les métis n’étaient pas pleinement reconnus par leur père européen, vu qu’ils étaient des enfants bâtards. Ils ne pouvaient donc pas bénéficier de l’héritage parce que c’était interdit, mais avaient quelques privilèges dans la société capverdienne, vu que le système esclavagiste avait une certaine tolérance et flexibilité.
Dans la condition de marron se trouvaient les fugitifs. Ce terme désigne l’esclave qui s’est enfui pour vivre en liberté. L’évasion était la manière la plus efficace d’atteindre la liberté et cette pratique a couramment été utilisée au Cap-Vert. Ce phénomène, appelé « marronnage » permettait aux marrons de vivre en bande, aux marges de la société. Juridiquement parlant, ils étaient considérés comme des esclaves, mais ils étaient vus comme des hommes libres. Les montagnes des îles de Santiago et Fogo leur offraient des refuges sécurisés et ils étaient très hostiles envers le reste des membres de la société, de peur d’être recapturés. Pour survivre, ils étaient obligés de mener des razzias dans les villages (Albuquerque et al.,1991).
Le schéma ci-dessous résume ce que nous avons jusqu’ici présenté en ce qui concerne la structure de la société esclavagiste pendant la colonisation.
En somme, d’après le schéma ci-dessus, il est possible d’en déduire que les Portugais détenaient tous les pouvoirs économiques et politiques. Pour ce qui est des noirs libres et des métis, leurs conditions de survie étaient considérablement précaires : vu qu’ils pouvaient difficilement être rémunérés (la main d’œuvre esclave dominait le marché du travail), ils ne disposaient pas de moyens de survie. En fin de compte, leur situation n’était pas très différente de celle des esclaves.
Cette structure sociale se serait maintenue pendant un certain temps. Delgado (2009) explique que le XVIIe a été marqué par l’arrivée au pouvoir des hommes métis qui ont détrôné les Blancs, ce qui a bouleversé la hiérarchie sociale. C’est justement sur cette nouvelle configuration sociale qu’il est possible de trouver les racines de la société capverdienne actuelle. L’abolition de l’esclavage et l’interdiction du trafic atlantique d’esclaves ont marqué une nouvelle période dans l’histoire de l’archipel : la Couronne a été obligée d’effectuer des ajustements qui ont considérablement bouleversé les relations sociales dominantes. Pendant ce temps-là, l’Empire portugais était très décadent en raison du nouveau formatage du commerce international et de l’affirmation de nouvelles puissances coloniales (telles que l’Angleterre et la France) qui imposaient une sévère concurrence aux Portugais. Le XXe siècle a été surtout marqué par la décadence du marché local, les grandes périodes de famines (1902-1903 ; 1920-1922 ; 1940-1950) qui ont décimé la population capverdienne et par la lutte de libération nationale qui a conduit à l’indépendance du Cap-Vert, rendue effective en 197511.
La présence européenne sur l’archipel était faible : en réalité, les Chartes n’ont pas beaucoup attiré les Portugais et les îles ont été peuplées surtout par des esclaves. La justice sociale était évidemment déterminée selon les origines des individus et les conflits sociaux étaient très fréquents. Néanmoins, c’est cette cohabitation entre individus d’un peu partout qui sera à l’origine de la langue et de la culture capverdiennes.
Nous allons y revenir dans le prochain chapitre.
Histoire du Cap-Vert : quelques faits marquants
Comme nous l’avons constaté dans les chapitres précédents, le métissage est une caractéristique fondamentale de la communauté capverdienne. De fait, le brassage d’individus, de langues et de cultures a contribué à la formation d’une société dont la culture est fortement diversifiée. Nous verrons dans les prochaines sections que l’élément culturel a permis au peuple capverdien de faire face aux adversités et, par conséquent, de définir et affirmer une identité singulière.
La formation d’une société insulaire : l’émergence et l’affirmation de la culture capverdienne
L’origine du mot culture remonte au XIIe siècle. Il descend du latin « cultura » et, dans son sens littéral, il désigne l’action de cultiver la terre. Vers la moitié du XVIe siècle, un second sens lui est attribué et il renvoie alors au développement des facultés intellectuelles par des exercices appropriés. Autrement dit, il commence d’être appliqué à tout ce qu’un individu acquiert par ses propres moyens ou par le biais de l’instruction/éducation afin d’assimiler davantage de connaissances et de comprendre et développer sa propre vision du monde. Cela renvoie à l’ensemble des connaissances, des croyances, des valeurs (morales ou intellectuelles), des traditions, des coutumes, des comportements propres à un groupe humain. Dans une perspective similaire, le mot culture peut également être synonyme de « tradition », car chaque individu naît dans un contexte dont l’intériorisation des normes est nécessaire afin d’acquérir une identité sociale. C’est-à-dire que chaque individu est membre d’un groupe ou bien d’un ensemble qui permet de lui attribuer un statut.
En somme, parler de la culture c’est se référer aux relations que l’Homme entretient avec le monde, plus particulièrement avec l’environnement dans lequel il est inséré. Au sens large, c’est tout ce que l’homme acquiert par l’intermédiaire d’un groupe social déterminé, notamment ce qui est transmis par le langage, les coutumes, l’éducation et même, de manière implicite, les gestes, les attitudes ou les règles de comportement. Selon Cavalli-Sforza (2005), en anthropologie sociale et culturelle ou en ethnolinguistique, cette interaction est caractérisée comme étant très dynamique et susceptible d’évoluer et subir des mutations. En effet, la dynamique et la transformation de la culture sont liées au contact avec d’autres cultures et à l’évolution des sociétés.
D’après Rocher (1992 : 104-105), ce sont les anthropologues et les sociologues qui ont mis en lumière les principales caractéristiques de la culture, à savoir : Elle s’adresse à toute l’activité humaine, qu’elle soit cognitive, affective ou conative (c’est-à-dire le fait d’agir au sens strict) ou même sensori-motrice. Cette expression souligne que la culture est action, qu’elle est d’abord et avant tout vécue par des personnes. C’est l’observation de cette même action qui permet d’inférer l’existence de la culture et d’en tracer les contours. Dans le sens inverse, c’est parce qu’elle se conforme à une culture donnée que l’action des individus peut être dite action sociale ;
Les manières de penser, de sentir et d’agir sont plus ou moins formalisées : dans le cadre d’un code de lois, dans des formules rituelles, des cérémonies, un protocole, une théologie, etc., elles sont très formalisées alors qu’elles le sont moins et à des degrés divers dans les arts, dans le droit coutumier, dans certains secteurs des règles qui régissent les relations interpersonnelles, etc. ;
Les manières de penser, de sentir et d’agir sont partagées par une pluralité de personnes. Rocher souligne qu’il peut suffire de quelques personnes pour créer la culture et que le nombre de personnes importe peu. L’idéal est que des façons d’être soient considérées comme normales par un nombre suffisant de personnes, ce qui permet de reconnaître qu’il s’agit bien de règles de vie ayant acquis un caractère collectif, et donc social ;
La culture n’est pas innée. Rien de culturel n’est hérité biologiquement ou génétiquement, rien de la culture n’est inscrit à la naissance dans l’organisme biologique. L’acquisition de la culture résulte des divers modes et mécanismes de l’apprentissage (dans son sens large).
Au-delà de ces caractéristiques, Rocher (1994) ajoute que la culture remplit deux fonctions distinctes, l’une sociale (car elle permet de réunir une pluralité de personnes en une collectivité spécifique) et l’autre psychique (étant donné qu’elle fonctionne comme une sorte de moule qui fournit aux personnalités psychiques des individus des modes de pensée, des connaissances, des idées, des canaux privilégiés d’expression des sentiments, des moyens de satisfaire ou d’aiguiser des besoins psychologiques).
Pour la formation d’une culture, un environnement où chaque individualité agit en apportant sa contribution est nécessaire, ce qui en même temps fait en sorte qu’elle soit diffusée et préservée. C’est en tenant compte de cet aspect que Bernardi (1992 : 49) a indiqué les quatre facteurs essentiels à la survie d’une culture, notamment : l’anthropos (l’Homme n’existe pas sans la culture de la même manière qu’il n’y a pas de culture sans les hommes ; il est à la fois un produit et producteur de sa propre culture), l’ethnos (l’Homme a besoin d’être en communauté pour assurer la préservation de sa culture), l’oïkos (c’est l’environnement dans lequel l’Homme laisse manifester sa propre culture) et le chronos (la culture naît, se développe et évolue en fonction du temps ; au fur et à mesure que le temps passe, de nouveaux éléments sont introduits et d’autres ont tendance à disparaître). Ces différents facteurs qui composent la culture d’une manière générale ne sont pas simplement juxtaposés l’un à l’autre. Des liens les unissent et des rapports de cohérence les rattachent les uns aux autres.
En un mot, les manifestations culturelles sont le résultat des transformations et de l’évolution humaines. Comme la diversité est un trait essentiel de la race humaine, les manifestations culturelles varient massivement au sein des communautés, à travers des coutumes, des croyances, des traditions orales, des savoirs populaires, des langues, des rythmes musicaux, des danses, des modèles de comportement, des visions du monde, entre autres. Ces différentes considérations nous montrent que le mot culture est utilisé dans différents domaines et contextes. C’est pourquoi il s’apprête à des interprétations diverses et variées. En effet, la culture signifie non seulement ce que l’homme assimile à travers le contact avec d’autres individus, mais encore ce qu’il crée ou modifie.
En ce qui concerne le contexte capverdien, il est possible de constater que c’est le dialogue des civilisations qui est au cœur de ce qui est aujourd’hui la culture capverdienne. Comme l’archipel ne comptait pas de populations autochtones, des individus issus de plusieurs communautés/groupes qui ne partageaient pas la même culture se sont retrouvés sur ces îles et ont naturellement ressenti le besoin de manifester leurs sentiments ou d’exprimer leur pensée. Face aux nombreuses adversités qu’une situation coloniale peut représenter, ils ont dû forger une nouvelle manière de vivre afin de satisfaire leurs besoins culturels. Sur ce sujet, Duarte (1998) écrit que c’est l’Africain qui a été le principal agent déclencheur des transformations culturelles au Cap-Vert. Force est de constater qu’il a été ramené de force au Cap-Vert en tant qu’esclave et a subi une plus forte violence culturelle par rapport à ceux qui sont restés sur le continent, dans la mesure où il a été enlevé à sa famille, à sa tribu et coupé de ses traditions. En un mot, il a été déraciné et transplanté vers un environnement différent où, entre autres, on lui a imposé une langue inconnue. Contrairement aux Portugais qui détenaient le pouvoir en tant que dominants, ce sont les Africains qui ont ressenti le plus le besoin de la mise en place d’une résistance culturelle en se basant sur des éléments issus des diverses ethnies présentes dans la société esclavagiste capverdienne. La cohabitation forcée entre seigneurs et esclaves a fait que, petit à petit, les uns ont intégré la culture des autres.
Madeira (2015) écrit que la culture capverdienne est le résultat de ce processus hétérogène au cours duquel les manifestations culturelles ont été créées, synthétisées et/ou modifiées sous différentes formes. Elle possède ses propres spécificités qui permettent de la distinguer des autres, étant donné qu’elle a acquis des traits spécifiquement capverdiens. En effet, pendant son apprentissage culturel, l’Homme n’est pas passif en ce qui concerne l’assimilation de nouveaux éléments. Il les modifie fréquemment, en rajoute, diminue et invente de nouvelles composantes.
Sur l’archipel, au fur et à mesure que la cohabitation s’intensifiait, une culture métisse s’est développée, résultat de la modification et du mélange hétérogène des cultures africaine et européenne. De fait, plusieurs pratiques culturelles africaines ou européennes ne pouvaient pas avoir lieu à l’identique, comme dans leur espace socioculturel d’origine, car les individus se trouvaient loin de leur oïkos. Par exemple, les Portugais avaient leurs propres habitudes alimentaires et les plats étaient généralement préparés par des femmes portugaises. Une fois au Cap-Vert, même s’ils faisaient venir les ingrédients par bateau à partir du Royaume, ce sont les femmes africaines qui les préparaient à leur façon, selon leur culture (Albuquerque et al, 1991). Chacun s’est donc retrouvé obligé de s’adapter et d’accepter la nouvelle réalité culturelle. Ce sont ces aspects qui poussent Madeira (2015) à caractériser la culture capverdienne d’« hybride ». En raison du peuplement des autres îles, cette même culture a été diffusée sur l’ensemble du territoire insulaire. À partir d’un brassage culturel et des influences de la colonisation, les Capverdiens ont créé des manières spécifiques d’affronter la vie quotidienne, basées sur des manifestations culturelles, des symboles et des représentations sociales.
|
Table des matières
Introduction générale
0.1 – Les motivations pour le choix du sujet
0.2 – Le contexte de la recherche
0.3 – La problématique de recherche
0.4 – Les questions de recherche
0.5 – L’organisation de la thèse
Partie I – Histoire du Cap-Vert : quels liens avec la langue capverdienne ?
Chapitre 1 – La découverte et peuplement des îles du Cap-Vert
1.1 – Le peuplement
1.2 – Les premières colonies
Chapitre 2 – La composition ethnique de la société capverdienne pendant la colonisation
2.1 – Le contingent européen
2.2 – Le contingent africain et la traite d’esclaves dans la capitainerie du Cap-Vert
2.3 – La structure sociale de la société esclavagiste capverdienne
Chapitre 3 – Histoire du Cap-Vert : quelques faits marquants
3.1 – La formation d’une société insulaire : l’émergence et l’affirmation de la culture capverdienne
3.2 – Le mouvement littéraire Claridade
3.3 – L’indépendance du Cap-Vert
Partie II – Cadre théorique de la recherche : le contexte épistémologique
Chapitre 4 – La sociolinguistique : une science née de la critique
4.1 – Macrosociolinguistique et microsociolinguistique
4.2 – L’interdisciplinarité dans la sociolinguistique
Chapitre 5 –La langue, le langage et la parole : quels rapports ?
5.1 – La typologie des langues
5.2 – Les statuts des langues
5.3 – Norme(s) et communautés linguistiques
Chapitre 6 – La diversité langagière : effets et conséquences
6.1 – La variation linguistique
6.2 – L’analyse de la pluralité linguistique
6.3 – Les langues en interaction
Chapitre 7 – Les politiques linguistiques
7.1 – La planification linguistique
7.2 – Quelles politiques linguistiques pour la diversité linguistique ?
7.3 – L’utilisation des langues nationales dans l’Afrique postcoloniale
Partie III – L’étude de terrain
Chapitre 8 – Les langues du Cap-Vert : une analyse macrosociolinguistique
8.1 – La langue capverdienne : sa genèse et son évolution
8.2 – La langue portugaise du Cap-Vert
8.3 – Les langues du Cap-Vert : entre cohabitation, interdictions et interventions……………. 236
8.4 – Les langues étrangères du Cap-Vert
Chapitre 9 – Principes méthodologiques dans l’enquête sociolinguistique
9.1 – Les types d’enquêtes
9.2 – Les techniques de collecte de données
9.3 – Les techniques d’enquête adoptées
Chapitre 10– L’enquête de terrain
10.1 – La définition du sujet d’étude
10.2 – Les choix méthodologiques
10.3 – Les résultats obtenus et les discussions
10.4 – Bilan général : qu’apporte la langue capverdienne aux Capverdiens ?
10.5 – Les réponses aux questions de recherche
Conclusions et perspectives
Références bibliographiques
Télécharger le rapport complet