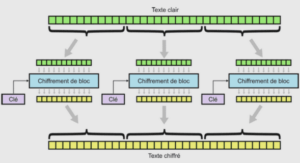Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Physiopathologie [4, 5]
Les fistules pré-auriculaires situées en avant du bord antérieur de l’hélix sont les fistules congénitales les plus fréquentes de la face et du cou. Elles résultent embryologiquement de la fusion incomplète des six colliculi de His entrant dans la constitution de l’oreille externe au cours de la sixième semaine de vie embryonnaire.
Clinique [2-5]
Les fistules pré-auriculaires sont le plus souvent asymptomatiques, de découverte fortuite lors d’un examen ORL ou dermatologique de routine.
Elles sont aussi évoquées devant la présence :
d’une simple dépression punctiforme,
d’un orifice fistuleux situé en avant de la racine de l’hélix, au-dessus du bord supérieur du tragus d’où sourd un liquide séreux ou du caséum,
Parfois, c’est un épisode de surinfection avec écoulement purulent par l’orifice externe ou abcès pré auriculaire, qui amène au diagnostic.
L’examen otoscopique doit s’assurer de la normalité du tympan.
Elles peuvent être unilatérales ou bilatérales, sporadiques ou familiales et dans ce cas, elles sont bilatérales.
Il existe des formes isolées et syndromiques. Parmi les différents syndromes, deux syndromes autosomiques dominants sont à rechercher de façon systématique :
Le syndrome branchio-oto-rénal (BOR) caractérisé par la présence de fistule pré auriculaire dans 70 à 80 % des cas, de kystes ou fistules branchiale, de microtie, de surdité dans 95 % des cas et de malformation rénale.
Le syndrome branchio-otique présentant les mêmes caractéristiques sans l’atteinte rénale. L’expressivité est variable et les gènes impliqués dans ces syndromes sont EYA1, SIX 1 et SIX 5.
Paraclinique [5, 15]
L’audiogramme permet d’éliminer une aplasie mineure associant un pavillon subnormal, un conduit auditif externe normal ou sténosé, des malformations ossiculaires et une oreille interne normale. Etant donné que sur le plan embryologique les oreilles externe et moyenne dérivent chacune des deux premiers arcs branchiaux, toute anomalie d’un de ces arcs peut induire une lésion malformative de l’oreille externe et de l’oreille moyenne.
Traitement [5, 10]
Certaines fistules sans complications ne justifient que d’une surveillance.
L’intervention est nécessaire pour une fistule avec écoulement ou épisodes de surinfection, mais à distance de ceux-ci.
En cas de surinfection, une antibiothérapie anti staphylococcique est nécessaire ; un drainage chirurgical peut s’imposer en cas de collection.
L’indication opératoire sera purement esthétique ou dans un but préventif des infections.
L’exérèse complète de la fistule est réalisée à distance de l’épisode infectieux.
Technique opératoire
Réaliser une incision losangique circonscrivant l’orifice fistuleux
Puis excision complète de la fistule avec les tissus avoisinants :
S’exposer largement : étendre l’incision péri fistulaire vers le haut.
Ne pas tenter de repérer le trajet fistuleux mais enlever au large les tissus entre hélix et plan profond de l’aponévrose.
Limite postérieure : cartilage de l’hélix.
Limite inférieure : fascia parotidien.
Limite profonde : fascia temporalis.
L’exérèse est réalisée en monobloc jusqu’au plan de l’aponévrose temporale en dedans, emportant au besoin un peu de périchondre de la racine de l’hélix pour mettre plus sûrement à l’abri d’une récidive.
Détail des étapes chirurgicales
Incision elliptique autour de la fistule.
Prolonger l’incision supérieurement, noter la position du nerf facial.
Disséquer jusqu’au fascia temporalis en haut et en avant de la fistule.
Disséquer les tissus mous externes par rapport au fascia dans une direction postéro-inférieure.
Repérer le cartilage de l’hélix.
Disséquer le cartilage en sous péri-chondral, et repérer la zone d’adhérence.
Exciser une ellipse de cartilage, en profondeur de l’apex de la fistule, là où les tissus de la fistule adhèrent au cartilage.
Enlever la pièce.
Laver la zone opératoire.
On peut laisser un petit drain ou des crins in situ.
Suture en deux plans.
LYMPHANGIOME KYSTIQUE (LK)
Physiopathologie [2, 13, 15]
Le lymphangiome kystique est une tumeur bénigne en rapport avec une dysembryoplasie portant sur le système lymphatique dont les localisations cervico-faciales sont les plus fréquentes. Il fait partie des malformations vasculaires à bas débit.
Clinique [2, 13, 15]
Rare chez l’adulte, il survient généralement avant l’âge de deux ans. Au plan macroscopique, le lymphangiome kystique peut être constitué de kystes de grande taille (macrokystique de localisation sous hyoïdienne) ou de kystes de petite taille (microkystique de localisation sus-hyoïdienne).
Il s’agit de tuméfactions molles, non douloureuses, évoluant par poussée qui peuvent grossir brutalement à l’occasion d’un épisode infectieux ORL.
Il peut être potentiellement grave par sa tendance extensive et infiltrante des tissus de voisinage et par ses complications aigues telles que les surinfections, les poussées inflammatoires et hémorragiques, la dyspnée. Le lymphangiome kystique peut se stabiliser, voire régresser.
Paraclinique [2, 14]
L’imagerie est d’un grand apport dans le diagnostic des lymphangiomes kystiques. Elle permet en plus d’orienter la démarche thérapeutique.
L’IRM est l’examen le plus adapté pour apprécier l’extension en profondeur du lymphangiome, avant d’en réaliser son exérèse.
L’examen anatomo-pathologique donne la confirmation histologique.
Traitement [13, 15]
La chirurgie conservatrice est l’approche la plus souvent recommandée. Les formes macrokystiques cervicales peuvent bénéficier d’une chirurgie ou d’une sclérothérapie in situ. Les formes microkystiques sont souvent impossibles à éradiquer en totalité, il s’agira de faire en fonction des cas une simple surveillance, la chirurgie, la sclérothérapie ou des résections au laser.
KYSTES ET FISTULES DU PREMIER ARC BRANCHIAL
Physiopathologie [2, 11]
Les arcs branchiaux sont des structures métamériques qui se forment autour de la quatrième semaine du développement embryonnaire et qui guident la morphogenèse de la région cervico-faciale. Les arcs branchiaux se constituent à partir du mésoblaste et de l’ectomésenchyme (mésenchyme dérivant des crêtes neurales dans la région céphalique). À la fin de la quatrième semaine, il y a quatre paires bien définies d’arcs branchiaux et deux autres arcs rudimentaires qui ne sont pas visibles en surface de l’embryon. Ils sont séparés les uns des autres par les poches branchiales.
Chaque arc renferme un axe cartilagineux, un segment vasculaire et un nerf crânien. Chaque arc va guider la formation de structures anatomiques.
Par exemple, le premier arc est à l’origine du cartilage de Meckel qui donnera : le marteau, l’enclume et la mandibule, les muscles masticateurs, une partie du muscle digastrique, le muscle du marteau, l’artère maxillaire interne et le nerf trijumeau.
Alors que la fente et la poche vont donner le conduit auditif externe, la trompe auditive, la caisse du tympan et les cellules mastoïdiennes.
À l’état physiologique, ils disparaissent totalement.
Les kystes et fistules d’origine branchiale résultent d’un défaut de coalescence d’une fente ou d’une poche branchiale entraînant la persistance d’un reliquat de l’appareil branchial.
Les manifestations cliniques sont propres à chaque reliquat embryologique et la localisation de ces anomalies permet de préciser la poche ou fente branchiale dont elles dérivent.
Clinique [2, 15, 16]
L’orifice externe se trouve dans la région comprise entre le tragus, la symphyse mentonnière et le milieu de l’os hyoïde (triangle de Poncet). L’orifice interne se situe au niveau du plancher du conduit auditif externe. Le trajet de la fistule est parallèle au CAE.
Un kyste peut s’être développé sur le trajet de cette fistule et donner en cas de surinfection des tableaux trompeurs faisant évoquer une pathologie parotidienne.
Il existe deux types anatomiques :
le type I correspond à une duplication du conduit auditif externe. Le kyste siège dans la région rétro-auriculaire avec un trajet fistuleux situé en dehors du nerf facial ;
le type II est plus fréquent. Le kyste se trouve dans la partie inférieure de la région parotidienne avec un trajet fistuleux passant dans la parotide, au contact du nerf facial et se termine à la jonction ostéo-cartilagineuse du conduit auditif externe et passe souvent inaperçu.
Cliniquement, les kystes se présentent comme des masses de la région rétro-ou sous-auriculaire.
Des fistulisations cutanées peuvent également apparaitre à la suite de surinfections du kyste.
L’examen otoscopique, réalisé de façon systématique, recherche une duplication du conduit auditif ou la présence d’une bride entre la membrane tympanique et le plancher du conduit auditif.
KYSTES ET FISTULES DU DEUXIEME ARC BRANCHIAL
Physiopathologie [15, 16]
Le terme de kyste de la 2e fente (K2) est d’un usage pratique, mais il n’est pas tout à fait correct car ces kystes résultent d’un défaut de résorption du sinus cervical, cavité créée par l’expansion vers le bas du 2e arc qui passe en pont au-dessus des 3e et 4e arcs. Il est donc préférable de les dénommer « kystes amygdaloïdes » (association d’un épithélium et d’un tissu lymphoïde au sein du kyste) ou « kystes du sinus cervical ».
Clinique [2, 16]
Le diagnostic peut être fait à la naissance devant une fistule localisée au niveau du bord antérieur du muscle SCM, ou plus tardivement devant une surinfection (tableau de tuméfaction inflammatoire cervicale). Il n’est pas rare que le diagnostic ne soit porté qu’à l’âge adulte.
L’orifice interne, quand il existe, est situé au voisinage de la loge amygdalienne. L’orifice externe, lorsqu’il existe, siège le long du bord antérieur du muscle SCM.
L’association d’un kyste et d’une fistule est possible.
Le kyste, assez volumineux, est souvent développé dans la région sous-digastrique et plus en avant que les adénopathies de cette région. Il est placé immédiatement en arrière de la loge sous maxillaire.
Ces fistules sont le plus souvent isolées, mais il faut évoquer de principe, notamment en cas de forme bilatérale, une association syndromique (syndrome oto-branchio-rénal), nécessitant la réalisation d’une échographie rénale.
Elles sont sous-classifiées en quatre types de lésions.
Type I : Les lésions sont antérieures au muscle sterno-cléido-mastoïdien (SCM) et ne sont pas en contact avec la gaine carotidienne.
Type II : Ces lésions sont les anomalies les plus courantes du deuxième arc et sont profondes au SCM, et antérieures ou postérieures à l’artère carotide.
Les lésions de type III : passent entre les artères carotides internes et externes et sont adjacentes au pharynx.
Les lésions de type IV : sont médiales à la gaine carotide et se situent à proximité du pharynx adjacent à la loge amygdalienne.
Paraclinique [2, 12]
L’imagerie par échographie ou scanner reste l’examen de référence afin de confirmer la nature kystique de la tuméfaction cervicale.
Le fistulogramme peut confirmer le diagnostic clinique. Il est particulièrement utile pour montrer la longueur et l’emplacement de la fistule ainsi que la présence éventuelle d’un kyste associé.
Traitement [12, 15]
En cas de fistule, le traitement chirurgical consiste en l’exérèse d’une petite zone de la peau autour de l’orifice fistuleux, puis en la dissection du trajet fistuleux poursuivie le plus haut possible. L’extrémité distale du canal fistuleux est ligaturée, puis on sectionne ce canal juste en amont de cette ligature. Le fait de laisser en place un petit segment fistuleux distal n’entraine pas de risques particuliers.
La chirurgie est souvent facilitée par l’injection préopératoire dans la fistule de bleu de méthylène ou la paraffine, ou par l’insertion d’un mince cathéter.
Devant un kyste, l’exérèse chirurgicale se fait par une cervicotomie pratiquée le long du bord antérieur du muscle SCM.
KYSTES ET FISTULES DU TROISIEME ARC BRANCHIAL
Physiopathologie [4]
Le troisième arc est constitué par le nerf glossopharyngien et la carotide interne. Il va permettre la formation de la partie haute du sinus piriforme, du thymus, de la glande parathyroïde inférieure, de la grande corne et du corps de l’os hyoïde et d’une partie de l’épiglotte. Un défaut de coalescence entre le troisième et le quatrième arc est responsable de la présence d’une fistule de la troisième poche qui part de la paroi pharyngée latérale par rapport au sinus piriforme, réalise une boucle au-dessus du nerf XII, passe en arrière de la carotide interne et se termine derrière le lobe latéral de la thyroïde.
Clinique [3, 4, 16]
Ces kystes et fistules sont le plus souvent situés à gauche. Ils n’ont pas d’orifice fistuleux cutané primitif (une fistulisation cutanée secondaire liée à une surinfection est possible). La tuméfaction inflammatoire suppurée et/ou la fistule cutanée secondaire se situent le long du bord antérieur du SCM, au niveau du pôle supérieur de la thyroïde. Leur trajet court au contact de la face postérieure du lobe thyroïdien traverse la membrane thyrohyoïdienne et se termine par une fistule muqueuse au niveau du sinus piriforme à sa paroi latérale.
Ces kystes sont révélés par des infections itératives cervicales basses, très évocatrices. Il s’agit d’abcès latéro-cervical, thyroïdien ou de thyroïdite du pôle supérieur du lobe thyroïdien gauche. Elles peuvent être révélées chez le nouveau-né par un stridor plus ou moins associé à une masse cervicale
Paraclinique [8, 16]
Outre l’imagerie (échographie cervicale, TDM ou IRM cervicale), le bilan diagnostic repose sur l’endoscopie à la recherche de la fistule du sinus piriforme. L’œsophagogramme au baryum peut également être utile avec 50% à 80% de sensibilité.
Traitement [11, 16]
Deux traitements sont possibles. Le premier est la cautérisation de l’orifice fistuleux par voie endoscopique à l’aide d’une coagulation bipolaire ou d’une fibre laser. L’autre est l’exérèse chirurgicale du kyste par cervicotomie avec dissection du nerf récurrent et ligature de l’orifice fistuleux du sinus piriforme. La résection partielle du cartilage thyroïdien peut être nécessaire pour obtenir une exposition adéquate lorsque la fistule entre dans le sinus piriforme. Ce traitement est plus efficace mais aussi plus à risques de lésion du nerf récurrent.
KYSTE VALLECULAIRE
Physiopathologie [9]
Les deux principales hypothèses proposées pour expliquer la pathogenèse du kyste valléculaire suggère que ce kyste soit :
Une conséquence de l’obstruction des canaux excréteurs des glandes de la base de la langue, secondaire à une inflammation chronique, à un traumatisme ou une néoplasie
Ou à une malformation embryologique.
Le kyste valléculaire (KV) a été signalé dans la littérature sous différents noms, ce qui a entraîné une certaine confusion. Les termes utilisés : kyste de rétention muqueuse, kyste épiglottique, kyste de la base de la langue, kyste congénital, et, plus encore récemment, kyste canaliculaire.
Clinique [9]
Le kyste valléculaire est une cause rare mais reconnue de stridor et de détresse respiratoire dans la petite enfance, et il a été associé à une obstruction soudaine des voies aériennes entraînant la mort. Il produit un stridor inspiratoire avec obstruction des voies aériennes immédiatement après la naissance, avec difficultés d’alimentation et incapacité à prospérer chez les patients plus âgés.
Il se compose d’une masse kystique uniloculaire de taille variable découlant de la surface linguale de l’épiglotte et contenant un fluide clair et non-infecté.
Paraclinique [9, 17]
Lorsqu’un kyste valléculaire soupçonné est identifié à la laryngoscopie, le diagnostic peut être confirmé sous anesthésie générale par la ponction des kystes et la marsupialisation thérapeutique. Si la masse n’est pas localisée ou ne se révèle pas kystique, l’échographie ou la TDM cervicale peuvent facilement mettre en évidence la nature kystique de la lésion et le caractère unique ou multiple du kyste. L’IRM est l’examen de référence. La confirmation diagnostique ne peut être qu’anatomopathologique. Le contenu du kyste est muqueux et aseptique.
Traitement [18]
Le traitement du kyste valléculaire est chirurgical. Il peut se faire selon plusieurs méthodes. La méthode conventionnelle consiste en une marsupialisation du kyste par des micro-instruments laryngés, par une vaporisation par le laser CO2 ou encore par électrocoagulation.
KYSTE DERMOIDE
Physiopathologie [2,19]
Classés comme des tumeurs bénignes de cellules germinales, les kystes dermoïdes (KD) sont composés d’agents ectodermiques et des structures mésodermiques. Ils correspondent à des anomalies de fermeture de la ligne médiane, par défaut d’accolement des premier et deuxième arcs branchiaux. Ils sont souvent isolés, situés dans la région supra-hyoïdienne (contrairement aux kystes du tractus thyréoglosse), sous le plancher buccal
Clinique [3, 4, 19]
Le diagnostic est fait le plus souvent chez le jeune enfant, fortuitement, devant une tuméfaction arrondie, ferme ou discrètement molle, de croissance lente, de siège variable. On peut les retrouver jusque dans la région sus sternale.
Les kystes ad-hyoïdiens adhérent à l’os hyoïde et ascensionnent à la déglutition. Ni l’examen clinique, ni l’échographie cervicale ne permettent de les différencier avec certitude d’un kyste du tractus thyréoglosse.
Les kystes sus-hyoïdiens apparaissant sous la forme d’une tuméfaction arrondie, soulevant le plancher buccal antérieur et le frein de langue, ou comme une tuméfaction sous mentale dans les formes plus basses. Dans cette localisation, au niveau du plancher buccal, on devra faire la différence avec une grenouillette, plus translucide et de localisation plus paramédiane, ainsi qu’avec un lymphangiome kystique également plus translucide.
Ils peuvent se compliquer d’épisodes de surinfection pouvant fistuliser.
Paraclinique [3, 4]
L’échographie cervicale permet de visualiser une lésion kystique bien limitée sous-cutanée par rapport au plan musculaire, de vérifier la position et d’éliminer toute pathologie de la thyroïde. Au moindre doute, une TDM ou une IRM sont réalisées.
Traitement [4]
Le traitement est chirurgical et se fait en dehors d’épisodes infectieux. L’exérèse doit être complète et se fait par voie endobuccale pour les kystes situés au-dessus du mylo-hyoïdien et par voie cervicale horizontale pour les kystes situés sous le mylo-hyoïdien. S’il n’existe pas de plan de clivage entre l’os hyoïde et le kyste, le corps de l’os hyoïde doit être reséqué.
|
Table des matières
PREMIERE PARTIE : RAPPELS
1. KYSTE DU TRACTUS THYREOGLOSSE (KTT)
1.1. Physiopathologie
1.2. Clinique
1.3. Paraclinique
1.4. Traitement
2. FISTULE PRE-HELICEENNE (FPH)
2.1. Physiopathologie
2.2. Clinique
2.3. Paraclinique
2.4. Traitement
3. LYMPHANGIOME KYSTIQUE (LK)
3.1. Physiopathologie
3.2. Clinique
3.3. Paraclinique
3.4. Traitement
4. KYSTES ET FISTULES DU PREMIER ARC BRANCHIAL
4.1. Physiopathologie
4.2. Clinique
4.3. Paraclinique
4.4. Traitement
5. KYSTES ET FISTULES DU DEUXIEME ARC BRANCHIAL
5.1. Physiopathologie
5.2. Clinique
5.3. Paraclinique
5.4. Traitement
6. KYSTES ET FISTULES DU TROISIEME ARC BRANCHIAL
6.1. Physiopathologie
6.2. Clinique
6.3. Paraclinique
6.4. Traitement
7. KYSTE VALLECULAIRE
7.1. Physiopathologie
7.2. Clinique
7.3. Paraclinique
7.4. Traitement
8. KYSTE DERMOIDE
8.1. Physiopathologie
8.2. Clinique
8.3. Paraclinique
8.4. Traitement
DEUXIEME PARTIE : NOTRE ETUDE
1. PATIENTS ET METHODES
1.1. Cadre d’étude
1.1.1. Données sociodémographiques
1.1.2. Présentation de l’Hôpital pour Enfants de Diamniadio
1.1.3. Présentation du service ORL
1.2. Type et durée d’étude
1.3. Population
1.3.1. Critères de sélection
1.3.2. Echantillonnage
1.4. Procédure de collecte des données
1.5. Variables étudiées
1.6. Analyse des données
2. RESULTATS
2.1. Données épidémiologiques
2.1.1. Fréquence
2.1.2. Sexe
2.1.3. Âge
2.1.4. Origine géographique
2.2. Données cliniques
2.3. Données thérapeutiques
2.3.1. Type d’anesthésie
2.3.2. Type d’intervention
2.3.3. Drainage
2.3.4. Durée d’hospitalisation
2.3.5. Suites opératoires
2.3.6. Surveillance -évolution
2.3.6.1. Surveillance
2.3.6.2. Evolution
3. DISCUSSION
3.1 Contraintes et limites
3.2 Aspects épidémiologiques
3.2.1 Fréquence
3.2.2 Age
3.2.3 Sexe
3.3 Aspects thérapeutiques
Conclusion
Recommandations
REFERENCES
Télécharger le rapport complet