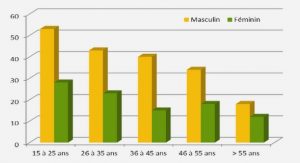Détermination des écosystèmes vulnérables au changement climatique
La détermination des écosystèmes vulnérables au changement climatique a été effectuée dans chaque région bioclimatique. Plusieurs écosystèmes ont été définis, par de nombreux scientifiques, particulièrement vulnérables aux changements climatiques. Il s’agit des récifs coralliens, des mangroves et de l’écosystème « forêt ». Cette étude a été essentiellement basée sur ces derniers. D’après Leadley& al. (2010), il existe deux (2) hypothèses sur la réaction possible des écosystèmes à l’évolution climatique mondiale: 1) le mouvement des écosystèmes et 2) la modification des écosystèmes.
– Le mouvement des écosystèmes se manifeste par une migration des écosystèmes relativement intacts vers de nouveaux emplacements très proches de leur climat et environnement actuels.
– La modification des écosystèmes se traduit par des changements sur place de la composition et de la dominance des espèces parallèlement aux changements du climat et des autres facteurs environnementaux.
Le réchauffement climatique pourrait donc avoir des conséquences catastrophiques sur les écosystèmes. Il peut causer autre entre leur dégradation, leur fragmentation, la réduction de leur surface ou leur disparition. Ces conséquences sont directement ou indirectement provoquées par le changement climatique. En d’autres termes, ce dernier influe sur les écosystèmes forestiers soit directement par l’élévation des températures et par des variations des précipitations soit indirectement par des interactions avec d’autres facteurs comme les changements d’affectation des terres (GIEC, 2000).
Entretienauprès des personnes ressources
L’entretien est une démarche paradoxale qui consiste à provoquer un discours sans énoncer les questions qui président à l’enquête (Blanchet & Gotman, 1992). Cette méthode a pour but de recouper et de compléter les informations issues des investigations bibliographique et webiographique. Il constitue une méthode de recueil d’informations qui consiste en des entretiens oraux, d’individus ou de groupes, avec plusieurs personnes sélectionnées soigneusement, afin d’obtenir des informations sur des faits ou des représentations, dont on analyse le degré de pertinence, de validité et de fiabilité en regard des objectifs du recueil d’informations (De Ketele & Roegiers, 1993). Les entretiens ont également pour fonction de recueillir des données et mettre à jour certains indicateurs qui permettront de vérifier ou non les hypothèses. Ils peuvent être directifs, semi-directifs ou libres. Le type d’entretien utilisé dans cette recherche est l’entretien de type semi-directif, en ce sens qu’il n’est ni entièrement ouvert, ni entièrement fermé. L’enquêteur dispose alors d’un certain nombre de thèmes ou guide d’entretien (annexe 8), relativement ouvertes, sur lesquels il souhaite que l’interviewé réponde. Il ne pose pas forcément toutes les questions dans l’ordre dans lequel il les a notés et sous leur formulation exacte. Il y a alors davantage de liberté pour le chercheur mais aussi pour l’enquêté. Le chercheur essaie simplement de recentrer l’entretien sur les thèmes qui l’intéresse quand l’entretien s’en écarte, et de poser les questions auxquelles l’interviewé ne vient pas par luimême (Lefèvre, 2009). Les séances d’entretien ont été menées auprès des personnes ressources au niveau des institutions œuvrant dans le domaine tel que le :
– DBEV (Département de Biologie et Ecologie Végétale) à la Faculté des Sciences – Université d’Antananarivo,
– DBA (Département de Biologie Animale) à la Faculté des Sciences – Université d’Antananarivo,
– MBG (Missouri Botanical Garden),
– MEF (Ministère de l’Environnement et des Forêts),
– REBIOMA (Réseau de la Biodiversité de Madagascar),
– WCS (Wildlife Conservation Society) et,
– WWF (World Wildlife Fund for Nature).
Les effets potentiels du changement climatique sur le statut et la distribution
Le changement climatique aura probablement un impact négatif sur la reproduction, la survie et l’habitat disponible de Propithecus candidus. D’ici 2055, il est prévu que son habitat (Nord-est de Madagascar) subira une augmentation de température de 1 à 2 ºC et une augmentation de la pluviométrie de 50mm/an (Hannah & al., 2008). Une étude récente a montré que même une légère diminution des précipitations peut affecter négativement leur reproduction. Les propithèques femelles plus âgées avec des dents usées élevant des nourrissons ont perdu des nourrissons pendant les mois de faible pluviométrie. Les phases chaudes associées à de fortes pluies ont entraîné une baisse de fécondité des propithèques (définie comme le nombre de descendants par femelle par an, survivant à l’âge d’un an). Il a été noté que les cyclones pendant la gestation (grossesse) ont des impacts les plus sévères sur les taux de fécondité des propithèques, à la fois en affectant directement la reproduction des propithèques et en endommageant les arbres fruitiers fortement préférés dont dépendent les mères qui allaitent. Le changement climatique se traduira par le déplacement de Propithecus candidus vers des altitudes plus hautes et plus fraiches. Néanmoins, de nombreux groupes peuvent ne pas avoir un habitat convenable à une altitude plus élevée vers lequel se déplacer (en particulier les groupes en dehors des aires protégées montagneuses de Marojejy et d’Anjanaharibe-Sud). Il est possible que les perturbations humaines sur l’habitat de Propithecus candidus augmentent à cause du changement climatique. Les agriculteurs à Madagascar ont déjà rapporté une diminution des récoltes attribuée à des sécheresses, des changements dans la saisonnalité des pluies, et une augmentation des cyclones attribuée au changement climatique. L’utilisation des ressources forestières dans les aires protégées pourrait bien augmenter dans les années à venir, ce qui mettrait encore plus en danger cette espèce.
Analyse des effets néfastes du changement climatique sur la biodiversité
Une espèce peut réagir de manière différente selon la région ou la zone où elle se trouve. C’est le cas des espèces ayant une aire de distribution vaste. A titre d’exemple le lémurien Hapalemur griseus localisé au Nord-est de Madagascar est plus affecté par le changement climatique comparé à celui se trouvant au Sud-est de Madagascar. En effet, les cyclones sont plus violents au Nord-Est de Madagascar et risquent de perturber la population de Hapalemur griseus s’y trouvant, ce qui n’est pas le cas de la population de la même espèce localisée au Sud-est de Madagascar.
CONCLUSION
La présente étude a permis de mettre en évidence les répercussions du changement climatique sur labiodiversité malgache au niveau espèce et écosystème. La modélisation de 74 espèces de plantes endémiques a indiqué que la plupart des espèces (45%) vont avoir leur distribution se contracter. En outre, 42,46% des espèces de Lémuriens, environ le quart (1/4) des espèces d’Amphibiens et la majorité des espèces de Poissons (96%) paraissent être en danger. Les forêts dans la région Méridionaleet celles dans la région Orientale et Sambirano ne sont pas également épargnées par la désertification et par les cyclones violents. De même, les mangroves et les récifs coralliens dans la région Occidentale subissent les effets néfastes du changement climatique. Toutefois, ce phénomène a permis à certaines espèces (Dyscophus insularis, Colotis guenei, Heteropsis ankaratra, algues vertes) d’étendre leur distribution. Néanmoins, les impacts du changement climatiquesont souvent difficiles à discerner avec certitude et à mesurer avec précision. Certaines variables (radiations solaires, modifications des courants, changement d’équilibres biogéochimiques) n’ont pu être prises en considération et les projections concernant les changements futurs et les réactions des espèces à ces changements demeurent souvent incertaines. D’ailleurs, les facteurs qui influent sur la biodiversité ne sont pas seulement ceux liés aux changements climatiques. Il est alors bien souvent difficile de distinguer les effets du changementclimatique des impacts des autres pressions existantes. Aussi, la considération des autres facteurs affectant la biodiversité est capitale pour une meilleure gestion de la biodiversité de Madagascar. D’ailleurs, l’ampleur potentielle des dégâts causés par le changement climatique sur la biodiversité malgache est claire. Les mesures d’adaptation pour maintenir cette biodiversité remarquable nécessitent, en conséquence, une mobilisation forte et urgente de tous les acteurs concernés. Mais toute mesure d’adaptation ne peut être adéquate sans être précédée d’une connaissance réélle des impacts potentiels des changements climatiques sur les espèces et les écosystèmes. Les plus menacés et les plus vulnérables devraient être priorisés. Dans ce sens, il serait indispensable de développer des modèles et des scénarii prédictifs fiables. Par ailleurs, des prospections sur terrain devraient être effectués pour rendre plus authentiques les résultats. Ils devront notamment se faire au niveau régional et national. Néanmoins, la méthode d’investigation utilisée dans cette étude, basée sur les connaissances actuelles disponibles au niveau bibliographique, se trouve être une synthèse qui permet de détecter les lacunes devant être considérées pour les futures recherches. En somme, il est indispensable d’analyser la vulnérabilité à l’échelle « pays » via les régions bioclimatiques, d’évaluer la résilience et d’étudier la capacité d’adaptation ; mais comment peut-on transformer la problématique du changement climatique à Madagascar en une opportunité au bénéfice de la conservation de sa biodiversité exceptionnelle, de la durabilité de ses ressources naturelles et de son économie?
|
Table des matières
1. INTRODUCTION
2. CADRE METHODOLOGIQUE
2.1. Problématique
2.2. Hypothèses
2.3. Matériels et méthodes
2.3.1. Les régions bioclimatiques de Madagascar
2.3.2. Ecosystèmes et espèces
2.3.3. Méthodes de collecte des données
2.3.4. Traitement et analyse des données
2.3.5. Cadre opératoire
2.3.6. Démarche méthodologique
3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
3.1. CONSTAT METEOROLOGIQUE
3.1.1. Au niveau de la température
3.1.2. Au niveau de la précipitation
3.1.3. Au niveau des phénomènes météorologiques
3.2. LES ESPECES ENDEMIQUES FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
3.2.1. Les espèces floristiques
3.2.2. Les espèces faunistiques
3.3. LES ESPECES CIBLES AU SEIN DES REGIONS BIOCLIMATIQUES
3.3.1. Régions bioclimatiques et régions administratives
3.3.2. Répartition des espèces cibles par région bioclimatique
3.3.3. Conséquences du changement climatique sur les espèces cibles
3.3.4. Etude de cas
3.4. LES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SUR LES ECOSYSTEMES
3.4.1.Les écosystèmes terrestres
3.4.2. Les écosystèmes côtiers et marins
3.5. ANALYSE COMPARATIVE DES EFFETS DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
3.5.1. Au niveau espèce
3.5.2. Au niveau écosystème
4. DISCUSSIONS ET RECOMMANDATIONS
4.1. DISCUSSIONS
4.1.1. Sur la méthodologie
4.1.2. Sur les résultats
4.1.3. Sur les hypothèses
4.2. RECOMMANDATIONS
5. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE ET WEBIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet