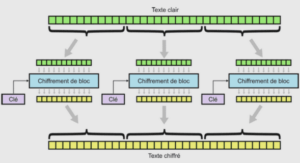Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Les maladies dûes aux déjections fécales (19)
Les manifestations cliniques dûes au péril fécal les plus importantes sont les diarrhées et les parasitoses. La transmission se fait directement ou indirectement par le biais des matières fécales. Portes d’entrée des germes (15).
. voie conjonctivale voie respiratoire voie cutanée.
. voie digestive.
. lors d’un acte médical comme l’injection intramusculaire ou intraveineuse.
. Mode de transmission de l’infection.
. Le mode de transmission de l’infection peut se présenter sous deux formes :
· soit sous forme d’hétéro-infection : quand le germepasse directement d’un individu malade à un individu sain ;ou indirectement par l’i ntermédiaire de l’eau, des aliments ,de la terre ,etc.
· soit sous forme d’auto-infection : quand le germe reste dans l’organisme malade à l’état latent, mais il trouve sa virulence augmentée quandil y a une diminution de résistance de l’organisme ,d’où la réinfection.
Souvent, les personnes qui transmettent l’infection montrent peu de signes ou aucun signe de la maladie alors que les personnes qui souffrent de la maladie, jouent un rôle majeur dans la transmission.
Le péril fécal pollue l’eau souterraine, les nappes alluvionnaires qui servent à l’approvisionnement en eau. On peut citer certaines affections transmises par l’eau (cf. Tableau N° 1A).
Trois facteurs affectent la transmission de l’infection d’une personne à une autre : la latence, la persistance et la multiplication, afin de sélectionner les méthodes qu’on va appliquer pour lutter contre les agents pathogènes dans les différents systèmes(21).
La latence est l’intervalle entre les excrétions d’un agent pathogène et le moment où il devient infectieux par un hôte. Il est indispensabl e de tenir compte de cette latence, car les infections causées par les vers intestinaux nécessitent une latence bien déterminée. Les œufs ont besoin de rester quelques temps hors du co rps de l’hôte pour passer à l’état infectieux. Cela est différent des agents pathogènes provoquant la diarrhée qui sont immédiatement infectieux.
La persistance est: la durée du temps pendant leque un agent pathogène peut survivre après avoir quitté son hôte dans un autre milieu. Cette persistance varie d’un germe à un autre et crée un risque sur la santé (même après untraitement bien conduit ) par une seconde transmission.
La multiplication des agents pathogènes varie d’un agent à un autre. Si certains agents pathogènes ne se multiplient pas hors du corps de l’hôte, d’autres exigent un autre milieu ou environnement (sol, hôte-intermédiaire, etc….) comme la plupart des parasites intestinaux. Malgré ces différences, la plupart desagents pathogènes ont un point commun : C’est l’excrétion par des matières fécales.
Pollution du milieu environnemental
En milieu rural comme dans certaines villes, les excréments sont souvent laissés sur le sol, les plages, les terrains vagues, les tinettes, les rives des cours d’eau ou même sur la voie publique (surtout durant la nuit). La présence de ces excréments dans ces endroits constitue un grand risque non seulement sur les infections dûes au péril fécal par l’intermédiaire des mouches ou directement pour les piétons (dans le cas des ankylosostomes ). Les excréments affectent aussi l’air libre qui gêne le bien être edchacun par la propagation des odeurs et la prolifération des insectes.
Pollution de l’approvisionnement en eau potable
Les gens qui défèquent dans ou près des rivières uo des cours d’eau ou même des sources d’eau polluent directement l’eau des habita nts qui vivent en aval de ces sources, ou indirectement, par la contamination de la nappe phréatique pour les autres qui utilisent l’eau de puits comme source d’eau potable (sauf si le sous-sol est à l’abri d’une couche épaisse de sable).
Branche d’activité
Une vaste rivière domine la commune d’Ankorondro. D’après la source venant de la mairie, la terre cultivable est d’environ 3500 hectares dont la terre cultivée est seulement de 2040 environ rizières et autres cultures. La totalité de la population travaille dans l’agriculture et l’élevage. Mais la riziculture est la principale culture vivrière. C’est une culture traditionnelle. Cette riziculture reste tributaire du régime des pluies et des crues. Les zébus sont les principaux “ moteurs ” pour assurer les transports et les labours.
Mais le rendement diminue d’une année à l’autre. Ceci est dû à une technique rudimentaire et à la mauvaise répartition de la pluie chaque année qui entraîne un ensablement des champs cultivés et quelquesfois une inondation.Les cultures de maniocs, haricots, maïs sont des cultures complémentaires.
A la fin de la période de pluie, la plupart des vilageois pratiquent la pêche traditionnelle.
Rôles et attributions par sexe
Dans les zones rurales où la subsistance est basée essentiellement sur l’agriculture, (comme dans le cas de la commune d’Ankirondro), l’h omme gère toutes les institutions et pourvoit aux revenus du ménage. Les hommes prennenttoujours les décisions importantes. La femme est chargée du ménage, y compris la gestion ud revenu, des enfants et des petits travaux pour l’agriculture. En d’autres termes, les femmes sont généralement très occupées et restent au village pendant toute la journée.
En somme, la situation en milieu rural à Madagascar reste partout la même. La société est caractérisée par une structure et culture tradionnelle et un niveau de vie très bas.
L’Habitat et l’approvisionnement en eau
Comme dans toute l’île, il y a deux saisons : la s aison des pluies (du mois de Décembre au mois de Mars ) où l’eau est très abondante et il y a souvent des inondations (cf : transect ) , et une saison sèche (mois d’avril au mois de Novembre ) où l’eau est de plus en plus difficile à trouver car il faut faire 1 à 2Km pour en trouver .
De ce fait , la population a recours à l’eau venant des inondations, durant la saison de pluies et utilise l’eau stagnante ou un puits non protégé pendant la saison sèche .
Toute la population est concernée par cette situation car on ne peut trouver aucune autre solution. Aucune borne fontaine n’existe dans cette commune .
Cette situation se répercute beaucoup sur l’état de santé de la population pendant toute l’année. Durant la saison des pluies , l’eau avec les différents déchets s’écoule et les villageois l’utilisent comme eau de boisson. Ainsi elle est la cause des maladies diarrhéiques.
Type d’aisance
Le taux d’utilisation de latrines dans cette commune est nul. Aucun logement ne possède de latrines .
Ainsi les excréments sont laissés sur le sol, et constituent le péril fécal .Pendant la saison des pluies , ces déchets seront transportéspar l’eau de ruisseaux et provoquent l’insalubrité totale des eaux de boisson . Ces problèmes ont un impact sur l’état de santé de la population que nous allons présenter dans le prochain chapitre .
Sources d’eau et activités relatives aux sources d’eau
Dans la plupart des communes rurales à Madagascar, la majorité des gens utilisent comme eau de ménage celle de la rivière ou de la rizière . Mais dans le cas de la commune d’Ankirondro , deux familles seulement ont un puits mal protégé contre les salissures .Les autres se contentent de l’eau de la rizière même pendant la période de pluie pour leur toilette et leur eau de cuisine.
Eaux usées et ordures
Comme dans tous les milieux ruraux , il n’y a pas de structure pour l’évacuation des ordures ménagères et des eaux usées ne se fait pasLes. gens jettent leurs ordures juste en dehors de leur maison ou stockées pour les animaux domestiques . Quelquefois, les ordures sont brûlées ou jetées aux fumiers .
Méthode de mesure du premier paramètre
Ce paramètre est constitué par trois différentes enquêtes dont chacune a sa propre méthode de mesure :
Le problème d’utilisation des latrines.
Nous avons utilisé la méthode d’échantillonnage, aupremier degré par tirage aléatoire (ou randomisation), consiste à faire un tirage sans remise jusqu’à l’obtention d’une population d’étude de 100 unités.
La compréhension de la population étudiée sur les rincipales maladies dûes aux déjections fécales.
Nous avons choisi comme base de recrutement les résultats issus du tirage sans remise précèdent c’est-à-dire les 100 ménages recrutés.
Pour la sélection nous faisons appel à la méthode d’échantillonnage non probabiliste de commodité par laquelle les unités disponibles au moment de l’enquête sont incluses dans l’échantillon.
Enquête concernant les pratiques et habitudes de défécation.
Nous avons utilisé la technique de collecte des données qui est l’observation passive. Cette technique consiste à observer la situation de manière ouverte ou cachée mais sans intervenir.
Méthode de mesure pour l’essai de sensibilisation sur la lutte contre le péril fécal.
Choix des participants
Nos objectifs pour ce choix des participants sont :
Faire participer la population cible.
Avoir des participants représentatifs de la régionétudiée.
Avoir des participants actifs, motivés, et qui deviendront des modèles pour leur région.
Nous avons utilisé des méthodes d’échantillonnage ifférentesd dans le choix des participants. Ce sont :
L’échantillonnage probabiliste systématisé qui consiste à faire un choix à un intervalle régulier à partir d’une base de données ou de sondage.
L’échantillonnage non probabiliste par quota, qui nous permet d’inclure dans l’échantillon un certain nombre d’unités faisant partie des catégories différentes et qui présentent des caractères précises.
Enquête sur le problème d’utilisation de latrines
Dans l’impossibilité de faire une enquête exhaustive, l’étude portera sur l’échantillon de 100 ménages parmi les 236 inclus soit 9,53 % desménages dans toute la communauté qui sont de 1043 ménages).
Avec l’aide des agents de la mairie et du fonkontany d’Ankirondro, nous avons numéroté de 1 à 236 les ménages dans ce chef lieu ed la commune. Puis nous faisons un tirage sans remise de ces numéros jusqu’à l’obtention de 100 ménages d’échantillon.
La suite consiste à poser la même question : « à votre avis, pourquoi le gens qui vivent à Ankirondro, ne veulent pas utiliser de latrines ? » à chaque chef de ménage par une entrevue libre non guidée par l’enquêteur. Après nous avonsclassé les réponses obtenues. La limite de cette méthode se situe à la réticence de la population étudiée devant l’enquête ( c’est-à-dire devant la question posée et l’enquêteur) car notreenquête se déroule auprès des habitants du monde rural.
Enquête sur la compréhension de la population concernant les principales maladies dûes à la déjection fécale
Durant l’enquête sur l’utilisation des latrines, parmi les 100 ménages recrutés, nous avons sélectionné ceux où il y avait des enfants entre 0 et 5 ans . Nous avons posé aux parents (père ou/ et mère ou une personne qui s’occupe de ces enfants) des questions ouvertes sur les idées locales concernant la transmission et les principales maladies dûes aux déjections fécales.
Dans un premier temps, nous leur avons demandé si leurs enfants ont déjà été atteints d’une diarrhée ou ont présenté des symptômes de parasitoses intestinales avant et au moment de l’enquête, tels que : le prurit anal, la présence des vers dans les excréta.
Si la réponse est oui, nous demandons leur avis concernant la cause possible et la prévention de ces maladies.
|
Table des matières
1. Première partie : Considérations générales
1.1 L’hygiène et l’assainissement
1.1.1 Définition
1.1.2 L’hygiène et l’assainissement en milieu rural.
1.2 Le peril Fecal
1.2.1 Définition
1.2.2 La contamination
1.2.3 Les latrines
1.3 Importance de l’assainissement
1.3.1 Risque pour la santé
1.3.2 Risque pour l’environnement
1.4 Situation à Madagascar
1.4.1 Situation des Latrines à Madagascar
1.4.2 Quelques exemples de lutte contre le péril fécal à Madagascar
2. Deuxième partie : Notre Etude
2.1 Cadre d’Etude
2.1.1 Caractères Geoclimatiques
2.1.2 Données démographiques
2.1.3 Données – Socio – Economiques
2.1.4 Etat d’hygiène de la commune
2.1.5 Etat de santé de la population
2.2 Methodologie
2.2.1 Enquête sur les problèmes d’utilisation de latrines
2.2.2 Enquête sur la compréhension de la population étudié sur les principales maladies dues aux
déjections fécales.
2.2.3 Enquête concernant les pratiques et habitudes de défécation à l’air libre dans cette commune. 2.2.4 Choix des participants
2.2.5 Impact de la sensibilisation contre le péril fécal faite par les participants.
2.2.6 Paramètres a évaluer
2.2.7 Analyse statistique
2.3 Résultats
2.3.1 Identification des problemes sur le peril fecal et de latrines
2.3.2 Essai de sensibilisation sur la lutte contre le peril fecal dans la Commune d’ankirondro
3. Troisième partie : Commentaires, Discussions et suggestions Erreur ! Signet non défini.
3.1 Commentaires et Discussions
3.1.1 Les réflexions à partir des différentes stratégies appliquées à Madagascar.
3.1.2 Identification des problèmes sur le péril fécal et de latrines
3.1.3 Essai de sensibilisation sur la lutte contre le peril fecal dans la commune d’ankirondro
3.2 Suggestions
3.2.1 Cadre general d’intervention
3.2.2 Stratégie de vulgarisation
3.2.3 Mesures de protection de la sante
Conclusion
Annexe
Bibliographie
Télécharger le rapport complet