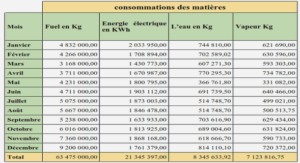Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Traction hippomobile
L’utilisation des animaux dans le transport en Afrique est très ancienne remontant au XVIIème siècle à travers les activités des commerçants, des colonisateurs, des missionnaires et des autorités administratives. Les chevaux étaient utilisés dans les plateaux et zones semi-arides tandis que les bovins furent utilisés dans d’autres zones pour la traction des charrettes et chariots (Starkey, 2004).
Bien que la mécanisation soit la tendance générale dans la plupart des activités quotidiennes, l’utilisation du cheval dans le domaine du transport au Sénégal n’est nullement affectée. La majorité des chevaux de Louga et de Thiès (92%) est utilisée dans la traction hippomobile ; preuve de l’importance du transport hippomobile dans ces régions du Sénégal (Akakpo et al., 2009).
En milieu urbain, le cheval tire les calèches pour transporter les gens d’un quartier à un autre à l’image du taxi (figure 1 A).
En plus du transport des personnes, divers types de marchandises comme les biens consommables, matériels de constructions, l’eau etc. relèvent de la traction équine (Figure 1 B). Ainsi, pendant six mois de saison sèche, nombre de personnes trouvent leurs moyens de subsistance à travers cette activité (Havard et al., 2007).
Avec un travail de six jours par semaine, les calèches et charrettes apportent à leur propriétaire un gain monétaire quotidien moyen respectif de 2202 FCFA ($ 3,6 US) et 2 779 FCFA ($ 4,6 US) pour des chiffres d’affaires quotidiens respectifs de 3 600 ($ 6 US) et 4 200 FCFA ($ 7 US) (Ly, 2003). Une étude plus récente donne une marge nette journalière de 2300 FCFA ($ 3,8 US) pour un attelage de traction hippomobile au Sénégal en 2012 (Roamba, 2014).
Hippisme et sports équestres
La tradition des courses équestres est très ancienne au Sénégal. Les premières compétitions remontent à la période anté-coloniale. Le peuple Bourbas depuis cette époque organisait des compétitions hippiques en ligne droite, le vainqueur recevait diverses récompenses dont des bœufs. Avec l’introduction d’un enjeu, les courses véritables venaient de naître mais étaient exclusivement réservées à l’élite.
A l’époque coloniale, la première compétition fut organisée en 1895 par Faidherbe au niveau de l’hippodrome de Saint-Louis (Ndoye, 1988).
En 1942, il fut établit par arrêté, un règlement des courses et dès lors sont nées les compétitions hippiques modernes (Ndoye, 1988).
Aujourd’hui encore, nous avons plusieurs compétitions et sports équestres organisés : le Pari mutuel urbain (PMU), les sauts d’obstacles etc. (figure 2). En 2013, 23 millions de FCFA ($ 40 000 US) était mis en jeu pour 74 chevaux répartis en six courses pour une compétition nationale. L’organisation des courses bénéficie chaque année de 120 millions de FCFA ($ 200 000 US) correspondant seulement à 2% des recettes de la Loterie Nationale Sénégalaise (LONASE) (ATS, 2013).
Un peu comme la lutte traditionnelle, le spectacle hippique au Sénégal est beaucoup apprécié par le public, ce qui explique son développement actuel. Certaines structures ont dès lors été mises en place à cet effet. Il s’agit notamment de la fédération sénégalaise des sports équestres qui regroupe à son tour plusieurs associations dont l’Association Sportive des Forces Armées (ASFA) et les clubs tels que le Poney Club de Hann (PCD), le Racing Club de Dakar (RCD) et autres. L’Escadron monté de la gendarmerie nationale participe également à différentes compétitions d’équitation à travers une section équestre de l’ASFA (Ndao, 2009).
A travers l’art équestre, certaines races locales ont été revalorisées. Le Mpar en est un exemple. En effet, il a été testé et réhabilité. Ce dernier est aujourd’hui largement exploité au niveau des poneys-clubs (Bathily, 2015).
Autres utilités du cheval
Les activités agricoles en zone rurale, le commerce du cheval, et la consommation de viande chevaline sont également des sous-secteurs où le cheval révèle son importance. Dans les zones rurales de nombreux pays africains où l’agriculture est la principale activité ne bénéficiant pas d’un certain niveau de mécanisation, la force animale demeure très sollicitée. Ce sont les bœufs, les chevaux ou les ânes que l’on utilise dans les travaux champêtres.
Si dans certains pays les bovins sont les plus exploités à cette fin, au Sénégal, les équidés sont essentiellement à la tâche. Ils participent activement à toutes les étapes de la chaine de production agricole (Seydou, 2013).
L’Etat conscient de cela a entrepris des mesures d’amélioration des races locales à travers l’importation d’étalons exotiques afin de les croiser avec les juments locales (APS, 2016). Les métis qui seront issus d’un tel croisement auront une plus grande capacité de traction que leurs mères et seront plus adaptés aux conditions climatiques que les étalons pur-sang exotiques.
Hormis l’agriculture, certaines personnes se sont investies dans le commerce du cheval. Ces acteurs relèvent le plus souvent du monde rural ayant une organisation en réseau en fonction de leurs relations ethniques. Cette activité concerne surtout les Wolof, Sérère, Peulh et les Lawbé qui se retrouvent dans les marchés à bétail (Ndao, 2009). Les éleveurs de chevaux, les intermédiaires et les convoyeurs peuvent chaque année gagner respectivement un minimum de 1 175 900 FCFA ($1960 US), 312 000 FCFA ($ 520 US) et 509 600 FCFA ($ 850 US) à travers cette activité (Ndao, 2009).
Si dans certains pays comme la France ou la Chine, la viande de cheval est appréciée, la réalité est toute autre au Sénégal. La boucherie chevaline est très limitée au Sénégal en raison des habitudes alimentaires et des tabous religieux chez les Sénégalais (Sy, 2004).
Systèmes d’élevage
Système traditionnel
Il se rencontre surtout en zone rurale. Il est caractérisé essentiellement par l’utilisation des ressources naturelles disponibles (Faye, 1988). A l’extérieur du cadre familial, un petit espace est souvent aménagé pour garder l’étalon à l’attache pour éviter qu’il ne disparaisse au moment des travaux.
Les juments qui mènent une pâture libre au tour des villages ne sont présentées à l’étalon qu’au moment des chaleurs. Mais le plus souvent, elles rencontrent par hasard des mâles qui les saillissent dans la nature peu importe l’état sanitaire et génétique de ces derniers (Ndao, 2009). L’alternative à cette méthode est celle dite « contrôlée » où le choix porte sur un étalon sélectionné moyennant des sommes symboliques (Diouf, 1997). Les poulains qui, généralement naissent au début ou pendant l’hivernage, sont mis au pâturage en liberté avec leurs mères ; ils sont ainsi exposés aux intempéries (Akpo, 2004).
L’élevage traditionnel concerne les races locales telles que le Mbayar, le Mpar, le Foutanké ou Cheval du fleuve mais aussi les métis issus de croisement entre étalons exotiques des haras nationaux et les juments des paysans (Ndoye, 1988). Les animaux (femelles et mâles non actifs) mènent une pâture libre surtout en saison sèche. Il n’y a que les mâles qui reçoivent en compensation de leur force de travail des fanes d’arachides, du son et des graines de céréales en supplémentation. L’alimentation des chevaux de traction est insatisfaisante de manière générale car les ressources disponibles sont insuffisantes et pauvres en nutriments (Faye, 1988).
Système moderne
Il ne se rencontre que dans les villes ou dans les zones périurbaines. Ce système est pratiqué au niveau des haras nationaux. Pour le développement de l’élevage équin, l’Etat sénégalais a mis en place en 2004 le Haras National localisé à Kébémer dans la région de Louga. A côté du Haras national il y a le Centre de Recherche Zootechniques (CRZ) de Dahra comme second exemple où les chevaux sont élevés selon un système intensif. Ces structures sont mises en place par l’Etat dans le but de promouvoir et développer l’élevage des équidés et des activités liées au cheval (Sénégal, 2004).
A la différence des Haras, la mission de l’Escadron est de maintenir l’ordre de participer aux manifestations, escortes, services d’honneur (escortes présidentielles, fête de l’indépendance) et de développer l’équitation militaire (Ndao, 2009).
Les chevaux élevés dans ces structures bénéficient de meilleures conditions de vie que ceux du système précédent. En effet, ils sont logés, régulièrement nourris et non surexploités. Ils bénéficient de soins vétérinaires et d’entretien corporel. Les écuries servent de logement aux chevaux. On distingue deux types d’écuries : les écuries communes et les écuries individuelles.
Les écuries communes peuvent être à un bâtiment ou à plusieurs bâtiments. Dans ce type d’écurie, les animaux ont la possibilité d’entrer en contact les uns les autres ce qui limite l’efficacité alimentaire et le temps de repos à cause des mouvements et des phénomènes de dominance (Diouf, 2013).
Les écuries dites individuelles : elles sont destinées le plus souvent aux chevaux de sport pour leur permettre une meilleure récupération après les activités sportives.
L’écurie de la caserne Samba Diery Diallo (Escadron monté) qui a été l’un des sites de cette étude est de ce type.
Les box sont dotés à l’intérieur de bac à aliment et souvent d’abreuvoirs. Les abreuvoirs peuvent aussi être collectifs comme dans le cas de l’Escadron. Le sol est couvert de paille pour améliorer le niveau de confort lorsque le cheval se met en décubitus. La construction d’une écurie doit permettre une bonne aération des animaux, leur procurer suffisamment d’ombre tout en leur évitant les intempéries telles que les pluies, les courants d’air etc. (Amniot, 1982).
La consommation d’eau est de 20 à 25 litres par jour. La quantité journalière d’aliment distribuée varie de 10 à 14 kg dont 6 à 7 kg de paille en fonction du niveau d’activité. (Epanya Wonje, 2009 ; Ndour, 2010).
La reproduction est bien contrôlée et se fait en fonction des objectifs précis. Les reproducteurs sont d’abord sélectionnés sur la base de leur performance.
Les éleveurs de chevaux bénéficient de la part des haras de la semence exotique pour fertiliser leurs juments permettant d’obtenir des métis plus performants.
Contraintes à l’élevage équin
Contraintes climatiques et alimentaires
La disponibilité des ressources fourragères est conditionnée par la pluviométrie. En réalité la disponibilité fourragère est assez limitée dans plusieurs régions du pays. Le climat étant de type sahélien avec seulement une durée de trois mois de pluies, on assiste à une rareté du fourrage (IED Afrique, 2017). Cette rareté est accentuée par l’avancée inquiétante du désert. Les points d’abreuvement sont également rares pour les mêmes raisons. Avec la pauvreté en milieu rural, l’alimentation peut se poser comme un facteur limitant dans la mesure où l’on voudrait avoir des animaux bien nourris de manière à être robuste pour le travail.
Contraintes sanitaires
Le cheval fait partie des animaux domestiques les plus naturellement sensibles aux maladies et conditions climatiques (Ndiaye, 1978). L’insuffisance ou le manque de suivi médical sont des causes d’incidence de maladies chez les chevaux au Sénégal. Les maladies bactériennes les plus importantes du cheval sont le tétanos, le botulisme, la gourme et la lymphangite ulcéreuse qui ont une prévalence élevée dans la zone sylvo-pastorale (Ndao, 2009). Les hémoparasitoses telles que la trypanosomose, la babésiose ; les parasitoses gastro-intestinales comme les ascaridioses, strongyloses et habronémose constituent les maladies parasitaires les plus fréquentes. Elles constituent un obstacle majeur à l’élevage du cheval surtout au sud du pays (NISDEL, 2004). La lymphangite épizootique se trouve au premier rang parmi les affections fongiques les plus répandues même si l’aspergillose et les candidoses sont aussi rencontrées. La peste équine est en tête de liste des maladies virales. En effet, en 2001 et 2007, elle a entrainé des pertes considérables du cheptel dans la zone du bassin arachidier.
Ces pertes ont été expliquées par le fait que la campagne de vaccination faisait face à une insuffisance de vaccins et au manque d’implication des éleveurs (Ndao, 2009 ; Toukam, 2008 ; Akpo, 204). Dans une moindre mesure sont enregistrées d’autres maladies virales à savoir l’anémie infectieuse des équidés, l’encéphalomyélite et la grippe des équidés (Akpo, 2004). Les maladies les plus fréquentes en clinique sont les maladies cutanées, digestives avec une prédominance des coliques, les affections de l’appareil locomoteur et les maladies respiratoires (Diouf, 2013).
Contraintes technico-économiques
Les structures de recherche telles l’Institut Sénégalais de Recherches Agricoles (ISRA), le Laboratoire National d’Elevage et de Recherche Vétérinaire (LNERV) ne sont pas suffisamment équipées en personnel et équipement pour répondre aux besoins du secteur en termes de couverture sanitaire et d’amélioration de la reproduction (IPAR, 2014). C’est ce qui explique en partie la persistance de certaines maladies comme la peste équine (Ndao, 2009 ; Fall, 1992). Les ressources financières attribuées par l’Etat au développement de la filière demeurent faibles. Cette situation associée avec le caractère irrégulier des versements du Pari Mutuel Urbain (PMU) de la Loterie nationale (LONASE) est là un frein à la réalisation des projets de développement de l’élevage équin. De plus, les études montrent que les propriétaires de chevaux ont des revenus assez limités. Cela peut également limiter l’entretien sanitaire et alimentaire que ces propriétaires pourraient apporter à leurs chevaux.
Bien-être du cheval
Définition
D’après l’Organisation Mondiale de la Santé Animale (OIE), le bien-être animal (BEA) se définit comme étant la manière dont un animal évolue dans les conditions qui l’entourent. Le bien-être d’un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis : bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, la sensation de sécurité, la possibilité d’expression du comportement naturel, l’absence de souffrances physiques et psychiques (OIE, 2016). Les normes de BEA ont été incluses dans le mandat de cette organisation en 2002 mais ce n’est qu’en 2005 que les premières normes ont été publiées et d’autres encore par la suite. Le bien-être animal requiert la prévention et le traitement des maladies, une protection appropriée, des soins, une alimentation adaptée, des manipulations réalisées sans cruauté lors des expérimentations, un abattage ou une mise à mort effectué dans des conditions décentes.
Impact de la maltraitance sur les performances du cheval
Toute maltraitance est source de stress chez les animaux, le cheval en particulier. Le stress a des effets négatifs sur la santé et les performances du cheval. Les blessures sont des portes d’entrée de germes les exposant à de nombreuses maladies comme le tétanos (Barrey et al., 1994). Les maladies lorsqu’elles affectent l’appareil cardio-respiratoire vont conduire à un essoufflement rapide lors de l’effort physique. Ceci réduit le temps du travail et logiquement le profit de l’éleveur.
La faim et la soif sont également des causes irréfutables de vulnérabilités. Les services de maréchalerie sont insuffisants, raison pour laquelle dans les zones rurales et même urbaines les chevaux connaissent une fréquence d’affections locomotrices (Diouf, 2013 ; Ndour, 2010).
Le manque d’abris adéquats pour ces animaux est nuisible à leur santé car le cheval supporte mal les intempéries climatiques, les vents en particulier (Faye, 1988).
Après ces généralités sur l’élevage du cheval au Sénégal, nous avons porté intérêt à la biochimie clinique de l’espèce ainsi que la notion de valeurs usuelles dans le second chapitre qui fait suite.
BIOCHIMIE CLINIQUE DU CHEVAL
Eléments de biochimie clinique
La biochimie est une branche de la biologie qui étudie la composition et les réactions chimiques de la matière vivante et des substances qui y sont issues. La biochimie clinique a pour but d’analyser les molécules contenues dans les fluides de l’organisme et de fournir des résultats dont l’interprétation oriente le clinicien dans son diagnostic. Il existe une grande variation des valeurs biologiques entre espèces (tableau II) et entre individus d’une même espèce comme il a été rapporté dans plusieurs travaux (Miegeville, 2015 ; Kaneko et al., 2008 ; Gul et al., 2007). Une bonne interprétation se doit de prendre en compte les différents facteurs de variation car toute variation n’est pas forcément pathologique. Nous nous interesserons dans ce chapitre à l’exploration de la fonction hépatique, renale, musculaire de même qu’aux paramètres énergétiques et l’équilibre hydroélectrolytique. Certains aspects sur les valeurs usuelles seront aussi abordés.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
CHAPITRE I : GENERALITES SUR L’ELEVAGE DU CHEVAL AU SENEGAL
I.1. Importance de l’élevage du cheval au Sénégal
I.1.1. Importance sociale
I.1.2. Importance économique
I.1.2.1. Traction hippomobile
I.1.2.2. Hippisme et sports équestres
I.1.3. Autres utilités du cheval
I.2. Systèmes d’élevage
I.2.1. Système traditionnel
I.2.2. Système moderne
I.3. Cheptel chevalin
I.4. Races exploitées au Sénégal
I.4.1. Races locales
I.4.1.1. Cheval du fleuve et le Foutanké
I.4.1.2. Mbayar
I.4.1.3. Mpar ou cheval du Cayor
I.4.2. Races exotiques
I.4.3. Autres races
I.5. Contraintes à l’élevage équin
I.5.1. Contraintes climatiques et alimentaires
I.5.2. Contraintes sanitaires
I.5.3. Contraintes technico-économiques
I.6. Bien-être du cheval
I.6.1. Définition
I.6.2. Impact de la maltraitance sur les performances du cheval
CHAPITRE II : BIOCHIMIE CLINIQUE DU CHEVAL
II.1. Eléments de biochimie clinique
II.1.1. Exploration de la fonction hépatique
II.1.1.1. Tests de cytolyse hépatique
II.1.1.2. Tests de l’insuffisance hépatique (IH)
II.1.1.3. Tests de cholestase hépatique
II.1.1.4. Tests de l’inflammation hépatique
II.1.2. Exploration de la fonction rénale
II.1.2.1. Créatinine
II.1.2.2. Urée
II.1.3. Exploration de la fonction musculaire
II.1.3.1. Créatine-kinase (CK)
II.1.3.2. ASAT ou Transaminase Glutamo Oxaloacétique (TGO)
II.1.4. Etat énergétique
II.1.4.1. Glucose
II.1.4.2. Réserves lipidiques
II.1.5. Equilibre hydro-électrolytique
II.1.5.1. Calcium
II.1.5.2. Phosphore
II.1.5.3. Magnésium
II.2. Valeurs usuelles en biochimie
II.2.1. Définition et intérêts
II.2.2. Quelques principes dans la mise en place de valeurs usuelles
II.2.3. Facteurs de variation dans la mesure des grandeurs biologiques
DEUXIEME PARTIE : ETUDE EXPERIMENTALE
CHAPITRE III : MATERIEL ET METHODES
III.1. Cadre d’étude
III.2. Echantillonnage
III.3. Prélèvement et traitement des échantillons
III.4. Analyses de laboratoire
III.4.1. Dosage des substrats
III.4.2. Dosage des transaminases
III.4.3. Dosage des minéraux
III.5. Analyses statistiques
CHAPITRE IV : RESULTATS ET DISCUSSION
IV.1. Résultats
IV.1.1. Caractérisation de la population d’étude
IV.1.2. Valeurs moyennes obtenues
IV.1.3. Variations des paramètres biochimiques
IV.1.3.1. Variations en fonction de l’utilisation du cheval
IV.1.3.2. Variations selon le groupe d’âge
IV.1.3.3.Variations selon le statut reproducteur
IV.2. Discussion
IV.2.1. Caractérisation de la population d’étude
IV.2.2. Valeurs moyennes des paramètres biochimiques
IV.2.3. Variation des paramètres biochimiques
IV.3. Recommandations et perspectives
IV.3.1. Recommandations
IV.3.2 Perspectives
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
WEBOGRAPHIE
ANNEXES
Télécharger le rapport complet