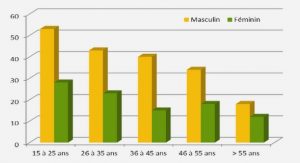Enquête systématique par ménage
Un entretien individuel ou plutôt par ménage est effectué systématiquement. Cette approche permet de respecter l’aspect confidentiel de l’entretien, et d’obtenir une certaine disponibilité de l’interlocuteur. Mais à la longue, cette situation d’isolement risque d’être ennuyeuse pour l’interlocuteur. C’est pour cela que sur le terrain, le temps d’un entretien tourne autour de 1h -1h 30 mn. Ceci est complété parfois par des visites de champs, notamment pour la mesure de parcelles. En effet, localement, la superficied’une parcelle s’estime soit par le nombre de laboureurs pour les tanety soit par le nombre de répiqueuses pour la rizière.
L’expérience (P.M. DECOUDRAS, 1997) a montré qu’au-delà de 15 à 30 entretiens, quel que soit l’effectif global de la population, les réponses identiques vont se répéter et que peu d’informations nouvelles émergent. Ainsi, 30 ménages d’Andohasahabe sont enquêtés.
Au début, un questionnaire (cf. annexe C) a été élaboré pour servir de support. L’objectif étant de déceler la stratégie socio-économique mise en œuvre par la population vis-à-vis de la gestion des ressources forestières, le questionnaire comporte quatre principales rubriques :
– L’identité du ménage
– Les activités socio-économiques
– L’usage de la forêt
– La compréhension et les attentes vis-à-vis du projet écotouristique
Pour éviter la méfiance des paysans face au caractère formaliste de l’utilisation d’une fiche d’enquête préétablie, les fiches ne sont pas complétées instantanément. Une check-list de questions est établie, comportant les principales rubriques et les questions clés.
Le pré-test des questions mené auprès de quelques ménages a conduit à supprimer les questions sur l’écotourisme. En effet, la notion est nouvelle. Les paysans n’arrivent pas encore à bien formuler leurs attentes personnelles par rapport au projet. Par contre ce thème a été mieux discuté en groupe.
Andohasahabe : méconnu par les organismes de développement
Une dizaine d’organismes intervient dans la CRS (CRS, 01). Au niveau du fokontany de Bedia où se trouve le village d’Andohasahabe, la FAO/PNUD mène localement des actions auprès des associations paysannes. Il s’agit de vulgarisation des techniques en apiculture mettant ainsi à profit l’existence de forêts naturelles ou de reboisement local. Même si depuis un an, la FAO intervient au niveau du village d’Ampasina, voisin du terroir étudié, aucun appui technique n’est enregistré à Andohasahabe. L’introduction de la FAO a en effet commencé par une « réunion d’informationsensibilisation » du projet d’apiculture. Il appartenait aux paysans intéressés de se regrouper en association pour pouvoir bénéficier de l’appui technique proposé. Deux groupements d’Ampasina collaborent actuellement avec la FAO. Il est à noter que les membres de ces associations habitent le même village que le technicien local. Faute de capacité organisationnelle, les autres paysans, dont ceux d’Andohasahabe, ne reçoivent aucun appui. C’est à travers des initiatives individuelles que les paysans y entreprennent l’apiculture. Ils fabriquent des ruches traditionnelles en bois ou en terre battue. Le responsable technique à Ampasina espère un effet tâche d’huile de ses actions pour atteindre les autres villages comme Andohasahabe. D’une façon générale, en tant que village riverain, utilisateur du corridor forestier, cette absence d’intervention pour le développement afin de sauvegarder les ressources forestières suscite des réflexions sur la répartition des intervenants au niveau de la province de Fianarantsoa, notamment sur la priorisation des zones d’interventions.
Richesse floristique
Le nombre d’espèces à Andreana tourne autour de 30. Cela présente des ressemblances au cas observé à Vinanintelo (S. GOODMAN, 2001). Un nombre moins élevé est enregistré sur les versants ouest d’Ambohipanja qui comptent 20 à 23 espèces. Alors que sur le versant nord, 27 espèces ont été relevées. Au sommet d’Ambohipanja, la diversité floristique est la plus riche des endroits inventoriés avec 44 espèces.
La canopée
La hauteur de la canopée constitue la grande différence entre les deux sites. Une ouverture est remarquée au niveau de la strate moyenne.
– A Ambohipanja, la hauteur de la canopée s’élève suivant l’altitude et est constituée d’arbres de 10 à 16m. En bas de pente, la strate supérieure est constituée d’arbres de 10-12m. Weinmannia rutenbergii Engl est la plus haute. Sur le versant, la taille des arbres est de 10-14m, Weinmannia rutenbergii Engl compose principalement cette strate. Au sommet, la canopée atteint jusqu’à 16m de hauteur avec l’Eugenia gossypium Les arbres de hauteurs sont rares.
– A Andreana, la végétation est moins haute au sommet qu’en bas de pente. La canopée atteint jusqu’à 20m en bas de pente. Au sommet, elle tourne au tour de 16m. Pour le premier cas, Ilex mitis Radlk et Albizia gummifera C.A.Sm constituent l’étage supérieure; Brachylaena sp, Anthoccleista madagascariensis Baker, Calophyllum chapelieri Drake sont recensées pour le deuxième.
Les voies de communication
Une piste de 6 km lie Andohasahabe à Sahambavy. Elle est pratiquable presque toute l’année par des voitures 4×4. Des nids de poules sont observés à certains endroits. Mais il n’y a aucun pont ou tranche dangereuse sur le trajet. Cette piste s’appelle localement « chemin du thé » car sa construction a comme principal objectif de desservir la plantation d’eucalyptus qui appartient à la société exploitant la théïculture. Mais en réalité, la piste est d’usage public.
Avis « favorables » des opérateurs
Les opérateurs consultés se sont montrés favorables et optimistes quant à la réalisation du projet écotouristique à Andohasahabe.
– GIFT : Comme ce projet coïncide avec la relance de la destination « Fianarantsoa », le président de ce groupement est favorable pour sa concrétisation.
– FCE : Avec la réhabilitation de cette ligne, la FCE entend contribuer au développement touristique de la région. D’autant plus que la FCE est dotée d’une Micheline, moyen de locomotion destiné spécialement à transporter les touristes. Le développement touristique aux alentours de Sahambavy augmenterait éventuellement le trafic, même saisonnier. L’existence d’infrastructure constituée parla voie triangle permettant au wagon de faire un demi-tour au niveau de la gare de Sahambavy favorise à juste titre la fréquentation de cette zone par les touristes, en empruntant le chemin de fer. Ainsi, le rôle de la FCE dans le développement écotouristique n’est pas négligeable. En effet, cet organisme consacre actuellement une part de son budget à l’identification et au développement des activités touristiques tout au long de son trajet. Cela est effectué selon des causes environnementales qui sont de préserver la nature par le biais de l’écotourisme. En plus, les responsables y espèrent attirer beaucoup plus de voyageurs en leur proposant de fréquenter ces sites.Les opérateurs locaux, en l’occurrence la SIDEXAM et le Lac Hôtel, espèrent une complémentarité. Ainsi, l’extension du circuit jusqu’à Ambohipanja multiplierait les visiteurs et prolongerait la durée de leur séjour dans la région.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PRESENTATION DE LA RECHERCHE
CHAPITRE I PROBLEMAT IQUE – HYPOTHESES – OB JECT IFS
I. PROBLEMATIQUE
II. HYPOTHESES
III. OBJECTIFS
CHAPITRE II METHODOLOGIE
PREMIERE HYPOTHESE
I DEMARCHE
II. OUTILS
II.1 Entretien individuel
II.2 Discussions en groupes
II.3 Réunion en séances plénières
DEUXIEME HYPOTHESE
I. DEMARCHE
II. OUTILS
II.1 Inventaire
II.2 Evaluation des potentialités
II.3 Identification des mesures d’accompagnement
RESULTATS ET ANALYSES
CHAPITRE I LES PARTIES PRENANTES ET LEURS STRATEGIES
I. ANDOHASAHABE : MECONNU PAR LES ORGANISMES DE DEVELOPPEMENT
II. PRESENCE THEORIQUE DES SERVICES ETATIQUES : EAUX ET FORETS (SEF)
III. POPULATION LOCALE : GESTIONNAIRE DE LA FORET
III.1 Droits sur les produits forestiers
III.2 Droits sur la terre
CHAPITRE II L’ORGANISATION SOCIO-SPATIALE
I. ORGANISATION SOCIALE PRECAIRE
I.1 Administration territoriale classique
I.2 L’inexistence remarquable de « dina »
I.3 Organisation liée au village d’origine
II. LES ACTIVITES AGRICOLES
II.1 Pratiques agricoles différenciées par zone culturale
II.2 Le « tavy »
CHAPITRE III ETAT DE LA RESSOURCE FORESTIERE
I. FLORE : ESPECES DIVERSES AVEC DE NOMBREUSES ESPECES ENDEMIQUES
I.1 ANALYSE FLORISTIQUE
I.1.1 Richesse floristique (cf. tableau n° 1)
I.1.2 Affinité floristique
I.1.3 Fréquence (cf. tableau n° 1)
I.1.4 Diversité systématique
I.2.1 Stratification
I.2.3 Dominance
I.2.4 Dégradation
II. LES PLANTES NON LIGNEUSES ET LES AUTRES TYPES DE FORMATIONS VEGETALES
II.1 Les plantes non ligneuses
II.2 Le «kapoka »
II.3 Le « ala anjavidy »
II.4 La pseudosteppe
III FAUNE
CHAPITRE IV LES POTENTIALITES ECOTOURISTIQUES DU SITE
I. LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DU SITE
I.1 Les paysages
I.2 Les éléments historiques et culturels
I.3 Les infrastructures
II. LES ACTIVITES TOURISTIQUES DANS LA ZONE
II.1 Les opérateurs et leurs activités
II.2 Promotion et marché touristique
II.3 Evaluation des potentialités touristiques du site
II.4 Proposition d’aménagement physique du site
CHAPITRE V RECOMMANDATIONS
I. RECOMMANDATIONS TECHNIQUES
I.1 Consensus entre tavy et écotourisme
I.2 Développement écotouristique local
II. RECOMMANDATIONS METHODOLOGIQUES
II.1 Enquêtes socio-économiques
II.2 Inventaires des potentialités du site
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet