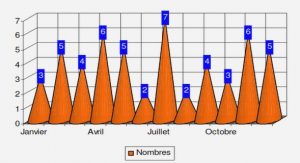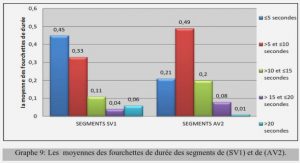Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Historicisation du discours sur l’architecture vernaculaire, de la seconde moitié du XIXème siècle à nos jours
Débuts d’une théorisation
L’expression architecture domestique vernaculaire a été employée pour la première fois par George Gilbert Scott, architecte britannique, en 1858 dans Remarks on Gothic Architecture1. Néanmoins, l’architecture vernaculaire a pendant longtemps été exclue de la discipline architecturale, étant jugée comme incompatible avec cet art, ou tout simplement hors des bornes de sa définition première. Si l’on s’intéresse aux écrits de James Fergusson2, historien en architecture écossais, de 1874, qui selon Paul Oliver3, historien en architecture anglais, a établi les fondations de l’historicisme de l’architecture moderne, on constate une séparation nette entre les constructions non-architecturales et les constructions monumentales et ornementées qui elles, selon J. Fergusson, composent l’architecture. Dès lors, des critères de dimensions et de prestige s’imposent pour considérer ce qui est ou n’est pas architecture, excluant d’emblée les constructions vernaculaires du domaine architectural.
Ainsi, en architecture, la sémantique peut justifier l’utilisation de l’adjectif qualificatif vernaculaire mais c’est plutôt le nom commun architecture qui est remis en question dans l’expression. En effet, les termes architecture et architecte dérivent du grec arkitekton qui signifie maître ou chef de construction. Dans ce sens, sémantiquement parlant, l’architecture serait forcément produite par des architectes ce qui remettrait en question le sens direct de l’expression architecture vernaculaire, qui initialement se pense et se construit sans architecte de formation.
Bien que l’expression ait pu poser, et pose toujours question, des architectes et historiens, de différentes nationalités, se sont progressivement intéressé au sujet, de façon théorique ou également dans leur pratique. Plusieurs écrits ont émergé, concernant une discipline qui originalement se trouvait hors des champs de la théorie. Même si le sujet est de plus en plus abordé, les termes employés par les auteurs diffèrent voire se contredisent, comme expliqué dans la partie précédente. Pour tenter d’historiciser la théorisation de l’architecture vernaculaire, il semble essentiel de prendre en compte des écrits de savants sur le sujet qui parfois n’emploient même pas les termes d’architecture vernaculaire. Pourtant leur travail traite bien de cette thématique, mais les champs lexicaux et terminologies qu’ils utilisent varient selon chacun.
Lors de son discours4 de 1936 sur l’architecture rurale, Giuseppe Pagano, architecte et représentant du mouvement rationaliste italien, introduit cette dernière via une critique de l’architecture savante, en remettant en cause ses principes d’esthétisme, qui selon lui, étaient les premiers critères de considération de l’architecture à l’époque. Dans un second temps, il salue l’architecture rurale qui transgresse ces dogmes classiques imposés par l’architecture savante, comme par exemple le principe de symétrie, en prônant la liberté de formes de chaque maison rurale selon différents critères constructifs. Dès lors, une première vision fonctionnaliste de l’architecture vernaculaire émergea.
Selon Paul Oliver5, l’intérêt des savants pour l’architecture vernaculaire est assez récent, et remonte au milieu des années 1950, en plein dans le mouvement moderne. Cependant, il admet qu’une certaine résistance existe simultanément. C’est ce que souligne Bernard Rudofsky, architecte et historien autrichien, en évoquant le désintérêt grandissant pour l’architecture rustique face au développement de l’architecture moderne6.
Néanmoins, l’auteur de Shelter and Society cite plusieurs architectes du XXème siècle qui ont pris en compte l’architecture vernaculaire dans leur travail. Frank Lloyd Wright7, architecte américain, est l’un des premiers de notoriété internationale à évoquer cette discipline.
Ainsi, plusieurs notions ressortent des écrits des auteurs précédemment cités pour définir ce qui peut ou pouvait caractériser les architectures indigènes, folks, rurales ou primitives. Il est nécessaire de prendre en compte ces caractéristiques dans leurs contextes, c’est à dire en considérant l’époque et la localisation de ces écrits. En premier lieu, on peut noter l’appréciation des auteurs pour la fonctionnalité des espaces des constructions qu’ils évoquent. En effet, Le Corbusier note une organisation hiérarchisée des espaces selon leur fonction, Christian Norberg-Schultz parle de formes ayant un sens en opposition aux constructions actuelles et Sibyl Moholy-Nagy, quant à elle, mentionne une planification et une organisation spatiale en accord avec des nécessités fonctionnelles spécifiques aux constructions étudiées. Elle ajoute que ces dernières sont dépourvues d’ornementations qui ne feraient pas partie de la structure initiale. Finalement, toutes ces analyses rappellent la maxime Form follows function établie par Louis Sullivan14 en 1896 et qui a engendré le mouvement moderne en architecture.
De plus, tous les auteurs cités précédemment comparent les constructions folks, primitives, rurales ou indigènes avec les bâtiments qui leur sont contemporains. De cette comparaison, la place de l’architecte ainsi que son enseignement sont remis en question. En effet, Christian Norberg-Schultz tout comme Frank Lloyd Wright voient dans ces constructions une source d’inspiration et d’apprentissage pour tout architecte de leur temps. Norberg-Schulz ajoute que ses contemporains ont perdu une compétence primordiale dans leur travail qui se retrouve cependant dans la pratique qu’il décrit comme primitive. Le Corbusier va encore plus loin lorsqu’il considère que les architectures de son époque sont devenues uniquement démonstratives en perdant leur sens premier, qui est, selon lui, de servir.
Paul Oliver a écrit de nombreux ouvrages sur la question du vernaculaire en architecture dont The Encyclopedia of vernacular architecture of the world en trois volumes15 qui consiste à l’élaboration d’un inventaire du patrimoine vernaculaire mondial. L’ensemble de son travail a fait évoluer la théorie sur le sujet de façon conséquente. Dans son livre Shelter and Society, il regroupe des paroles d’architectes, les confronte et parfois les critique. Dans un second temps, il développe différents aspects de l’architecture vernaculaire déjà évoqués par les auteurs qui l’ont précédé en y ajoutant des dimensions anthropologiques et sociologiques jusque là inexistantes. En effet, selon lui, étudier et comprendre une architecture vernaculaire spécifique, en tant que artéfact, c’est comprendre la société qui l’habite16. Dans ce sens, la discipline architecturale vient s’ajouter aux sciences humaines pour l’étude de sociétés. L’auteur ajoute qu’elle permettrait également l’étude de notre propre société occidentale, si l’on considère d’un nouveau regard, nos moeurs et nos habitudes culturelles souvent inconscientes en rapport avec les bâtiments que nous occupons17. D’autre part, Paul Oliver remet en question le travail de l’architecte au sein de sa société. Les propos qu’il emploie à son sujet, en généralisant pour tout architecte, sont parfois ironiques voire cyniques, comme il le dit lui-même, et montrent une vision très biaisée de ce que faisait et pensait un architecte à son époque18. Il évoque ainsi le clivage qui peut exister entre l’architecte et le reste de la société. Selon lui, le premier a bâti sa propre vision de l’architecture sans prendre en compte les besoins de la seconde pour qui l’architecture doit être initialement construite19. Il met alors ce paradoxe en évidence par comparaison avec les principes auxquels répondent les communautés vernaculaires.
Ainsi, l’étude de la notion de vernaculaire semble être pour les architectes du XIXème et XXème siècles une façon de questionner leur discipline et leur place dans la société dans la modernité. Bien que l’intérêt des savants pour l’architecture vernaculaire ait augmenté lors de la seconde moitié du XXème siècle, les pratiques vernaculaires, elles, ont disparu de plus en plus. En effet, la mondialisation croissante a eu un impact important sur le monde du bâtiment et la construction des villes, menaçant l’avenir de ces pratiques20. L’homogénéisation des matériaux et des techniques de construction s’est intensifiée aux quatre coins du monde, évinçant progressivement les traditions constructives autochtones. L’apparition de bâtiments de grande hauteur, très souvent en béton armé et en verre, s’est faite de plus en plus fréquente que cela soit dans des pays développés ou en développement. La disparition des communautés et donc des architectures vernaculaires est devenu un phénomène récurrent21, entraînant la perte d’identité et de savoir-faire ancestraux. De ce fait, s’est posée la question de la préservation de ces traditions vernaculaires et des techniques traditionnelles de ces sociétés en transition. Bernard Rudofsky22 et Paul Oliver23, dans leurs écrits, regrettent la propagation de ce phénomène et alertent sur la possible perte de qualité de vie des sociétés concernées suite à ce changement. Paul Oliver ajoute qu’une meilleure compréhension des communautés vernaculaires ne pourrait qu’être utile pour appliquer intelligemment les techniques de construction occidentales à des sociétés qu’il qualifie “d’exotiques”.
Ivan Illich, philosophe autrichien du XXème siècle, s’est également intéressé à la question du vernaculaire dans la société, au-delà de la dimension architecturale. Dans plusieurs de ses ouvrages, il fait référence au sujet et en donne une définition dans Le Genre Vernaculaire24. Il y explique que tout ce qui est vernaculaire est considéré comme n’étant pas marchandise. En d’autres termes, cela signifie qu’il n’y a pas de vente de ce produit et donc pas de profit. Ce qui est vernaculaire est fait pour répondre à un besoin spécifique de l’ordre du domestique et qui est donc à l’écart de tout marché et de toute spéculation possible. De ce fait, l’espace vernaculaire est incompatible avec une société au fonctionnement capitaliste où le logement a une valeur économique et où le nombre de mètres carrés a une importance. Dans ce sens, Illich, dans Le Genre Vernaculaire et Dans les Miroirs du Passé, oppose l’espace vernaculaire à l’appartement moderne des grands ensembles qu’il considère hors des champs de l’habitat, puisqu’il s’agirait selon lui de “casiers où entreposer la force de travail pendant la nuit” 25 , et renverrait donc à la marchandisation du logement, espace de pause ou simple abris pour le travailleur lambda. Il constate l’existence de ce phénomène à plusieurs endroits du globe ce qui rappelle la généralisation du phénomène déjà observée par P. Oliver et B. Rudofsky.
La comparaison que Illich met en place ne s’arrête pas à la seule valeur marchande des deux types d’habitations mais prend également en compte la notion d’habiter26 qui, selon lui, n’existe que dans les communautés vernaculaires, et donc, pas dans l’appartement moderne. Selon lui, vivre dans un logement et l’habiter sont deux choses distinctes qui ont pu, au cours du temps, être confondues par abus de langage. Ici, l’auteur met en relation les termes habiter et habitudes27 qui auraient quasiment le même sens. Ainsi, la manière stipulations jusqu’à la codification par Théodose (le “Code théodosien”). Il désigne l’inverse d’une marchandise : “Vernaculum, quidquid domi nascitur, domestici fructus; res quae alicui nota est et quam non emit” (Du Cange, Glossarium Mediae et Infimae Latinitatis, vol VIII. p.283). Était vernaculaire tout ce qui était confectionné, tissé, élevé à la maison et destiné non à la vente mais à l’usage domestique. En anglais comme en français, il s’emploie principalement pour désigner la langue “natale”” d’habiter un espace propre à l’habitant vernaculaire, serait une traduction, un miroir de ce dernier puisqu’il y mettrait en oeuvre des habitudes. De ce fait, comprendre la façon d’habiter serait un moyen de comprendre l’habitant par le biais de ses habitudes mises en place dans son espace. L’auteur définit alors l’espace vernaculaire comme demeure28, de domus, c’est à dire qu’elle devient base de l’unité sociale, à la fois en tant que lieu et moyen relationnel pour les individus qui l’habitent. Dans ce sens, la demeure est à la fois le lieu de vie et d’habitat de l’individu vernaculaire29. C’est pourquoi, selon Illich, la demeure n’existe pas dans le logement moderne30.
D’autre part, l’auteur développe le concept d’art d’habiter31, qu’il met en corrélation avec l’art de vivre. Ici il introduit la notion du travail de l’architecte, qu’il considère comme incompatible avec ce qu’il nomme art d’habiter. Selon lui, ce dernier est, en premier lieu, de l’ordre du populaire, c’est à dire qu’il émane du peuple vernaculaire dans lequel l’architecte n’est pas inclus. De plus, la maîtrise de cet art ne pourrait se faire que via un processus initiatique et progressif indépendant de la formation professionnelle de l’architecte32. Finalement, l’auteur conclut que c’est à l’habitant vernaculaire de développer son art d’habiter pour se faire sa demeure car l’architecte est dépourvu de cette qualité puisqu’il n’est que concepteur d’espaces neutres.
De ce fait, si le résident d’appartement n’habite pas son logement, c’est parce que cet espace a été façonné pour qu’il ne puisse plus y développer sa liberté d’habiter, telle que décrite par l’auteur. Il n’est alors plus défini comme habitant mais comme logé33 puisque c’est l’architecte qui a conçu son espace de vie et non pas lui. D’autre part, on peut ici noter la différence grammaticale implicite entre l’usage de “habitant” qui réfère à la forme active du gérondif “en habitant” et l’usage de “logé” qui réfère à la forme passive “être logé”. L’utilisation de ces deux formes témoigne d’une différence d’implication du résident : l’habitant – forme active – met en oeuvre un processus tandis que le logé – forme passive – le subit.
Finalement, Illich ajoute que la différence, autre que l’art d’habiter, entre l’habitant vernaculaire et le logé moderne provient de la culture de chacun. Selon lui, celle du logé a évolué dans le sens où ce dernier s’est progressivement empêché de développer sa liberté d’habiter. Dans ce sens, le logé ne verrait dans son logement qu’un espace hermétique où le nombre de mètres carrés prévaut tandis que l’habitant vernaculaire a gardé ses habitudes culturelles que l’on retrouve aussi bien dans son langage, dans son art de vivre et de mourir.
Plusieurs auteurs rejoignent Illich au sujet de la remise en question du logement moderne, de sa conception par l’architecte et de leurs effets sur les individus. C’est le cas, entre autre, de Bernard Rudofsky qui blâme l’irrationalité des constructions modernes qui iraient à l’encontre des besoins des individus qui les habitent34. Selon lui, ces individus se seraient eux-mêmes imposé un goût universel pour une configuration spatiale uniformisée de leur logement. En effet, étant démunis d’une quelconque capacité d’appropriation ou, en référence à Illich d’art d’habiter, les individus de notre société se contentent d’espaces de vie standardisés où l’angle droit domine35. Il ajoute ironiquement que la société, de manière générale, s’est même habituée à accepter une déchéance anticipée des nouvelles constructions36. Il renvoie alors à l’idée que les architectes construisent avant tout pour une reconnaissance, une belle publication via une “photographie pour la postérité” et cherchent un certain esthétisme pour leur bâtiment sans se soucier des usages à venir dans la construction qu’ils viennent de livrer.
Mais, cette quête de style ou d’esthétisme ou comme dirait Illich, la recherche de cet “espace cartésien, tridimensionnel, homogène, dans lequel bâtit l’architecte” (cf note 32), mène souvent à une uniformisation des constructions qui interroge, voire qui révolte. Michel Guéneau, traducteur de Dialectes Architecturaux, s’exprime dans ce sens dans sa préface37. Il décrit ironiquement la pratique des architectes actuels qui selon lui “dessinent des emballages pour emballer l’espace”, et tendent à oublier que la vie et ses usages se déclinent en une multiplicité de possibilités qu’ils ne peuvent pas maîtriser ni en imposer une parmi tant d’autres.
D’autre part, à plusieurs reprises, Bruno Zevi note une absence de relation entre architecture savante et architecture populaire, qu’il nomme également dialectes architecturaux38. Il évoque par exemple un clivage entre village rural versus ville ou métropole39. Il mentionne aussi le manque de considération de l’enseignement académique pour l’architecture populaire40. Bernard Rudofsky lui, évoque plutôt la posture des architectes et leurs désintérêts face à la ruralité41.
|
Table des matières
Avant-propos
Etude sémantique et définitions
I) Historicisation du discours sur l’architecture vernaculaire, de la seconde moitié du XIXème siècle à nos jours
A) Débuts d’une théorisation
B) Dans une capitalisation globale, une modernité mondialisée
C) Considérations sur l’architecture vernaculaire au XXIème siècle
D) Vision personnelle
II) Etat des lieux et compréhension d’un contexte
A) Présentation générale de l’Ethiopie
B) Présentation générale d’Addis-Abeba
1) Evolution des politiques de logement
2) Addis-Abeba aujourd’hui
C) Modes de vie
III) Quelle(s) architecture(s) vernaculaire(s) à Addis-Abeba ?
A) Les richesses vernaculaires existantes
1) Les pratiques habitantes
2) Les autres acteurs du vernaculaire
B) Les limites vernaculaires
C) Perspectives
1) Retours extérieurs
2) Synthèse
Conclusion
Bibliographie
Iconographie
Annexes
Lexique
Retranscription de l’entretien avec Pierre David
Retranscription de l’entretien avec Anteneh Tesfaye Tola
Retranscription de l’entretien avec Helawi Sewnet
Télécharger le rapport complet