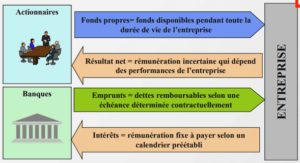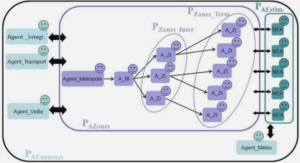Histoire de la Construction des Routes
Les Anciennes Civilisations et la Route
Les civilisations antiques ont construits des fabuleux bâtiments et monuments qui sont encore debout, nous permettons de connaitre leur culture et niveau de vie. Ces civilisations ont construit les routes utilisés dans les gères ainsi que les voyages et le commerce. Cette section examine brièvement les modèles des routes construites à travers l’histoire par civilisations connues [01].
La Route Égyptienne
Il y a enivrant 5000 ans, avant l‘invention de la roue, les personnes et les matériaux ont été transporté par voie terrestre à pied ou par les animaux. Les égyptiens lors de la construction des pyramides ont utilisée, pour le transport des pierres lourdes, des rouleaux en pierres couverts par une matière qui diminué le frottement entre la pierre et le sol, ainsi que la réduction de l‘intensité de la charge. Puis ils ont créé une surface dure sur laquelle marche leurs rouleaux (1km consommer 10 ans pour le construire) .
La Route du Royale Babylon
La voie du Babel a été construite en 620 JC, c‘est la première utilisation du bitume dans un revêtement de la chaussée, le bitume était le maintien des pierres entre eux. La chaussée était sur 1 km de long et de largeur varie entre 10 à 20 m [02].
La Route du Royale Perse
La première route construite à une distance importante est celle du roi DARIUS I de Perse. C‘était construit en 500 avant JC sur une période de 60ans.Une de ses grandes caractéristiques est l‘utilisation d‘une ligne droite en tant que la plus courte distance entre deux points. Elle comprenait également la première voie de contournement de la ville. C‘est que les romains ont l‘exploité et modernise plus tard [03].
La Route du Turnpike Trusts
Instituer en Angleterre par une loi de 1707, les Turnpike Trusts étaient organismes indépendants publics chargés de leur côté de collecter des commissions sur le trafic routier pour améliorer les routes, au moment où se développe le concept de public trust. Les commissions faisaient payer bien les usagers venant d’autres régions mais aussi les collectivités locales, qui devaient conserver les sommes, sous l’autorité d’un contrôleur et d’un trésorier, veillant à ce qu’elles soient réinvesties dans l’entretien et l’amélioration du réseau routier. Plus de 20 000 miles de routes étaient sous le contrôle des Turnpike trusts avant les années 1830, pour des commissions annuelles de 1,5 million de Sterling [03].
La Construction de la Route Britannique
La science de la construction des routes a été presque complètement perdu de Roman jusqu’à ce que l’avènement de Telford et Macadams dans le milieu du XVIIIe siècle. Beaucoup a été écrit sur les types de construction utilisés par chacun de ces deux grands pionniers de l’ingénierie. Figures (fig.1.2) et (fig.1.3) illustrent leurs techniques. Les deux ingénieurs ont compris les principes de base nécessaires pour la durabilité et la capacité pour acheminer le trafic par tous les temps. Ils ont reconnu la nécessité d’un bon système de drainage, stabilité du sous-sol, construction en couches, un bon compactage pour assurer un verrouillage de particules de pierre concassée et de contrôle de la granulométrie et sa propreté.
La différence essentielle entre les deux méthodes réside dans leur approche de l’économie. Telford construit épaisse pour fournir une route à durer plus longtemps. MacAdam pense qu‘à condition que la couche de surface ait été rendue imperméable par attrition et compactage la couche de fondations pourrait être supprimée [04].
Pavage des rues de Paris au XIIe
Les rues des villes étaient dans une situation dégager, lorsque Philippe-Auguste, en 1184, frappé de l’état boueux de celles de Paris, entreprit pour la première fois de les faire paver. Les voies qui ont été pavées formaient ce qu’on appelait la croisée de Paris voir la figure (fig.1.4). C’était l’intersection des deux grandes voies qui joignaient du nord au sud la porte Saint-Denis à la porte Saint-Jacques, et de l’est à l’ouest la porte Baudet au château du Louvre. Cette partie du pavé de Paris resta toujours à la charge du roi. Si l’administration municipale en eut l’entretien jusqu’en 1318, elle reçut une indemnité qui la couvrit de la dépense [05].
Développement des Chaussées Routières
La structure d‘une chaussée représente l‘ensemble des couches de revêtement, en matériaux liés et non liés, utilisées dans la construction de la chaussée sur le sol support. Le rôle principal de cette structure est de répartir les efforts induits par le trafic en les amortissant progressivement de manière à ce que les efforts transmis au sol support soient suffisamment faibles pour assurer la stabilité et la durabilité de la chaussée pendant sa durée de vie escomptée.
L‘épaisseur des couches composant la chaussée doit être donc suffisante pour assurer cette fonction. L‘épaisseur totale de la structure de la chaussée et les épaisseurs des couches qui la composent sont généralement déterminées par l‘étude de dimensionnement de chaussée ou par l‘utilisation de structures types pour certaines chaussées à faible trafic. En France, la méthode en vigueur est celle décrite dans le guide technique de Conception et Dimensionnement de Structure de Chaussées publié pour la première fois en 1971 sous la forme de catalogues de structures-types et révisé en 1977, 1988 et finalement en 1994 [06].Cette démarche est une démarche rationnelle basée sur une approche semimécanistique qui intègre à la fois les caractéristiques mécaniques des matériaux, la mécanique de la structure et une part d‘empirisme. En revanche, la méthode AASHTO 93 (American Association of State Highway and Transportation Officials) [07], qui est largement utilisée en Amérique du Nord et dans d‘autres pays du monde, est purement empirique. La comparaison entre les deux méthodes a bien montré la supériorité de la méthode française sur la méthode AASHTO et sur d‘autres méthodes de dimensionnement, du fait de sa prise en compte des caractéristiques mécaniques des enrobés lors de la conception de chaussées [06]. L‘homme a inventé la route pour répondre à ses besoins de déplacement. Ces besoins ont évolué et par conséquence la structure de chaussée a aussi évolué avec le temps. De plus, les nouvelles technologies dans les domaines des matériaux de construction ont permis de donner à la route des nouvelles fonctionnalités pour répondre à des besoins de sécurité et de confort comme le drainage d‘eau de surface, la réduction de bruit et l‘amélioration de l‘adhérence pneu-chaussée entre autres. L‘émergence des concepts de développement durable et les préoccupations environnementales ont aussi joué un rôle important dans l‘évolution des structures routières. Les nouvelles structures utilisent de plus en plus de matériaux recyclés, des enrobés bitumineux tièdes, des matériaux traités aux liants hydrauliques et même des liants d‘origine végétale.
|
Table des matières
Introduction générale
CHAPITRE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
1.1. Histoire de la Construction des Routes
1.1.1. Les Anciennes Civilisations et la Route
1.2. Développement des Chaussées Routières
1.2.1. Les Différentes Catégories de Structures des Chaussées
1.2.2. Les Bitumes
1.2.3. Les Granulats
1.2.4. Les Enrobés
1.3. Dégradations des Couches en Enrobes Bitumineux
1.3.1. Catégories des Phénomènes Défavorables à la Durabilité des Revêtements Routiers
1.3.2. Modes de dégradation et d’usures des revêtements routiers
1.3.3. Dégradation par déformation (Phénomène d’orniérage)
2. Définition
3. Les types d’orniérages
4. Le mécanisme d’orniérage
1.4 Le recyclage
4.1.1. Le recyclage dans le monde
4.1.2. Les opérations de recyclage
4.1.3. Les procédés de recyclage
4.1.4. Fabrication
1.4.5. Domaines d’emploi et Performances
1.4.6. Recyclage à froid en centrale
1.4.7. Recyclage au liant hydraulique
1.5. Les polymères
1.5.1. Définition des polymères
1.5.2. Différents types de polymères utilisés pour la modification des enrobés
1.5.3. Propriétés macroscopiques des polymères
Conclusion
CHAPITRE II : EXPOSÉ DE LA MÉTHODE DES PLANS D’EXPÉRIENCES
2.1. Introduction
2.2. But des plans d’expérience
2.2.1. Méthode Traditionnelle des Essais
2.2.2. Méthodologie des Plans d’expériences
2.3. Différents modelé des plans d’expériences
2.3.1. Plans factoriels complets
2.3.2. Plan Taguchi
2.3.3. Les Plans des Surfaces de Réponse
2.3.4. Les plans de Box-Behnken
2.3.5. Les plans de mélanges
2.3.6. Les plans hybrides
2.4. Les éléments d’un plan d’expérience
2.5. Les étapes d’un plan d’expérience
2.5.1. Première étape
2.5.2. Deuxième étape
Conclusion
CHAPITRE III ETUDE EXPÉRIMENTALE
3.1. Introduction
3.2. Le béton bitumineux semi grenus (BBSG)
3.3. Matériaux utilisés
3.3.1. Choix des agrégats neuf
3.3.2. Identification des échantillons neuf
3.3.3. Nettoyage des granulats
3.3.4. Essais chimique
3.3.5. Le liant neuf
3.3.6. La Poudrette des Caoutchoucs
3.3.7. Agrégat d’enrobé
3.4. Formulation d’un enrobé sain
3.4.1. Etude Marshall
a. Préparation du Mélange et Confection des Éprouvettes d’essai
b. Analyse des résultats de l’essai Marshall
3.4.2. Essais D’immersion – Compression Lcpc – Duriez
a. Préparation du Mélange et Confection des Éprouvettes d’essai
b. Analyse des résultats de l’essai Duriez
3.5. Formulation d’un enrobé recyclé
3.5.1. À base d’agrégats d’enrobé
a. Méthode
b. Analyse des résultats
3.5.2. À base de la poudrette des caoutchoucs
a. Méthode
b. Analyse des résultats conclusion
Conclusion
CHAPITRE IV : OPTIMISATION D’UNE FORMULATION D’ENROBÉ RECYCLÉ
4.1. Introduction
4.2. Formulation d’un enrobé recyclé
4.3. L’approche par plan d’expérience
4.3.1. Méthode du plan factoriel complet
4.4. Les paramètres d’étude
a. Pourcentage des agrégats d’enrobé
b. Pourcentage de poudrette
c. Température de fabrication
d. Durée de malaxage
4.5. Les matériaux utilisés
4.6. Préparation des corps d’épreuve
4.6.1. Malaxage des éprouvettes
4.6.2. Moulage des éprouvettes
4.6.3. Préparation des éprouvettes
4.6.4. Mode opératoire
4.7. L’approche par la méthode des plans d’expérience
4.7.1. Analyse des résultats
a. Analyse fiabiliste
b. Échantillonnage
4.7.2. Effet de la température sur la pénétrabilité de liant modifié
4.7.3. Effets des facteurs sur la réponse
4.8. Optimisation de la fabrication des enrobés recyclés
4.9. Effet de l’environnement sur les performances mécanique des enrobé recyclés
4.9.1. Protocole des essais
4.9.2. Résultats des essais et discutions
Conclusion générale