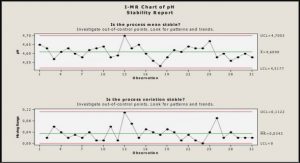Quelques notions sur le haricot
a. Historique : Le haricot commun, décrit par Linné en 1753, qui lui a donné pour nom d’espèce Phaseolus vulgaris L., est une plante annuelle cultivée pour l’alimentation humaine et parfois utilisée pour guérir certaines morsures, brûlures ou pour prévenir certaines maladies (CIRAD, 2002 ; HUBERT, 1978). Cette plante, originaire de l’Amérique Centrale et de l’Amérique latine, est déjà apparue vers 7000 ans avant Jésus Christ. Il a été introduit en Afrique il y a près de quatre siècles et ce continent se trouve désormais au second rang des régions tropicales productrices de haricot derrière l’Amérique latine (BORGET, 1989 ; FAO, 1990 ; MESSIAN et SEIF, 2004 ; ALLEN, 1996). Le haricot est introduit à Madagascar depuis 1775 et actuellement, il fait l’objet de culture vivrière dans différentes régions de Madagascar (RANDRIANJANAHARY, 2015).
b. Caractères morphologiques : Le haricot est une plante herbacée et annuelle, dont le système radiculaire est pivotant et profond. La racine peut descendre jusqu’à 1,20 m de profondeur et on trouve le plus grand nombre de racines entre 0,20-0,25 m de profondeur sur un diamètre de 0,50 m autour de la tige. La longueur de la tige varie suivant la variété, elle peut atteindre 2m à 3 m de long pour des « haricots à rames » et 30 cm à 40 cm de long pour des « haricots nains ». Les premières feuilles, au nombre de deux, sont simples et opposées. Les feuilles adultes sont alternes et composées trifoliées, de couleur verte ou pourpre. Les folioles ont une forme ovale-acuminée, presque losangée et ont de 6 à 15 cm de long sur 3 à 11 cm de large. Les fleurs sont du type papilionacé, naissant à l’aisselle des feuilles, groupées en grappes déterminées de 4 à 10 fleurs. Ce sont des fleurs hermaphrodites, zygomorphes et comprennent : 5 sépales, 2 pétales, 9 étamines soudées par leur base et une étamine libre, un ovaire, une loge renfermant 4 à 8 ovules, surmontée par un style portant un stigmate. Les fruits sont des gousses allongées, généralement droites, plus ou moins longues et terminées par une pointe. Elles renferment en moyenne 4 à 8 graines. Les graines sont de forme soit sphérique, soit cylindrique, et sont très diversement colorées : en blanc, vert, rouge, violet, noir, brun ou même bicolores ou tachetées selon les variétés (HUBERT, 1978 ; WIKIPEDIA).
c. Position systématique : Selon la classification botanique et selon la classification décrite par CHARLES (1998) ; CHAUX et FOURY (1994), la position taxonomique du haricot est la suivante:
Règne : VEGETAL
Embranchement : PHANEROGAMES
Sous embranchement : ANGIOSPERMES
Classe : DICOTYLEDONES
Sous classe : ROSIDAE
Ordre : ROSALES
Famille : FABACEAE
Sous famille : PAPILIONOIDEAE
Tribus : PHASEOLEAE
Genre : Phaseolus
Espèce : vulgaris
Nom vernaculaire : Common bean en
Anglais, haricot en
français et tsaramaso en
malagasy.
d. Cycle biologique : Le cycle biologique de haricot comprend deux phases : la phase végétative et la phase reproductive (SCHOONHOVEN et al., 1992).
Phase I : La phase végétative
Elle comprend 05 stades :
Stade V0 : Germination, absorption d’eau par la graine, émergence de la radicule et transformation en racine primaire.
Stade V1 : Apparition des cotylédons, les cotylédons apparaissent au niveau du sol et commencent à se séparer.
Stade V2 : Développement de deux premières feuilles, feuilles primaires totalement ouvertes.
Stade V3 : Développement de la première feuille trifoliolée, la première feuille trifoliée s’ouvre et la deuxième apparait.
Stade V4 : Développement de la troisième feuille trifoliolée, la troisième feuille trifoliée s’ouvre et les bourgeons sur les nœuds inférieurs produisent des branches.
Les stades V2, V3 et V4 constituent la phase de croissance. Au bout d’un mois, le pied de haricot possède une dizaine de feuilles trifoliolées et atteint sa hauteur définitive. Les figures suivantes représentent les différentes étapes de la phase végétative :
La phase II : La phase reproductive
Elle comprend 05 stades :
Stade R5 : Préfloraison : apparition des premiers boutons floraux
Stade R6 : Floraison : éclosion de la première fleur
Stade R7 : Formation des gousses
Stade R8 : Remplissage de la gousse
Stade R9 : Maturation : changement de la couleur des gousses
Quelques notions sur la rouille
A Madagascar, depuis le moment où un laboratoire spécialisé fut en état de fonctionner, c’est- à-dire à partir de 1930, les phythopalogistes font des recherches et des études en laboratoire des maladies des plantes, en particulier les maladies déterminées par des Basidiomycètes qui sont parmi les organismes responsables de la rouille. Les basidiomycètes sont des champignons caractérisés par la production de spores monocaryotiques, haploïdes, appelées basidiospores, à l’extérieur de sporocystes appelés basides (AOUAR, 2012). La rouille est une maladie cryptogamique attaquant les feuilles et les gousses. Elle est provoquée par un agent phytopathogène dénommé Uromyces appendiculatus. Ce microorganisme est très virulent et très répandu sur les différentes variétés de haricots qu’on trouve à Madagascar (BOURIQUET, 1951). A part Madagascar, cette espèce existe aussi dans le monde entier, plus particulièrement dans les endroits où les conditions climatiques sont favorables à son développement. Les conditions favorables à l’agent pathogène sont les zones fraîches à des températures modérées entre 17°C et 22 °C et alternées par une humidité élevée (supérieure à 95%) (ROGER, 1951 ; KHOUADER et al., 2013). Du point de vue polyphytisme, Uromyces appendiculatus renferme différents races biologiques spécialisées, non distinguables morphologiquement ; plusieurs races de rouille sont fondées sur les plantes hospitalières attaquées ; par exemple : Uromyces phaseoli var. typica, sur les Phaseolus et Uromyces phaseoli var. vignae (Uromyces vignae) sur les Vigna (THIAGO et al., 2008 ; CHUNG et al., 2004).
Interactions de la rouille avec les autres microorganismes
Souvent, dans une condition optimale, l’association d’Uromyces appendiculatus avec les autres microorganismes pathogènes ou non pathogènes, peut être observée. On peut citer : Pseudomonas syringae, agent responsable de la bactériose à halo ; Colletotrichum lindemuthianium agent responsable de l’anthracnose (HARTER et al., 1935).
DISCUSSION
Cinq (05) variétés de haricots ont été utilisées pour tester leur tolérance visà-vis d’Uromyces appendiculatus en utilisant le mode d’inoculation sur feuilles et des plants témoins non inoculés. La souche U. appendiculatus utilisée est obtenue à partir de plants malades présentant les symptômes de la rouille. Puisque U. appendiculatus est un parasite obligatoire, la méthode d’extraction directe des spores a été utilisée pour l’isolement des spores. L’observation macroscopique des feuilles malades et l’observation microscopique des spores et du mycélium confirment que U. appendiculatus a des hyphes cloisonnés révélés par le colorant bleu de coton. Les pustules de la rouille présentent un aspect poudreux et de couleur brune rousse. Sous microscope optique, les spores extraites sont des urédospores arrondies, rugueuses et de couleur brune claire. Dans la littérature, plusieurs auteurs ont montré que U. appendiculatus a les caractéristiques citées précédemment (KHOUADER et al., 2013). L’analyse statistique de la hauteur des plants, montre que la rouille n’influe pas la croissance des plants. En effet, on n’a pas observé de symptômes de la rouille sur les tiges et les branches ; cette remarque a été confirmée par ALLEN (1996). Par contre, la rouille a une influence sur la taille des feuilles qui sont des organes cibles pour les variétés sensibles. En effet, l’observation des feuilles pendant la phase végétative a montré que quelques unes sont déformées et s’atrophient. U.appendiculatus, infectant les feuilles, provoque une chute de l’activité photosynthétique en détruisant les chloroplastes (ROGER, 1990). Ainsi, les feuilles infectées, déformées par la rouille, captent mal l’énergie lumineuse provoquant le disfonctionnement de la plante. Uromyces appendiculatus est un champignon biotrophe qui importe les produits de la photosynthèse vers les sites d’infection. Près des pustules de rouille, les concentrations de fructose, glucose et saccharose sont élevées. L’accumulation de ces produits dans les sites d’infection provoque l’hypertrophie des feuilles (LIVNE et al., 1976). Sur les 05 variétés de haricots sélectionnées, 03 variétés : AWASH MELKA, MENAKELY et RANJONOMBY sont sensibles à la rouille. Tandis que les 02 autres variétés (SMC 18 et SMC 21) sont résistantes. A partir de 28 JAI pour les 03 variétés présentant le symptôme, l’indice de la maladie est de 25% et atteint une valeur d’indice maximal à 56 JAI pour MENAKELY, 70 JAI pour AWASH MELKA et 84 JAI pour RANJONOMBY. Lorsque l’indice de la maladie atteint une valeur maximale, la valeur reste presque constante jusqu’à la mort des plants. Cette valeur constante est due au vieillissement des feuilles. Or le développement de la rouille est favorisé par la présence d’une jeune feuille (MERSHA et HAU, 2008). Les variétés résistantes peuvent limiter ou inhiber la germination des spores sur les feuilles. ROGER (1990) a montré que le mécanisme de résistance est lié à l’épaisseur de la cuticule. Les plantes sont résistantes lorsque la cutine de la cuticule atteint 0,1 mg par Cm2 de la surface foliaire.La résistance des deux cultivars peut être aussi expliquée par l’interaction génétique plante hôte – U.appendiculatus. La résistance des plants est conférée par un gène de résistance à la fois andine et un pool de gènes mésoaméricains (JOHNSON et GEPTS, 2002 ; ARAYA et al. 2004 ; JOCHUA et al., 2004). Lorsque le symptôme est bien visible à l’œil nu, à partir de 30 JAI, le symptôme apparait comme une tache jaune sur la face inférieure des feuilles. THIAGO et al. (2008) déterminent que la tache jaune sur les feuilles est due à la croissance mycélienne des spores qui pénètrent à travers les stomates et envahissent ensuite la surface foliaire pour former une pustule de couleur brune. Les pustules sont bien visibles à partir de 42 JAI et le taux d’attaque de la rouille est très sévère pendant la période de formation des gousses (SCHOONHOVEN et al., 1992). Les plants non inoculés pour chaque variété sensible ont une charge de gousses plus élevée que les plants inoculés. Ces résultats montrent que la rouille a une influence sur la formation des gousses. Seule la variété AWASH MELKA classée comme étant une variété sensible, a le taux de rendement influencé par la maladie. Le taux de rendement AWASH MELKA PI est faible par rapport à l’AWASH MELKA PNI. ARUNGA et al. (2012) indiquerait que l’infection de la rouille a une influence importante sur le rendement de culture de haricots.
|
Table des matières
Introduction
Partie I : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I. 1. GENERALITES SUR LE HARICOT
I.1. 1. Quelques notions sur le haricot
a. Historique
b. Caractères morphologiques
c. Position systématique
d. Cycle biologique
I.1.2. Importance du haricot
a. Importance alimentaire
b. Importance commerciale
c. Autres importances
I.1.3. Les contraintes de la culture du haricot
a. Contraintes biotiques
b. Contraintes édaphiques
c. Contraintes climatiques
I. 2. GENERALITES SUR LA ROUILLE
I.2.1. Quelques notions sur la rouille
I.2.2. Classification
I.2.3. Cycle de vie d’Uromyces appendiculatus
I.2.4. Clé de détermination de la rouille
a. Mode d’apparition des symptômes
b. Caractères morphologiques et caractères biométriques des spores
I.2.5. Epidémiologie
I.2.6. Processus d’infection
I.2.7. Caractères physiologiques
I.2.8. Interactions de la rouille avec les autres microorganismes
I.2.9. Diversité de la virulence de la rouille
Partie II : MATERIELS ET METHODES
II.1. MATERIELS
II.1.1. Site d’étude
II.1.2. Echantillonnage du substrat de haricot
II.1.3. Matériels biologiques
a- Matériel végétal
b- Pustule d’Uromyces appendiculatus
II.2. METHODES
II.2.1. Prélèvement des échantillons de plants malades
II.2.2. Identification, études des caractères morphologiques et structuraux d’U.appendiculatus
a-Caractères morphologiques : examen macroscopique
b-Caractères morphologiques : examen microscopique
II.2.3.Préparation de l’inoculum
II.2.4.Inoculation
II.2.5. identification et isolement des microorganismes autres que Uromyces appendiculatus
II.3. MISE EN PLACE DU DISPOSITIF
II.3.1. Nettoyage de la serre
II.3.2. Préparation du substrat
II.3.3. Semis
II.3.4. Dispositif expérimental
II.4. EVALUATION DES SYMPTOMES
II.5. CALCULS ET ANALYSES DES DONNEES
II.6. ETUDES DES PARAMETRES
II.6.1. Paramètres morphologiques
II.6.2. Evolution de la maladie
II.6.3. Paramètres reproductifs
II.6.4. Rendement des graines
Partie III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
III. Etudes des caractères morphologiques et structuraux
III.1. Examen macroscopique
III.2. Examen microscopique
III.2.1. Mycélium
III.2.2. Spores
III.3. Identification des maladies autres que la rouille
III.4. Résultats des paramètres étudiés
III.4.1. Paramètres morphologiques
III.4.2. Evolution de la maladie
III.4.3. Paramètres reproductifs
III.4.4. Rendement des graines
Partie IV : DISCUSSION
Discussion
Conclusion et perspectives
Références bibliographiques
Annexes
Résumé
Abstract
Télécharger le rapport complet