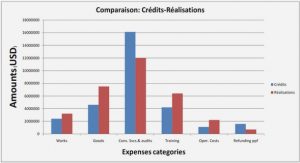Au cœur de la torpeur estivale 2014, alors que, quatre ans après sa création, l’opinion publique ne sait plus très bien si la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet (HADOPI) existe toujours et si elle continue à lutter tant bien que mal contre le piratage de biens culturels sur les réseaux d’échange pair-à-pair, une série de tribunes de presse relance le débat et rouvre les controverses, quelques mois avant la présentation d’une nouvelle « loi Création » annoncée pour 2015 et quelques semaines avant l’entrée sur le marché français de Netflix, plate-forme légale de téléchargement illimité de films et de séries télévisées par abonnement mensuel.
Un nouveau cycle de débats est relancé par la tribune du producteur indépendant Jean Labadie le 6 août 2014 qui interpelle directement la Ministre de la culture avec ce titre : « Madame Filippetti, la piraterie tue le cinéma ». Ce producteur a en effet été confronté à un échec commercial cuisant à l’occasion de la sortie du film Raid II en France le 23 juillet. Alors que le film est sorti en DVD aux États-Unis le 8 juillet avec une version française pour le marché canadien, les sociétés spécialisées dans la traque des contrefaçons audio-visuelles ont repéré 2500 mises à disposition sur les réseaux pair-à-pair, et 1100 liens sur les plates-formes de streaming illicites. L’attaque de la politique gouvernementale, appuyée le lendemain par une autre tribune de distributeurs indépendants , est rude : « HADOPI première version n’était pas parfait mais menaçait de sanctions ceux qui volaient (car, oui, le piratage est un vol) les ayants droit, auteurs, producteurs ou diffuseurs de films. Votre gouvernement n’a eu de cesse que de détruire cette entité sans avoir jamais, en deux ans, proposé une quelconque riposte contre les contrevenants. Pourquoi dans ce cas ne pas laisser chacun se servir dans les magasins d’alimentation ou de prêt-à-porter ? Ne serait-il pas aussi légitime de se vêtir et de manger à sa faim sans payer ? Peut-être même davantage que de visionner Drive ou les Beaux Jours ? Sommes-nous un métier qu’il vous semble légitime de laisser piller ? Avons-nous eu affaire il y a deux ans à une pure promesse électorale ? Dépénaliser le piratage et en faire cadeau aux électeurs sans que ça ne coûte un euro au futur gouvernement. Une stratégie à court terme qui oublie pertes d’emplois, de TVA, d’impôt sur les sociétés, etc ! Une promesse de campagne devenue cauchemar pour tous les intervenants de l’industrie du cinéma et de la télévision ! Peut-être au fond le gouvernement a-t-il fait un rêve : celui que le cinéma soit gratuit… Dans ce cas-là, pourquoi ne pas produire qu’avec des fonds publics ? Avec des auteurs, des techniciens bénévoles ou fonctionnarisés ? ».
Cette tribune est suivie le lendemain d’une réponse de la ministre par communiqué de presse qui assure de sa détermination à protéger la production cinématographique française, puis d’une prise de position du secrétaire général de la HADOPI, Eric Walter, directement concerné par la première tribune. Dans cet interview, Eric Walter prononce une phrase qui nous semble confirmer notre idée initiale et renvoyer à la question essentielle de l’introduction à notre thèse : pourquoi étudier la genèse de la HADOPI ?
Nouveaux illégalismes et nouvelles disciplines
La question de la frontière entre le légal et l’illégal, la qualification de la licéité des actes et ses évolutions à l’ère numérique sont des problématiques centrales de notre thèse. Le crime, les délits, les infractions aux règles sociales ont été, en creux, un objet précoce de la sociologie. Il est donc utile de tenter de dresser ici le panorama des apports théoriques qui ont pu être énoncés puisque le sujet de nos recherches est tout entier dirigé vers les épreuves rencontrées pour établir un consensus sur des actes illicites, leur définition, leur mesure, leur répression et leur contrôle. Dès la fin du XIXème siècle, la sociologie naissante a énoncé, par la voix d’Émile Durkheim (1894: 65-72) , le curieux paradoxe de la normalité du crime, sa nécessité, voire son utilité. En remarquant que le « crime est normal parce qu’une société qui en serait exempte est tout à fait impossible », Durkheim constate la réalité du crime comme facteur d’unité de toute vie sociale et facteur solidaire des conditions fondamentales indispensables à l’évolution normale de la morale et du droit. Il détecte aussi dans le concept de crime une dynamique qui accompagne les évolutions sociales et remarque que des actes qui lèsent le sentiment de dignité humaine sont progressivement entrés dans le droit pénal dont ils ne relevaient pas primitivement. Faisant le parallèle avec la diversité des niveaux de conscience au sein d’une société, il affirme que ce qui confère à un acte un caractère criminel n’est pas son importance intrinsèque mais celle que lui prête la conscience commune. Durkheim va jusqu’à affirmer que le crime est non seulement nécessaire à la cohésion sociale mais qu’il participe utilement à l’évolution de celle-ci en préparant et annonçant nombre de changements. Prenant à témoin la condamnation de Socrate et la lutte contre les hérésies au Moyen Age, Durkheim présente les faits fondamentaux de la criminologie et sa possible utilité sociale dans des transformations qui seront ultérieurement jugées nécessaires. Pour lui : « le criminel n’apparaît plus comme un être radicalement insociable, comme une sorte d’élément parasite, de corps étranger et inassimilable introduit au sein de la société ; c’est un agent régulier de la vie sociale » (Durkheim 1894: 69). En dernier lieu, cette approche du fait criminel et délictueux repose à nouveaux frais la question de la théorie de la peine et, notamment, la définition de sa fonction à « rechercher ailleurs », au-delà du simple rôle de remède au crime.
Le renversement de la charge qu’opère Durkheim à propos de la fonction sociale du crime va être prolongé par Michel Foucault et son célèbre concept «d’illégalisme» qui va nous être très utile pour tenter de définir tant le concept de téléchargement illicite et de piratage que la figure même du « pirate ». Cependant, la réception idéologique et politique de son célèbre livre Surveiller et punir de 1975 a quelque peu masqué l’argument central qui ne portait pas fondamentalement sur une sociologie critique de la prison et de la politique carcérale. La prison n’est ici qu’une illustration, certes importante, d’un projet beaucoup plus vaste qui porte sur les dispositifs historiques d’objectivation et de « disciplinarisation » des individus et des groupes. Comme Foucault le précise en conclusion : « S’il y a un enjeu politique d’ensemble autour de la prison, ce n’est pas de savoir si elle sera ou non correctrice, qui y exercera le pouvoir, ou si une alternative à l’emprisonnement est possible. Le problème actuellement est plutôt dans la grande montée des dispositifs de normalisation et toute l’étendue des effets de pouvoir qu’ils portent à travers la mise en place d’objectivités nouvelles » (1975: 313). Dans le sillage de Durkheim, Foucault, rejetant lui aussi toute approche substantialiste de la criminalité, va inaugurer une nouvelle rupture conceptuelle dans l’analyse du fait criminel et délictueux en bousculant les catégories d’évidence de la science juridique, et en historicisant la gestion sociale des conduites indisciplinées pour fonder une théorie du pouvoir et des instruments de répression et de contrôle des populations. Le concept d’illégalisme émane de l’étude historique que Foucault fait de la non application et de l’inobservation massive d’édits et d’ordonnances sous l’Ancien Régime. L’étude de l’ampleur du phénomène fait apparaître une cohérence et une économie propre à travers le mécanisme des privilèges, que celui-ci soit un consentement muet du pouvoir ou une impossibilité d’imposer la loi. Les marges de tolérance placées sous l’effet de lois ou de coutumes locales étaient garanties aux populations les moins privilégiées et leur remise en cause ponctuelle par le pouvoir pouvait provoquer de brutaux soulèvements de la population. Un tel illégalisme nécessaire ne se distinguait pas juridiquement ou moralement de la criminalité (contrebande, pillage, vagabondage, lutte armée contre les levées d’impôts divers). Il servait de condition d’existence à une part importante de la population et recevait, de ce fait, une forme de tolérance. Cette partie de la population objectivement criminelle bénéficiait alors d’une valorisation spontanée, ni tout à fait convergente ni foncièrement opposée, de la part du reste de la population, (y compris les classes dominantes). Dans certains cas, l’illégalisme est indispensable pour assurer un effet de levier à la croissance économique, notamment ceux liés aux questions fiscales, largement acceptés par la population : la tolérance devient alors encouragement. L’articulation entre illégalisme et économie est un apport sociologique essentiel avec la distinction par Foucault de deux types d’illégalisme : l’illégalisme de biens (vol, rapine, chapardage, vaine pâture) toléré jusque là dans la société rurale et féodale mais, qui sous l’effet de la généralisation de la propriété terrienne au XVIIIe siècle, se transforme en infractions pures et simples. Ces illégalismes liés à la propriété foncière deviennent de plus en plus insupportables aux nouvelles classes possédantes quand ils affectent la propriété commerciale et industrielle. La production, le transport et l’accumulation de marchandises mais aussi le développement de nouveaux comportements illégaux (fausse monnaie, explosion de la contrebande, vol de marchandises…) vont donner lieu à un « recodage » des illégalismes. Avec l’avènement de l’économie capitaliste, l’importance croissante du statut juridique de la propriété va restructurer l’économie des illégalismes non plus de biens mais de droits. Se produit alors une première rationalisation de l’anarchie normative des punitions de l’Ancien Régime, inappliquées et inapplicables, par une vaste réforme pénale qui se caractérise par un adoucissement des peines lié au souci d’humanisation de la punition, une codification plus nette et une diminution de l’arbitraire en vue « d’un consensus mieux établi à propos du pouvoir de punir ». Il faut adapter la granularité de la punition pour atteindre une cible plus ténue mais plus répandue mais aussi diminuer son coût économique et politique en augmentant son efficacité. La réforme pénale du XVIIIe siècle cherche ainsi déjà à constituer une nouvelle économie et de nouvelles technologies du pouvoir de punir. Le système pénal prend trois siècles plus tard un tournant essentiel pour notre sujet : celui de concevoir un dispositif juridicotechnique pour assurer la gestion différentielle des illégalismes sans avoir le projet de les supprimer tous. Plus que le concept d’illégalisme lui-même, l’apport essentiel de Foucault porte sur la mise en évidence des mécanismes et des dispositifs gestionnaires et différenciés des illégalismes. La fausse neutralité des catégories révèle l’activité toujours rouverte de qualification et de la différenciation des illégalismes ainsi que l’adaptation des techniques de poursuite des contrevenants, des mécanismes de sanction et de conduite à distance des comportements. Une individualisation des peines vise à « mettre en circulation dans le corps social des signes de punition exactement ajustés, sans excès ni lacunes, sans dépense inutile de pouvoir, mais sans timidité» (1975: 101) dans des sociétés désormais marquées par l’intensification de l’activité économique, la circulation généralisée des biens matériels et le fait que les moyens et les outils de production d’une grande partie de la richesse se trouvent dans les mains des catégories sociales sur lesquelles une surveillance et une discipline nouvelles des comportements doivent s’exercer. Foucault affirme donc que la pénalité ne vise pas à réprimer tous les illégalismes mais à les différencier et à tracer les frontières de la tolérance par des outils de gestion qui attribuent une qualification relative et dynamique aux actes illicites. Ces idées ont naturellement rencontré un important écho dans la littérature traitant des catégories classiques de la délinquance d’atteinte aux biens ou aux personnes, non sans un certain constructivisme propre à la sociologie critique. L’étude de l’évolution du délit de contrefaçon à l’ère numérique et l’histoire de la création d’un nouveau mécanisme de différenciation entre la contrefaçon et le téléchargement illicite nous ont paru originales et propices à une compréhension renouvelée des effets politique du numérique. En effet, si l’on peut s’accorder sur l’existence d’une phase de requalification des actes illicites et sur la création d’outils de gestion de leur discipline, il nous semble intéressant de décrire précisément la fabrication de l’un d’entre eux à travers l’invention d’une nouvelle infraction et de nouveaux moyens matériels de constat et de poursuite.
L’économisation et les biens culturels
Notre thèse n’est pas une thèse d’économie bien que la motivation du législateur à agir sur le téléchargement illicite vise expressément à sauver l’économie de la culture et, par là, la culture ellemême. Même si notre travail se réclame de la sociologie de l’action publique, nous énonçons ici le cadre général des controverses que la science économique a pu générer à propos des échanges de biens culturels à l’ère numérique. Nous souhaitons souligner que l’économisation et la mise en marché des artéfacts culturels sont des phénomènes finalement assez localisés dans le temps et l’espace et suspendre un instant d’un point de vue méthodologique la croyance dans l’économisme qui considère que le capitalisme constituerait la seule forme possible d’échanges et de mise en relations entre les biens et les personnes. C’est ainsi qu’avant même la numérisation des contenus, la science économique a placé les biens culturels sous le régime de l’exception et de l’incertitude (Le Guern, Dauncet: 2012). La difficulté à faire entrer les œuvres culturelles dans l’économie de marché (capable d’intégrer ces objets dans un réseau d’agents calculateurs aptes à résoudre des conflits d’intérêts résolus dans des transactions établissant une équivalence mesurée par des prix) a débouché sur la nécessité de créer une catégorie à part de biens : celle de « biens d’expérience » (Gensollen 2004). Cette catégorie existe pour singulariser et tenter de formaliser une dimension essentielle qui pose des problèmes à la rationalisation marchande. Les productions culturelles résistent en effet au mode d’existence fondamental de l’économie de marché qui consiste à établir une frontière claire entre les caractéristiques internalisables d’une œuvre que l’on peut littéralement « prendre en compte » et celles qui génèrent des externalités, par essence incalculables. Ces graves lacunes informationnelles sont résumées par le fameux leitmotiv de William Goldman (1984: 39) à propos des biens culturels : « personne ne sait ». Cette incertitude a pour conséquence essentielle de rendre instable la relation cardinale de l’économie de marché entre incitation, utilité et profit (même lorsqu’elle est cadrée par de vastes tentatives de distribution judicieuse de droits de propriété par le droit de propriété littéraire et artistique, dont nous examinerons les épreuves subies par le numérique au premier chapitre). Dans le laboratoire des biens culturels, l’économisation révèle ses caractéristiques de « monstre » qui peine à étendre ses outils et espaces de calcul ingouvernables en dehors d’une production stabilisée et close d’internalités. Malgré la grande efficacité du marché pour multiplier les valeurs d’usage, pour rendre compatibles des plans décentralisés, pour favoriser l’innovation et pour mobiliser des ressources, économistes, politiques et industriels affirment – un peu désolés – que « les biens culturels ne sont pas des marchandises comme les autres ». La prolifération des externalités semble sans limite et provoque de nombreuses market failures. Pourtant, tous les modèles d’affaires et les théories économiques ont été employés: protectionnisme avec les quotas nationaux ; libre échange et libre circulation avec les politiques libérales européennes ; structuration des réseaux de distribution par la publicité ; subvention publique massive ; modèle d’affaire de l’achat d’un support, abonnement à l’acte ou illimité… L’hybridité des agencements économiques, la diversité même des typologies d’objets (musique, cinéma, livre, spectacles, pour les plus classiques, mais aussi jeux vidéo, luxe et même tourisme) et l’accumulation d’innovations technologiques de production et de diffusion (phonogramme, photographie, radio, télévision, numérique…) attestent des limites des formatages marchands pour cadrer les qualifications des objets culturels et résoudre le problème de la tarification. En effet, la notion de bien culturel se satisfait mal de l’instabilité des caractéristiques qui lui sont associées et expliquent pourquoi une demande lui est adressée, pourquoi il est recherché et quelles sont les équivalences d’échange qu’il génère à travers un prix. Ces incertitudes intrinsèques aux biens culturels soulignées ici brièvement sont indispensables pour éclairer, à côté des tentatives d’économisation des biens culturels, d’autres formes d’organisation des échanges qui seront mobilisées pour nos travaux : à savoir celui du désintéressement, plus connu sous les expressions d’économie du don ou du partage, fortement revendiqué par les militants de l’internet libre opposés aux dispositifs de répression et de discipline des comportements illicites du téléchargement illégal. Dans leur article « Tu ne calculeras pas ! », Michel Callon et Bruno Latour (1997) ont souligné l’importance de penser symétriquement et non en opposition l’intéressement marchand (échanges et tarification) et le désintéressement (don, partage). L’utilitarisme capitaliste et l’antiutilitarisme du don et du partage ne sont pas opposés, ce sont les deux faces d’une même réalité sociale qui résolvent la question du collectif. L’échange marchand individualise, internalise, fabrique et sépare des agences calculatrices et intéressées qui, une fois la transaction achevée, permettent d’être quitte de toute obligation. Il est par ailleurs utile de souligner qu’il n’existe pas d’agents économiques individuels calculateurs ou donneurs mais qu’il s’agit toujours de performances collectives distribuées qui traversent chacun.
|
Table des matières
INTRODUCTION GÉNÉRALE
I – Nouveaux illégalismes et nouvelles disciplines
II – L’économisation et les biens culturels
III – Les instruments de l’action publique
IV – La science économique, le piratage et la réponse graduée
V – Le plan de la thèse
CHAPITRE 1 – LE PIRATAGE COMME ÉPREUVE
I – Dissociation, agencement et opérations du droit de propriété littéraire et artistique à l’ère numérique
Qui possède l’œuvre ? Controverses sur le droit d’auteur au XIXe siècle
Droit d’auteur et économie des grandeurs
Droit d’auteur et économie des qualités : « la culture n’est pas une marchandise comme les autres »
Espace de calcul, fonction de gestion et performativité
Droit d’auteur et économie des industries culturelles
Flexibilité, expansions, limites et exceptions
II – Quand le délit de contrefaçon perd prise
Les repères de l’infraction
Matérialité
Localisation
Imputation
Flexibilité des repères de l’infraction
Les ressources du droit général de la contrefaçon
La qualification des faits du régime général de la contrefaçon
L’imputation et la responsabilité en régime général de la contrefaçon
Constat et sanction en régime général de la contrefaçon
Localisation du délit et détermination de la loi applicable
Conclusion
CHAPITRE 2 – RECODER LES ILLÉGALISMES. Les Mesures Techniques de Protection, les illusions d’une «police technique»
I – Principes généraux, économiques et juridiques des Mesures Techniques de Protection
Principes généraux
Principes économiques
Principes juridiques
II – Les mises à l’épreuve des Mesures Techniques de Protection
L’épreuve des exceptions au droit de propriété littéraire et artistique
III – La « mise en loi » des Mesures Techniques de Protection : les difficultés de l’encastrement entre technologie et droit (loi DADVSI, 1er août 2006)
L’arrêt Mulholland Drive du 22 avril 2005, signal d’alarme des juges au législateur
L’Autorité de Régulation des Mesures Techniques et l’interopérabilité
Le régime des exceptions et les tensions entre ordre juridique et ordre technologique
Conclusion : Les MTP, instrument par destination de l’action publique
CHAPITRE 3 – REPRENDRE PRISE. Faire surgir, enquêter, calculer : les ayants droit comme public
I – Les Sociétés de Perception et de Répartition des Droits d’auteur et droits voisins (SPRD)
Origines, périmètres et fonctions de représentation
Régime juridique
Le réseau des SPRD
Le pivot SACEM-SDRM-SACD
II – L’obtention d’un pouvoir d’enquête sur les réseaux pair-à-pair
La révision de la loi Informatique et libertés
Saisine et réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel, juillet 2004
« Erreurs d’appréciation » de la CNIL, annulation par le Conseil d’État, mai 2007
III – Mise en œuvre du pouvoir d’enquête et matérialité de la preuve sur les réseaux pair-à-pair
Le rapport « Znaty »
Calculer et certifier l’empreinte d’une œuvre
Conclusion
CHAPITRE 4 – NÉGOCIER LE DROIT. La mission Olivennes, le rapport et les accords de l’Élysée : agir en créant des associations robustes
Introduction
I – « La gratuité, c’est le vol »
Genèse de la mission Olivennes
Le choix de Denis Olivennes – son essai « La gratuité, c’est le vol »
II – Retisser des associations fortes
Les pistes ouvertes par le rapport « Le développement et la protection des œuvres culturelles sur les nouveaux réseaux »
Le filtrage
La mise en œuvre de contravention
La mise en œuvre d’un dispositif d’avertissement
La mise en œuvre d’une sanction civile
La négociation des accords de l’Élysée
Interactions et négociations entre acteurs
L’influence légistique des accords de l’Élysée
Les accords de l’Élysée et le droit négocié
Le rôle de l’accord de l’Élysée dans la fabrique de la loi
Conclusion
CHAPITRE 5 – NATURALISER L’ACCÈS À INTERNET L’assemblage de l’adresse IP aux normes communautaires et constitutionnelles
I – La matérialité de l’adresse IP
L’adressage IP, maillon essentiel du réseau des réseaux
Notions essentielles
Bref historique du protocole TCP/IP
L’adressage IP
Preuve et identité électroniques
La collecte de la preuve numérique en matière pénale
L’identité numérique : entre matérialité et présomption
II – Le rôle de l’adresse IP dans le concept de riposte graduée
La riposte graduée : une chance de clarification du statut juridique de l’adresse IP
« La charte musique » du 28 juillet 2004
Prémices de « l’approche graduée » au Conseil Supérieur de la Propriété Littéraire et Artistique
Le rôle du traitement de l’adresse IP dans sa traduction en donnée personnelle
La coupure de l’accès – et la fiction technique de sa « sécurisation » -, mère des controverses
III – Contrepoint communautaire : le Paquet Télécom et l’amendement Bono/Cohn-Bendit
Le Paquet Télécom, l’agenda et les acteurs en présence
Le projet politique de l’amendement Bono/Cohn Bendit
« On s’en fout du parlement européen ! »
IV – La saisine du Conseil constitutionnel
CONCLUSION GÉNÉRALE