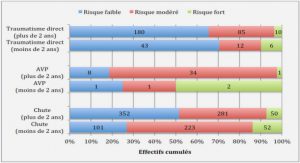Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE)
Notre pays dispose de ressources en eau très importantes mais inégalement reparties. Prenons le cas de Toliara, pendant la période de crue l’eau est très abondante et la région risque d’être inondée alors qu’en période sèche, la même région souffre terriblement d’un manque d’eau. Ce problème se présente malheureusement dans d’autres régions de la Grande Ile. C’est donc une des raisons du besoin de gérer l’eau : protection, assainissement, conservation de laressource en eau et sa mise en valeur. En cas de limitation des ressources en eau disponibles, priorité est donnée à l’approvisionnement en eau potable tenant compte des normes de consommation retenues dans le code de l’eau. Ensuite, l’eau d’irrigation nécessaire à l’agriculture peut provenir des eaux de surface ou des eaux souterraines les installations respectant les normes de débit spécifique utiles aux cultures, fixées par décret. Les quantités d’eau prélevées ne doivent pas léser les autres utilisateurs. Tout projet d’irrigation initié par une personne morale ou physique de droit privé requiert l’avis de l’Autorité Nationale de l’Eau et de l’Assainissement (ANDEA) en ce qui concerne l’utilisation des ressources en eau aussi bien de surface que souterraines. Enfin, pour l’utilisation de l’hydroélectrique, des dispositions réglementaires définiront les conditions techniques d’aménagement des centrales hydroélectriques, lesquelles feront préalablement l’objet d’étude d’impact conformément à la loi N° 90.003 du 21 décembre 1990 portant Charte de l’Environnement.
Contrôle laitier
La production laitière s’exprime en kilos, et la production journalière est le poids de lait correspondant aux traites complètes d’un soir et du matin suivant. La production mensuelle s’exprime en mois de 30 jours. Et la production au cours d’une lactation est la somme des productions observées ou estimées au cours de la lactation. La durée d’une lactation est fonction de l’époque du vêlage souvent inférieur à 300 jours, le repos de la mamelle étant entre deux lactations de 60 – 70 jours. Afin de permettre des comparaisons entre toutes les vaches d’un troupeau, il est intéressant de donner la production en 270 jours. Il est intéressant, en particulier pour estimer le rendement économique du troupeau de calculer la production moyenne par vache, par mois, par an, du troupeau de vache en lactation. Enfin, l’estimation de la production laitière, il est quelquefois impossible d’effectuer un contrôle laitier régulier, en particulier lorsqu’on a affaire à des animaux élevés en ranchining. Si le veau est en permanence avec sa mère, où s’il tête matin et soir tout le lait de la mère, on peut avoir une assez bonne estimation de la production laitière en utilisant la formule suivante [MEMENTO DE L’AGRONOMME]:
L4 = 9.18 (P4 – Pn)
L4 : la production laitière en 4 mois, (kg) ;
P4 : poids en 4 mois ;
Pn : poids à la naissance.
Pour des animaux bien nourris, la production journalière maximale peut atteindre 7 à 8 litres.
Délimitation de la zone d’influence
Le premier bénéficiaire de ce projet est donc les villageois riverains de chaque construction. Car à propos de l’irrigation, l’activité ne crée pas seulement du travail pour les gens mais contribue surtout à la croissance et au rendement des cultures. De plus, on connaît tout l’avantage apporté par l’adduction en eau potable dans une région, si on ne parle que de la survie et de la santé de la population. Ensuite, l’électricité est un indicateur de développement régional et la création de moyennes et petites entreprises, éventuellement d’industries (textile, agro-alimentaire, etc…). Donc, ce sera toute la commune qui en bénéficiera mais, même le Fivondronana tout entier sera concerné car les diverses taxes qui vont en découler peuvent être utilisés pour aider les autres communes. En outre, si on observe un peu sur la production d’électricité au niveau de la Province, on connaît les problèmes de ce secteur actuellement. Un projet pareil pourrait résoudre, en partie, ce problème car l’électricité qui alimente cette zone vient d’Antananarivo Renivohitra. Ensuite, d’ici quelques années, à cause de l’explosion démographique à Madagascar, il y aurait certainement un problème d’alimentation en eau potable au niveau des grandes et moyennes agglomérations et donc la construction de réservoirs de ce type résoudrait bien de problèmes. Inondation et ensablement des plaines d’Antananarivo seraient résolus dans la même foulée. Enfin, l’alternative pensant à élever des vaches laitières, dans la région, pourrait être étendue à travers les Hautes Terres Centrales de Madagascar. Une forte augmentation de la production laitière peut être envisagée et l’importation de ce produit diminuera à terme. D’autres imaginent déjà une exportation vers les pays membres du SADEC. Un autre avantage concernerait l’importation de carburants et on peut deviner l’économie en devises que le pays en tirerait. Et tout cela repose, en fait, sur la construction de la centrale hydroélectrique.
CONCLUSION
Nous n’avons pas pu faire l’étude de ce projet sans les visites dans cette région et de la consultation, de l’analyse d’un certain nombre d’ouvrages spécialisés. L’étude s’est basée surtout sur la GIRE et de son impact environnemental. Si nous parlions impact sur le plan social, la GIRE permet d’apporter, aux populations de cette zone, l’eau potable dont ils ont grandement besoin. Nous savions également tous les avantages obtenus à partir de la disponibilité en qualité et en quantité d’eau suffisante : vie, santé, gain de temps, etc…. De même pour la construction de la centrale hydroélectrique, la production d’électricité peut satisfaire toute la zone et voire même plus. L’éclairage public sera désormais possible et donc, la sécurité de la population sera plus assurée. Sur le plan économique, l’eau constitue la base de toute ressource agricole car, non seulement, le rendement de la production augmentera, mais une nouvelle vision de la pratique d’autres types de cultures sera abordée : culture fourragère, culture de contre-saison qui sont vraiment utiles pour l’élevage bovin. Sur le plan environnemental, le paysage retrouvera son image d’antan à travers les plantations de nouveaux arbres, d’arbustes, de cultures fourragères au niveau des zones concernées. En outre, l’étude de ce projet rapporte, globalement, pour la région d’Andramasina des impacts positifs non négligeables tant sur le plan économique qu’environnemental. On a vu également que le taux de rentabilité de 8%, fort intéressant, est inférieur au taux bancaire de 15 % actuellement. Le projet est donc rentable financièrement. Avec une projection, allant en augmentant, du nombre de consommateurs, le projet aura une durée de vie illimitée. En bref, le projet est rentable sur tous les plans et c’est important pour le développement d’Andramasina et du Fivondronana tout entier et voire pour la Nation alors vivement sa réalisation.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : CONTEXTE GENERAL
I Contexte du secteur eau
I.1 Gestion Intégrée de la Ressource en Eau (GIRE)
I.2L’ANDEA
II Contexte de la zone d’étude
II.1Description du milieu récepteur
II.1.1Situation géographique
II.1.2Climat
II.1.3Hydrogéologie
II.1.4Relief
II.1.5Végétation
II.2Les données agro socio-économiques
II.2.1Population
II.2.2Activités économiques
II.2.3Les problèmes socio-économiques
II.2.4 Présentation de la rivière
II.3 Programme et perspective
PARTIE II : CADRE D’ETUDE
I Identification des sites
I.1Travaux intérieurs
I.1.1Etudes géologiques
I.1.2Etudes hydrologiques
I.2Projet en cours
I.2.1Evaluation de besoins en eau
I.2.2Capacités des ressources
I.2.3Adéquation ressource et besoins
II Aménagements des bassins
II.1Définition
II.2Identification
II.3Méthodes
II.3.1Techniques de lutte contre l’érosion
II.3.2Classements des terrains
III Les pâturages
III.1Elevage traditionnel
III.2Amélioration de l’élevage traditionnel
III.3Les pâturages artificiels
III.4 Etude simple sur la production laitière
III.4.1Bâtiments
III.4.2Traitement de lait
III.4.3Contrôle laitier
III.5Etude du revenu annuel
PARTIE III : PROCESSUS DE REALISATION
I Schéma directeur
II Etude de rentabilité du projet
II.1Evaluation du projet
II.1.1L’installation du système A.E.P
II.1.2 La construction des canaux d’irrigation
II.1.3L’installation du système hydroélectrique
II.2Analyse de la rentabilité économique
II.2.1La valeur actuelle nette (VAN)
II.2.2Taux de rentabilité interne (TRI)
II.3 Conclusion partielle
PARTIE IV : ETUDE D’IMPACT DU PROJET
I Délimitation de la zone d’impact du projet
II Délimitation de la zone d’influence
III Les impacts négatifs
III.1.1 Les impacts du projet sur le plan social
III.1.2 Les impacts sur le plan économique
III.1.3 les impacts sur le plan environnemental
IV Les impacts positifs
IV.1.1Les impacts du projet sur le plan social
IV.1.2 Les impacts sur le plan économique
IV.1.3Les impacts sur le plan environnemental
V Méthodologie de l’étude d’impact
V.1.1 Identification des impacts
V.1.2Analyse et évaluation de ces impacts
V.1.3 Etude comparative des impacts
V.1.4Les mesures d’atténuations et ou de compensation
V.1.5Le plan de gestion environnementale du projet
V.1.6Conclusion partielle
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet