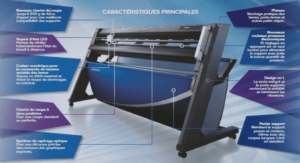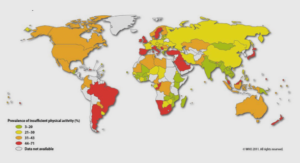Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Le réseau personnel sans fil
Le réseau personnel sans fil, noté WPAN pour Wireless Personal Area Network, concerne les réseaux sans fil d’une faible portée : de l’ordre de quelques dizaines mètres. Ce type de réseau sert généralement à relier des périphériques ou un assistant personnel à un ordinateur sans liaison filaire ou bien à permettre une liaison sans fil entre deux machines très peu distantes. Il existe plusieurs technologies utilisées pour les WPAN :
Bluetooth a été lancé par Ericsson en 1994 et propose un débit théorique de 1 Mbps pour une portée maximale d’une trentaine de mètres. Bluetooth, connue aussi sous le nom IEEE 802.15.1, possède l’avantage d’être très peu gourmande en énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée à une utilisation au sein de petits périphériques.
HomeRF (Home Radio Frequency) a été lancé en 1998 par le HomeRF Working Group et propose un débit théorique de 10 Mbps avec une portée d’environ 50 à 100 mètres sans amplificateur. La norme HomeRF soutenue notamment par Intel, a été abandonnée en Janvier 2003, notamment car les fondeurs de processeurs misent désormais sur les technologies Wi-Fi embarquée (via la technologie Centrino, embarquant au sein d’un même composant un microprocesseur et un adaptateur Wi-Fi).
La technologie ZigBee : elle permet d’obtenir des liaisons sans fil à très bas prix et avec une très faible consommation d’énergie, ce qui la rend particulièrement adaptée pour être directement intégrée dans de petits appareils électroniques. La technologie ZigBee, opérant sur la bande de fréquences des 2,4 GHz et sur 16 canaux, permet d’obtenir des débits pouvant atteindre 250 Kbps avec une portée maximale de 100 mètres environ.
Les liaisons infrarouges permettent de créer des liaisons sans fil de quelques mètres avec des débits pouvant monter à quelques mégabits par seconde. Cette technologie est largement utilisée pour la domotique (télécommandes) mais souffre toutefois des perturbations dues aux interférences lumineuses. L’association IrDA (infrared data association) prenant en charge de la technologie a été formé en 1995 regroupe plus de 150 membres.
UWB (Ultra Wide Band) 802.15.3a : elle offre une connexion sans fil à très haut débit atteignant 100 Mbps pour une distance de 15 m et 1,3 Gbps sur une portée de 1m. Elle occupe une bande de fréquence supérieure à 500 MHz et utilise généralement les bandes de fréquences de 3,1 à 10,6 GHz.
Le réseau local sans fil
Le réseau local sans fil, noté WLAN pour Wireless Local Area Network, est un réseau permettant de couvrir l’équivalent d’un réseau local d’entreprise, soit une portée d’environ quelques centaines de mètres. Il permet de relier entre eux les terminaux présents dans la zone de couverture. Il existe plusieurs technologies concurrentes mais on cite principalement :
Le Wifi ou Wireless Fidelity soutenu par l’alliance WECA offre des débits allant jusqu’à 54 Mbps sur une distance de plusieurs centaines de mètres.
HiperLAN2 (HIgh Performance Radio LAN 2.0), norme européenne élaborée par l’ETSI. Ce réseau permet d’obtenir un débit théorique de 54 Mbps sur une zone d’une centaine de mètres dans la gamme de fréquence comprise entre 5 150 et 5 300 MHz.
Le réseau métropolitain sans fil
Le réseau métropolitain sans fil, WMAN pour Wireless Metropolitan Area Network, est un réseau utilisé dans les campus ou dans les villes c’est-à-dire dans un rayon de quelques dizaines de kilomètres. C’est un type de boucle local radio qui permet une liaison sans fil. Il regroupe également les technologies permettant à un particulier ou une entreprise de s’interconnecter via les ondes radios. Parmi ces technologies, on peut citer :
LMDS (Local Multipoint Distribution Service) : technique d’accès large bande par onde radio qui utilise les fréquences situés entre 26 GHz et 29 GHz. Il est principalement destiné à des utilisations de type point à multipoint ou de liaisons point à point sur des distances pouvant atteindre 8 km.
MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) : c’est un système de diffusion de la télévision par un émetteur terrestre qui fonctionne dans la bande de fréquences de 2,5 et 3,5 GHz. Les signaux sont analogiques en modulation de fréquence ou en modulation d’amplitude.
Wimax (Worldwide Interoperability for Microwave Access) : ce standard utilise une bande de fréquence de 2 à 11 GHz et permet un débit de 70 Mbps sur un rayon de 50 km maximum.
La norme Wimax mobile devrait permettre des services comme la communication VoIP sur téléphones portables ou encore l’accès à des services mobiles à haut débit.
Le réseau régional sans fil
Les réseaux régionaux sans fils font l’objet de la norme IEEE 802.22. Ils occupent les fréquences de la bande réservée à la diffusion de la télévision interactive comprise entre 54 MHz et 862 MHz. L’originalité de ces réseaux porte sur la capacité de ses équipements à utiliser de façons dynamiques les bandes de fréquences inoccupées. La vitesse de transmission atteint 18 Mbps sur des canaux de 6 MHz. Cette technologie utilise l’OFDM et assure la qualité de service au niveau de la couche MAC. La portée peut atteindre une cinquantaine de km et un point d’accès peut interconnecter 30000 utilisateurs.
L’architecture de la technologie
La figure 2.04 suivante illustre la pile caractéristique de la technologie Bluetooth. On peut observer, depuis la partie basse la pile, les couches bas niveau propres à la technologie, la couche de transmission simple de données, les couches de communication avec la téléphonie, les couches des protocoles adoptés et les couches des applications de haut niveau.
Les couches propres à Bluetooth La couche Radio
Cette couche opère dans la bande ISM autour de 2.4 GHz et utilise l’étalement de spectre comme type de communication. La bande s’étend de 2400 à 2483.5 Mhz dans la majorité des pays pour optimiser l’étalement de spectre. Cette bande est divisée en canaux de 1 Mhz soit 79 canaux au total. Pour transmettre des données, la technologie Bluetooth utilise le FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum). Puisqu’on travaille dans une bande de fréquence libre, d’autres technologies peuvent causer des interférences, on utilise alors de petits paquets de données et des sauts de fréquence rapides. En effet, le principe du FHSS est la commutation rapide entre plusieurs canaux de fréquence, utilisant un ordre pseudo aléatoire connu tant à l’émetteur qu’au récepteur pour la synchronisation.
L’utilisation de FHSS dans Bluetooth permet :
Une synchronisation parfaite entre l’émetteur et le récepteur car ils sont obligés d’utiliser la même séquence de sauts pour communiquer.
D’émettre à plusieurs simultanément.
De limiter les interférences.
Le débit nominal de saut est de 1600 sauts par seconde c’est-à-dire 625 μs par slot de communication. La modulation utilisée est le GFSK acronyme de Gaussian Frequency Shift Keying.
La couche bande de base
La couche bande de base contrôle la couche radio. Les sauts de fréquences sont gérés par cette couche. Cette couche prend en charge aussi de la sécurité dans les mécanismes bas niveau. Tous les paquets qui circulent dans les réseaux Bluetooth est en provenance de la couche bande de base. La couche bande de base peut gérer deux types liaisons : le SCO et le ACL.
SCO ou Synchronous Connection Oriented : ce type de connexion permet une transmission bidirectionnelle. Une connexion SCO fonctionne en temps réel, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de retransmission possible. C’est ce type de connexion qui est utilisé pour la transmission de la voix. Bluetooth utilise dans ce cas des créneaux réservés afin de réduire au maximum le délai. Il est alors possible d’atteindre un débit de 64Kbps, sachant qu’un maître peut gérer jusqu’à 3 liens de ce type.
ACL ou Asynchonous Connection Less : C’est ce type de connexion est utilisé pour l’échange de données. Avec les connexions ACL, il est possible d’effectuer un multicast et d’obtenir des débits de 723.2 Kbps en sortie et un débit de 57.6 Kbps en entrée.
La couche bande de base fournit aux appareils les fonctionnalités nécessaire pour synchroniser leurs horloges et établir des connexions. Les procédures de découvertes des adresses des appareils sont aussi gérées par cette couche.
La couche de contrôle des liens logiques et protocoles d’adaptation
C’est la couche avec laquelle la plupart des applications interagissent avant l’intervention d’un contrôleur d’hôtes. Cette couche définit le multiplexeur de service et de protocole, appelé en anglais PSM (Protocol and Service Multiplexer), pour chaque type d’utilisation.
Les principales fonctions de cette couche sont :
Multiplexage : ce protocole permet aux diverses applications d’utiliser la liaison entre deux appareils simultanément.
Segmentation et réassemblage : ce protocole réduit la taille des paquets en provenance de divers applications selon la taille de paquets supportée par la couche bande de base. Elle effectue aussi l’opération inverse c’est-à-dire la reconstitution des paquets.
Qualité de service : L2CAP permet aux applications de faire des requêtes de qualité de service comme la largeur de bande, le temps de latence et la variation des durées de communication. Il est dans ses rôles de vérifier si les liaisons établies supportent cette fonctionnalité et de les mettre en oeuvre si c’est possible.
La couche de protocole de découverte de service
Le SDP, Service Discovery Protocol, est une base de données disponible dans les périphériques Bluetooth (pas tous, ceci n’est pas obligatoire) à l’intérieure de laquelle on trouve tous les détails concernant le périphérique, ses fonctions et comment s’y connecter. Cette base de données contient une liste de services et à chaque service sont attribuées des informations de configuration et de connexion. Lorsqu’un périphérique fait une recherche sur le réseau, il peut effectuer une requête SDP sur les périphériques à découverts pour examiner si ceux-ci sont compatibles avec la fonction désirée (téléphonie, imprimante, échange de données…). Il est important de noter qu’une découverte SDP se fait au-dessus d’une connexion L2CAP, via le PSM 1. Cela signifie qu’une connexion L2CAP supplémentaire est nécessaire pour découvrir les services disponibles. Celle-ci sera suivie d’une autre connexion L2CAP, cette fois-ci sur le PSM adéquat.
La machine Virtuelle de Dalvik DVM
C’est une machine virtuelle de base avec une mémoire extrêmement petite. Elle a été conçue spécialement pour les systèmes embarqués Android et à travailler dans des situations à faible consommation. La DVM exécute des codes avec l’extension .dex (Dalvik executable) qui est l’équivalent des codes en .class de la machine virtuelle Java classique.
Le graphisme
Grâce à des bibliothèques graphiques 2D et 3D basés sur OpenGL ES 1.0, il est possible qu’avec Android on puisse avoir de jolies applications comme Google Earth et des jeux spectaculaires comme Second Life.
La base de données SQLite
C’est une base de données relationnelle extrêmement petite, de l’ordre de 500 ko, qui est intégré dans les systèmes Android. Sa simplicité la rend plus facile d’usage pour les plateformes comme Android.
La disposition graphique maniable
La plateforme peut s’adapter avec toutes les dimensions d’écran, le VGA, les bibliothèques graphiques cités précédemment et les dispositions d’affichage des Smartphones traditionnels. Un moteur graphique 2D est aussi inclus. L’accès au sous-système et aux couches composites 2D ou 3D est géré par une bibliothèque spécifique.
Les connectivités
Le système Android supporte une grande variété de technologie incluant le GSM, le GPRS, l’EDGE le CDMA, l’UMTS, l’HSDPA, l’HSUPA, l’EVDO, le LTE, le Bluetooth et le Wifi.
|
Table des matières
CHAPITRE 1 LES RESEAUX SANS FILS
1.1 Introduction
1.2 La propagation des ondes radios
1.2.1 Les phénomènes à petite échelle
1.2.2 Les phénomènes à grande échelle
1.3 Les catégories de réseaux sans fils
1.3.1 Le réseau personnel sans fil
1.3.2 Le réseau local sans fil
1.3.3 Le réseau métropolitain sans fil
1.3.4 Le réseau régional sans fil
1.3.5 Le réseau étendu sans fil
1.4 Les services dans les réseaux sans fils
1.4.1 La téléphonie
1.4.2 Les messageries
1.4.3 Autres services
1.5 Avantages et inconvénients des réseaux sans fils
1.5.1 Les avantages du réseau sans fil
1.5.2 Les inconvénients du réseau sans fil
1.6 Conclusion
CHAPITRE 2 LA TECHNOLOGIE BLUETOOTH
2.1 Introduction
2.2 Cas d’utilisations
2.3 Les types de réseaux
2.3.1 Le pico-réseau
2.3.2 L’inter-réseau
2.4 L’architecture de la technologie
2.4.1 Les couches propres à Bluetooth
2.4.2 Les couches des protocoles adoptés
2.4.3 Le RFCOMM
2.4.4 Les couches des protocoles spéciaux
2.5 Gestion des communications
2.5.1 Les différents types d’adresses
2.5.2 Format du paquet Bluetooth
2.5.3 Illustration des communications
2.6 Caractéristiques
2.7 Conclusion
CHAPITRE 3 LE SYSTEME ANDROID
3.1 Introduction
3.2 Les Smartphones
3.3 Les versions d’Android
3.4 Architecture du système Android
3.5 Les caractéristiques d’Android
3.5.1 Le framework
3.5.2 La machine Virtuelle de Dalvik DVM
3.5.3 Le graphisme
3.5.4 La base de données SQLite
3.5.5 La disposition graphique maniable
3.5.6 Les connectivités
3.5.7 La messagerie
3.5.8 Le navigateur Web
3.5.9 Le multimédia
3.5.10 Les matériels
3.6 Le développement d’application
3.6.1 La structure d’une application Android
3.6.2 L’interface de programmation pour les interfaces utilisateurs
3.6.3 L’interface de programmation pour les graphismes et les animations
3.6.4 L’interface de programmation pour le stockage de données
3.6.5 L’interface de programmation pour les connectivités
3.6.6 L’interface de programmation pour le multimédia
3.6.7 L’interface de programmation pour la localisation et les capteurs
3.7 Conclusion
CHAPITRE 4 REALISATION D’UNE APPLICATION DE MESSAGERIE
4.1 Introduction
4.2 Le module d’extension ADT d’eclipse
4.3 Fonctionnement de l’ADT
4.3.1 L’installation du module :
4.3.2 L’espace de travail
4.4 Description de l’application de messagerie somesoBT
4.4.1 A propos de somesoBT
4.4.2 Le fonctionnement de l’application
4.5 L’application réalisée
4.5.1 Présentation et illustration
4.5.2 Contraintes pendant la réalisation
4.6 Conclusion
CONCLUSION GENERALE
ANNEXE 1 LE LANGAGE JAVA
ANNEXE 2 EXTRAITS CODE SOURCE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet