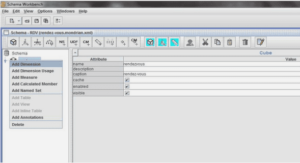Généralités sur les réseaux mobiles
L’usage des services de communications mobiles a connu un essor remarquable, ces dernières années. A la fin de l’année 2012, on compte environ 6.4 milliards d’abonnés à travers le monde et en 2013 6,84 milliards. C’est véritablement un nouveau secteur de l’industrie mondiale qui s’est créé, regroupant notamment constructeurs de circuits électroniques, de terminaux mobiles, d’infrastructures de réseaux, développeurs d’applications et de services et opérateurs de réseaux mobiles. [1] [2] Concernant les réseaux mobiles, les réseaux de la 1ère génération ont été intégrés au réseau de télécommunication dans les années 80. Ces systèmes ont cependant été abandonnés il y a quelques années laissant la place à la seconde génération, appelée 2G lancée en 1991.Elle est encore active de nos jours. Nous pouvons distinguer deux autres types de générations au sein même de la seconde : la 2.5G, ou GPRS (Global Packet Radio Service) et la 2.75 ou aussi appelée EDGE (Enhanced Data rate for GSM Evolution). Le principal standard utilisant la 2G est GSM. A la différence de la 1G, la seconde génération de normes permet d’accéder à divers services, comme l’accès à Internet. Tandis que pour la 3èmegénération, elle permet un haut débit pour l’accès à l’internet et le transfert de données. Cette dernière connait deux évolutions à son sein qui sont la 3,5G ou 3G+ ou encore Super 3G, aussi appelée HSPA (High Speed Packet Access) et la 3,9 G connu sous le nom de LTE. En ce qui concerne la nouvelle génération 4G (LTE Advanced), elle n’est déployée jusque-là que par quelques pays. Cependant, le réseau LTE permet déjà un très haut débit, une moindre latence et beaucoup d’autres services que l’on verra dans la suite.
Architecture générale d’un réseau mobile
L’architecture d’un réseau mobile inclut trois entités fonctionnelles :
❖ le terminal mobile, appelé aussi équipement utilisateur (ou usager), abrégé en UE (User Equipment) ;
❖ le réseau d’accès ou RAN (Radio Access Network) ;
❖ le réseau cœur ou CN (Core Network).
On distingue également deux domaines :
❖ le domaine de l’UE, qui inclut les équipements propres à l’utilisateur ;
❖ le domaine de l’infrastructure, constitué des équipements propres à l’opérateur.
En effet, l’histoire des réseaux mobiles est jalonnée par quatre, et bientôt cinq, étapes principales auxquelles on donne couramment le nom de génération. Ce sont donc ces trois entités, ou encore ces deux domaines qui seront mise en exergue durant l’étude de l’évolution de ces générations.
La première génération de téléphonie mobile
La première génération de téléphonie mobile (notée 1G) possédait un fonctionnement analogique et était constituée d’appareils relativement volumineux.
Il s’agissait principalement des standards suivants [1] [3]:
➤ AMPS (Advanced Mobile Phone System), apparu en 1976 aux Etats-Unis, constitue le premier standard de réseau cellulaire. Utilisé principalement Outre Atlantique, en Russie et en Asie, ce réseau analogique de première génération possédait de faibles mécanismes de sécurité rendant possible le piratage de lignes téléphoniques ;
➤ TACS (Total Access Communication System) est la version européenne du modèle AMPS. Utilisant la bande de fréquence de 900 MHz, ce système fut notamment largement utilisé en Angleterre, puis en Asie (Hong-Kong et Japon) ;
➤ ETACS (Extended Total Access Communication System) est une version améliorée du standard TACS développé au Royaume-Uni utilisant un nombre plus important de canaux de communication ;
➤ NMT (Nordic Mobile Telephone) dans les pays scandinaves ;
➤ Radiocom2000 en France ;
➤ C-NETZ en Allemagne.
Ces systèmes devaient offrir un service de téléphonie en mobilité. Ils ne parvinrent pas à réellement franchir les frontières de leurs pays d’origine et aucun système ne s’imposa en tant que véritable norme internationale. D’un point de vue technique, ces systèmes étaient basés sur un codage et une modulation de type analogique. Ils utilisaient une technique d’accès multiples appelée FDMA (Frequency Division Multiplex Access), associant une fréquence à un utilisateur. La capacité de ces systèmes demeurait très limitée, de l’ordre de quelques appels voix simultanés par cellule. Cette contrainte de capacité, ainsi que les coûts élevés des terminaux et des tarifs de communication ont restreint l’utilisation de la 1G à un très faible nombre d’utilisateurs (60 000 utilisateurs de Radiocom2000 en 1988 en France). Par ailleurs, les dimensions importantes des terminaux limitaient significativement leur portabilité [1]. Les réseaux cellulaires de première génération ont été rendus obsolètes avec l’apparition d’une seconde génération entièrement numérique.
La deuxième génération de la téléphonie mobile
La seconde génération de réseaux mobiles (notée 2G) a marqué une rupture avec la première génération de téléphones cellulaires grâce au passage de l’analogique vers le numérique qui permet ainsi une sécurisation des données (avec cryptage).
Le réseau GSM
GSM est le standard utilisant les bandes de fréquence 900 MHz et 1800 MHz en Europe. Grâce à ce dernier, il est possible de transmettre la voix ainsi que des données numériques de faible volume, notamment des messages textes (SMS, pour Short Message Service) ou encore des messages multimédias (MMS, pour Multimedia Message Service). La norme GSM permet un débit maximal de 9,6 kbps.
Le réseau GSM est composé de la partie BSS (Base Station Sub-system) qui est un sous-système de l’architecture GSM et qui assure les transmissions radioélectriques et gère les ressources radio; elle est composée des stations mobiles, des BTS (Base Transceiver Station)et des BSC (Base Station Controller) qui contrôlent un ensemble de BTS et permettent une première concentration des circuits. Le réseau est aussi composé de la partie NSS (Network Sub System) composée des MSC (Mobile Switching Center), VLR (Visitor Location Register), HLR (Home Location Register) ainsi que de l’Auc (AUthentification Center). Cependant, des extensions de la norme GSM ont été mises au point afin d’en améliorer le débit. C’est le cas notamment du standard GPRS (General Packet Radio System).
Le réseau GPRS
Le GPRS est une extension du protocole GSM : il ajoute par rapport à ce dernier la transmission par paquets. Cette méthode est plus adaptée à la transmission des données. En effet, les ressources ne sont allouées que lorsque des données sont échangées, contrairement au mode « circuit » en GSM où un circuit est établi, ainsi que les ressources associées, pour toute la durée de la communication. Le standard GPRS permet alors d’obtenir un débit théorique maximal de l’ordre de 171,2 kbit/s, plus proche de 50 kbit/s dans la réalité. Cette technologie ne rentrant pas dans le cadre de l’appellation « 3G » a été baptisée 2.5G.
Son architecture ajoute à celle du GSM, le SGSN (Serving GPRS Support Node), routeur permettant de gérer les coordonnées des terminaux de la zone et de réaliser l’interface de transit des paquets avec la passerelle GGSN (Gateway GPRS Support Node), qui est une passerelle s’interfaçant avec les autres réseaux de données (internet). Le GGSN est notamment chargé de fournir une adresse IP aux terminaux mobiles pendant toute la durée de la connexion.
Le réseau EDGE
La norme EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) présentée comme 2.75G quadruple les améliorations du débit de la norme GPRS en annonçant un débit théorique de 384 Kbps, ouvrant ainsi la porte aux applications multimédias. En réalité la norme EDGE permet d’atteindre des débits maximum théoriques de 473 kbit/s, mais elle a été limitée afin de se conformer aux spécifications IMT-2000 (International Mobile Telecommunications-2000) de l’ITU (International Telecommunications Union).
La troisième génération de la téléphonie mobile
Les spécifications IMT-2000 de l’ITU définissent les caractéristiques de la 3G.
Ces caractéristiques sont notamment les suivantes :
➤ un haut débit de transmission : 144 Kbps avec une couverture totale pour une utilisation mobile, 384 Kbps avec une couverture moyenne pour une utilisation piétonne, 2 Mbps avec une zone de couverture réduite pour une utilisation fixe.
➤ compatibilité mondiale
➤ compatibilité des services mobiles de 3ème génération avec les réseaux de seconde génération.
La 3G propose d’atteindre des débits supérieurs à 144 kbit/s, ouvrant ainsi la porte à des usages multimédias tels que la transmission de vidéo, la visioconférence ou l’accès à internet haut débit.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITRE 1 EVOLUTION DES GENERATIONS DE RESEAUX
1.1 Introduction
1.2 Généralités sur les réseaux mobiles
1.3 Architecture générale d’un réseau mobile
1.4 La première génération de téléphonie mobile
1.5 La deuxième génération de la téléphonie mobile (2G)
1.5.1 Le réseau GSM
1.5.2 Le réseau GPRS
1.5.3 Le réseau EDGE
1.6 La troisième génération de la téléphonie mobile (3G)
1.6.1 Le réseau UMTS
1.6.1.1 L’équipement utilisateur
1.6.1.2 Le sous-système radio RNS (Radio Network Subsystem)
1.6.1.3 Le réseau cœur (UMTS Core Network)
1.6.1.4 Les fréquences utilisées en UMTS
1.6.1.5 Le débit de l’UMTS
1.6.1.6 Technologies utilisées en UMTS
1.6.2 Les évolutions HSPA
1.6.3 Les évolutions HSPA+
1.7 Une avancée vers le LTE
1.7.1 Architecture du réseau LTE
1.7.1.1 Le réseau core EPC
1.7.1.2 Le réseau d’accès e-UTRAN
1.7.2 Capacité
1.7.3 Les débits
1.7.4 La latence
1.7.5 L’adaptation au spectre disponible
1.7.6 Les catégories d’UE d’un système LTE
1.8 Conclusion
CHAPITRE 2 LE RESEAU D’ACCES DE L’UMTS
2.1 Introduction
2.2 Mécanismes de propagation
2.3 Les types d’interférences
2.4 Caractéristiques du canal radio
2.4.1 La sélectivité en fréquence
2.4.1.1 Etalement multivoie
2.4.1.2 Bande de cohérence
2.4.1.3 Canaux sélectifs en fréquence
2.4.1.4 Canaux non sélectifs en fréquence
2.4.2 Canal à évanouissement rapide et à évanouissement lent
2.4.2.1 Etalement Doppler
2.4.2.2 Temps de cohérence
2.4.2.3 Canal à évanouissement rapide
2.4.2.4 Canal à évanouissement lent
2.5 La notion de diversité
2.6 Les modes de duplexage
2.7 Le réseau d’accès UMTS
2.7.1 La structure en couches du réseau
2.7.2 Les protocoles de l’interface radio
2.7.3 Les canaux
2.7.3.1 Les canaux logiques du système UMTS
2.7.3.2 Les canaux de transport du système UMTS
2.7.3.3 Les canaux physiques du système UMTS
2.7.4 Description de l’UTRAN
2.7.4.1 Le CDMA
2.7.4.2 Le concept W-CDMA
2.7.4.3 Le concept TD/CDMA
2.7.4.4 Comparaison entre le mode FDD WCDMA et TDD TD/CDMA
2.8 Les catégories d’UE d’un système UMTS
2.9 Conclusion
CHAPITRE 3 LE RESEAU D’ACCES DU LTE
3.1 Introduction
3.2 Structure de trame de l’interface radio
3.3 Principes de l’OFDM
3.3.1 La modulation OFDM
3.3.2 Le préfixe cyclique
3.3.3 La démodulation OFDM
3.4 L’OFDMA
3.5 La modulation SC-FDMA
3.6 La dimension fréquentielle en LTE
3.7 Les canaux
3.7.1 Les canaux logiques
3.7.2 Les canaux de transport
3.7.3 Les canaux physiques
3.7.4 Association des différents canaux
3.8 Techniques MIMO
3.9 Capacité en LTE
3.10 Ordonnancements en LTE
3.10.1 Algorithmes d’ordonnancement en downlink
3.10.1.1 Les algorithmes opportunistes
3.10.1.2 Les algorithmes équitables
3.10.1.3 Algorithmes considérant les délais
3.10.1.4 Algorithmes optimisant le débit
3.10.1.5 Les algorithmes multi-classe
3.10.2 Algorithmes d’ordonnancement en uplink
3.10.2.1 Ordonnanceurs de flux best effort
3.10.2.2 Ordonnanceurs considérant la QoS
3.10.2.3 Ordonnanceurs traitant la puissance du signal
3.11 Conclusion
CHAPITRE 4 HANDOVER ENTRE UMTS ET LTE
4.1 Introduction
4.2 Les mécanismes de mobilité en mode connecté
4.3 Généralités sur le handover
4.3.1 Les différents types de handover
4.3.2 Les différentes phases d’un handover
4.3.3 Le rôle de l’UE dans un handover
4.4 Le handover LTE vers UMTS
4.4.1 Mécanismes de Direct Forwarding et de Direct Tunnel
4.4.2 Procédure du handover en mode paquet
4.4.2.1 Les mesures
4.4.2.2 La préparation du handover
4.4.2.3 L’exécution du handover
4.5 Le handover UMTS vers LTE
4.5.1 Procédure du handover
4.5.1.1 Les mesures LTE
4.5.1.2 La préparation
4.5.1.3 L’execution du handover
4.6 Critères du handover
4.6.1 Puissance recue
4.6.2 Le délai
4.6.3 Echec du handover
4.6.3.1 Handover LTE vers UMTS
4.6.3.2 Handover UMTS vers LTE
4.7 Conclusion
CONCLUSION GENERALE