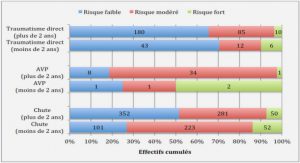Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
CONTEXTE GEOLOGIQUE
L’émergence de l’île de la Grande Comore est considérée comme récente, tant à l’échelle géologique des temps, qu’au niveau des îles de l’Archipel car elle a émergé, il y a 2 millions d’années, après Mayotte, Anjouan et Mohéli. Son origine serait due à la succession de plusieurs phases volcaniques (phases supérieure, intermédiaire et inférieure), séparées par des phases de repos et d’altération et associées à une remontée de la croûte (PAVLOVSKY et de SAINT OURS, 1953).
Généralités sur le volcanisme de la Grande Comore
Définition
Un volcan est un relief formé à la suite de l’éjection et de l’empilement de matériaux issus du manteau terrestre (laves, cendres,…). Il peut être terrestre ou sous-marin et prend en général une forme conique couronnée par un cratère. En réalité, c’est un appareil naturel qui fait communiquer les entrailles de la terre (le manteau) à la surface, et c’est grâce à lui que circule le magma (www.bbc.co.uk/schools/gcsebitesize, 2015).
Caractéristiques
Un volcan est formé de différentes structures caractéristiques :
Une chambre magmatique située entre 10 et 50 km sous la croûte terrestre et alimentée par le magma du manteau.
Un cratère où débouche la cheminée principale et passe la plupart du magma pendant l’éruption.
Une cheminée principale où transite le magma. Elle est située entre la chambre magmatique et le cratère et peut mesurer jusqu’à 10 km.
Des cheminées secondaires situées entre la chambre magmatique et les flancs du volcan, qui peuvent donner naissance à des cônes secondaires par où sort une partie du magma.
Types de volcans
Il existe deux (02) grands types de volcans :
-Les volcans effusifs ou volcans rouges : caractérisés par des éruptions calmes, des émissions de laves fluides sous forme de coulées. Ils sont souvent situés sur une dorsale océanique ou sur un point chaud.
Exemples : volcanisme hawaïen, volcanisme strombolien
-Les volcans explosifs ou volcans gris : caractérisés par des éruptions très violentes, des émissions de laves pâteuses, de nuées ardentes, de matériaux solides et de panaches volcaniques. Ils sont souvent situés sur une zone de subduction. (www.volcanisme.explosif.free.fr/Généralités.htm, 2015)
Exemple : volcanisme vulcanien
Nous allons maintenant donner quelques précisions sur le volcanisme de la Grande Comore. Les trois (03) entités volcaniques du Sud au Nord telles que Mbadjini, Karthala et Grille sont considérées respectivement comme types vulcanien, hawaïen et strombolien.
Type vulcanien
C’est un volcan explosif dont le nom provient du volcan Sicilien « vulcano ». Pour ce type, les laves basaltiques s’écoulent plus difficilement car elles sont plus riches en silice et leur dégazage est moins aisé.
Le massif de Mbadjini, au Sud-Est, qui date d’une phase plus ancienne (Miocène) correspond à ce dynamisme. On y trouve des terrains qui sont fortement altérés en sols ferralitiques et argileux.
Type hawaïen
C’est un type défini d’après les éruptions historiques des volcans boucliers laviques du Kilauea et du Mauana Laua, tous deux situés sur l’ile d’Hawaï, dans l’archipel du Pacifique. Ces boucliers-volcans sont caractérisés par l’émission de magmas basaltiques très fluides et ils sont essentiellement constitués par un empilement de coulées. Ce qui caractérise le mieux l’éruption hawaïenne est l’émission de basaltes fluides par des évents situés à l’intérieur de la caldera sommitale ou par des fissures qui s’ouvrent progressivement du haut vers le bas (zones de rift) sur les flancs externes du volcan (CLERMONT-FERRAND, 1985).
Le massif du Karthala occupant la presque totalité de l’île est recouvert d’un entassement épais de coulées de laves récentes (supérieur), correspondant à ce type de volcan.
Les formations les plus caractéristiques y paraissent les coulées à scories et à dalles, les nappes minces de projections volcaniques ainsi que les cônes adventifs de projection (PHILIPPE B. B., 1993).
Type strombolien
C’est un type défini d’après l’activité persistante historique du STROMBOLI, modérément explosive, caractérisée par l’éjection rythmique de scories (lapilli, bombes, cendres). La lave refroidit rapidement près du sommet, c’est pourquoi les flancs sont très abrupts. Le magma incandescent atteint dans la cheminée un niveau suffisamment élevé pour que les bouffées gazeuses entrainent des lambeaux de lave qu’elles projettent au-dessus du cratère. Ces lambeaux se figent lors de leur trajectoire et passent à l’état de scories noires, boursouflées et bulleuses capables de se briser lors de la retombée au sol (CLERMONT-FERRAND, 1985).
Ce volcanisme strombolien, bien développé dans le massif de la Grille (au Nord de l’île), est présenté sous forme de cônes de scories ayant parfois la forme d’anciens cratères. Ces formations sont constituées d’éléments très vacuolaires et plus ou moins consolidés (lapilli, cendres, scories) (PHILIPPE B. B., 1993).
La phase volcanique inférieure, la plus ancienne, n’a été mise en évidence que dans la partie sud de l’ile. Les laves de la phase intermédiaire ont été mises en évidences dans le massif de Mbadjini où elles recouvrent les formations de la phase inférieure ainsi que dans la partie Nord de l’ile (PHILIPPE B. B., 1993).
Les laves de la phase inférieure, fréquemment altérées, sont des laves porphyriques mélanocrates (ankaramites, ankaratrites basanitiques). Les laves de la phase volcanique supérieure caractérisent les roches compactes ou vacuolaires gris noirâtre ou gris fer, surtout des basaltes andésitiques, basaltes labradoriques, basanitoides et limburgites (SAÏD HASSANI M. et SAÏD AHMED O., 2006).
La figure 6 ci-dessous montre que Ngazidja est une île essentiellement basaltique. Les massifs de la Grille et du Karthala sont peu couverts des pouzzolanes (roche volcanique siliceuse, à structure alvéolaire). L’île est affectée par trois systèmes de fracturation de direction : NO-SE, NE-SO, N-S.
Figure 6 : Carte géologique de la Grande Comore (Source : PATRICK et AL, 1993)
CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
Du fait de la jeunesse du relief, de la perméabilité importante des sols volcaniques, liée à une fissuration importante de la roche, le réseau hydrographique permanent en Grande Comore est très faible. Il n’existe pas de ruissellement superficiel qu’exceptionnellement, lors de très forts orages ou de cyclones et des intenses pluviosités (ABDOULKARIM A. et SOULET H., Janvier 2011).
CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
Les conditions hydrogéologiques de la Grande Comore sont classées dans le domaine dit du milieu volcanique insulaire. En effet, un milieu volcanique insulaire est dû à un magmatisme associé aux zones de subduction dans lesquelles deux plaques océaniques entrent en collision (RAPPORT COLLOQUE INTERNATIONAL SUR LE KARTHALA, Novembre 2008). Des travaux réalisés dans les années 80 et 90 par le Bureau de Recherches Géologique et Minière(BRGM) et la Direction de la Coopération Technique pour le Développement (DCTD) ont montré l’existence de deux catégories des nappes dont la nappe de base et la nappe perchée (IBRAHIM A. K., 2009). Ces nappes perchées et de base constituent les principales cibles pendant l’intervention géophysique.
Nappes de base (ou nappes du littoral)
Du fait des perméabilités extrêmement élevées des roches basaltiques et de l’existence des chemins d’écoulement souterrains complexes et influencés par l’hétérogénéité importante des terrains, l’eau infiltrée ne rencontre pas d’obstacles au cours de sa projection verticale. Cette eau rejoint le niveau zéro de la mer pour constituer la nappe de base dont la surface de contact entre eau douce et eau de mer forme le biseau salé. (IBRAHIM A. K., Septembre 2009). Les aquifères supportant cette nappe de base exploitée sur le littoral de la Grande Comore sont constitués essentiellement de blocs de basaltes scoriacés et vacuolaires parfois en dalles.
Sa profondeur varie selon l’altitude et elle constitue une source importante d’alimentation en eau potable dans de nombreux villages côtiers de Grande Comore. Mais le problème majeur de leur exploitation reste l’intrusion marine qui peut entrainer l’augmentation de la minéralisation de l’eau douce. En d’autres termes, le niveau moyen de la nappe à 1 km de la côte n’est que de 30 cm au dessus du niveau moyen de la mer. Les variations des niveaux de la mer (marées) pouvant être de l’ordre de 3 à 4 m, la nappe est mise en charge par la mer à chaque marée et cela induit une pénétration d’eau salée (L. JEAN-LOUIS et S. SYLVIANE, Février 2011). Ce système dynamique entraine une zone de mélange eau douce-eau salée (eau saumâtre) très développée et une interface eau douce-eau salée diffusée et progressive.
Plusieurs facteurs peuvent influencer la salinité de l’eau des puits côtiers :
− la distance du puits à la mer
− la perméabilité des roches aquifères
− la recharge de l’aquifère en relation avec la pluviométrie
− la présence d’écoulements préférentiels d’eau douce (fractures des roches, dykes, failles…)
Des études réalisées dans les années 80 dans le cadre des projets de la Commission de l’Océan Indien (COI) pour la construction et l’exploitation des puits côtiers en Grande Comore, ont montré que la distance du puits à la mer constitue en général le facteur le plus dominant.
Nappes perchées (ou nappes d’altitudes)
Il s’agit des nappes peu puissantes c’est-à-dire des nappes à faibles débits formées sur les couches argileuses issues de l’altération des basaltes anciens et au sein des formations pyroclastiques possédant souvent des croûtes argileuses, des cendres volcaniques altérées au Nord du massif de la Grille et dans le massif de Mbadjini (JEAN-LOUIS L. et SYLVIANE S., Février 2011).
L’exploitation de nappes perchées présenterait des avantages importants par rapport à l’exploitation de la nappe de base :
−les nappes perchées sont à l’abri de toute pollution marine
− l’eau exploitée de ces nappes peut être distribuée par système gravitaire
Mais seules six sources ont été recensées et aménagées par l’Organisation des Nations Unis (ONU) à la fin des années 80 dont la variation du débit de ces sources, de l’ordre de 3 à 4 m3/ jour en saison sèche, et de 30 à 100 m3/ jour en saison des pluies (cf. tableau ci-dessous), témoigne du faible volume d’eau de réserve de ces nappes perchées, superficielles. Toutes ces sources fournissent une eau peu minéralisée du fait de temps de transit faibles dans des roches volcaniques (230 µS/cm mesuré à la source Bondé) (JEAN-LOUIS L. et SYLVIANE S., Février 2011).
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE I : GENERALITES SUR LA ZONE D’ETUDE
I-1 : CADRE GEOGRAPHIQUE
I-2 : CONTEXTE CLIMATIQUE
? Vents
? Pluviométrie
? Température
I-3 : CONTEXTE GEOLOGIQUE
I-3-1 : Généralités sur le volcanisme de la Grande Comore
I-4 : CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE
I-5 : CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
? Nappes de base (ou nappes du littoral)
? Nappes perchées (ou nappes d’altitudes)
CHAPITRE II : RAPPELS METHODOLOGIQUES ET MATERIELS UTILISES
II-1: GENERALITES SUR LES AQUIFERES EN MILIEU VOLCANIQUE
II-1-2 : Types des nappes en milieu volcanique
II-1-3 : Recharge des nappes aquifères
II-2 : METHODES DE PROSPECTION GEOPHYSIQUE DE SUBSURFACE ET ACQUISITION DE DONNEES
II-2-1: METHODE ELECTROMAGNETIQUE TEMPORELLE ou TDEM (Time Domain Electromagnetic)
II-2-2 : METHODE ELECTRIQUE
II-3 : INTERPRETATION ET TRAITEMENT DE DONNEES
II-3-1 : Sondage TDEM
II-3-2 : Sondage électrique
II-3-3 : Panneau électrique
CHAPITRE III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS DES DONNEES DE RESISTIVITE
III-1 : TECHNIQUE DE MESURE SUR TERRAIN
III-2 : CALAGE D’INTERPRETATION
III-3 : RESULTATS ET INTERPRETATION DE PROSPECTION GEOPHYSIQUE
? Secteur I : MALE
? Secteur II : DZHADJOU
? Secteur III : INANE
? Secteur IV : MIDJENDJENI
III- 4 : SYNTHESE DES RESULTATS
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES ET WEBOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet