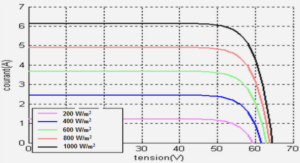Généralités sur l’eau et la pollution des eaux souterraines
Définitions
Quelques définitions des termes clés utilisés dans ce travail sont nécessaires pour la compréhension.
– Pollution de l’eau : il s’agit de la dégradation de la qualité de l’eau par l’introduction dans l’eau de substances extérieures (physiques, chimiques ou biologiques) en grande quantité qui la rend nuisible à la consommation. [13]
– Eau potable : une eau potable est une eau claire, de bonne odeur, de bon goût et exempte de produits toxiques que l’on peut boire et utiliser pour la cuisson sans nuire à la santé .
Sources de pollution des eaux souterraines
En général, les eaux souterraines sont naturellement propres mais l’activité des hommes les pollue. Presque toutes les activités humaines entrainent la pollution de l’eau. Il s’agit des facteurs de pollution de l’eau qui se trouvent à proximité et en amont des puits, à savoir :
– Les fosses d’aisance ;
– Les ordures et les fumiers ;
– Les bassins ;
– Les effluents des douches ;
– L’élevage (bétail, volailles) ;
– Les cimetières.
Ces sources de pollution sont classées par catégories, les sources naturelles, les sources agricoles, les sources industrielles et les sources résidentielles.
Sources naturelles
L’eau souterraine contient des sources de pollution naturelle .Cela dépend de la texture géologique qu’elle traverse. Elle peut absorber des quantités élevées de magnésium, de calcium, et de chlorures dans les roches et les sols sédimentaires.
Sources Agricoles
Les sources agricoles de contamination des eaux souterraines sont les pesticides, les engrais, les herbicides et les déjections animales. Si ces matières sont délaissées près des puits, ils s’infiltrent et contaminent l’eau.
Sources industrielles
Les rejets et les effluents des usines sont aussi des sources de contamination des eaux souterraines, s’ils ne sont pas traités convenablement. Ils sont souvent déversés dans l’environnement. Certaines industries utilisent des canalisations souterraines pour évacuer leurs effluents non traités. Tout cela est entrainé vers la nappe phréatique et la pollue.
Sources résidentielles
Les rejets domestiques sont les premières sources de pollution des eaux de puits. Les puisards d’évacuation des eaux domestiques, les fosses d’aisance, le stockage incorrect de déchets comme les peintures, les détergents synthétiques, les dissolvants, les huiles, les médicaments, les désinfectants, les produits chimiques de piscine, les pesticides, les batteries, l’essence et le carburant diesel, etc.… Ils s’infiltrent dans le sol et peuvent mener à la contamination des eaux souterraines.
Conséquences de la pollution de l’eau
Une eau polluée nuit principalement à la santé. L’eau retient tous les agents extérieurs en contact avec elle, dissous ou non dissous. Par conséquent, des bactéries et des microbes se développent dans l’eau. A l’utilisation de ces eaux polluées, il en résulte des maladies comme :
– le choléra ;
– la diarrhée ;
– la dysenterie ;
– l’hépatite A ;
– la typhoïde ;
– la poliomyélite ;
– des maladies de la peau (la gale).
Traitements des eaux
Avant de boire ou d’utiliser pour la cuisson l’eau d’un puits ou d’une source, il faut procéder à des traitements, si sa potabilité n’est pas assurée. Pour traiter l’eau, il y a des gestes à adopter. Par exemple, utiliser un système de filtre qui élimine les déchets physiques, bouillir l’eau avant de boire et utiliser des désinfectants comme l’eau de javel. Toutefois, en pratique, Il y a trois étapes indispensables à suivre pour traiter les eaux de puits, à savoir la filtration fine, la stérilisation aux Ultra-Violets (UV), l’affinage au charbon actif et la chloration de l’eau.
Filtration fine de l’eau
La filtration consiste à éliminer toutes les particules fines qui se trouvent dans l’eau, comme les boues, les poussières, les particules diverses, etc.…. Pour cela, il faut passer l’eau à un microfiltre. Il a des pores suffisamment petits, de quelques 0,2 micromètre de diamètre, pour retenir les micro-organismes pathogènes. Au bout, le microfiltre fera sortir une eau claire. Par contre, il faut changer fréquemment les microfiltres.
Stérilisation aux Ultra-Violets
La stérilisation aux Ultra-Violets permet d’assurer le traitement de l’eau de manière fiable et non chimique. Cela consiste à faire passer l’eau à désinfecter dans un tube de quartz, contenant un tube à rayonnement Ultra-violet. Le rayonnement détruit toutes les matières vivantes présentes dans l’eau, c’est-à-dire les bactéries. Cette méthode ne laisse pas de produit chimique ni d’odeur.
Affinage au charbon actif
Cette étape de traitement permet de rendre l’eau plaisante à la consommation. Ce traitement consiste à la filtration par charbon actif. Pour cela, le charbon actif élimine les principaux polluants chimiques dangereux et artificiels, comme les produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, pesticides), les Composés Organiques Volatils (les COV : hydrocarbures aromatiques, phénol, benzène, etc…), les métaux lourds (mercure, plomb)… Il assure aussi l’amélioration du goût, l’odeur et l’aspect de l’eau.
Chloration de l’eau
Le traitement par chloration de l’eau consiste à verser du chlore dans l’eau pour la désinfecter (exemple l’hypochlorite de calcium). Ce traitement est plus facile à réaliser, car il est pratique et moins coûteux. [16] Après traitement, il faut utiliser directement l’eau et éviter de la stockée trop longtemps. Le but est d’éviter le risque de rémanence, c’est-à-dire le redéveloppement des bactéries les plus agressives.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE THEORIQUE
1.Généralités sur l’eau et la pollution des eaux souterraines
1.1 Définitions
1.2 Sources de pollution des eaux souterraines
1.3 Conséquences de la pollution de l’eau
1.4 Traitements des eaux
1.5 Cycle de l’eau
1.6 Caractéristiques physico-chimiques des eaux souterraines
2.Normes de potabilité de l’eau
3.Méthodologie d’analyse par chromatographie ionique
3.1 Historique
3.2 Définition
3.3 Principe de séparation en chromatographie ionique
3.4 Grandeurs caractéristiques en chromatographie
3.5 Contrôle de la qualité des analyses par chromatographie ionique
PARTIE EXPERIMENTALE
4.Présentation de la zone d’études
4.1 Situation géographique
4.2 Sources d’eaux de consommation
4.3 Contexte géologique
4.4 Contexte hydrogéologique
4.5 Climat
5.Appareillage
6.Méthodes et processus utilisés sur le terrain et au laboratoire
6.1 Plan d’échantillonnage
6.2 Prélèvements d’échantillons
6.3 Mesures sur le terrain
6.3.1 Ph et température
6.3.2 Conductivité
6.3.3 Oxygène dissous
6.3.4 Alcalinité
6.4 Préparation des échantillons au laboratoire
6.4.1 Mode opératoire
6.4.2 Conditions expérimentales
7.Résultats et interprétations
7.1 Contrôles de la qualité des analyses par chromatographie ionique
7.2 Caractéristiques des points d’échantillonnage
7.3 Paramètres mesurés sur le terrain
7.4 Résultats d’analyse par chromatographie ionique
7.4.1 Cations
7.4.2 Anions
7.5 Comparaison des résultats avec les normes de potabilité
7.5.1 Comparaison des valeurs des paramètres mesurés sur le terrain avec les normes de potabilité
7.5.2 Comparaison des valeurs de concentrations en ions majeurs avec les normes de potabilité
7.5.3 Interprétations
7.6 Faciès chimiques
7.7 Diagrammes de Schoeller
7.8 Origines de la minéralisation des eaux
8.Recommandations
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE
ANNEXES
RESUME