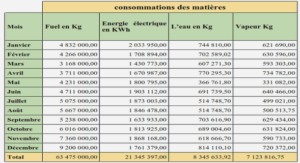Depuis des milliers d’années, l’humanité a utilisé diverses ressources trouvées dans son environnement en particulier les plantes afin de soigner et de traiter nombreuses maladies. En effet, les propriétés thérapeutiques des plantes sont dues à la présence de centaines, voire de milliers de composés naturels bioactifs appelés métabolites secondaires. Ces derniers sont par la suite accumulés dans différents organes et parfois dans des cellules spécialisées de la plante. On découvre encore des vertus insoupçonnées dans bien des plantes. En outre, de nombreux principes actifs contenus dans les plantes n’ont encore jamais été synthétisés, et restent donc exclusivement disponibles dans le végétal. Apprendre à puiser dans la riche gamme de plantes proposées deviendra donc une manière la plus naturelle de prendre en charge sa santé et c’est ce qu’a compris la plupart des chercheurs de l’UCAD notamment ceux du Laboratoire de Pharmacognosie et Botanique qui depuis sa création font de la recherche sur les plantes d’intérêt médical.
Actuellement l’intérêt d’une grande partie des recherches porte sur l’étude de molécules anti oxydantes d’origine naturelles pour lutter contre le stress oxydatif qui correspond à un déséquilibre entre la génération d’espèces oxygénées activées (EOA) et les défenses antioxydants de l’organisme en faveur des premières. Et nos mauvaises habitudes alimentaires ainsi que notre mode de vie, augmentent de façon anormale la production des espèces oxygénées activées dans notre organisme. Et beaucoup d’études ont montré que les phénomènes oxydatifs interviennent dans l’initiation de maladies telles que l’athérosclérose, les problèmes inflammatoires, cardiaques, pulmonaires, les cancers, le processus de vieillissement, le diabète pour ne citer que ceux-là. Nous vivons dans une atmosphère riche en oxygène, et les radicaux, ceux qui réagissent particulièrement avec l’oxygène, sont des sous produits naturels de la respiration. « Un pourcent de l’oxygène que nous consommons se transforme en radicaux réactifs à l’oxygène » dit le biochimiste Barry Halliwell, l’un des pionniers de la recherche sur les radicaux libres (Halliwell, 1999). Vu la diversité et la gravité des maladies qu’induit le stress oxydant, et comprenant que les plantes vertes sont pleines d’antioxydants pour cause, elles produisent de l’oxygène pur pendant la photosynthèse, pour se protéger elles-mêmes, elles fabriquent un puissant assortiment d’antioxydants. Depuis 2009, le Laboratoire de Pharmacognosie et Botanique du Département de Pharmacie de la Faculté de Médecine de Pharmacie et d’Odontologie (FMPO) s’est investis dans la recherche de l’activité anti radicalaire et antioxydant des plantes médicinales (Sarr, 2014), en vue de lutter contre le stress oxydant et ses pathologies associées.
GENERALITES SUR LE STRESS OXYDATIF
DEFINITION
Le stress oxydatif est défini comme étant le déséquilibre entre la génération des espèces réactives de l’oxygène et la capacité du corps à neutraliser et à réparer les dommages oxydatifs (Boyd et al., 2003).
RADICAUX LIBRES
Les radicaux libres sont des espèces chimiques, atomiques ou moléculaires, contenant un ou plusieurs électron(s) libre(s) non apparié(s) sur leurs couches externes (Lehuchers et al, 2001). Du fait de leur instabilité énergétique, les radicaux libres ont tendance à revenir immédiatement à un état stable en captant un électron à une autre molécule: ils peuvent donc être oxydants. En jouant le rôle d’accepteur d’électrons, les radicaux libres ont donc la propriété d’être réactifs vis-à-vis des autres molécules, possédant un temps de demi-vie court (Koechlin, 2006). Les molécules ainsi transformées deviennent à leur tour d’autres radicaux libres et initient ainsi une réaction en chaîne. C’est typiquement ce qui se passe lors de la peroxydation lipidique (Dacosta, 2003 ; Vansant, 2004).
ESPECES REACTIVES DE L’OXYGENE
Les espèces réactives de l’oxygène incluent les radicaux libres de l’oxygène (radical super-oxyde, radical hydroxyle, monoxyde d’azote, etc…) mais aussi certains dérivés réactifs non radicalaires dont la toxicité est tout aussi importante tels que le peroxyde d’hydrogène et le peroxynitrite (Bartosz, 2003. Halliwell et Whiteman 2004) .
L’anion super-oxyde
L’anion superoxyde est la forme réduite de l’oxygène moléculaire, grâce aux oxydases comme la NADPH-oxydase, qui apporte un électron donné par le NADPH sous forme H° et transforme l’O2 en O2°- (Serteyn, 2002). C’est le radical le plus abondamment formé dans la cellule mais il a la réactivité la plus faible vis-à-vis des substrats bio organiques (Dellatre et al, 2007). En effet, à partir de l’anion superoxyde, on aboutit au peroxyde d’hydrogène par voie enzymatique, ou au peroxynitrite par réaction avec le NO° (Stief, 2003).
L’action sur les lipides
Les espèces réactives de l’oxygène ont pour cible privilégié les lipides et leurs acides gras polyinsaturés. En effet, elles sont capables d’arracher un hydrogène sur les carbones situés entre deux doubles liaisons, pour former un radical diène conjugué, ou oxydé en radical peroxyde. Cette dernière réaction est appelée peroxydation lipidique, et les produits d’oxydation formés peuvent participés à la régulation des fonctions métaboliques, de l’expression des gènes et de la prolifération cellulaire en tant que second messager (Lehucher, 2001). La peroxydation lipidique se déroule en trois étapes :
a- L’initiation
Dans cette étape un acide gras polyinsaturé est attaqué au niveau d’un carbone situé entre deux doubles liaisons par un radical hydroxyle avec arrachement d’un atome d’hydrogène qui laisse un électron non apparié. L’acide gras subira alors une suite de réarrangements des doubles liaisons (Jacques et André., 2004).
b- La propagation
Cette phase débute lorsqu’une molécule d’oxygène attaque le radical acide gras (R°) pour former un radical peroxyle (RO2° ) qui peut arracher un H à un autre acide gras polyinsaturé et créer un nouveau radical libre qui s’oxydera et ainsi de suite (Baudin, 2006).
c- La terminaison
La phase de terminaison consiste à la recombinaison des deux peroxyles pour former un peroxyle relativement stable (RO2° + RO2° →ROOR +O2) ou le plus souvent à la réaction d’un radical avec une molécule antioxydante dite » briseur de chaines » (Khohen et Nyska, 2002).
MALADIES LIEES AU STRESS OXYDATIF
Le stress oxydatif est défini comme étant un déséquilibre de la balance entre pro oxydant et antioxydant. Ce phénomène résulte de la production excessive de radicaux oxygénés. Il est potentiellement impliqué dans le développement de plus d’une centaine de pathologies humaines différentes (Pincemail et al, 2002 ; Wootton-Beard et Ryan, 2011), notamment dans le développement de l’athérosclérose (Harrison et coll. 2003), dans les troubles associés à la reperfusion post-ischémique (Zweier et Talukder, 2006), dans l’initiation et le maintien de l’hypertension artérielle, la cataracte, le cancer et même le vieillissement (Valko et al., 2007). Certains auteurs suggèrent que les NO produits par les fibroblastes cardiaques pourraient être impliqués dans les maladies cardiaques inflammatoires (Farivar et al, 1996).
La production excessive de NO, conséquence de l’induction de la NO synthétase par les cellules, est la cause de l’inflammation du cerveau et de la neurodégénération telles que la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de parkinson, la maladie d’Alzheimer (Liu et al, 2002). Le traitement de patients atteints de vascularite avec les vitamines E et C réduit la génération du superoxyde par les neutrophiles, et peut jouer le rôle d’adjuvant de thérapie (Harper et al, 2002). Une étude a rapporté que les espèces réactives de l’oxygène sont impliquées dans la progression de la résistance à l’insuline ainsi que dans le dysfonctionnement des cellulesβ, conduisant au diabète (Evans et al, 2002).
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE: ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
CHAPITRE I: GENERALITES SUR LE STRESS OXYDATIF
I-1 DEFINITION
I-2 RADICAUX LIBRES
I-3 ESPECES REACTIVES DE L’OXYGENE
I-3-1 L’anion super-oxyde
I-3-2 Le peroxyde d’hydrogène
I-3-3 Le radical hydroxyle
I-3-4 L’oxygène singulet
I-3-5 Le monoxyde d’azote
I-3-6 Le peroxynitrite
I-4 TOXICITE DES RADICAUX LIBRES AU NIVEAU CELLULAIRE
I-4-1 L’action sur les protéines
I-4-2 L’action sur les acides nucléiques
I-4-3 L’action sur les lipides
I-5 MALADIES LIEES AU STRESS OXYDATIF
CHAPITRE II : SYSTEME DE PROTECTION CONTRE LES RADICAUX LIBRES
II-1Définition et classification des antioxydants
II-2 Moyens de défenses endogènes
II-3 Moyens de défenses exogènes
CHAPITRE III: DIFFERENTES METHODES D’ETUDES DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE
III-1 Piégeage du radical 2,2-diphényl-1picrylhydrazyl (DPPH°)
III-2 Test FRAP
III-3 Test ORAC
III-4 Test TEAC ou ABTS
III-5 Test de réduction du radical nitroxyde
DEUXIEME PARTIE: EVALUATION DE LA RECHERHE
CHAPITRE I: MATERIEL ET METHODES
I-1 OBJECTIFS ET CADRE D’ETUDE
I-1-1 But
I-1-2 Objectif général
I-1-3 Objectifs spécifiques
I-1-4 Cadre d’étude
1-1-4-1 Situation géographique du Laboratoire
I-1-4-2 Historique et Organigramme du Laboratoire
I-1-4-3 Les activités du Laboratoire
I-1-4-4 Présentation du Jardin d’Expérimentation des Plantes Utiles
I-1-4-5 Equipements du Laboratoire
I-2 METHODOLOGIE ET MATERIEL UTILISE
I-2-1 Type d’étude
I-2-2 Matériel utilisé
I-2-3 Méthodologie de collecte des Thèses et Mémoires
CHAPITRE II: RESULTATS ET DISCUSSION
II-1 RESULTATS
II-1-1 Exploitation des Thèses et Mémoires
II-1-1-1 Nombre de Thèses et Mémoires soutenus par année
II-1-1-2 Inventaire des Thèses et Mémoires sur les plantes antioxydantes de 2009 à 2015
II-1-1-3 Nombre de plantes recensées
II-1-1-4 Répartition des espèces médicinales par famille
II-1-1-5 Les méthodes utilisées par les auteurs pour la recherche de l’activité Antioxydante
II-1-1-5-1 Détermination de l’activité antioxydante par la méthode Bio-autographique
II-1-1-5-2 Pourcentage d’inhibition des plantes étudiées sur le DPPH
II-1-1-5-3 Pourcentage d’inhibition des plantes étudiées sur l’ABTS
II-1-1-5-4 Pouvoir réducteur des plantes testées par la méthode FRAP
II-1-1-5-5 Plantes étudiées par le test de réduction du radical nitroxyde
II-1-2 Difficultés rencontrées
II-2 DISCUSSION
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES