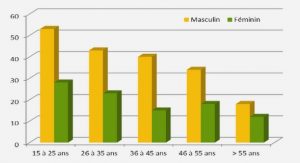Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Morphologie externe
Les crevettes Pénéides sont des arthropodes marins à symétrie bilatérale ayant des antennes et des pièces buccales comportant des mandibules. Elles possèdent un rostre bien développé, garni d’épines dorsales, ventrales et aussi possédant des pinces aux trois premières paires de pattes. Sa coloration est brune sombre avec des bandes transversales claires et sombres marquant la carapace.
La femelle se distingue du mâle par un réceptacle séminal externe appelé « thelycum » situé à la base de la quatrième paire de pattes thoraciques. L’appendice copulateur du mâle ou « petasma » se situe sur les endopolites de la paire de pattes abdominales (pleiopodes). Figure n° 2 – Morphologie externe de Penaeus monodon
Biologie
Principales étapes du cycle biologique
. La Penaeus monodon est une espèce qui vit sur le fond (CHEN, 1976). La reproduction se manifeste par les rythmes climatiques, saisonniers et lunaires. L’accouplement a lieu juste après la mue. La fécondation a lieu en pleine mer par l’insertion des spermatophores à l’intérieur du thelycum de la femelle. Elle ne dépend pas de la maturité des crevettes.
La femelle qui va pondre doit se trouver au stade de post-mue, durant la pleine lune. Quelque soit sa taille, la femelle est capable de pondre plusieurs centaines de milliers d’œufs. Les oeufs sont fécondés au moment de l’expulsion puis dispersés dans l’eau. L’incubation dure 12 à 15 heures après la ponte.
Le développement embryonnaire dure entre 12 et 18 heures pour une température comprise entre 24 et 28°C. La segmentation totale débute une demi-heure après la ponte.
La vie larvaire dure au minimum 18 jours. Il existe douze stades et des trois phases. La vitesse de développement est fonction de la température. L’optimum se situe vers 28°C. Les différents stades larvaires sont donnés dans la figure n°3.
La phase nauplius
C’est la première phase larvaire. Le nauplius a un corps massif, globuleux, non segmenté, et renflé. L’éclosion a lieu dans 13 à 14 heures après incubation à une température comprise entre 27 à 29°C. La phase nauplius dure 6 jours pendant laquelle la larve ne s’alimente pas mais utilise ses réserves vitellines.
La phase zoé
La larve zoé comprend deux parties bien distinctes. L’une est ovale et l’autre postérieure est allongée. Les stades post-zoé, zoé, après -zoé durent 4 à 5 jours. Durant cette phase, l’animal se nourrit de phytoplancton et de zooplancton. C’est un organisme filtreur. Lorsque les larves sont bien nourries, elles rejettent un cordon fécal constitué d’algues à moitié digérées, caractéristiques du bon état de l’élevage.
La phase mysis
C’est la troisième phase larvaire. Elle comporte 3 stades qui durent au total 5 jours. Elle nage à l’horizontal. L’alimentation du mysis est de plus en plus carnée. La larve a grossièrement l’apparence de petite crevette.
La phase postlarve
Le développement des postlarves dure 2 à 3 semaines (PL1 à PL21). Les postlarves adoptent progressivement des morphologies et des comportements des adultes. Le principal caractère séparant les mysis et les postlarves est la présence pour ces dernières d’appendices abdominaux utilisés pour la nage. Pendant la phase diurne, les postlarves sont au repos complet. Mais pendant la phase nocturne, l’activité dévient très importante : prise de nourriture, mue, déplacement et migration. Elles se nourrissent de zooplancton. C’est surtout au niveau de cet état physiologique que commence le grossissement des crevettes.
Mue
La croissance des Arthropodes est fondée au cycle des mues dont la fréquence est inversement proportionnelle au gain de poids de l’animal. La durée du cycle inter mue varie en fonction de la nourriture, de certains paramètres physico-chimiques du milieu et du poids de l’animal. La mue correspond au rejet du squelette qui assure une croissance périodique et au nettoyage de la carapace, protection contre les parasites. Le taux de croissance maximal recherché en élevage dépend d’une part de la fréquence des mues et d’autre part de la prochaine mue.
L’alimentation est un facteur prépondérant influençant l’état de l’animal. De plus, un renouvellement massif de l’eau d’un bassin joue un rôle dans le maintien des paramètres physico-chimiques de l’eau. Et les périodes lunaires constituent une des causes de mue.
Pour connaître les différents stades de mue, l’observation se focalise au niveau des uropodes ou des pléopodes sur le bord interne de l’endopolite tiers distale.
Il y en existe trois sortes de mue telles dure, semi dure et molle. L’observation se fait facilement soit par pression soit au toucher de la face latérale du céphalothorax, au niveau des deux premiers segments abdominaux.
– Dure (l’ensemble de D1 et D2) : carapace indéformable par pression. les crevettes ont fini de se muer.
– Semi dure : l’ensemble de semi dure claire (SDC) et de semi dure rouge (SDR) : il y a enfoncement par une légère pression puis la carapace reprend sa forme.
– Molle (M) : après une pression, il y a une déformation complète ; les crevettes font la mue.
CONDUITE D’ELEVAGE
En aquaculture de crevettes, l’élevage de Penaeus monodon comprend trois étapes : élevage larvaire, prégrossissement et grossissement. Primo, cette partie décrit la conduite de l’alimentation pendant la phase larvaire et au niveau de la ferme de grossissement. Secundo, les rôles des principaux paramètres influençant l’élevage et leurs conséquences sur l’alimentation des crevettes sont à avancer. Ce sont les paramètres physico-chimiques (O2, T°, pH, Secchi, Salinité) et les paramètres biologiques (phytoplancton et zooplancton).
Alimentation
Alimentation en phase larvaire
L’élevage larvaire est réalisé dans des bacs cylindro-coniques ou en forme de « U ». Les larves sont nourries avec des aliments frais (algues microscopiques, nauplius d’Artemia) et des micros particules ou des aliments en poudre.
Le Penaeus monodon et Penaeus indicus sont omnivores lorsqu’ils sont jeunes. Puis, ils deviennent carnivores (CROSNIER, 1965). La nutrition des crevettes varie en fonction du cycle biologique ou du stade de développement. Au cours du premier mois, la productivité naturelle couvre une grande partie de la nourriture.
Les nauplii ne se nourrissent pas. Elles vivent de leurs réserves vitellines pendant quelques jours. Les larves zoé se nourrissent d’algues unicellulaires vivantes (Monochrsis lutheri (3 à 5µ), Tetraselmis chui (10 à 12µ), Tetraselmis suecice (10 à 12µ), Tetraselmis tetrathele (10 à 12µ) et Isochrysis sp). Elles sont des organismes filtreurs.
Les larves mysis se nourrissent de composés d’algues phytoplanctoniques et leur alimentation est de plus en plus carnée.
Alimentation en phase de grossissement
Les postlarves subissent un prégrossissement en système intensif avant de passer aux bassins de grossissement proprement dit. L’élevage se pratique dans de bassins en terre argileuse. Le prégrossissement dure en moyenne 30 à 45 jours et le grossissement 4 à 5 mois. La densité est de 50 à 80 postlarves/m2 au prégrossissement et 5 à 9/m2 au grossissement (AVALLE et ROTHIUS., 1991). Durant la phase de prégrossissement, en plus du phytoplancton et du zooplancton, il faut adapter les postlarves à se nourrir avec des granulés de dimension très fine.
A la ferme de grossissement, les granulés représentent l’aliment de base des postlarves juvéniles. Généralement, la distribution se fait 2 à 4 fois par jour (ANONYME, 1987).
Besoins qualitatifs
L’aliment des crevettes doit contenir des besoins énergétiques importants pour la locomotion, la prise de nourriture, l’entretien, la croissance, la constitution d’un nouvel exosquelette à chaque mue.
Pour la croissance des crevettes, la qualité de l’aliment est très importante. Cette qualité dépend des constituants dans les matières premières utilisées.
a) Les lipides : Ils assurent les apports énergétiques et doivent figurer à faible proportion dans l’aliment en raison de leur dégradation. Et, ils jouent un rôle très important dans le métabolisme des crevettes.
b) Les protides : Ils tiennent le rôle de liants aux différents ingrédients.
c) Les protéines : Elles sont indispensables à la croissance. Et, elles doivent être apportées dans l’aliment à un taux variant de 40% pour l’espèce Penaeus monodon.
d) Les vitamines : Elles interviennent également dans la croissance, la reproduction et la pigmentation des animaux.
e) Les acides aminés essentiels (arginine, leucine, isoleucine, lysine, histidine.) : ils sont aussi indispensables pour la croissance des crevettes.
f) Les sels minéraux : Ils sont indispensables à l’édification du futur exosquelette ou carapace comme le calcium, le phosphore, le potassium, les apports en vit C, en stérols, en sels minéraux, en acides aminés et en matière grasse.
Besoins quantitatifs
Selon diverses sources, le taux de protéines dans l’aliment des crevettes Penaeus monodon doit varier entre 35 et 45% (farine de poisson, ou tête de crevette). Les besoins spécifiques chez les crevettes sont encore mal connus. Toutefois, on sait qu’ils varient selon l’âge.
Présentation
a) L’aspect macroscopique : l’aliment composé pour Pénéides se présente sous forme de granulés allongés de longueur variée et de diamètre entre 2,2 et 2,5 mm.
b) La flottabilité : Il s’agit de savoir le pourcentage d’aliment qui flotte dans l’eau. Ainsi, la flottabilité massive a un effet néfaste sur la consommation des crevettes, la croissance et surtout la gestion d’aliment. Les crevettes ne peuvent pas y accéder tout de suite lors de la distribution.
c) La stabilité : Il s’agit de préciser la consistance de l’aliment sous l’eau. Les granulés doivent avoir assez de consistance pour que les crevettes puissent les manipuler aisément à l’aide de leurs appendices. Ils doivent demeurer dans l’eau pendant une dizaine d’heures puisque les crevettes ne se précipitent pas directement sur la nourriture comme le font les poissons (TACON, 1990).
d) L’attractabilité : Il s’agit de la connaissance du pouvoir d’attraction de l’aliment par les crevettes. Le test d’attractabilité sert à vérifier si un aliment est apprécié ou moins apprécié par les crevettes. Afin que les granulés soient recherchés par les animaux, ils sont enrobés d’attractants comme des extraits d’organismes marins, de la poudre d’Artémia salina et de la morine extraite de Bombyx mori.
Le rapport de stage ou le pfe est un document d’analyse, de synthèse et d’évaluation de votre apprentissage, c’est pour cela chatpfe.com propose le téléchargement des modèles complet de projet de fin d’étude, rapport de stage, mémoire, pfe, thèse, pour connaître la méthodologie à avoir et savoir comment construire les parties d’un projet de fin d’étude.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE I : ETUDE BIBLIOGRAPHIQUE
I. MILIEU D’ETUDE
I.1. Contexte actuel de la crevetticulture
I.2. Présentation du milieu d’étude
I.2.1. Localisation géographique
I.2.2. Milieu biophysique
I.2.3. Milieu social et économique
II. GENERALITES SUR LE Penaeus monodon
II.1. Taxonomie
II.2. Morphologie externe
II.3. Biologie
II.3.1. Principales étapes du cycle biologique
II.3.2. Mue
III. CONDUITE D’ELEVAGE
III.1. Alimentation
III.1.1. Alimentation en phase larvaire
III.1.2. Alimentation en phase de grossissement
III.1.2.1. Besoins qualitatifs
III.1.2.2. Besoins quantitatifs
III.1.2.3. Présentation
III.2. Paramètres de contrôle du milieu d’élevage
III.2.1. Paramètres physico-chimiques
III.2.1.1. Oxygène dissous
III.2.1.2. Température
III.2.1.3. pH
III.2.1.4. Turbidité
III.2.1.5. Salinité
III.2.2. Paramètres biologiques
III.2.2.1. Phytoplancton
III.2.2.2. Zooplancton
CONCLUSION PARTIELLE
PARTIE II : MATERIELS ET METHODES
I. CHRONOGRAMME DE L’ESSAI
I.1. Préparation avant l’ensemencement
I.1.1. Préparation du fond
I.1.2. Assec
I.1.3. Labour
I.1.4. Chaulage
1.1.5. Elimination des prédateurs et des compétiteurs
I.1.6. Mise en eau et fertilisation de démarrage
I.2. Travaux durant l’élevage
I.2.1. Fertilisation d’entretiens en cours d’élevage
I.2.2. Renouvellement d’eau au cours d’élevage
I.2.4. LAB – LAB
II. MATERIELS
II.1. Animaux
II.2. Bassins et accessoires
II.3. Fertilisants
II.4. Aliments
II.6. Appareils de mesure des paramètres physico-chimiques
II.7. Fiche synthétique des bassins
III. METHODES
III.1. Procédures à suivre pour la méthode 100% mangeoire
III.1.1. Introduction d’un nouveau type d’aliment
III.1.2. Système de notation avec la méthode mangeoire
III.1.3. Calcul de l’ajustement de la ration suivant la notation
III.1.4. Plafond de la quantité par mangeoire et mesures à prendre
III.1.5. Avant chaque distribution
III.1.6. Pendant la distribution, à chaque mangeoire
III.1.7. Après chaque distribution
III.1.8. Notion de biosécurité
III.2. Mesure des paramètres zootechniques et physico-chimiques
III.2.1. Contrôle quotidien
III.2.2. Contrôle hebdomadaire
III.2.3. Etude de corrélations
III.3. limite de l’étude
CONCLUSION PARTIELLE
PARTIE III : RESULTATS ET DISCUSSION
I. RESULTATS SUR LES PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
I.1. Oxygène dissous
I.2. Salinité
I.3. Température
I.4. Turbidité
I.5. Discussion sur les paramètres physico-chimiques
II. RESULTATS DES PERFORMANCES ZOOTECHNIQUES
II.1. Indice de conversion
II.2. Croissance moyenne
II.3. Taux de Nutrition (TN)
II.4. Taux de survie
II.5. Discussion sur les performances zootechniques
III.ETUDE DE CORRELATION ENTRE LES DIFFERENTES VARIABLES
III.1. Corrélation entre les facteurs biologiques
III.2. Corrélation entre les facteurs biologiques et les facteurs environnementaux
IV. PROPOSITIONS D’AMELIORATIONS
CONCLUSION PARTIELLE
CONCLUSION GENERALE
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet