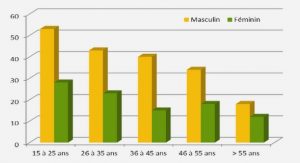Le karité est un arbre typique des savanes arborées soudaniennes [1]. Il n’existe qu’en Afrique et pousse généralement à l’état sauvage, sans qu’il faille le cultiver ou lui prêter une attention particulière [2]. En plus de fournir des fruits savoureux et nutritifs, des produits médicaux, un bois résistant et des chenilles riches en protéines, l’arbre est particulièrement célèbre pour son produit gras mondialement connu et appelé beurre de karité [3]. Dans chaque village africain, la fabrication du beurre de karité est une activité très ancienne, principalement, réservée aux femmes. Elle se fait à partir des noix des fruits du karité et nécessite une certaine habileté, une attention particulière et un effort physique soutenu. Toutefois, le rendement reste relativement bas et la qualité du produit très variable dépendant des capacités et de l’attention de la transformatrice. Les utilisations sont nombreuses, aussi bien dans la pharmacopée traditionnelle que dans les pratiques quotidiennes. Sur le plan international, le beurre de karité est un produit très prisé en raison de ses excellentes propriétés cosmétologiques et thérapeutiques pour la peau, sans oublier que la majorité des exportations est tournée vers l’industrie chocolatière. En effet, depuis quelques années, l’Union Européenne a autorisé l’incorporation des huiles végétales (et notamment le beurre de karité) comme substitut au beurre de cacao dans les chocolats. Ainsi, le commerce du beurre de karité est devenu une activité génératrice de plusieurs millions de dollars qui fournit une part significative des revenus en devises de plusieurs pays africains [4].
ETUDE BOTANIQUE DU KARITE
HISTORIQUE
Le beurre de karité est connu et utilisé, en Afrique, depuis des millénaires. Les égyptiens de l’antiquité l’utilisait déjà .On raconte que Néfertiti lui devait sa grande beauté grâce à ses extraordinaires vertus hydratantes, protectrices et réparatrices de la peau [5].
Les premières traces écrites, sur le karité, furent ceux du géographe arabe ALUMARI vers 1348 et du voyageur marocain Ibn BATTUTA en 1354. AL-UMARI décrit le karité et en particulier son fruit comme suit :
« …Il y a un arbre appelé Kariti qui a un fruit semblable au limon et dont le goût est semblable à la poire avec à l’intérieur un noyau charnu. On prend ce noyau qui est tendre, on le broie et on retire une sorte de beurre qui devient compact comme lui. On en blanchit les maisons, on le brûle dans les lampes, on en fait du savon. Si on veut manger ce corps gras on le traite au feu. Le produit obtenu est utilisé comme le beurre… » .
Le récit d’IBN BATTUTA reste le plus grand témoignage écrit sur le karité avant les explorations européennes. Les détails dans son livre «Le fabuleux voyage d’Ibn Battuta» reflètent déjà la vie africaine centrée autour du karité :
«… De Bébé accueilli dans une vigoureuse friction au beurre de karité jusqu’au lit du roi défunt spécialement taillé dans la noblesse du tronc de l’arbre de karité, la vie du village bat au rythme de l’arbre sacré comme la vie de la femme. En effet, de juillet à décembre, toute l’activité de la femme est dévolue à la collecte en brousse, à la vente des noix au marché et à la préparation des fruits de l’arbre qui serviront l’année durant aux besoins domestiques et culinaires de la famille…» .
Plus de quatre siècles plus tard, à la recherche de l’or, un directeur de la compagnie normande pour l’exploitation du commerce du Sénégal, André Brüe, rapporte son histoire avec le beurre de karité, au cours d’une de ses pérégrinations commerciales le long du fleuve Sénégal : «Les marchands marabouts lui donnèrent plusieurs calebasses remplies d’une certaine graisse un peu moins blanche que le suif de mouton et à peu près de la même consistance; ils l’appellent Bataula dans le pays. Les nègres du bas de la rivière l’appellent Bambouk Toulou, c’est-à-dire beurre de Bambouk (province)…..Les nègres se servent de cette graisse comme nous nous servons du beurre ou saindoux en France» [8]. Le karité et son beurre ont été documentés ensuite par l’explorateur écossais Mungo Park (1771-1806) dans son ouvrage, de 1797, intitulé : « Travels in the interior districts of Africa ». Il y donne de précieuses informations : botanique, physique, géographique, économique…sur le beurre de karité et y décrit aussi ses principales utilisations et son mode de préparation traditionnelle encore utilisé aujourd’hui :
«…Indépendamment des esclaves et des marchandises qu’ils portent pour les blancs, les marchands amènent sur la côte de Gambie, du fer natif, des gommes odorantes et du « shétoulou », ce qui signifie littéralement « beurre d’arbre » ou « beurre végétal ». Ce beurre est extrait d’une espèce de noix, par le moyen de l’eau bouillante….Il ressemble au beurre ordinaire et en a la consistance…Les populations locales en font une grande consommation et par conséquent il est toujours très recherché…Les habitants étaient toujours occupés à recueillir les fruits de l’arbre « shea »(Karité). Cet arbre croît abondamment dans toute cette partie du pays Bambara. Il n’est pas planté par les habitants, mais on le trouve croissant naturellement dans les bois. Lorsqu’on défriche les forêts pour cultiver la terre, on coupe tous les arbres, excepté les « sheas»» [9].
A la lumière de ces témoignages, il ne fait aucun doute que le karité et le beurre qu’il produit sont, depuis très longtemps, à l’origine d’une très importante activité africaine.
APPELLATIONS ET TAXONOMIE
Le karité a connu une longue histoire du point de vue de la nomenclature. En effet, depuis le XIXème siècle, il a changé plusieurs fois d’appellation .
En 1838, George Don, en souvenir de l’explorateur écossais, appela l’arbre Bassia parkii [10]. En 1864, Theodore Kotschy créa le genre Butyrospermum qui, selon lui, comprenait deux espèces : le Butyrospermum parkii ou karité du Soudan occidental et le Butyrospermum niloticum forme propre au bassin du Nil. Les recherches de Pierre (1884), Wildeman et Chevalier ont permis d’établir que les espèces de Kotschy ne sont que deux variétés de la même plante à laquelle doit être conservé le nom Butyrospermum parkii [10]. En 1962, Frank Nigel Hepper, botaniste anglais, parle d’une seule espèce Butyrospermum paradaxum composée de deux sous-espèces : B.paradaxum subsp. niloticum et B.paradoxum subsp. Parkii [11,12]. Actuellement, la combinaison binominale acceptée est : Vitellaria paradoxa (C.F.Gaertn.) [10-12]. Selon Cronquist (1981), le karité appartient au règne des plantae, à la division des Magnoliophyta, à la classe des Magnoliopsida, à l’ordre des Ebenales et à la famille des Sapotaceae [13]. Plennington(1991) a proposé une classification de la famille des Sapotacées en 5 tribus dont celle des Mimusopeae. Cette dernière est sudivisée en 3 sous-tribus : les Mimusopinae avec 6 genres, les Manilkarinae avec 6 genres et les Glueminae avec 5 genres. Le genre Vitellaria se trouve dans la sous-tribu des Mimusopinae [14]. La troisième version de la classification phylogénétique des angiospermes (APGIII) de 2009, classe l’espèce Vitellaria paradoxa (C.F.Gaertn.) dans le règne des plantes de la façon suivante :
– Règne Plantae
– Clade Angiospermes
– Clade Eudicotyledonae (Dicotylédones vraies)
– Clade Asteridae
– Ordre Ericales
– Famille Sapotaceae
– Genre Vitellaria
– Espèce V.paradoxa
L’espèce Vitellaria paradoxa est scindée en deux sous-espèces [12] :
– Vitellaria paradoxa subsp.paradoxa, présente, en Afrique occidentale et centrale.
– Vitellaria paradoxa subsp.nilotica, retrouvée, en Afrique de l’Est.
La seconde se distingue de la première par sa plus forte pilosité et ses fleurs plus grandes. Le karité a plusieurs noms vernaculaires parmi lesquels on trouve : en français « arbre à beurre » ; en anglais « shea butter tree », « shea tree » « bambouk butter tree », « galam butter tree » [12]; en dialecte sénégalais « ghariti » [16] ; en dialecte malien « si yiri » ou « Si » [16]; en dialecte ghanéen « ngu », « tokuti » [16]; en dialecte béninois « sombu », « bulanga », « kareegi », « emin » [16]; en dialecte nigérian « tosso », « tubbi » [16] ; en dialecte camerounais « oum kouroum », « sap », « kekombichop », « kol », « Karehi », « sougoum », « kadanya», « kelé », « soro », « kire » [16] et en dialectes autochtones « shétoulou » [17], « bhindi », « bindi », « bamia » [7].
REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Le karité est un arbre qui pousse, uniquement, à l’état sauvage, dans le continent africain [2]. Il habite une zone géographique qui s’étend du Sénégal au Soudan au nord et de la Côte d’ivoire à l’Ouganda au sud (figure 2). Cette zone, surnommée « la ceinture du karité », forme une bande d’environ 5000 Km de longueur et 400 à 750 Km de largueur [18]. Elle couvre, environ, 1 million de Km² [19]. Sa limite, la plus septentrionale, se trouve à l’ouest et suit approximativement une ligne Kayes-Mopti-Niamey alors que sa limite, à l’est, se trouve entre les lacs Turkana (Rodolphe anciennement) et Victoria [20]. On retrouve le karité au : sud-est du Sénégal ; à l’est de la Guinée ; au nord de la Côte d’ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigeria et du Cameroun; au sud du Mali, du Niger, du Tchad et du Soudan; au Burkina Faso et au nord du Centrafrique et de l’Ouganda. Des petits peuplements ont été signalés en Ethiopie et en RDC (figure 2) [20,21]. Il est intéressant de remarquer que le karité n’approche nulle part des côtes [21]. Le karité est l’arbre typique des forêts sèches claires et des savanes arborées soudaniennes ayant une saison sèche très marquée (5 à 8 mois) et une pluviosité comprise entre 500 et 1200 mm par an. Il se développe, préférentiellement, sur sol sablo-argileux ou argilo-siliceux, évitant les zones régulièrement inondées [22].
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LE BEURRE DE KARITE
CHAPITRE I: ETUDE BOTANIQUE DU KARITE
I. HISTORIQUE
II. APPELLATIONS ET TAXONOMIE
III. REPARTITION GEOGRAPHIQUE
IV. DESCRIPTION BOTANIQUE DU KARITE
IV.1. Aspect général
IV.2. Le système racinaire
IV.3. Les branches
IV.4. Les feuilles
IV.5. Les fleurs
IV.6.Les fruits
IV.7. Les noix et les amandes
V. UTILISATIONS DU KARITE
V.1. Les racines
V.2. L’écorce
V.3. Le bois
V.4. Les feuilles
V.5. Les fleurs
V.6. Les fruits
CHAPITRE II: OBTENTION DU BEURRE DE KARITE
I. RECOLTE
II. PREPARATION DU BEURRE DE KARITE
II.1.Méthode traditionnelle
II.1.1. Dépulpage
II.1.2. Cuisson
II.1.3. Séchage des noix
II.1.4. Décorticage
II.1.5. Concassage
II.1.6. Grillage des amandes
II.1.7. Pilage et laminage des amandes
II.1.8. Barattage et lavages
II.1.9. Conditionnement et conservation du beurre de karité
II.2. Méthode artisanale
II.3. Méthode industrielle
II.3.1.Pression mécanique
II.3.2. Extraction chimique
III. RAFFINAGE DU BEURRE DE KARITE
III.1. Raffinage mécanique
III.2. Raffinage chimique
III.2.1. Neutralisation
III.2.2.Décoloration
III.2.3. Désodorisation
DEUXIEME PARTIE : ETUDE ANALYTIQUE DU BEURRE DE KARITE
CHAPITRE I : ETUDE PHYSICO-CHIMIQUE DU BEURRE DE KARITE
I.CARACTERISTIQUES DU BEURRE DE KARITE
I.1. Caractéres organoleptiques
I.1.1. Aspect
I.1.2. Couleur
I.1.3. Odeur
I.1.4. Saveur
I.2.Propriétés physico-chimiques
I.2.1. Propriétés physiques
I.2.2. Propriétes chimiques
II.COMPOSITION CHIMIQUE DU BEURRE DE KARITE
II.1. Fraction saponifiable
II.1.1. Les glycérides
II.1.2. Les esters cireux
II.1.3. Les acides gras
II.1.4. Les phospholipides
II.2. Fraction insaponifiable
II.2.1. Les esters résineux ou alcools triterpéniques
II.2.2. Les phytostérols ou karitéstrérols
II.2.3. Les hydrocarbures
II.3. Autres composés
III. COMPARAISON DES CONSTANTES PHYSICO-CHIMIQUES DU BEURRE DE KARITE AVEC CERTAINES GRAISSES ET AUTRES HUILES VEGETALES
III.1. Comparaison avec le beurre de cacao
III.2. Compositions chimiques comparées du beurre de karité et autres huiles végétales traditionnelles
CHAPITRE II : PROPRIETES BIOLOGIQUES ET UTILISATIONS DU BEURRE DE KARITE
I. PROPRIETES BIOLOGIQUES DU BEURRE DE KARITE
I.1. Partie saponifiable
I.2. Partie insaponifiable
I.3. Vitamines
I.4. Latex
II. UTLISATIONS DU BEURRE DE KARITE
II.1. Utilisations traditionnelles
II.1.1. En alimentation
II.1.2. En cosmétologie
II.1.3. En médecine traditionnelle
II.1.4. En savonnerie
II.1.5. En éclairage
II.1.6. Autres utilisations
II.2. Utilisations industrielles
II.2.1. En industrie agroalimentaire
II.2.1.1. En margarinerie
II.2.1.2. En biscuiterie et pâtisserie
II.2.1.3. En industrie chocolatière
II.2.2. En industrie cosmétique
II.2.3. En industrie pharmaceutique
TROISIEME PARTIE : PERSPECTIVES DU BEURRE DE KARITE
CHAPITRE I : PATRIMOINE DE KARITE
I. PROTECTION DU KARITE
II. SYLVICULTURE DU KARITE
III. ESSAIS DE MULTIPLICATION VEGETATIVE
III.1. Essais de multiplication végétative naturelle
III.2. Essais de multiplication végétative artificielle
IV. MENACES CLIMATIQUES
V. MENACES ANTHROPIQUES
VI. MENACES FONGIQUES
VII. PARASITISME VEGETAL
VIII. MENACES DES ANIMAUX ET DES INSECTES RAVAGEURS
CHAPITRE II : ECONOMIE DU KARITE
I. PRODUCTIONS MONDIALES DE NOIX ET DE BEURRE DE KARITE
II. EXPORTATIONS MONDIALES DE NOIX ET DE BEURRE DE KARITE80
III. IMPORTATIONS MONDIALES DE NOIX ET DE BEURRE DE KARITE81
IV. MARCHE DU BEURRE DE KARITE
V. ARTICULATION DE LA FILIERE COMMERCIALE DU BEURRE DE KARITE
CHAPITRE III : INTERET EN CHOCOLATERIE
I. LES GRANDES LIGNES DE LA CONTREVERSE DU CHOCOLAT
II. PERSPECTIVES EN CHOCOLATERIE
CONCLUSION