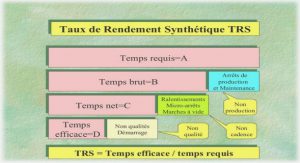Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Structure et synthèse du tramadol
Structure chimique
Le tramadol a comme nom chimique : 2-[(dimethylamino) methyl] -1-(3-methoxyphenyl) cyclohexan-1-ol hydrochloride. C’est une poudre cristalline blanche ou sensiblement blanche (Pharmacopée européenne). La forme commerciale utilisée est une combinaison du dextrogyre (+) et du lévogyre (-) énantiomères (Subedi et al., 2019).
L’hydrochloride tramadol est formé de seize (16) atomes de carbone, vingt-cinq (26) molécules d’hydrogènes, deux (2) atomes d’oxygènes, un azote et un groupement chlore. Il est composé d’un groupe azote lié à deux groupes méthyl et à un phényle lui-même unis à un hydroxyle et à un noyau aromatique relié à un groupe méthoxy.
Synthèse
Synthèse chimique
La synthèse chimique du tramadol hydrochloride débute par une réaction de Mannich entre le cyclohexanone (1), paraformaldéhyde (ou formaldéhyde) (2), et diméthylamine hydrochloride (ou diméthyle amine sulfate) (3) pour former le 2 diméthylaminométhyl-cyclohexanone hydrochloride (4). Après conversion du (4) en une base libre (5), il y’a addition du méthoxy-phényle bromure de magnésium (ou m méthoxy-phényle de lithium pour produire le tramadol base(Smyj et al., 2013).
La figure 2 illustre la synthèse chimique du tramadol hydrochloride.
Biosynthèse du tramadol
Récemment il a été démontré qu’on pouvait extraire le tramadol d’une plante originaire du Cameroun Nauclea latifolia (Kusari et al., 2014). En effet il serait présent dans les racines et l’écorce de cette plante (Schmidt et al., 2015).
L’extraction et la caractérisation se font par HPLC et les propriétés analgésiques sont testées in vivo sur des modèles de souris(Subedi et al., 2019).
Les acides aminés : L-lysine, L-arginine, L-tyrosine, L-phénylalanine et L-tryptophane sont des précurseurs biosynthétiques du tramadol. Une voie biosynthétique a été proposée par les auteurs par analyse isotopique spécifique à la position 13C(Schmidt et al., 2015).
Propriétés physico-chimiques
L’hydrochloride de tramadol est un solide soluble dans l’eau et le méthanol ; il est peu soluble dans l’acétone. Le tableau I qui suit montre quelques propriétés physico-chimiques du tramadol hydrochloride.
Pharmacologie
Le médicament à base de tramadol est un antalgique central classé dans le palier 2. Il est indiqué dans le traitement de la douleur aigue ou chronique sévère à modérée. Il s’est révélé efficace dans les douleurs, neuropathiques, relatives à l’ostéoarthrite, au rhumatoïde et à la lombalgie(Hassamal et al., 2018).Il est administré par voie orale, rectale, intramusculaire et intraveineuse.
Mécanisme d’action
L’hydrochloride de tramadol agit au niveau du système nerveux central. Le mélange racémique (+) dextro et (-) lévo énantiomères ont une action analgésique synergique (Subedi et al., 2019).En effet on note une action agoniste opioïde et une action monoaminergique en inhibant la recapture de la sérotonine et de la norépinephrine(Dickman, 2007).Le (+) tramadol et le métabolite (+) -O-déméthyle-tramadol (M1) sont des agonistes du récepteur opioïde μ. Le (+) tramadol inhibe la recapture de la sérotonine tandis que le (-) tramadol inhibe la recapture de lanorépinephrine. Ceci accroit l’inhibition de la transmission de la douleur (nociceptive) au niveau de la moelle épinière(Grond & Sablotzki, 2004). Il faut noter aussi que le M1 tramadol a 300 fois plus d’affinité sur les récepteurs opioïdes μ que la molécule mère(Sheikholeslami et al., 2016).La complémentarité et l’action synergique des 2 énantiomères bonifient l’action analgésique et la bonne tolérance du mélange racémique.
Pharmacocinétique
Absorption et biodisponibilité
Après administration d’une dose orale de 100mg au volontaire sain, le tramadol est rapidement absorbé ; les concentrations plasmatiques sont décelables environ 15 à 45minutes après ingestion. La concentration plasmatique maximale est atteinte en deux heures environ et l’état d’équilibre est trouvé au bout de deux jours maximum(Dayer et al., 1994).
Après administration d’une dose unique, la biodisponibilité orale moyenne du tramadol se situe entre 68 et 75%. A doses itératives, la biodisponibilité augmente et peut atteindre 90 à 100 % ceci est probablement dû au premier passage métabolique(Sheikholeslami et al., 2016).
Distribution
Le tramadol a eu une structure lipophile entrainant ainsi une bonne diffusion tissulaire. Son volume de distribution après une administration orale chez un sujet malade jeune est de 306L. Cependant sa fixation au niveau des protéines plasmatiques est faible (20 % environ)(Smyj et al., 2013).Le pic de concentration au niveau du cerveau est atteint par la molécule mère et son métabolite majeur (M1) respectivement 10 et 20-60 minutes après administration. Ils traversent facilement la barrière placentaire (80 % de la concentration maternelle)par contre ils sont excrétés en faible quantité au niveau du lait maternel (1 %) (Sheikholeslami et al., 2016).
Métabolisme
Le tramadol est métabolisé exclusivement au niveau du foie par le cytochrome P450 système enzyme. Il subit six réactions métaboliques : O-déméthylation, N-déméthylation, oxydation du cyclohexyle, N désalkylation oxydative, déshydratation et enfin conjugaison. La transformation se déroule en deux phases ; la phase 1 est composée principalement de réactions de O-N déméthylation et la 2ème phase constituée de conjugaison(Sheikholeslami et al.,2016) ;(Miotto et al., 2017).
Le cytochrome P2D6 catalyse la réaction de transformation du tramadol en O-déméthyle tramadol (M1) et les cytochromes P-450 3A4 et B6 agissent au niveau de la réaction de N-déméthylation pour la formation du N-déméthyle tramadol(Hassamal et al., 2018).M1 et M2 sont à nouveau métabolisés pour donner trois autres métabolites secondaires que sont le di-N, N-déméthyle tramadol (M3), le tri-N-N O-déméthyle tramadol (M4) et di-N,O-déméthyle tramadol (M5). Les O-déméthyles tramadol à savoir M1, M4 et M5 subissent des réactions de conjugaison pour finir en sulfates et glucuronides (réactions phase 2). Tout au long de la phase 1, onze métabolites vont être produits et douze durant la phase 2(Gillen et al., 2000).M1 est le métabolite le plus actif possédant un effet analgésique opioïde ce qui n’est pas le cas de M2 qui est pharmacologiquement inactive et ne possède pas d’activité sur les récepteurs opioïdes et M5 est active mais a un faible pouvoir analgésique comparé à M1(Sheikholeslami et al., 2016) ;(Hassamal et al., 2018).
Remarque : Le cytochrome P2D6 responsable de la transformation du tramadol en M1 est polymorphe. Il varie selon les individus. Cette variabilité du phénotype peut être classée en quatre catégories : les faibles métaboliseurs, les métaboliseurs intermédiaires, les métaboliseurs extensifs et les métaboliseurs ultra-rapides. Ceci affecte le métabolisme du tramadol et l’accumulation de ses métabolites causant des différences sur l’efficacité et l’apparition d’effets indésirables(Subedi et al., 2019) ;(Sheikholeslami et al., 2016).
Elimination
Le tramadol est excrété principalement par le rein, 90% dans les urines et 10% dans les selles. 25 à 32% sont éliminés sous forme inchangée ; le temps de demie vie d’élimination est de 5 à 6h et la clairance après administration orale est de 742 ml/min(Smyj et al., 2013). Le temps d’élimination de M1 est plus long (6,7 et 9h). Chez les personnes présentant une insuffisance rénale ou hépatique sévère, le temps de demi-vie est prolongé respectivement par un facteur de 2 ou 3. De ce fait il est recommandé d’accroître l’intervalle entre les prises chez ces patients (Dayer et al., 1994).
Pharmacodynamie
Indications
L’efficacité antalgique du tramadol a été démontrée par de nombreuses études. Le tableau II montre l’utilisation du médicament à base de tramadol dans les différentes douleurs.
Interactions médicamenteuses
D’après le site drug.com le médicament de tramadol interagit avec 946 médicaments ; 491 sont des interactions médicamenteuses majeures, 447 sont des interactions modérées et 8 sont mineures.
Il interagit principalement avec les inhibiteurs de la MAO, les antidépresseurs (tégrétol), les anticoagulants (digoxine) certains antibiotiques (rifampine, érythromycine, quininidine) et les médicaments qui peuvent provoquer une somnolence. L’association est déconseillée avec les antagonistes morphiniques (buprénorphine, nalbuphine, pentazocine), l’alcool, la carbamazépine et la naltrexone. Enfin diverses autres associations doivent être prises en compte avec les autres analgésiques morphiniques agonistes, antitussifs morphine (dextrométhorphane, noscapine, pholcodine), antitussifs morphiniques vrais (codéine, éthylmorphine), benzodiazépines, barbituriques, autres médicaments sédatifs, inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine, venlafaxine, médicaments abaissant le seuil épileptogène (notamment les antidépresseurs imipraminiques et inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine) (Subedi et al., 2019) ; ( Ciles et al., 2013).
Toxicologie
Le tramadol est connu comme étant un opioïde atypique car il possède un faible potentiel d’abus d’où sa bonne tolérance. La dose à ne pas dépasser est de 400mg par jour et le taux sanguin thérapeutique est de 0,1 à 0,3mg/l (Senay et al., 2003) ; (Michaud & al., 1999). Son intoxication est visible aux doses de 0,03 à 22,59 mg/l et entraine des effets semblables à ceux des opioïdes à savoir myosis, vomissement, dépressions ou arrêt respiratoire, hyperexcitabilité du SNC (convulsions), coma et collapsus cardiovasculaire. Il peut entrainer la mort surtout s’il est associé aux dépresseurs du SNC à l’exemple d’Alprazolam et de l’éthanol (Epstein et al., 2006) ; (Michaud et al., 1999).
Même si le tramadol a des effets comparables aux opioïdes, la survenue d’une accoutumance semble rare et les syndromes de sevrages sont moins sévères que ceux provoqués par les autres opioïdes. Des données recueillies par le système de pharmacovigilance en Allemagne confirment ces propos en révélant moins de cas d’abusif avec le tramadol qu’avec la dihydrocodéine, la codéine, la tilidine/nalaxone ou le dextropropoxyphéne lorsque ce nombre de cas d’usage abusif a été comparé à la quantité de médicaments prescrit, et ce sur une période de 14ans. Les symptômes d’activation du SNC avec myosis et dépression respiratoire peuvent être attribués aux effets monoaminergiques de la molécule et l’administration de nalaxone (dépression respiratoire) ou de benzodiazépines (convulsions) amène une disparition rapide des signes de toxicité(Dayer et al., 1994).
Le tramadol et ses métabolites N-démethyl tramadol, O-démethyltramadol peuvent être détectés dans le sang par chromatographie gazeuse couplée à la spectrométrie de masse (CG-MS) après extraction basique et acétylation. Ils peuvent aussi être trouvés au niveau du contenu gastrique (Michaud et al., 1999).
La dose létale du tramadol est de 300 à 350 mg/kg(Subedi et al.,2019).
GENERALITES SUR LA PHARMACODEPENDANCE
Définitions
Pharmacodépendance
D’après l’OMS, la pharmacodépendance est définie comme « un état psychique et quelquefois également physique résultant de l’interaction entre un organisme vivant et un médicament se caractérisant par des modifications du comportement et par d’autres réactions, qui comprennent toujours une pulsion à prendre le médicament de façon continue ou périodique afin de retrouver ses effets psychiques et quelquefois d’éviter le malaise de la privation ». Cet état peut s’accompagner ou non de tolérance. Un même individu peut être dépendant à l’égard de plusieurs médicaments.
La dépendance psychique est « un état dans lequel il existe un sentiment de satisfaction et une impulsion psychique qui nécessitent l’administration régulière ou continue de drogue afin de produire du plaisir ou d’éviter les sensations désagréables ».
La dépendance physique quant à elle « est un état d’adaptation qui se manifeste par des troubles physiques intenses lors de l’interruption de l’administration de la drogue ou lorsque l’effet de la drogue est modifié par l’administration d’un antagoniste spécifique »(Kramer & Cameron, 1975).
Abus
L’abus est un mauvais emploi, un usage excessif ou injuste de quelque chose. C’est le fait d’outrepasser aussi certains droits, de sortir d’une norme, d’une règle et, en particulier, injustice, acte répréhensible établis par l’habitude ou la coutume ; excès selon Larousse.
Le terme abus des drogues est un jugement social. Il serait difficile de formuler une définition qui soit acceptable par la majorité des personnes s’occupant de l’usage des drogues. On peut estimer qu’une personne abuse de drogues lorsqu’elle utilise une substance illicite (par exemple l’héroïne ou la cocaïne), lorsqu’elle fait usage d’une substance licite en quantité considérée comme excessive par d’autres personnes (par exemple l’éthanol) ou lorsqu’elle consomme une substance licite, quelle qu’en soit la quantité (par exemple le tabac)(OMS, 2002)(John C.M. Brust, M.D., 2004).
Détournement
Le détournement est défini par Larousse comme « une action de soustraire illégitimement quelque chose à sa destination normale pour son profit ». Le médicament peut faire objet de détournement, qui selon la définition communément acceptée consiste dans son utilisation « en dehors de sa norme d’usage, c’est-à-dire à une fin autre que celle pour laquelle il était initialement prévu. Le détournement concerne généralement les médicaments sur ordonnance, mais peut aussi impliquer des médicaments en vente libre s’ils sont utilisés non conformément aux indications précisées sur la notice du produit (Thoër et al.,2008).
Addiction
Le Larousse médical définit l’addiction comme un processus de dépendance plus ou moins aliénante à des toxiques ou à des comportements.
L’addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d’accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s’accompagne d’une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives(Larousse, s. d.-b).
L’addiction est une dépendance psychique. Le terme anglais « addict » que l’on pourrait traduire par accro désigne une personne dont la dépendance psychique, associée ou non à une dépendance physique, fait de la recherche de drogue une préoccupation quotidienne.
En 1964, le Comité d’experts pour la pharmacodépendance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a émis la recommandation que les termes addictionaux drogues et accoutumance aux drogues soient remplacés par le terme pharmacodépendance (Eddy et al., 1965).
Drogues, stupéfiants
La drogue est une « substance psychotrope naturelle ou synthétique, généralement nuisible pour la santé, susceptible de provoquer une toxicomanie, et consommée en dehors d’une prescription médicale» (Larousse, s. d.-a).En pharmacologie, toute substance capable de perturber les mécanismes physiologiques est une drogue ; les médicaments sont des drogues employées à des fins thérapeutiques (Universalis, s. d.).Selon L HULSMAN et H.van RANSBEEK, les drogues sont des substances produisant un changement de la conscience (Hulsman & Van Ransbeek, 1983).
Un stupéfiant est une substance, médicamenteuse ou non, dont l’action sédative, analgésique, narcotique et/ou euphorisante provoque à la longue une accoutumance et une pharmacodépendance (toxicomanie) (Larousse).Les stupéfiants sont généralement des produits toxiques agissant sur le système nerveux et conduisant à la dépendance d’après le Conseil Aide et Action contre la Toxicomanie(CAAT)(Carcel, 2007)
Mésusage
Le mésusage est « un usage abusif ou détourné de quelque chose ».En pharmacologie, un mésusage est une utilisation intentionnelle et inappropriée d’un médicament ou d’un produit, non conforme à l’autorisation de mise sur le marché ou à l’enregistrement ainsi qu’aux recommandations de bonnes pratiques(CRPV, 2014)
Aspects neurologiques de la pharmacodépendance
La recherche sur les mécanismes neurobiologiques qui sous-tendent le développement de l’addiction des substances psychoactives a produit ces dernières années un changement radical de la compréhension de ce trouble « bio-psycho-médico-social ». Il serait intéressant de comprendre pourquoi une certaine partie des gens perd la liberté de s’abstenir alors qu’il y a une autre partie qui a les capacités de résister à l’addiction. Les facteurs mis en jeu sont maintenant mieux compris. Parmi ceux-ci, on retrouve les facteurs génétiques (environ 50 % du risque de développer une addiction, avec par exemple leur participation dans la sensibilité aux effets plaisants, la tolérance et le métabolisme), les facteurs développementaux (vie intra-utérine, enfance, adolescence) et les facteurs environnementaux (stress, drogue, social, familial, culturel) qui sont impliqués dans le risque de perdre le contrôle de la consommation et de présenter un usage compulsif(Inserm, 2014).
L’addiction est liée dans un premier temps au plaisir des prises initiales et implique l’augmentation de la transmission dopaminergique du circuit mésocorticolimbique. Le chemin qui mène du plaisir à la dépendance passe très certainement par des phénomènes liés d’une part à l’automatisme dans lequel le comportement initialement motivé devient par la suite une habitude et d’autre part à une augmentation progressive de la motivation à consommer (tolérance inverse ou sensibilisation)(Vanderschuren & Pierce, 2010). Les effets plaisants, dits encore récompensant des drogues sont relayés par la libération de dopamine dans le noyau accumbens (Nac) par les terminaisons synaptiques en provenance des neurones de l’aire tegmentale ventrale (ATV) du circuit mésocorticolimbique. En effet, les drogues font une usurpation du rôle des comportements (alimentation, sexualité) ou les effets des substances qui produisent naturellement du plaisir via la libération de dopamine. Ces différents mécanismes dont la diminution du tonus inhibiteur qu’exercent les neurones GABAergiques sur les neurones dopaminergiques de l’ATV, la libération d’opioïdes et d’endocannabinoïdes endogènes, et une action directe sur les neurones dopaminergiques en augmentant leur fréquence de décharge expliquent l’augmentation extracellulaire de la dopamine. Il faut noter que la libération de dopamine dans la partie dorsale du striatum (région qui semble jouer un rôle majeur dans les aspects liés aux habitudes et aux automatismes caractéristiques du comportement addictif et de la recherche compulsive de drogue) induite par l’indice contextuel pourrait même être supérieure à celle induite par la drogue elle-même. Ceci démontre l’importance de l’environnement dans l’addiction. Ces indices environnementaux associés au désir de consommer la drogue entraînent des réponses conditionnées en contrôlant la transmission dopaminergique et maintiennent une forte motivation à consommer (Schultz, 2010).Chez les sujets dépendants, des études d’imagerie ont montré des niveaux supra-physiologiques de dopamine dans le Nac associés à une diminution marquée de la fonction dopaminergique, avec notamment une réduction des taux de récepteurs D2 de la dopamine. La diminution de la transmission dopaminergique est à l’origine de la baisse généralisée de la sensibilité du système de la récompense aux effets des récompenses naturelles. En revanche, les effets de la drogue et l’apprentissage conditionné entre ces effets et les stimuli neutres associés (indices contextuels) se renforcent. La baisse des récepteurs D2 de la dopamine pourrait jouer un rôle majeur dans la vulnérabilité à devenir dépendant.
La figure 7 est une représentation du neurone dopaminergique de l’aire tegmentale ventrale projetant dans le noyau accumbens et sous le contrôle d’interneurones GABAergiques et opioïdergiques.
Dans les premières étapes du développement de l’addiction, les consommations associées au plaisir voire à l’intoxication activent le circuit de la récompense (Nac, ATV et pallidum ventral) et donc celui de la sortie motrice (striatum dorsal et cortex moteur). Le circuit de la récompense est toujours sous le contrôle inhibiteur cortical du circuit impliqué dans le contrôle exécutif (cortex préfrontal dorsolatéral (CPFDL), cortex cingulaire antérieur (CCA), cortex frontal inférieur (CFI) et cortex orbitofrontal latéral (COF). Parmi les critères de la pharmacodépendance, on retrouve la perte de contrôle de la consommation se caractérisant par un déséquilibre qui favorise la sur-activation des circuits de la récompense, de la motivation et de la mémoire/conditionnement (amygdale, COF médian pour l’attribution de la plus-value et le striatum dorsal pour les habitudes/automatismes) qui entraîne une exagération de la valeur attendue de la drogue. Deux autres circuits sont aussi suractivés, impliquant un réseau neuronal jouant un rôle dans l’humeur incluant la réactivité au stress (amygdale et hypothalamus) et l’intéroception (insula et CCA) contribuant au craving. Plusieurs systèmes de neurotransmission interviennent dans ces neuro-adaptations impliquant le glutamate, le GABA, la noradrénaline, la corticolibérine (Corticotropin Releasing Factor ou CRF) et les opioïdes(Baler & Volkow, 2006).
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : GENERALITES SUR LE TRAMADOL ET LA PHARMACODEPENDANCE
I Généralités sur le tramadol
I.1 Historique
I.2 Structure et synthèse du tramadol
I.2.1 Structure chimique
I.2.2 Synthèse
I.2.2.1 Synthèse chimique
I.2.2.2 Biosynthèse du tramadol
I.3 Propriétés physico-chimiques
I.4 Pharmacologie
I.4.1 Mécanisme d’action
I.4.2 Pharmacocinétique
I.4.2.1 Absorption et biodisponibilité
I.4.2.2 Distribution
I.4.2.3 Métabolisme
I.4.2.4 Elimination
I.4.3 Pharmacodynamie
I.4.3.1 Indications
I.4.3.2 Contre-indications
I.4.3.3 Effets indésirables
I.5 Toxicologie
II GENERALITES SUR LA PHARMACODEPENDANCE
II.1 Définitions
II.1.1 Pharmacodépendance
II.1.2 Abus
II.1.3 Détournement
II.1.4 Addiction
II.1.5 Drogues, stupéfiants
II.1.6 Mésusage
II.2 Aspects neurologiques de la pharmacodépendance
II.3 Prise en charge de la dépendance
DEUXIEME PARTIE : ABUS ET DETOURNEMENTS D’USAGE DES MEDICAMENTS A BASE DE TRAMADOL DANS LE MONDE
I. Objectifs
I.1 Objectif général
I.2 Objectifs spécifiques
II. Méthodologie
III Résultats
III.1 En Europe
III.2 En Asie
III.3 En Afrique
III.4 En Amérique
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet