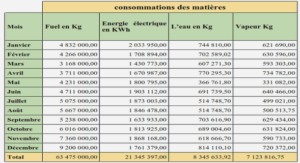Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Elevage au Mali
Typologie des systèmes d’élevage au Mali
Systèmes traditionnels
Les systèmes traditionnels de production du bétail sont fondés sur trois formes principales d’élevage : l’élevage nomade, l’élevage transhumant et l’élevage sédentaire. Ces trois formes se regroupent au sein de deux systèmes de production : les systèmes pastoraux avec élevage nomade et transhumant et les systèmes agropastoraux avec l’élevage sédentaire.
Systèmes pastoraux
Ils se pratiquent sur des zones où la pression sur la terre est faible et où l’agriculture est presque absente en raison de la faiblesse des précipitations et de l’aptitude des sols. Les terres de ces zones sont à usage pastoral et sylvicole.
Elevage nomade
L’élevage nomade se caractérise par des déplacements fréquents des éleveurs et de leurs troupeaux sans campement fixe au gré des ressources. Les aires de nomadisation sont distinctes ou confluentes et les groupes domestiques sont plus ou moins dissociés. Le procès de production se réalise sur un cycle saisonnier. Ce type d’élevage ou système pastoral pur est localisé dans les zones subdésertiques du Nord du pays (Adrar, Azaouad, Azaouak, Tilemsi) et au Nord du Sahel (Gourma et le Hodh). Les races élevées dans ces zones sont les zébus Maure et Touareg pour les bovins, les moutons et les chèvres du Sahel et les camelins.
Elevage transhumant
L’élevage transhumant comporte un système associé aux cultures pluviales et un système associé aux cultures de décrue. Il est caractérisé par des mouvements d’aller-retour entre territoires pastoraux par des groupes ou des communautés pastorales à la recherche de ressources dans des territoires autres que les leurs. Ces mouvements (transhumance) se font selon des axes définis et pour une période donnée.
La transhumance est un phénomène caractéristique du Sahel. Elle amène les pasteurs du Sud vers le Nord en début de saison des pluies pour éloigner les troupeaux des zones sous exploitation agricole ou des zones inondables (cas du Delta Central Nigérien). Le retour vers le Sud s’effectue au fur et à mesure de l’assèchement des points d’eau de surface et l’épuisement des pâturages du Nord. En saison sèche, les ressources disponibles pour les animaux sont plus importantes au Sud (eau des cours d’eau, pâturages de décrue, graminées pérennes, sous-produits de récoltes…).
Dans la zone agropastorale du Delta intérieur du Niger existait un code pastoral hérité de l’empire de la Dina au début du XIX è siècle. Selon ce code, le Delta était subdivisé en territoires de pacage ou leydi. Un leydi était formé de villages de Peuhls sédentaires (ouro) et de pâturages, de villages de cultivateurs Rimaïbé (saré) et leurs terrains de culture, et un réseau de couloirs de passage pour le bétail.
Systèmes agropastoraux
Ce sont des systèmes où cohabitent agriculture et élevage. On distinguera dans ces systèmes en raison de la prédominance de l’une ou de l’autre des activités, un sous-système à élevage dominant et un sous-système où l’agriculture est l’activité principale.
Sous-système à élevage dominant :
Ce sous-système existe à la frange nord de la zone sahélienne où l’irrégularité des pluies ne donne pas de garantie sûre pour les cultures, mais assure une production herbagère sur des zones encore étendues. Les éleveurs cultivent pendant la saison pluvieuse quelques zones de pénéplaine ou de bas-fonds aux fins d’une production complémentaire de subsistance. La transhumance est de règle mais l’’animal fait l’objet de peu de soins et s’intègre très peu à l’agriculture. Il fournit du lait et de la viande pour la consommation de l’éleveur et joue surtout un rôle d’épargne.
Sous-système à agriculture dominante
Il s’agit du système sédentaire où l’accent est mis sur l’agriculture. Quelques éleveurs sédentarisés et devenus agriculteurs s’adonnent à une transhumance de courte durée sur de faibles parcours. L’élevage se développe dans ce système par l’acquisition d’animaux par les agriculteurs grâce aux revenus tirés de l’agriculture. Ces animaux constituant une épargne, s’intègrent dans la production agricole par la fourniture de travail (bœufs de labour) et de fumier (contrat de fumure passés entre bergers et agriculteurs).
Système de production commerciale
L’amélioration des productions animales vise non seulement à accroître ces dernières pour la consommation des éleveurs, mais aussi à dégager des surplus susceptibles d’être commercialisés. Les systèmes de production commerciale portent ainsi sur deux domaines principaux : la production laitière et l’embouche.
Production laitière
Pour augmenter leur production de lait, quelques agropasteurs ont commencé à sélectionner les meilleures laitières de leur troupeau afin d’améliorer leur base alimentaire. L’amélioration de l’alimentation par l’utilisation de fourrages cultivés, de tourteaux de coton, de paille mélassée, de graines de coton ou d’aliment bétail a permis d’augmenter la production laitière de 0 à 3-5 L/j en saison sèche dans certains élevages de la zone cotonnière. Le lait produit est vendu aux mini-laiteries qui se sont installées dans certains centres urbains. Les producteurs alléchés par les revenus tirés, s’orientent à présent vers l’amélioration génétique par insémination artificielle aux fins d’accroître leur production laitière. Cette stratégie est adoptée par quelques éleveurs de la zone CMDT de Koutiala, de Sikasso et des régions de Mopti et Ségou.
Cette spéculation laitière est devenue l’activité dominante dans les élevages urbains et périurbains où existe un nombre élevé d’animaux de races améliorées. Des pics de production de 20 L/j ont pu être obtenus dans certains parcs de la zone périurbaine de Bamako.
Embouche
L’activité d’embouche est moins développée par rapport à la production laitière. Elle est pratiquée par quelques éleveurs de la zone périurbaine et par certains agropasteurs en zone rurale. Les animaux embouchés sont essentiellement des bovins en zone périurbaine et des moutons (moutons de Tabaski) ou des bovins de réforme (vaches stériles, bœufs de labour ou autres mâles en fin de carrière) en zone rurale.
Principales races bovines au Mali
Au Mali, on y rencontre plusieurs races de zébus et taurins.
Zébus
– Zébu Maure: la femelle est considérée comme une bonne laitière. En élevage extensif, elle donne entre 800 et 1000 litres de lait par an à 4.5 % de matières grasses. On le rencontre tout le long de la frontière avec la Mauritanie, dans la boucle du Niger principalement dans le cercle de Goundam et dans le delta central (SIDIBE, 2012).
– Zébu Touareg: il se rencontre dans la boucle du Niger au nord du delta central du Niger (Niafounké, Goundam). Son aptitude bouchère est très développée.
– Zébu Azawak: au Mali, sa zone privilégiée se trouve dans le cercle de Ménaka. Cette race est considérée comme la plus laitière de l’Afrique de l’ouest. Dans les élevages améliorés, la production laitière journalière peut atteindre 7-8 litres par jour voire 12 litres en station.
– Zébu Peulh Malien: C’est un zébu à grandes cornes et comporte des variétés soudanaises, nigériennes et sénégalaises. Au Mali, on le rencontre dans le Macina, les cercles de Nara, Nioro, dans la boucle du Niger et sur le plateau central nigérien. Actuellement, avec le déplacement des populations bovines. Son aire s’étend jusqu’à l’extrême sud du pays dans le cercle de Kadiolo. Les principales variétés sont:
o Zébu Peul soudanais: (région de Ségou), il a une robe grise, noire-pie et pie-noire type standard du Sahel (SIDIBE, 2012);
o Zébu Peulh du Macina: comporte plusieurs variétés qui sont: zébu Warbé ; zébu Peulh du Gondo-Mondoro ; zébu Peulh du delta; zébu Peulh du Séno
o Zébu Peulh Toronké: nord de la région de Kayes, présente d’excellentes aptitudes bouchères.
o Zébu Peulh Sambourou : rencontré dans les régions de Kayes et de Koulikoro, bon animal de boucherie avec des rendements-carcasse de 46 % en élevage extensif,
pouvant atteindre 55 % en embouche;
o Zébu Peulh Bororo : atteint 300-400 kg pour les mâles et 250-300 kg pour les femelles. La lactation s’étale sur 6 mois en moyenne et varie entre 2 litres en début et 1.5 litres en fin de lactation (SIDIBE, 2012).
Taurins
– Race N’dama : La race N’dama est le type le plus représentatif de l’espèce taurine en Afrique occidentale. Son berceau est le Fouta Djallon en Guinée. Au Mali, elle est rencontrée dans les cercles de Yanfolila (régions de Sikasso), Kéniéba et Kita (régions de Kayes). C’est une race connue pour sa trypanotolérance. Son aptitude bouchère est appréciable. Les taureaux atteignent 300 kg en moyenne et la vache 250 kg. Son rendement-carcasse est de 45 à 50 %.
Sous-race Méré: C’est un produit de croisement du N’dama et zébu Peulh qui possède des caractères ethniques bien fixés. Son aire géographique est le Kaarta, le Bélédougou, le Mandé et le Miankala. La vache donne 300 à 800 litres de lait par lactation et le rendement-carcasse est de 45-50 % (SIDIBE, 2012).
Importance de l’élevage au Mali
Le sous-secteur de l’élevage, de par son importance stratégique dans l’économie malienne, et la conjoncture actuelle marquée par une demande très forte des populations en produits animaux, figure en bonne place dans les actions prioritaires du Gouvernement. Selon MALI-INSTAT (2015), sa contribution au PIB national est de 15,2% en 2013 derrière les produits de l’agriculture (16,2%) et devant l’or (7,2%) Le cheptel national occupe le premier rang dans l’espace UEMOA et le second dans l’espace CEDEAO. Les effectifs sont estimés à : 10 622 620 bovins, 15 143 415 ovins, 21 087 150 caprins, 1 008 540 camelins, 538 500 équins, 979 000 asins, 82 425 porcins et 38 587 450 volailles (MALI-DNPIA, 2015). Le tableau II résume l’évolution des effectifs du cheptel malien des dix dernières années.
Contraintes zootechniques
Le faible potentiel génétique des races locales constitue l’élément fondamental de cette contrainte. Les productions laitières et bouchères des races locales sont toujours inférieures à celles des races exotiques.
Contraintes alimentaires
Elle représente une des contraintes majeures au développement de l’élevage en raison de la faiblesse des productions agricoles. Cette contrainte dépend de la pluviométrie, capricieuse et très aléatoire. On remarque surtout une réduction des aires de pâturages par une faiblesse de la disponibilité végétale surtout en saison sèche mais aussi l’obstruction des pistes de transhumance par l’accroissement des zones de culture. L’insuffisance en quantité et en qualité des sous-produits agricoles et agro-industriels demeure aussi une source non négligeable de ce déficit alimentaire (SIDIBE, 2012)
Contraintes d’eau
Les grandes zones d’élevage sahélien au Mali sont (à l’exception du Delta Central et des abords des fleuves) dépourvues de points d’eau permanents. Les eaux de surface qui s’y trouvent, s’assèchent dès le début de la saison sèche. La recherche de l’eau devient par conséquent un problème capital pendant la saison sèche dite période de disette. La dispersion des points d’eau existants (mares permanentes, puits, puisards) et leur éloignement des pâturages exploitables en cette saison, imposent des longs déplacements qui affaiblissent les animaux. Les ressources disponibles ne couvrent que les besoins d’entretien des animaux et leur productivité chutent considérablement (COULIBALY, 2003)
Contraintes pathologiques
Les principales maladies rencontrées chez les bovins au Mali sont la pasteurellose, la rickettsiose, la trypanosomose, la tuberculose, la brucellose et le charbon symptomatique. Des foyers de péripneumonie apparaissent périodiquement dans certains élevages. A ces grandes épizooties il faut ajouter les maladies parasitaires (parasites internes et externes) qui affectent surtout les jeunes et entraînent chez eux une mortalité élevée. Toutes ces maladies à cause d’une couverture vaccinale insuffisante et en l’absence d’un déparasitage systématique, provoquent une baisse de productivité chez les animaux et des pertes sèches (COULIBALY, 2003).
GENERALITES SUR LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE (PPCB)
Définition-Importance-Répartition géographique
La péripneumonie contagieuse bovine est une maladie infectieuse, contagieuse, transmissible, due à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype Small Colony (MmmSC). Elle est caractérisée sur le plan clinique par des troubles respiratoires (toux, dyspnée, jetage), des troubles articulaires (boiteries) chez les jeunes de moins de deux ans. Au plan lésionnel, on note une pneumonie et une pleurésie exsudatives, séro-fibrineuses dans les cas aigus et la présence de séquestres pulmonaires dans les cas chroniques. La maladie affecte essentiellement les bovins (Bos indicus, Bos taurus) et les buffles domestiques (Bubalus bubalus). Les buffles sauvages (Syncerus caffer) ne sont pas atteints dans les conditions naturelles. (YAYA, 2008)
Importance
La peste bovine a longtemps été considérée comme la principale menace du cheptel en Afrique. Après le succès des campagnes d’éradication de cette maladie basées sur la vaccination à grande échelle, les services vétérinaires des pays africains considèrent la PPCB comme une priorité sanitaire. Mais, pour de nombreuses raisons, il est difficile d’évaluer les pertes occasionnées par cette maladie. Une étude menée dans 12 pays Africains (Burkina Faso, Tchad, Côte d’Ivoire, Ethiopie, Ghana, Guinée, Kenya, Mali, Mauritanie, Niger, Tanzanie et Ouganda) a montré que les pertes dues à la PPCB, sont estimées par pays à 3,4 millions d’euros pour la PPCB endémique et 5,3 millions d’euros pour la PPCB épidémique. Au Nigeria, les pertes économiques dues à la PPCB ont été estimées en 1981 à 3,6 millions de dollars (YAYA, 2008). En 2000, le Mali a enregistré des pertes estimées à 548 476 euros du fait de la PPCB. (ABIOLA et al., 2005).
Répartition géographique
La PPCB était autrefois répandue en Europe et la plupart des autres continents. Ses répercussions économiques importantes dans les pays atteints justifient son inscription dans la liste des maladies notifiables de l’OIE. Grâce à des mesures de prophylaxie efficaces, son aire d’activité a été considérablement réduite, et seule l’Afrique continue à payer un lourd tribut à la maladie.
En Europe, l’Espagne est indemne depuis 1994, la France depuis 1906. Des foyers erratiques ont été cependant, observés en 1967, 1982 et 1984 (départements frontaliers franco-espagnols). Elle est maladie réputée contagieuse en Afrique et en France.
Etiologie
La péripneumonie contagieuse bovine est due à Mycoplasma mycoides subsp. mycoides biotype Small Colony (MmmSC). L’agent de la PPCB constitue le chef de file du groupe des Mycoplasmes et présente toutes les caractéristiques. Les mycoplasmes sont des micro-organismes procaryotes, limités par une membrane plasmique, dépourvus de paroi et incapables de synthétiser ses éléments précurseurs (acides muramique et diaminopimélique). Ils se développent sur milieux artificiels, liquides ou solides (acellulaires) avec des colonies typiques incrustées par leur centre dans la gélose. Ils ont un pléomorphisme très marqué (forme coccoïdes, en anneau, en massue, en chaînette, en hélice, triangulaire, astéroïdes, filamenteuse, bourgeonnantes ou ramifiées etc.) dû à l’absence de paroi rigide. Leur taille très petite est de l’ordre de 90 à 300 micromètres. La filtration membranaire à une porosité moyenne est de 450 micromètres. Les mycoplasmes sont stérol-dépendants excepté le genre Acholeplasma. Ils sont pénicillino-résistants mais sensibles aux antibiotiques intervenant dans la synthèse des protéines (AWOUNAM, 2009).
|
Table des matières
Introduction
PREMIERE PARTIE : SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
Chapitre I : Présentation du Mali
I.1. Relief et hydrographie
I.2. Climat
I.3. Flore et Faune
I.4. Découpage administratif du Mali
I.5. Démographie
I.6. Economie
Chapitre II : Elevage au Mali
II.1. Typologie des systèmes d’élevage au Mali
II.1.1. Systèmes traditionnels
II.1.1.1. Systèmes pastoraux
II.1.1.2. Systèmes agropastoraux
II.1.2. Système de production commerciale
II.2. Principales races bovines au Mali
II.3. Importance de l’élevage au Mali
II.4. Contraintes de l’élevage au Mali
II.4.1. Contraintes socio-économiques
II.4.2. Contraintes zootechniques
II.4.3. Contraintes alimentaires
II.4.4. Contraintes d’eau
II.4.5. Contraintes pathologiques
Chapitre III : GENERALITES SUR LA PERIPNEUMONIE CONTAGIEUSE BOVINE
III.1. Définition-Importance-Répartition géographique
III.1.1. Définition
III .1.2. Importance
III.1.3. Répartition géographique
III.2. Etiologie
III.2.1 Taxonomie
III.2.2. Propriétés physico – chimiques et culturales
III.2.2.1. Morphologie
III.2.2.2.Propriétés physico – chimiques
III.2.2.3. Culture et Milieu de culture
III.2.3. Propriétés Biologiques
III.2.3.1. Pouvoir pathogène
III.2.3.2. Pouvoir antigénique
III.2.3.3. Pouvoir immunogène
III.2.3.4. Pouvoir allergène
III.2.4. Résistance
III.3. Epidémiologie générale
III.3.1. Réceptivité et sensibilité
III.3.2. Sources de contagion
III.3.3. Mode de transmission
III.4. Epidémiologie de la PPCB en Afrique
III.5. Situation de la PPCB au Mali
III.6. Etude clinique
III.6.1. Signes cliniques de la maladie
III.6.2. Lésions
III.7. Diagnostic de la PPCB
III.7.1. Diagnostic sur le terrain
III.7.2. Diagnostic différentiel
III.7.3. Diagnostic de laboratoire
III.7.3.1. Prélèvement
III.7.3.2. Diagnostic microbiologique
III.7.3.3. Diagnostic sérologique
III.8. Lutte contre la Péripneumonie contagieuse bovine
III.8.1. Traitement
III.8.2. Prophylaxie
III.8.2.1. Stratégie défensive
III.8.2.2. Stratégie offensive
DEUXIEME PARTIE : ETUDE EXPERIMENTALE
Chapitre I : Matériel et Méthodes
I.1.Matériel :
I.1.1 Zone et période d’étude
I.1.2. Matériel de terrain
I.1.3. Matériel de laboratoire
I.2. Méthodes
I.2.1. Echantillonnage
I.2.2. Choix des troupeaux et animaux à prélever
I.2.3. Collecte et conservation des échantillons
I.2.4. Protocole de laboratoire :
I.2.5. Analyses statistiques des données :
Chapitre II : Résultats
II.1. Résultats généraux
II.2. Prévalence de la PPCB en fonction des régions
II.3. Prévalence de la PPCB en fonction des Cercles
II.4. Prévalence de la PPCB en fonction des « communes »
II.5. Prévalence de la PPCB en fonction des strates
II.6. Estimation du risque relatif
II.7. Analyse comparative entre la moyenne de la prévalence dans les zones du projet PRAPS et les zones hors PRAPS
Chapitre III : Discussion et recommandations
III.1. Discussion
III.1.1. Discussion de l’échantillonnage
III.1.2. Discussion de la méthode d’analyse
III.1.3. Discussion des résultats
III.2. Recommandations
III.2.1. Au PRAPS – MALI
III.2.2. Aux pouvoirs publics
III.2.3. Aux éleveurs
III.2.4. Aux professionnels de l’élevage et de la santé animale
Conclusion générale
Bibliographie
Télécharger le rapport complet