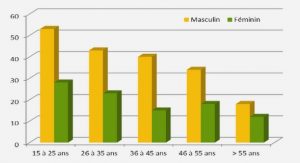GENERALITES SUR LA FILIERE OVINE ET CAPRINE
Elevage des petits ruminants dans le monde
Selon la FAO, la population de petits ruminants dans le monde est estimée à plus de deux milliards de têtes, dont plus de 80% se trouvent en Asie et en Afrique. Ce sont des animaux rustiques qui s’adaptent mieux à des conditions d’élevage difficiles par rapport aux autres espèces. La filière des petits ruminants contribue largement à l’amélioration de la sécurité alimentaire mondiale et renforce la lutte contre la pauvreté car 25 à 30% des paysans ruraux dans les pays en voie de développement pratiquent leur élevage et elle constitue quasiment le seul recours pour amortir une mauvaise récolte [15, 16]. Dans le continent Africain, les petits ruminants ont démontré leur faculté à résister dans les conditions de sècheresse, ainsi qu’à la rapidité de renouvellement de leur cheptel. La pratique de leur élevage est d’ailleurs rencontrée dans toutes les gammes d’exploitation et jouent deux rôles à la fois : vivrière et commercial [17]. La pathologie de préoccupation mondiale chez l’espèce ovine et caprine est actuellement la peste des petits ruminants (PPR), dont un programme d’éradication a été appuyé par la FAO [15].
Elevage des petits ruminants à Madagascar
Le nombre d’ovins et de caprins à Madagascar est estimé à plus de deux millions de têtes [18], mais ils sont surtout destinés à la consommation locale et leur système d’exploitation reste encore de type extensif [19]. La partie Sud du pays constitue un site de préférence pour leur élevage à cause des conditions climatiques qui leur sont favorables. Toutefois, cette filière peut se faire presque partout sur l’île [20]. Actuellement, l’élevage des petits ruminants est en plein développement à Madagascar. Le Ministère de l’Elevage s’est lancé, avec le soutien de la FAO, dans la promotion de la filière ovine et caprine afin de renforcer la lutte contre la pauvreté et d’améliorer la sécurité alimentaire dans le pays [21]. Depuis l’année 2015, un projet pour la mise en valeur de cette filière est en cours dans la Région Dianà [22, 23]. Le principal produit de la filière est la viande. Les animaux élevés sont en majorité des races locales et n’exigent pas beaucoup d’investissements. Par contre, pour la production de mohair, l’élevage de chèvres importées de race Angora se fait de type semi-extensif. En général, le lait de chèvre est utilisé pour la fabrication de fromages locaux [24]. L’élevage de la race Angora se fait surtout dans la région du Sud, principalement dans le «Fivondronana » d’Ampanihy, où se trouvent les célèbres tisserandes de tapis Mohair de Madagascar [25-27]. La production de Mohair a d’ailleurs été relancée par l’importation de chèvres de race Angora, l’année 2008 [25]. Les maladies les plus fréquentes chez les petits ruminants de Madagascar seraient l’ecthyma contagieux [20], ainsi que le « menatsinay » selon la dénomination locale dans la région du Sud. Ce dernier se manifeste par un syndrome hémorragique de l’intestin [11], et serait due à l’agent pathogène Clostridium perfringens [28].
LES ZOONOSES ABORTIVES
Généralités sur les zoonoses abortives
Les maladies abortives sont des maladies qui peuvent provoquer des avortements, des troubles de la fertilité, ainsi qu’une diminution des performances de reproduction et de la survie des jeunes [29]. Elles peuvent être une source de manque à gagner, voire même un frein majeur pour le développement du cheptel [30]. Toutefois, un taux d’avortement inférieur à 5% chez les petits ruminants serait considéré comme normal [31]. Les maladies abortives d’origine infectieuse sont considérées comme étant les plus redoutables, du fait qu’elles peuvent être facilement contagieuses et épizootiques, ainsi qu’à la possibilité d’existence de porteurs sains qui les font persister en excrétant continuellement les agents pathogènes dans l’environnement [32]. Ces affections peuvent également être transmises à l’homme. Selon l’OIE, 60% des agents pathogènes pour l’être humain sont d’origines animales et 75% des maladies émergentes animales peuvent le contaminer [33]. Ils sont à l’origine de zoonoses qui sont des maladies et infections pouvant se transmettre naturellement des animaux vertébrés à l’homme et inversement [34]. Parmi les zoonoses infectieuses abortives se distinguent la Brucellose qui a été considérée comme étant l’une des maladies zoonotiques les plus répandues dans le monde [35]. Puis la Chlamydophilose abortive et la Fièvre Q qui sont des causes majeures d’avortements chez les ruminants [5]. Ces deux affections ont été longtemps négligées en tant que zoonose à cause de l’absence de symptômes pathognomoniques qui pourrait les différencier d’une simple infection respiratoire [36]. Il y a aussi la Fièvre de la Vallée du Rift (FVR) qui est quasiment exclusif du continent Africain [37]. D’autres affections comme la Listériose et la Campylobactériose sont aussi des maladies abortives zoonotiques chez les petits ruminants [38], mais celles qui intéressent cette étude sont la fièvre Q, la Chlamydophilose abortive et la FVR.
Fièvre Q
Historique et caractéristiques
La fièvre Q ou « Query Fever » a été décrite pour la première fois par le Docteur Edward Derrick, après manifestation d’une maladie fébrile d’origine inconnue chez les personnels d’un abattoir à Queensland en Australie, l’année 1935 [39]. C’est une zoonose bactérienne très contagieuse et peut être rencontrée partout dans le monde, exceptée en Nouvelle Zélande [40]. C’est une maladie décrite dans le code sanitaire pour les animaux terrestres de l’OIE, à déclaration obligatoire pour les Etats membres [41]. Sa surveillance a pourtant été très souvent négligée [42], jusqu’à la récente épidémie de Pays-Bas avec 3.523 cas humains entre 2007 et 2009 qui a alerté le monde face à son importance zoonotique [39, 43]. La fièvre Q touche surtout les ruminants d’élevage dont les caprins, les ovins et les bovins [44]. Ce sont les principaux réservoirs de son agent pathogène, à l’origine de la contamination humaine [45, 46]. Mais elle peut aussi affecter les carnivores (chiens et chats), les lagomorphes (lièvres et lapins) ainsi que les oiseaux sauvages [47]. C’est une zoonose qui peut s’avérer dangereuse. En 2003, 300 personnes ont été infectées après qu’une brebis a mis bas au marché des bestiaux, en Allemagne [41]. Entre les années 2006 et 2011, 838 cas humains ont été diagnostiqués aux Etats-Unis, apparemment suite à l’exposition à des bétails infectés [48]. En Hollande, plus de 4000 cas ont été rapportés entre les années 2007 et 2011 [40]. Pour le cas de Madagascar, une épidémie a été constatée en 1962 à Tuléar, dont les victimes connues étaient des consultants fonctionnaires étrangers. En 1963, une trentaine de cas ont été diagnostiqués, incluant des citoyens malagasy [9].
Agent pathogène
L’agent pathogène qui est Coxiella burnetii a été identifié en même temps en Australie par F. M. Burnet et M. Freeman, et aux Etats-Unis par H. Cox et G. Davis, l’année 1937 [39, 49]. Anciennement classé dans la famille des Rickettsiaceae, c’est une bactérie Gram-négative appartenant maintenant à la famille des Coxiellaceae, ordre des Legionellales et de la sous-division des gamma-protéobactéries [42, 48].
|
Table des matières
INTRODUCTION
PREMIERE PARTIE : RAPPELS
I. GENERALITES SUR LA FILIERE OVINE ET CAPRINE
I.1. Elevage des petits ruminants dans le monde
I.2. Elevage des petits ruminants à Madagascar
II. LES ZOONOSES ABORTIVES
II.1. Généralités sur les zoonoses abortives
II.2. Fièvre Q
II.3. Chlamydophilose abortive
II.4. Fièvre de la Vallée du Rift
DEUXIEME PARTIE : METHODES ET RESULTATS
I. METHODES
I.1. Cadre d’étude
I.2. Type de l’étude
I.3. Période et durée de l’étude
I.4. Population d’étude
I.5. Mode d’échantillonnage et taille d’échantillon
I.6. Techniques de prélèvement
I.7. Paramètres enregistrés lors de l’enquête
I.8. Considération éthique
I.9. Méthodes appliquées au laboratoire
I.10. Traitement des données et interprétation des résultats d’analyse
I.11. Limites de l’étude
II. RESULTATS
II.1. Description de la population d’étude
II.2. Résultats sérologiques
II.3. Résultats en fonction des facteurs de risque
TROISIEME PARTIE : DISCUSSION
I. DISCUSSION
I.1. Concernant la méthodologie
I.2. Concernant les résultats obtenus
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES