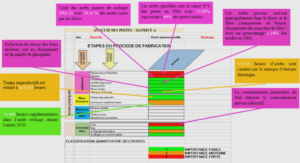D’après le Document de Stratégie pour la Réduction de la Pauvreté (DSRP) sur le plan national malgache qui a pris la louable décision de considérer l’accès à l’eau et l’assainissement comme étant un service social essentiel de base au même titre que l’éducation et la santé; la pauvreté humaine peut être caractérisée par l’insuffisance ou l’inexistence d’infrastructures sociales de base comme les infrastructures d’alimentation en eau potable et d’assainissement, les centres de soins de santé de base et les écoles de base.
L’étude hydrogéologique d’Andakana et Ampasimanjeva a été organisée respectivement aux mois d’avril et juin 2005 par la Société Géosciences pour le Développement de Madagascar (SGDM). Le but de l’étude est de déterminer le cadre géologique et d’améliorer la compréhension du régime de l’écoulement des eaux souterraines dans ces deux régions. Spécifiquement, le but de l’étude est de localiser le point favorable à l’implantation de forage d’exploitation d’eau souterraine.
GENERALITES SUR L’HYDROGEOLOGIE
L’hydrogéologie est la science des eaux souterraines, étudiant les conditions géologiques et hydrologiques, et des lois physiques qui régissent l’origine, la présence, les mouvements et les propriétés des eaux souterraines.
La localisation et la gestion des ressources en eau souterraines se basent sur les bilans climatique et hydrologique ainsi que sur l’analyse du contexte géologique et hydrogéologique. Elles se portent en générale sur l’étude des réservoirs : l’étude de l’origine de l’eau souterraine et ensuite la reconnaissance de ce qui est disponible pour pouvoir l’exploiter rationnellement.
LE CYCLE HYDROLOGIQUE NATUREL
Définition
Le cycle hydrologique est un concept qui englobe les phénomènes du mouvement et du renouvellement des eaux sur la terre. L’ensemble des processus de transformation et de transfert de l’eau forme le cycle hydrologique.
Le cycle de l’eau
Le cycle de l’eau est sujet à des processus complexes et variés parmi lesquels : les précipitations, l’évaporation, la transpiration (des végétaux), l’interception, le ruissellement, l’infiltration, la percolation, l’emmagasinement et les écoulements souterrains. Ces divers mécanismes sont rendus possibles par un élément moteur, le soleil, organe vital du cycle hydrologique .
Le bilan hydrique
On peut combiner les phénomènes continus du cycle de l’eau sur les trois groupes:
– précipitations,
– ruissellement de surface et l’écoulement souterrain,
– évaporation.
Il est intéressant de noter que dans chacune des groupes on retrouve respectivement les notions de transport, d’emmagasinement temporaire et parfois de changement d’état des eaux. Il s’ensuit que l’estimation des quantités d’eau passant par chacune des étapes du cycle hydrologique peut se faire à l’aide « de bilan hydrologique ».
P + S = R + E( S ± ∆S )
Avec :
P : précipitations (liquide et solide) [mm],
S : ressources (accumulation) de la période précédente (eaux souterraines, humidité du sol, neige, glace) [mm],
R : ruissellement de surface et écoulements souterrains [mm],
E : évaporation (y compris évapotranspiration) [mm],
S + ∆S : ressources accumulées à la fin de la période [mm].
On exprime généralement les termes du bilan hydrique en hauteur d’eau (mm par exemple). Cette équation exprime simplement que la différence entre le débit d’eau entrant et le débit d’eau sortant d’un volume donné (par exemple un bassin versant) au cours d’une période déterminée est égale à la variation du volume d’eau emmagasinée au cours de la dite période.
Utilisation des bilans hydriques
L’utilisation des bilans hydriques est basée sur :
• Étude de la circulation de l’eau sur et dans le sol
• Évaluation du renouvellement des nappes d’ES
• Installation de systèmes de drainage ou d’irrigation
• Aménagements hydriques .
➡︎ L’étude d’un aquifère de la zone commence toujours par le bilan hydrique de ses bassins hydrologique et hydrogéologique.
LES EAUX SOUTERRAINES ET LEURS MILIEUX
Identification géologique de l’aquifère
L’identification d’un aquifère repose sur trois critères :
– Géologique : identifie par des études stratigraphiques et structurales des formations lithostratigraphiques.
– Hydrodynamique
– Hydrochimique .
L’identification d’un aquifère débute par celle des réservoirs à identifier sa formation lithostratigraphique, ses surfaces limites, sa structure et ses formations hydrogéologiques.
LES NAPPES
Condition d’existence des nappes
L’existence d’une nappe est conditionnée par la conjonction de trois facteurs :
– Alimentation : Il faut que l’eau puisse venir remplir les pores de la nappe
– Facteurs lithologiques : l’aquifère doit être constitué à la fois d’une formation poreuse et perméable et à sa base d’un mur imperméable
– Facteur de structure : Une structure synclinale est favorable à l’accumulation de l’eau Les conditions d’alimentation, lithologique et structurale ne peuvent pas être considérées isolement.
Classification des nappes
a) Critère géologique
Sous ce critère on distingue :
– Nappe de terrain sédimentaire stratifié
– Nappe sédimentaire non stratifié
– Nappe de terrain cristallin ou éruptif (terrain fissuré ou altéré).
b) Critère hydrodynamique
On distingue deux types de nappe sous l’angle de la piézomètrique
● Nappe libre : une nappe dont la surface piézomètrique se confond avec la surface de la nappe.
● Nappe captive : une nappe dont le toit est inférieur à la surface piézomètrique.
|
Table des matières
Introduction Générale
GENERALITES
IDENTITE DE LA SGDM
PARTIE I : GENERALITE SUR L’HYDROGEOLOGIE ET CARACTERISATION DE L’AQUIFERE
I. LE CYCLE HYDROLOGIQUE NATUREL
I.1. Définition
I.2. Le cycle de l’eau
I.3. Le bilan hydrique
I. 4. Utilisation des bilans hydriques
I.5. Concept de bassin versant
I.5.1. Bassin versant hydrologique
I.5.2. Bassin versant hydrogéologique
II. LES EAUX SOUTERRAINES ET LEURS MILIEUX
a) Identification géologique de l’aquifère
b) L’eau dans le réservoir
III. LES NAPPES
III.1. Condition d’existence des nappes
III.2. Classification des nappes
a) Critère géologique
b)Critère hydrodynamique
PARTIE II : LES TECHNIQUES D’INVESTIGATION
I. PHOTO-INTERPRETATION
I. 1. La morphologie
I.2. La photogéologie
I.3. Les clés de la photo-interprétation
I.3.1 Phase d’identification
I.3.2 Phase d’interprétation
II. TELEDETECTION
II.1. Caractéristique de l’image
II.2. Technique de traitement des images satellitaires
III. INVESTIGATION GEOPHYSIQUE
III.1. Méthodes électriques
III. 1.1. Notion de résistivité électrique
III.1.2. Facteurs influençant la résistivité du sol
III.1.2.1. La porosité
III.1.2.2. La température
III.1.3. Concept de chargeabilité
III.1.4. Dispositifs de mesure
a ) La technique de sondage électrique
b) Le panneau électrique
b – 1. Technique d’acquisition de donnée en panneau électrique
III.2. Méthode électromagnétique
III.2.1. Principe
III.2.2. Dispositif de mesure
III.2.3. Résumé de la méthode électromagnétique transitoire
IV. Contrainte entre la photo-interprétation et télédétection
PARTIE III : APPLICATION DE LA GEOPHYSIQUE A LA PROSPECTION HYDROGEOLOGIQUE, SITE D’ ANDAKANA ET SITE D’AMPASIMANJEVA
I. ACQUISITION DE DONNEES GEOPHYSIQUES
I.1. Prospection électrique en courant continu
I.2. Présentation de l’appareil SYSCAL R2
I.3. Le sondage E.M
II. TRAITEMENT DE DONNEES
III. ÉTUDE HYDROGEOLOGIQUE
III.1. Site d’Andakana
III.1.1. Contexte géologique, hydrogéologique et géographique de la région
III.1.1.1. Situation géographique
a) Localisation du site
b) Géomorphologie
c) Climat
d) Contexte géologique
e) Situation hydrogéologique
III.1.2. Prospection géophysique
III.1.2.1. Panneau électrique et Interprétation
III.1.3. Résultat du forage
III.1.4. Conclusion
III.2. Site d’Ampasimanjeva
III.2.1. Contexte général
III.2.1.1. situation géographique et climatique
III.2.1.2. Contexte géologique et hydrogéologique
III.2.2. Photo-interprétation
III.2.3. Prospection géophysique
III.2.3.1 Interprétation
III.2.4. Discutions
Conclusion Générale