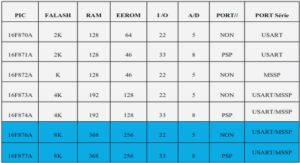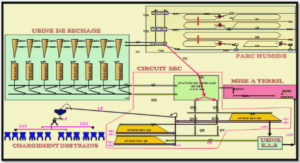Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Relation entre investissement et transformation structurelle
La plupart des analyses que l’on trouve dans la littérature sur l’Afrique subsaharienne soulignent la nécessité pour celle-ci de mettre en œuvre des politiques favorables à la transformation structurelle. Les théories de la croissance endogène ont déjà donné le ton en soutenant qu’un pays peut acquérir un nouvel avantage comparatif en dehors du secteur des matières premières par deux voies : 1) l’accumulation du capital humain qui crée des externalités positives et 2) les innovations technologiques (CNUCED, 2008). Le chemin qui mène à ce processus n’est pas unique (FMI, 2012).
Le débat est ouvert quant à savoir quelle stratégie chaque pays adoptera pour atteindre cet objectif. Les dotations en ressources naturelles, les qualifications de la main-d’œuvre et bien d’autres pèseront dans ce choix. Certains pays développeront l’industrie manufacturière, d’autres les services, d’autres encore l’agriculture pour ne citer que ceux-là.
Comme souligné plus haut, la transformation structurelle est un processus à travers lequel des activités nouvelles et plus productives émergent, processus normalement sous-tendu par un mouvement des ressources vers ces nouvelles activités au détriment des activités traditionnelles. Simultanément à ce mouvement, une proportion élevée de la main-d’œuvre se déplace des secteurs à faible productivité vers ceux à forte productivité (AfDB, OECD, UNDP et ECA, 2013). Selon la CNUCED (2012 p.30), le mouvement consécutif à la transformation structurelle se traduit par une diminution sensible de la part relative de l’agriculture traditionnelle et des activités extractives à faible productivité ou valeur ajoutée et concomitamment par une augmentation de celle des secteurs modernes à forte productivité tels que l’agriculture intensive, les industries et les services. Trois facteurs concourent à la transformation structurelle : (i) l’accumulation des facteurs, (ii) la réallocation des facteurs, et (iii) l’innovation technologique (CNUCED, 2012 p.30).
Pour les économistes classiques, l’accumulation des biens d’équipement apparaît comme le principal facteur de croissance. Le premier modèle de croissance néo-classique, proposé par Robert Solow en 1956, s’inscrit également dans cette logique. L’amélioration continue de la qualité des biens d’équipement, sous le jeu du progrès technique, traduit un autre type d’accumulation, centrée sur les connaissances. Joseph Schumpeter dans les années 1920 et, depuis la fin des années 1980 les théoriciens de la croissance endogène, en particulier Paul Romer, ont souligné l’importance de cet aspect dans le processus de croissance. Enfin, la qualité moyenne d’une heure travaillée évolue aussi dans le temps grâce à l’amélioration de la formation des travailleurs (éducation générale et formation professionnelle). Le capital humain désigne, à cet effet, l’ensemble des capacités productives d’un individu, incluant ses connaissances générales et spécifiques, et constitue un autre facteur de production « accumulable », dont Robert Lucas, en 1988, a montré le rôle.
À l’évidence, même si ces facteurs ne sont pas réductibles à l’investissement, force est de constater qu’ils ont besoin de l’investissement pour agir sur l’économie et la transformer. Cela est sans équivoque pour l’accumulation des facteurs, l’investissement étant la condition préalable à tout processus d’accumulation que celle-ci porte sur le capital physique ou sur le capital humain. En revanche, la relation est moins évidente pour la réallocation, celle-ci étant non pas un investissement mais une modalité d’affectation des ressources entre différents usages alternatifs. Elle est favorable à l’investissement uniquement dans le cas où les ressources réaffectées servent à financer la production. Quant à l’innovation technologique, elle est à la fois un investissement et un extrant de l’investissement. Elle est un extrant de l’investissement car, pour la mettre au point, des dépenses en recherche et développement sont nécessaires. C’est aussi un investissement dans la mesure où la mise en œuvre de l’innovation implique l’acquisition d’un support matériel (machines, équipements, etc.) ou immatériel (savoir-faire, technicité, capacité managériale ou organisationnelle) qui ne sont rien d’autres que des formes particulières de l’investissement.
Examinant la relation entre investissement privé et transformation structurelle, Sackey (2009 p. 410) a soutenu que « dans la mesure où l’investissement privé a une incidence sur la croissance économique, il peut être considéré comme une variable clé du processus de transformation structurelle en Afrique ». Puisque c’est l’investissement qui engendre la transformation structurelle à travers les mécanismes ci-dessus décrits, il est clair que pour la promouvoir ou l’accélérer, c’est sur l’investissement qu’il convient d’agir. Cependant pour autant que cela soit vrai, on ne doit pas ignorer qu’au regard de l’expérience récente des pays émergents, selon le degré et la forme qu’elle revêt, la transformation structurelle agit aussi sur l’investissement et explique la disparité des rythmes de croissance entre pays (WESS, 2006 p.29).
La réflexion sur les voies et moyens permettant d’agir sur l’investissement dans l’optique de promouvoir ou d’accélérer le processus de transformation structurelle mais aussi d’agir sur cette dernière pour améliorer la qualité des investissements, doit tenir compte des faits suivants : 1) malgré l’importance des investissements réalisés en Afrique subsaharienne, l’accumulation des facteurs n’a pas encore atteint le seuil critique à même d’engendrer une transformation structurelle véritable ; et 2) jusqu’à présent en Afrique subsaharienne, les investissements réalisés ont plus profité aux activités extractives, commerciales et de services qu’aux activités agricoles, industrielles et manufacturières.
Il est vrai que par l’entremise de la coopération bi – et multilatérale, l’Afrique subsaharienne a reçu et continue de recevoir des appuis financiers non négligeables sous forme d’aide, de prêts et de donations (OCDE, 2005) partiellement utilisés à des fins d’investissement20. Selon le rapport de l’OCDE (2013) sur les Perspectives Economiques de l’Afrique (PEA), les flux financiers étrangers vers l’Afrique, et vers l’Afrique subsaharienne en particulier, ont atteint un nouveau record en 2012 avec 186,3 milliards de dollars (soit 9,2% du PIB africain). Fait marquant, ces flux sont dominés par les transferts des migrants qui dépassent l’aide et les investissements directs étrangers. Mais en raison de l’accroissement exponentiel de la demande sociale, suscitée par une croissance démographique encore élevée et une urbanisation accélérée, bien que très importants, ces investissements semblent insuffisants par rapport aux besoins : insuffisants du point de vue quantitatif, les réalisations décalant toujours à la baisse par rapport à la demande sociale ; insuffisants aussi du point de vue qualitatif, une grande partie des ressources étant affectée à des usages moins productifs ou moins prioritaires. Interagissant, ces insuffisances ont freiné l’accumulation des facteurs qui à son tour a bloqué la transformation structurelle.
Le niveau des investissements en Afrique subsaharienne est certainement élevé, mais l’allocation s’est avérée très imparfaite et sous-optimale. Cela est particulièrement vrai pour les investissements extérieurs, concentrés quasi-exclusivement dans l’exploitation des ressources naturelles. Les vrais piliers de la croissance en Afrique subsaharienne, à savoir l’agriculture et l’industrie, ont une faible attractivité sur les multinationales ; le financement de ces secteurs est laissé aux soins de l’Etat et de quelques investisseurs privés nationaux qui ne disposent pas de surfaces financières importantes. Redoutant les risques de défaut des débiteurs exerçant dans ces domaines, le secteur bancaire s’en offusque également, l’essentiel de ses crédits finançant les activités commerciales et les services.
Investissement dans les pays de l’UEMOA
Ce qui précède montre que la transformation structurelle en zone UEMOA est aléatoire. A quoi doit-on imputer la cause ? Aux investissements ? C’est ce que nous tentons de voir dans ce point. L’évolution à long terme des investissements indique une situation difficile et chronique due, comme l’ont expliquée Desroches et Francis (2007), non pas à la rareté de l’épargne mais aux conditions d’accès à celle-ci. L’épargne domestique étant faible, chaque pays a dû satisfaire ses besoins d’investissement en capturant au maximum l’aide publique au développement. Le recours à cette source est inversement proportionnel au développement du secteur financier, notamment à sa capacité à mobiliser l’épargne domestique. Ainsi, ayant le taux d’épargne intérieure le plus élevé de l’Union, la Côte d’Ivoire a le taux d’aide publique au développement le plus faible (4%), alors que le Bénin et le Burkina, avec des taux d’épargne les plus faibles (respectivement 2,2% et 3,3%), bénéficient de la part d’aide la plus importante, respectivement 8,7% et 11%. Toutes les sources confondues, l’évolution des investissements en zone UEMOA décrit quatre principales périodes :
– les années 1960-1973 : cette période est marquée par une insuffisance des ressources tant humaines, matérielles que financières face à des besoins d’investissement énormes. 162,5 milliards de FCFA étaient investis en moyenne par an dans cette zone, ce qui correspond à un taux d’investissement de 18,2% ;
– les années 1974-1982 : elles se distinguent des années précédentes par la tendance à la hausse des investissements. Leur niveau est 6 fois plus élevé qu’en 1960-73, soit un taux d’investissement annuel moyen de 32,65% ;
– les années 1983-1993 : à cause d’une morosité économique et financière persistante, le taux d’investissement est réduit de plus de moitié : 15,7% contre 32,65% entre 1974 et 1982. Ceci est le résultat des terribles sécheresses, des politiques macroéconomiques et sectorielles malavisées, inspirées d’un modèle de développement qui assigne à l’État un rôle prépondérant en matière de production et de régulation (Banque mondiale, 1994 p.23). Toujours selon la Banque mondiale, la crise survenue au cours des années 80 était due à la surévaluation des monnaies, à la persistance des déficits budgétaires et à la remise en cause de la concurrence à travers l’adoption des politiques commerciales protectionnistes et les monopoles d’État. Malheureusement, les mesures préconisées pour la conjurer et en même temps pour relancer la croissance n’ont pas affecté les investissements. Ceux-ci n’ont commencé réellement à s’améliorer qu’à partir de la dévaluation du franc CFA en 1994. Ainsi, de moins de 942 milliards en 1993, les investissements sont passés à 1 879 milliards en 1994, hausse due aux performances de la Côte d’Ivoire, du Mali et du Niger ;
– les années postérieures à la dévaluation : à partir donc de 1994, la situation de quasi-stagnation constatée depuis les indépendances fait place à une nouvelle dynamique où les investissements augmentent de façon spectaculaire. Alors qu’il a fallu 15 ans (1963-1977) pour atteindre 1 000 milliards d’investissement, ce niveau est atteint en une seule année, en 1994. En sept ans, soit de 1994 à 2001, le seuil de 3 000 milliards est réalisé. De 2001 à 2008, l’accroissement des investissements s’accélère, de sorte qu’en huit ans, ils enregistrent un accroissement équivalent à celui obtenu en 1960-2001, soit 41 ans.
La situation par pays révèle une similitude de parcours. Pour la plupart des pays, le niveau d’investissement était faible et stationnaire, la moyenne annuelle étant inférieure à 200 milliards de F CFA entre 1960 et 1994. Avant 1970, le niveau des investissements était insignifiant. Après et cela jusqu’au début des années 80, la situation s’améliore dans tous les pays grâce aux emprunts extérieurs. La crise économique et financière survenue au début de la décennie 80 a entraîné une forte contraction des dépenses d’investissement. Les déséquilibres macroéconomiques ajoutés à la forte appréciation du FCFA ont rendu les mesures d’ajustement structurel et la dévaluation du FCFA nécessaires. Depuis lors, la situation n’a cessé de s’améliorer, sauf dans les pays en situation de crise persistante. L’amélioration constatée est due aux réformes économiques entreprises au cours des années 80 et 90 dans le cadre des Programmes d’Ajustement Structurel. L’assainissement des finances publiques et l’ouverture de nombreux secteurs à la concurrence ont permis à l’État de rationaliser ses interventions et de se concentrer sur les missions dans lesquelles il était le plus efficace. L’assainissement ainsi entamé est appuyé au niveau communautaire par la mise en place d’un dispositif de convergence et de surveillance multilatérale, ce qui en quelques années s’est traduit par des retombées positives en termes de croissance et de mobilisation des ressources extérieures, notamment de l’aide, des dons et des emprunts ainsi qu’une entrée relativement importante des investissements directs étrangers (IDE). La libéralisation du secteur financier au début des années 90 avec en toile de fond la dévaluation du FCFA ont parachevé le processus d’assainissement du cadre macroéconomique.
Mais en dépit de tous ces aménagements, les investissements restent globalement faibles dans l’UEMOA. Bien que faibles en volume, ils suivent une tendance haussière en pourcentage du PIB de 1963 (15%) à 1979 (plus de 40%). Ils s’effondrent littéralement de 1980 à 1993, retrouvant en 1985 leur niveau de 1963. La baisse se poursuit avec moins d’intensité jusqu’en 1993. De 1993 à 2010, les baisses et les hausses alternent quasi-annuellement, la tendance d’ensemble étant la stagnation.
Les séries du PIB et de l’investissement forment dans leurs mouvements des cycles où la décennie 1981- 90 représente le point de retournement bas, les années 1971-80 la récession et les années 1991-2000 la reprise. Ces séries sont symétriques, la différence étant simplement l’amplitude et la durée qui sont plus grandes pour la série du PIB.
REVUE DE LITTERATURE
La revue de littérature s’articule autour de six principaux points. Les premier et deuxième examinent les fondements théoriques de la transformation structurelle et de l’investissement. Le troisième traite de leurs relations réciproques. Les quatrième et cinquième points analysent les enjeux de la transformation structurelle liés à l’agriculture d’une part et à l’industrie manufacturière d’autre part. Enfin, le sixième point examine l’impact de la transformation sur l’investissement.
Fondements théoriques de la transformation structurelle
Comment les théories économiques abordent-elles la question de la transformation structurelle ? Quelle est sa place dans les modèles de croissance et de développement ? Nous examinons ces questions d’abord sous l’angle des théories économiques puis sous l’angle des modèles de croissance et de développement.
Changement structurel selon l’histoire économique et du développement
Dans la littérature relative à l’histoire et au développement économique, le changement structurel est en général analysé et théorisé en termes de « secteurs ». La principale difficulté que pose la notion de « secteur » est de savoir comment la conceptualiser, quand on sait que l’économie est constituée d’une diversité d’activités (Bauer et Yamey, 1957) imbriquées les unes aux autres. Une solution simple est de considérer les secteurs comme représentant des lignes d’activités économiques sans aucune différentiation. C’est l’hypothèse de la littérature théorique relative à la croissance dont le modèle de Von Neumann en est le prototype. L’autre solution extrême et opposée à celle-là est de définir des critères de différentiation sur la base desquels des lignes d’activités particulières seront regroupées en groupes homogènes, appelés secteurs, donnant ainsi lieu à différents modèles. Entre ces solutions extrêmes, on a un large éventail de théories appliquées à la croissance et au développement dans lesquelles le changement structurel n’apparait pas de façon significative (Syrquin, 2007 p.3).
Le terme « changement structurel » ou « transformation structurelle » est l’expression communément utilisée dans la littérature du développement et de l’histoire économique pour désigner les changements qui surviennent dans la composition des activités économiques d’un pays.
Ayant utilisé le concept dans son ouvrage, Pasinetti (1981) lui donne une signification légèrement différente. Du fait de l’influence de ses travaux, le « changement structurel » est considéré comme une composante à part entière de la « dynamique structurelle », concept théorique plus documenté qui est par ailleurs l’épine dorsale de ses recherches. L’auteur analyse le concept de « dynamique structurelle » dans le cadre d’une économie industrielle en présence du progrès technique (p.219). Son analyse commence avec la condition d’équilibre entre les ressources et les emplois. En l’absence de tout progrès technique, cette condition évidemment ne pose aucun problème de décision. L’équilibre est maintenu tant que les secteurs constitutifs de l’économie progressent à un taux de croissance uniforme. En revanche, si le progrès technique est introduit dans le système, chaque coefficient technique décroîtrait en suivant sa trajectoire propre dans le temps. En conséquence de cela, la structure des prix et celle de l’emploi connaîtront un changement, ce qui en remettant durablement en cause l’équilibre, fera apparaître le chômage. Il sera ainsi à moins que des dispositifs d’indemnisation soient mis en place pour soutenir les coefficients de la demande. En moyenne, la demande per capita continuera à croître comme condition nécessaire pour garder le système économique en situation de croissance équilibrée. Son importance devenant cruciale, cette condition imposera toute une série de nouvelles décisions en matière de consommation et d’investissement. En l’occurrence, l’existence du progrès technique imposera aux membres de la communauté tout un processus de prise de décision. Ceci est une caractéristique de toute société industrielle avancée, indépendamment de son organisation institutionnelle.
Mais au même moment où Pasinetti développait son approche, Kuznets amorçait son programme de recherche sur la croissance et le changement structurel qui a abouti à la conceptualisation de la
« Croissance Economique Moderne ». Malgré quelques similitudes, leurs approches présentent de profondes divergences (Syrquin, 2007 p.2) et débouchent sur des résultats opposés.
Pour Kuznets et plus généralement en histoire économique et du développement, la croissance et le changement structurel sont étroitement liés. Si on rejette l’hypothèse d’un monde parfait dans lequel les préférences sont homothétiques, la croissance de la productivité neutre et sans effet sectoriel systématique, les facteurs parfaitement mobiles et les marchés s’ajustant de façon instantanée, le changement structurel apparait comme une caractéristique centrale du processus de développement et un élément essentiel de l’élévation du taux de croissance (Syrquin, 2007). Il peut retarder la croissance si sa vitesse est très faible ou son orientation inefficiente ; mais il peut aussi contribuer à la croissance s’il améliore l’allocation des ressources, notamment en réduisant la disparité des revenus des facteurs entre différents secteurs ou en facilitant l’exploitation des économies d’échelle.
Dans la synthèse des approches classique et keynésienne, le changement structurel crée un défi permanent, celui de stabiliser le système. En effet, en raison de la dynamique structurelle de l’économie, il y a une forte tendance du système à tendre vers le sous-emploi. La peur du sous-emploi technologique revêt à cet égard une importance capitale.
Changement structurel selon les théories de la croissance
Kuznets est l’un des rares auteurs à réfuter l’existence d’une distinction entre croissance et développement. Analysant le processus de changement structurel dans les pays développés, il établit que celui-ci est partie intégrante du processus de la Croissance Economique Moderne.
Les modèles originels de la croissance qui sont des extensions du modèle keynésien ignorent le changement structurel, y compris d’ailleurs les versions multisectorielles qui postulent la croissance équilibrée comme solution. Mais dans le tournant des années 90, certains modèles formels ont essayé de reproduire les caractéristiques basiques du changement structurel en modifiant certaines hypothèses usuelles des modèles de croissance standards.
Le principal point de départ des présentations standards qui conduisent à la croissance déséquilibrée ont été, du côté de la demande, l’introduction des préférences non-homothétiques conformément au modèle de Stone-Geary (Echevarria, 1997; Kongsamut, Rebelo et Xie, 2001)25 ou à l’hypothèse d’une « hiérarchie des besoins » en matière de consommation (Stokey, 1988). Du côté de l’offre, la principale innovation a été autorisée pour la croissance de la productivité différentielle. Ceci a été le point central de la contribution de Baumol (1967) à la macroéconomie de la croissance déséquilibrée (“Macroeconomics of Unbalanced Growth”) où il pose l’hypothèse que les taux de croissance de la productivité sont exogènes. La version moderne de l’hypothèse de Baumol inclut les travaux de Ngai et Pissarides (2006) et la présentation d’Acemoglu qui établit que les résultats de Baumol pouvaient être générés de façon endogène en combinant différents stocks de capital et l’intensité capitalistique.
Changement structurel selon l’économie du développement
Contrairement aux théories de la croissance, la littérature empirique et théorique de l’économie du développement admet le changement structurel. Le processus de développement est généralement décrit comme transcendant la croissance, exigeant un minimum de changement structurel et dans certains cas des transformations sociales, politiques et institutionnelles (Syrquin, 2007).
Au vu de ce qui précède, il convient de noter que l’expansion économique et les modifications structurelles qui font passer une économie à faible productivité, essentiellement rurale, à une économie à forte productivité, urbanisée et industrielle ne sont pas spontanées mais suivent un processus graduel s’inscrivant dans le long terme (Syrquin, 1988 p.481). Au cours de ce processus, la productivité augmente dans la plupart des secteurs de l’économie et, dans le même temps, le centre de gravité passe des unités à productivité faible aux unités à productivité plus importante. Même si l’idéal porté par la transformation structurelle est accepté et partagé par tous, force est de reconnaître que les chercheurs ne lui donnent pas le même contenu ni ne l’appréhendent de la même manière. Reconnaissants son caractère multidimensionnel (Silva et Teixeira, 2008 ; Syrquin, 2010 et Lin, 2011 et 2012), ils le mesurent différemment.
Mesures de la transformation structurelle
Nous parlerons des variables utilisées dans les mesures, des techniques de mesure en général et spécifiquement de celles basées sur la productivité.
Variables de mesure
Les variables utilisées pour mesurer la transformation structurelle sont liées aux définitions données au concept. Les auteurs qui définissent la transformation structurelle en référence à la composition sectorielle utilisent généralement la production, la valeur ajoutée ou les agrégats tels que le revenu, l’emploi ou leur taux de croissance. Ceci est valable aussi bien pour l’économie toute entière que pour une partie de celle-ci (secteur, branche, activité). Selon Stijepic (2010), la mesure généralement utilisée pour estimer l’importance relative d’un secteur, d’une branche ou d’une activité est sa part dans le PIB réel. Il préfère cependant la part de l’emploi sectoriel en pourcentage de l’emploi total, bien qu’il reconnaisse lui-même qu’il est équivalent au premier. Pour mettre en évidence l’absence de transformation structurelle en Afrique, c’est ce même indicateur que l’OIT (2007) a utilisé. Constatant que de 1996 à 2006, l’emploi dans l’agriculture est tombé de 68,1% à 63%, elle a cherché à identifier le secteur auquel cette baisse a profité. Il est apparu que sur la période, l’emploi a légèrement baissé dans l’industrie passant de 9% en 1996 à 8,8% en 2006 alors qu’il s’est sensiblement accru dans les services passant de 22,9% en 1996 à 28,2% en 2006. Ces résultats montrent que les mouvements de la main-d’œuvre sont allés plus de l’agriculture vers les services que vers l’industrie (Sackey, 2009).
Si on en restait là, il ne serait pas exagéré de qualifier cette étude de l’OIT ou du moins sa conclusion de hâtive ou superficielle. Car, même si le transfert de la main-d’œuvre de l’agriculture aux services dénote un changement, on n’a aucune raison de penser que ce mouvement tendrait à accomplir une transformation profonde, c’est-à-dire le passage de l’économie à une trajectoire de production supérieure. L’information n’étant pas suffisante pour tirer une telle conclusion, le transfert de la main-d’œuvre devrait être associé à un autre indicateur qui renseigne sur les implications dudit transfert de la main-d’œuvre sur la croissance. Le facteur susceptible de jouer ce rôle est la productivité. Parmi ses nombreuses variantes, celle rapportée au facteur travail est la plus apte à capturer les changements auxquels les secteurs et activités économiques sont soumis. N’étant pas couplé avec la productivité, la migration de la main-d’œuvre dans l’étude de l’OIT (2007) n’est pas en mesure de capturer ces changements. En revanche, illustrant parfaitement ce raisonnement l’étude du FMI (2012, p.53) montre on ne peut plus clair la nécessité de prendre en compte ce discriminant. En effet, pour étudier le degré de transformation structurelle dans certains pays d’Afrique, le FMI s’est servi comme l’OIT (2007) de la migration des travailleurs sur la période 1995-2010, mais à la différence de cette dernière, il y a associé la productivité pour discriminer l’effet de cette migration sur l’économie. La prise en compte de ce facteur a permis de mettre en évidence l’existence de deux types de secteurs et activités distincts: les secteurs et activités à faible productivité moyenne (du travail) et ceux à forte productivité. Ces secteurs nettement différenciés, le transfert de la main-d’œuvre de l’un vers l’autre permet de décrypter l’impact de la migration sur la transformation structurelle.
Alternativement à la productivité du travail, un changement qualitatif des structures de l’économie est appréhendé à l’aide du ratio production industrielle-production agricole (Sackey, 2009 p.411).
Techniques de mesure
S’appuyant sur les agrégats économiques (production, exportation, valeur ajoutée, emploi, etc.), ces analyses manipulent des ratios calculés à l’aide de la technique des indices. Il existe des méthodes plus robustes telles que les modèles de croissance. Ceux-ci permettent non seulement d’identifier la contribution des différents inputs à la croissance mais aussi d’isoler le « résidu de Solow », c’est-à-dire la part de la croissance non-expliquée par la variation du stock physique des inputs. À ces techniques, s’ajoutent l’estimation économétrique des fonctions de production et les approches non paramétriques.
Les indices s’appliquent aux données sur le PIB, le stock du capital, le stock du travail ou toute autre grandeur relative soit, à l’ensemble de l’économie soit, à une de ses composantes (secteur, branche, activité) dont on voudrait connaître l’évolution sur une période de temps déterminée. L’indice est le rapport en pourcentage entre la valeur d’une grandeur à un moment donné et sa valeur à une période de base. Le solde de deux indices consécutifs donne le taux de croissance de la grandeur considérée.
Si les indices établissent le taux de variation d’une grandeur, les techniques comptables de la croissance décomposent cette variation pour en remonter jusqu’aux causes. On sait qu’il existe deux voies par lesquelles la quantité d’un produit peut être augmentée dans un processus de production: soit on augmente la quantité des facteurs qui concourent à cette production, soit on améliore la qualité de la combinaison productive, la troisième possibilité étant de combiner les deux. La solution qualitative détermine les conditions dans lesquelles un produit pourrait être accru sans modifier les quantités des facteurs utilisés. Elle mesure la productivité totale (globale) des facteurs (PTF). Cette partie du produit non-expliquée par l’accroissement du stock des facteurs de production (le plus souvent, capital et travail) est appelée « résidu de Solow » ou « progrès technique ».
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
CHAPITREI : ANALYSE DE LA TRANSFORMATION STRUCTURELLE DANS LE CONTEXTE DES PAYS DE L’UEMOA
1.1. Contexte des pays de l’UEMOA
1.2. Eléments structurants de la transformation structurelle
1.3. Secteurs moteurs de la transformation structurelle
1.4. Recherche d’indices de la transformation structurelle à travers la littérature empirique
1.5. Investissement dans les pays de l’UEMOA
1.6. Financement extérieur
CHAPITRE II : REVUE DE LITTERATURE
2.1. Fondements théoriques de la transformation structurelle
2.2. Fondements théoriques de l’investissement
2.3. Revue des relations entre investissement et transformation structurelle
2.4. Enjeux des investissements agricoles pour la transformation structurelle
2.5. Enjeux des investissements industriels pour la transformation structurelle
2.6. Impact de la transformation structurelle sur l’investissement 1
CHAPITRE III : CADRE METHODOLOGIQUE, RESULTATS ET DISCUSSIONS
3.1. Cadre méthodologique
3.2. Résultats des analyses descriptives et économétriques
3.3. Interprétations et discussions des résultats
3.4. Recommandations en matière de cadres d’intervention
CONCLUSION GENERALE
TABLE DES MATIERES
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Télécharger le rapport complet