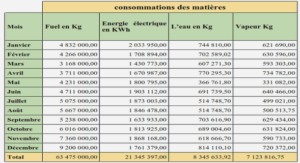Quand elle n’est pas un choix, la phytothérapie est donc une nécessité
Notre objectif a été donc d’essayer de valider scientifiquement les usages traditionnels antiasthmatiques de deux plantes endémiques : la bourache Borago officinalis (une plante commune, endémique, très répandue en lisière de foret, sur les bords des chemins et dans les décombres) et l’ortie Urtica dioica (une plante herbacée vivace de la famille des Urticacées, très commune, et très répandue). Pour cela, nous avons étudié l’effet des extraits se rapprochant le plus de l’usage traditionnel, à savoir les extraits aqueux en utilisant un modèle d’asthme expérimental murin. Tout comme nous avons étudié la composition phytochimiques de ces deux plantes afin de mettre en évidence les molécules antioxydantes (polyphénols) susceptibles de réduire le stress oxydatif auquel sont soumis les rats sensibilisés et rendus asthmatiques. Ainsi, nous nous proposons dans une première partie théorique de cette présente étude de développer les points suivants :
La maladie asthmatique : une définition, quelques données épidémiologiques et les facteurs impliqués dans l’expression et le développement de la maladie.
La Réaction inflammatoire asthmatique, les acteurs cellulaires impliqués et les médiateurs de l’inflammation asthmatique.
Le stress oxydatif : les systèmes de défenses enzymatiques et non enzymatiques, les dégâts et les biomarqueurs du stress oxydant.
Les composés phénoliques d’origines végétales : les différentes classes de phénols, les propriétés biologiques et intérêts thérapeutiques.
Dans la partie expérimentale, nous nous proposons d’évaluer :
L’activité antioxydante et la quantité en polyphénols des extraits de Borago officinalis et d’Urtica dioica. La composition qualitative des extraits des deux plantes par LC MS/MS.
Les effets cytotoxiques de l’ovalbumine et son implication dans l’induction d’un stress oxydant chez des rats Wistar sensibilisés au cours d’un protocole d’asthme expérimental par l’injection intra-péritonéale de l’allergène puis son inhalation.
Les effets du traitement de ces rats sensibilisés à l’ovalbumine par les extraits de la bourrache et de l’ortie, d’une part, sur l’inflammation bronchique et d’autre part sur le stress oxydatif survenant dans ce modèle murin d’asthme expérimental.
Médiateurs de la réponse immunitaire
Il s’agit principalement des médiateurs suivants :
– Histamine : il s’agit d’une amine vasoactive stockée dans les granules des mastocytes et des basophiles. Elle a une propriété broncho-constrictrice puissante par son action directe sur les récepteurs H1 exprimés sur les cellules musculaires lisses. Elle entraîne aussi une extravasation vasculaire également dépendante des récepteurs H1, et par conséquent, un œdème muqueux qui participe à l’obstruction bronchique. L’histamine augmente la perméabilité vasculaire et permet la contraction des muscles lisses localement (Schneider et al., 2005). – Cytokines : Elles peuvent diriger et modifier la réponse inflammatoire dans l’asthme et déterminer probablement sa sévérité. Les cytokines dérivant du Th2 incluant l’IL-5, qui est nécessaire pour la différenciation et la survie des éosinophiles ; l’IL-4 favorise la migration des éosinophiles vers le tissu pulmonaire et leur adhésions aux cellules endothéliales, ainsi que la production de mucus (Temann et al., 1997) et est importante pour la différentiation des cellules Th2. Cette dernière associée avec l’IL-13 sont importantes pour la production d’IgE. De plus, l’IL-13 qui peut être secrétée par les lymphocytes T, les mastocytes, les basophiles et les cellules épithéliales des voies respiratoires semble également jouer un rôle dans la réparation des cellules épithéliales ainsi que la métaplasie des cellules caliciformes. L’IL-1β et le facteur-α de nécrose de tumeur (TNF-α) amplifient la réponse inflammatoire et le facteur stimulant les colonies granulocytaires et les macrophages (GM-CSF) prolongent la survie des éosinophiles dans les voies respiratoires (Izuhara et al., 2009). – Chimiokines : ce sont des cytokines impliquées dans la migration cellulaire et dirigent ainsi la migration des populations leucocytaires requises vers le tissu enflammé. Elles sont sécrétées par de nombreuses cellules sentinelles après stimulation par des signaux de dangers. – Les médiateurs lipidiques de l’inflammation : Lorsque qu’une cellule (phagocyte ou mastocyte) détecte un signal de danger, la phospholipase A2 est activée (via la stimulation par le TNFα). Cette enzyme transforme les acides gras de la membrane plasmique de la cellule en leucotriènes, prostaglandines et PAF. Ces composés sont chimiotactiques pour les neutrophiles et les macrophages, et induisent aussi l’augmentation de la dilatation des vaisseaux et leur perméabilité, facilitant l’arrivée (Diapédèse) des leucocytes sur le site de l’inflammation.
– Les protéines de la phase aigües : Elles sont produites par les hépatocytes (cellules du foie) au moment de la phase aigüe de l’inflammation. Nous donnerons ici deux exemples, les deux pentraxines CRP (C-Reactive Protein) et SAP (Serum Amyloid-P). Toutes les deux sont de puissantes opsonines favorisant la phagocytose des pathogènes par les macrophages. La CRP est produite rapidement en réponse à l’IL-6, et son dosage dans le sérum est utilisé en clinique pour diagnostiquer une inflammation (Mayol et al., 2013).
Le monoxyde d’azote, •NO
Le monoxyde d’azote est produit de manière endogène lors du métabolisme de l’arginine par les « nitric oxide synthases » (NOS) dans des conditions physiologiques et physiopathologiques. L’isoforme inductible iNOS de l’enzyme peut être exprimée en réponse aux agents pro-inflammatoires, produisant ainsi de grandes quantités de monoxyde d’azote. Ce dernier se caractérise par une diffusivité élevée, une réactivité limitée et une demi-vie qui n’excède pas quelques secondes, il n’est donc pas particulièrement délétère pour les structures cellulaires. Malgré son rôle protecteur vis-à-vis du stress oxydant en limitant la lipoperoxydation et ses effets anti-inflammatoires, il est paradoxalement impliqué dans de nombreuses pathologies telles que le diabète, le cancer et les lésions neuronales dégénératives. De plus, le •NO peut interagir rapidement avec l’anion superoxyde et produire du peroxynitrite beaucoup plus réactif et délétère que ses précurseurs (Blanc et al., 2005).
Systèmes antioxydants exogènes
Les vitamines : Parmi lesquelles la vitamine E, qui englobe une famille composée des tocophérols et des tocotriénols (voir annexe 1), et dont la forme la plus active, l’α-tocophérol, est le principal antioxydant liposoluble dans le plasma et les érythrocytes. Situé dans les lipoprotéines et les membranes, l’ α-tocophérol est capable de piéger l’oxygène singulet et de réagir avec le radical hydroxyle pour former le radical tocophéryle. Parmi les vitamines il y a également la vitamine C (voir annexe 1). Fréquemment présente sous forme d’ascorbate, elle est considérée comme l’antioxydant le plus important des fluides extracellulaires. C’est un piégeur très efficace de l’ensemble des ERO. Elle réagit particulièrement avec les peroxyles aqueux en formant le radical ascorbyle ce qui protège les lipoprotéines et les membranes de la peroxydation lipidique (Valko et al., 2006). Les caroténoïdes : Ce sont des pigments issus des plantes et des microrganismes, et sont regroupés en deux grandes familles : les carotènes et les xantophylles. L’activité antioxydante de ceux-ci est liée à leur longue chaîne qui leur permet de réagir avec les radicaux ROO•, HO•, O2•-, R• par simple addition électrophile et transfert d’électron. Ils permettent, en particulier, de neutraliser l’oxygène singulet (Valko et al., 2006) (voir annexe 2). Les composés phénoliques en particulier les flavonoïdes, sont des métabolites secondaires des plantes. Leur capacité antioxydante réside dans leur faculté à « terminer » les chaines radicalaires par des mécanismes de transfert d’électrons et de protons, et à chélater les ions des métaux de transition capables de catalyser la peroxydation lipidique (voir chapitre suivant) (Leopoldini et al., 2011) (voir annexe 3).
Dosage ELISA de l’interleukine-4
Le dosage de l’interleukine-4 (IL-4) dans le sérum et le liquide du LBA des rats est réalisé grâce au kit Invitrogen Rat Interleukin-4 (Rt IL-4) qui utilise la méthode ELISA sandwich (REF : KRC0041 ; Lot : 1260054A1). La première étape de la technique ELISA est déjà effectuée lors de l’achat du Kit. Elle est nommée « coating », durant laquelle, l’anticorps de capture spécifique à l’IL-4 de rat avait été fixé au fond des cupules (figure 33). Lors de l’étape suivante, l’échantillon (contenant éventuellement l’antigène IL-4 à doser) ou le standard (contenant l’IL-4 à des doses connues) sont déposés dans les puits. Un second anticorps couplé à la biotine est alors ajouté. Durant la première incubation, il y a formation du sandwich car la molécule d’IL-4 se fixe d’une part sur l’anticorps immobilisé aux parois des puits et d’autre part sur l’anticorps biotinylé. Après l’étape du lavage, l’enzyme, la peroxydase liée à la streptavidine, est ajoutée permettant de transformer dans la dernière étape le substrat Tetramethylbenzidine (TMB) en produit coloré en bleu. L’ajout de la solution d’arrêt provoque le virage de la couleur au jaune. L’intensité de la couleur est directement proportionnelle à la concentration de l’IL-4 qui est déterminée par comparaison à la gamme-étalon du standard.
|
Table des matières
INTRODUCTION
PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE : CHAPITRE I. L’ASTHME
1.1. EPIDEMIOLOGIE
1.2. FACTEURS ETIOLOGIQUES DE L’ASTHME
1.2.1. Facteurs prédisposants
1.2.2. Les facteurs déclenchants
1.3. SENSIBILISATION ALLERGENIQUE
1.4. INFLAMMATION ET REMODELAGE BRONCHIQUE
1.5. MARQUEURS DE L’INFLAMMATION BRONCHIQUE
1.5.1 Médiateurs de la réponse immunitaire
1.5.2. Marqueurs du stress oxydant
PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE : CHAPITRE II. LE STRESS
1. LES RADICAUX LIBRES
1.1. LES ESPECES REACTIVES DE L’OXYGENE
Les espèces oxygénées réactives radicalaires
a. Le radical superoxyde, O2•-
b. Le radical hydroxyle, HO•
c. Les radicaux peroxyles
d. Le radical secondaire alkoxyles RO•
Les espèces oxygénées non radicalaires
a. L’oxygène singulet 1O2,
b. Le peroxyde d’hydrogène, H2O2
c. L’acide hypochloreux, HOCl
1.2. LES ESPECES REACTIVES DE L’AZOTE
a. Le monoxyde d’azote, •NO
b. Le peroxynitrite, ONOO-
2. LA PRODUCTION DE RADICAUX LIBRES
2.1. LA PRODUCTION INTRACELLULAIRE
2.2. LA PRODUCTION EXTRACELLULAIRE
3. MECANISMES D’ACTION DES ESPECES REACTIVES OXYGENEES ET LE STRESS OXYDANT OU OXYDATIF
a. Oxydation des composés lipidiques
b. Oxydation des composés protéiques
c. Oxydation de l’ADN
4. PROTECTIONS CELLULAIRES
4.1. LES ANTIOXYDANTS ENZYMATIQUES
a. Les superoxyde dismutases (SOD)
b. La catalase (CAT)
c. Les glutathion peroxydases (GPx)
4.2. LES ANTIOXYDANTS NON-ENZYMATIQUES
a. Systèmes antioxydants endogènes
b. Systèmes antioxydants exogènes
PARTIE BIBLIOGRAPHIQUE : CHAPITRE III. LES POLYPHENOLS
1. CLASSIFICATION CHIMIQUE
1.1. LES ACIDES PHENOLIQUES
1.1.1. Acides hydroxybenzoïques
1.1.2. Acides hydroxycinnamiques
1.2. LES FLAVONOÏDES
1.2.1. Les 4-oxoflavonoïdes
1.2.2. Les chalcones
1.2.3. Les flavanols
1.2.4. Les anthocyanes
1.3. TANINS
2. PROPRIETES BIOLOGIQUES ET INTERETS THERAPEUTIQUES
2.1. PROPRIETE ANTIOXYDANTE DES POLYPHENOLS
Capture ou piégeage directe des ERO
Chélation des ions métalliques
Inhibition des enzymes
Inhibition de la peroxydation lipidique
Activité antioxydante des acides phénoliques
2.2. POLYPHENOLS ET INFLAMMATION
2.3. POLYPHENOLS ET ACTIVITE ANTIASTHMATIQUE
PARTIE EXPERIMENTALE : MATERIEL ET METHODES
BUT ET OBJECTIFS
1. ETUDE DE LA COMPOSITION CHIMIQUE & DES PROPRIETES ANTI-OXYDANTES DES PLANTES CHOISIES
1.1. MONOGRAPHIES DES DEUX PLANTES ETUDIEES
1.1.1. La bourrache Borago officinalis L
1.1.2. L’ortie Urtica dioica L
1.2. CUEILLETTE DU MATERIEL VEGETAL
1.3. EXTRACTIONS
a. Extraction à l’eau
b. Extraction hydro-alcoolique
c. Calculs des rendements d’extraction:
1.4. DOSAGES COLORIMETRIQUES DES COMPOSES PHENOLIQUES
1.4.1. Dosage des phénols totaux
Protocole expérimental
1.4.2. Dosage des ortho-diphénols
Protocole expérimental
1.4.3. Dosage des flavonoïdes totaux
Protocole expérimental
1.4.4. Dosage des flavanols
Protocole expérimental
1.4.5. Dosage des tanins
Protocole expérimental
1.4.6. Dosage des anthocyanes.
1.5. ETUDE DE L’ACTIVITE ANTIOXYDANTE IN VITRO
1.5.1. Etude de l’activité antioxydante : Méthode DPPH
Protocole expérimental
Détermination de l’IC50
1.5.2. Etude de l’activité antioxydante par la méthode NBT
Protocole expérimental
1.5.3. Etude de l’activité antioxydante totale
Protocole expérimental
1.6. SEPARATION ET PURIFICATION PAR CHROMATOGRAPHIE LIQUIDE A HAUTE PERFORMANCE COUPLEE A LA SPECTROMETRIE DE MASSE (LC-MS/MS)
Protocole expérimental
2. ETUDE DES ACTIVITES BIOLOGIQUES IN VIVO
2.1. ANIMAUX ET CONDITIONS D’ELEVAGE
2.2. PROTOCOLE EXPERIMENTAL
2.2.1. Formation des lots et traitements des rats
2.2.2. Sensibilisation à l’ovalbumine
2.2.3. Provocation des animaux par aérosol
2.3. SACRIFICE ET PRELEVEMENTS
2.3.1. Prélèvement sanguin
2.3.2. Prélèvement du liquide broncho-alvéolaire
2.3.3. Prélèvement des organes
2.4. DOSAGE DES PROTEINES
2.5. NUMERATION DES LEUCOCYTES AU NIVEAU DU LIQUIDE DU LBA
2.6. DOSAGE ELISA DE L’INTERLEUKINE-4
Protocole expérimental
2.7. ETUDE HISTOLOGIQUE
a. Fixation
b. Enrobage et obtention des blocs
c. Confection de coupes
d. Coloration
2.8. EXPLORATION DES PARAMETRES DU STRESS OXYDANT
2.8.1. Dosage du malondialdéhyde
2.8.2. Dosage du glutathion
2.8.3. Dosage de l’activité enzymatique du glutathion peroxydase (GPx)
Protocole expérimental
2.8.4. Dosage de l’activité de la superoxyde dismutase (SOD)
Protocole expérimental
Calcul de l’activité SOD
2.8.5. Dosage de l’activité catalase (CAT)
Protocole expérimental
3. TRAITEMENT STATISTIQUE DES RESULTATS
PARTIE EXPERIMENTALE : RESULTATS & DISCUSSION
1. LA COMPOSITION CHIMIQUE & LES PROPRIETES ANTIOXYDANTES DES PLANTES CHOISIES
1.1. RESULTATS DES EXTRACTIONS
1.2. DOSAGE DES COMPOSES PHENOLIQUES
1.2.1. Dosage des phénols totaux
1.2.2. Dosage des ortho-diphénols
1.2.3. Dosage des flavonoïdes totaux
1.2.4. Dosage des flavanols totaux
1.2.5. Dosage des tanins totaux
1.2.6. Dosage des anthocyanes
1.3. ACTIVITE ANTIOXYDANTE
1.3.1. Méthode DPPH
1.3.2. Méthode NBT
1.3.3. Activité antioxydante totale
1.4. ETUDE DES CORRELATIONS
1.5. RESULTATS DE L’ANALYSE PAR LC MS/MS
1.5.1. Résultats de l’analyse par LC MS/MS pour les extraits de Borago officinalis
1.5.2. Résultats de l’analyse par LC MS/MS pour l’extrait éthanolique d’Urtica dioica
DEMARCHE D’IDENTIFICATION DES COMPOSES DE L’EXTRAIT ETHANOLIQUE D’URTICA DIOICA
DISCUSSION
2. LES ACTIVITES BIOLOGIQUES DES DEUX PLANTES
VARIATIONS DES PARAMETRES PHYSIO-HEMATOLOGIQUES & HISTOLOGIQUES
2.1. ETUDE DU POIDS CORPOREL ET DU POIDS RELATIF DES ORGANES
2.1.1. La croissance corporelle
2.1.2. Effet sur le poids relatif du foie et des poumons
2.2. ETUDE DES PARAMETRES DE LA REPONSE INFLAMMATOIRE
2.2.1. Taux des leucocytes dans le sang
2.2.2. Numération des leucocytes dans le liquide du LBA
2.3. DOSAGE DE L’INTERLEUKINE-4
2.4. ETUDE HISTOLOGIQUE
VARIATIONS DES PARAMETRES DU STRESS OXYDANT
2.5. LA PEROXYDATION LIPIDIQUE (DOSAGE DU MALONDIALDEHYDE)
2.6. LE GLUTATHION REDUIT
2.7. LA GLUTATHION PEROXYDASE
2.8. LA SUPEROXYDE DISMUTASE
2.9. LA CATALASE
2.10. ETUDE DE LA CORRELATION ENTRE LES PARAMETRES ETUDIES
Corrélations entre les paramètres in vivo
Corrélations entre les paramètres in vivo versus in vitro
CONCLUSION
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet