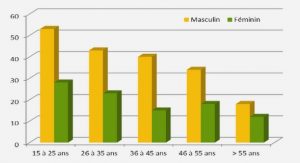Facteurs de la salinisation des sols
Les sols salés
Introduction
On distingue en général la salinisation primaire, liée à la présence naturelle relativement concentrée de sels (proximité de mers ou d’océans, présence de dépôts de sels…), et la salinisation secondaire, dont le développement apparaît étroitement lié à l’irrigation.
La salinisation est l’accumulation de sels hydrosolubles dans le sol. Ces sels sont le potassium (K+), le magnésium (Mg2+), le calcium (Ca2+), le chlorure (Cl-), le sulfate (SO42-), le carbonate (CO32-), le bicarbonate (HCO3-) et le sodium (Na+). L’accumulation de sodium est aussi appelée sodification. Les sels se dissolvent et se déplacent avec l’eau. Quand l’eau s’évapore, les sels restent.Tout d’abord, la salinisation implique une accumulation de sel par des processus naturels du fait d’une forte teneur en sel du matériau parent ou des nappes souterraines. En second lieu, la salinisation est provoquée par des interventions humaines, telles que des pratiques d’irrigation inappropriées, par exemple avec de l’eau d’irrigation riche en sel et/ou par un drainage insuffisant.
Les sols salés (définitions et pédogenèse)
Les sols sodiques aussi appelés sols salés ou sols halomorphes sont caractérisés par leur teneur élevée en sels solubles dans l’ensemble ou dans une partie du profil ou par la dégradation de la structure de l’un de leurs horizons ou de tout leur ensemble sous l’influence de l’un des ions provenant de ces sels, en particulier du sodium
Ces sols ont une grande extension en Algérie .Elle est due aux conditions arides où les possibilités d’exploitation sont considérable et les précipitations pluviales limitées (Aubert, 1976).
Les sols salés contiennent des sels plus solubles que le gypse, c’est-à-dire susceptible de passer dans la solution du sol en quantité assez importante pour gêner la croissance des plantes. En conséquence, les sols calcaires ne sont pas des sols salés, même si le carbonate de calcium est un sel comme un autre au plan chimique (Jean – Paul Legros ,2007).La salinisation des sols est généralement associée aux apports de sels dissous, issus de l’hydrolyse du substrat édaphique constitué de roches endogènes ou exogènes (salinisation primaire) ou des activités éoliennes et hydriques: embruns marins, e a u d’irrigation et nappe phréatique subaffleurante et salée (salinisation secondaire) (Dièye, 1994)La salinité des sols a été définie de manière différente suivant le domaine d’utilisation des sols. Du point de vue agronomique, un sol salin (saline soil) est défini comme un sol qui renferme assez de sels en solution, pour voir sa productivité diminuer (Richards, 1954).La salinité se mesure par la conductivité électrique en siemens S ou mhoms/m. Sachant que 1 S/m =1 mhos/m et 1 mhos = 1/ohm unité de résistance électrique.
La conductivité de l’eau peut être rapidement convertie en mg de sel par litre par la formule :
1 dS/m = 1 mS/cm = 640 mg/1 de sels.
L‘origine des sels solubles dans les sols est très variée. L’altération des roches contenant des minéraux sodiques, potassiques, magnésiens, donne des sels souvent solubles, en particulier carbonates et bicarbonates, parfois silicates, de ces métaux. En région aride ceux-ci se concentrent sur place ou dans les dépressions et zones basses du paysage. Parfois en zone endoréique, ils peuvent être apportés par les rivières qui viennent s’y jeter.
L’origine des sels peut aussi se trouver dans les dépôts lagunaires ou matériaux salés plus ou moins récents (G. GAUCHER) Ils peuvent être eux-mêmes roche mères des sols. Ils peuvent aussi fournir leurs sels aux oueds qui les transportent jusqu’aux nappes phréatiques plus ou moins profondes sous les sols des vallées et basses plaines, ou qui les répandent à leur surface lors des crues.
Enfin le vent peut causer l’apparition de phénomènes de salure sur des sols qui en étaient indemnes, en y déposant les Cléments de pseudosable salés et les cristaux de sels qui y sont mêlés et formés à la surface de sols très salés à alcali en particulier à la bordure de dépressions.
Que les sels solubles soient ainsi mis en place à la surface du sol, dans son matériau originel, dans la nappe phréatique peu profonde ou dans la nappe artésienne sous-jacente, ils sont rapidement remis en mouvement dans l’ensemble du profil par remontée de la nappe ou par phénomènes de capillarité favorisés par l’évaporation directe ou par l’intermédiaire de la végétation. Ou sous l’influence des pluies ou des eaux d’irrigation ou d’inondation. La richesse relative en ces divers sels de chacun des horizons varie dans un même profil du fait des réactions d‘échange cationique entre le sol et sa solution, mais aussi par suite des taux et vitesse de dissolution ainsi que viscosité différents des divers ions et sels. (Aubert, 1976).
L‘activité microbienne peut également provoquer la modification de certains sels tels que les sulfates. Les mouvements ne se produisent pas toujours verticalement, descendants ou remontants, mais parfois obliquement c’est le cas dans les dépressions ou les pentes sont assez fortes.
La richesse du sol en sels solubles ou en ions alcalisant tels que le sodium, se répercute dans sa morphologie, en surface et plus ou moins en profondeur.
La surface des sols sodiques est parfois couverte d’une véritable croûte saline. Elles ne sont pas épaisses et d’une certaine extension, semble-t-il, que dans les régions de Chotts ainsi que dans certaines dépressions endoréiques et dans certaines oasis des zones Sahariennes.
Le plus souvent ce ne sent que des efflorescences qui apparaissent à la surface de ces sols: salant blanc des sulfates et chlorures parfois bicarbonates de sodium et de magnésium, ou de gypse, ce dernier pouvant y devenir prépondérant.
Lorsque le milieu est riche en calcium et relativement peu en sulfates, le salant blanc de surface peut présenter une forte teneur en chlorures de Calcium et de magnésium en même temps que de sodium. C’est le salant hygroscopique, observé en particulier sur les Hauts Plateaux algériens (Pouget M, 1976).
Répartition de la salinité du sol
Les sols salés dans le monde
La salinité est un des processus de dégradation des sols les plus largement répandus sur la Terre. Les causes techniques les plus importantes à l’origine de la diminution de la production sur de nombreux périmètres irrigués, particulièrement dans les zones arides et semi-arides, ou de désastre sur de grandes surfaces en agriculture pluviale, sont l’engorgement, la salinisation et la sodication. Il est estimé, à partir de diverses données disponibles que :
Le monde perd au moins 3 hectares de terres arables chaque minute à cause de la salinité du sol
Bien que de nombreux pays utilisent les terres salinisées en raison de leur proximité aux ressources en eau et de l’absence d’autres contraintes environnementales, il y a un besoin clair d’une base Scientifique solide afin d’optimiser leur utilisation, de déterminer leur potentiel, productivité et durabilité pour cultiver diverses cultures, et d’identifier les pratiques de gestion intégrées appropriées.En Europe, on trouve des sols à forte teneur saline en Hongrie, en Roumanie, en Grèce, en Italie et dans la péninsule ibérique. Dans les pays nordiques, le déverglaçage des routes en utilisant du sel peut provoquer une salinisation localisée.On estime que la salinisation du sol affecte 1 à 3 millions d’hectares de terres en UE. Cette salinisation est considérée comme une cause majeure de désertification et constitue donc une forme grave de dégradation des sols. Ce problème de la salinisation en Europe s’accentue du fait de l’augmentation des températures et de la réduction des précipitations, caractéristiques du climat de ces dernières années.
Les sols salés en Algérie
Les sols salés sont très répandus en Algérie essentiellement dans les zones arides et semi-arides; des travaux effectués par déférents auteurs montrent que la majorité des sols agricoles en Algérie sont affectés par les sels (DURAND, 1958;HALTIM, 1985).De façon générale « les sols sodiques en Afrique du Nord proviennent principalement d’une action de la mer (pas actuelle) ou de la présence de dépôts lagunaires salés et gypseux répartis dans l’échelle stratigraphique depuis le Trias jusqu’au Quaternaire ».En Algérie d’après SZABLOCS (1989) 3,2 million d’hectares subissent à des degrés de sévérité variable, le phénomène de salinisation dont une bonne partie se trouve localisée dans les régions steppiques où le processus de salinisation est plus marqué du fait des températures élevées durant presque toute l’année, du manque d’exutoire et de l’absence de drainage efficient.Ce phénomène est observé dans les plaines et vallées de l’Ouest du pays (Mina, Cheliff, Habra Sig, Maghnia) dans les hautes plaines de l’Est (Constantine, Sétif, Bordj Bou Arreridj, Oum El Bouagui), aux abords des Chotts et de Sbkhas (Chott Ech Chergui, Chott Gharbi, Chott Hodna, Chott Melghir, Sebkha d’Oran, de Benziane, Zemmoul, Zazhrez Gharbi et Chergui, etc..) et dans le grand Sud (dans les Oasis, le long des oueds, etc…).
Facteurs de la salinisation des sols
Climat
Dans les régions à climat humide, les sols salins sont pratiquement inexistants ; la profonde percolation des eaux de pluie permet le lessivage des sels solubles. Dans les régions semi-arides, le lessivage et le transport des sels solubles sont faibles.L’évapotranspiration entraîne une concentration des sels dans la zone racinaire et dans la couche superficielle. Dans ce cas, la masse totale des sels reste constante dans le profile su sol et le volume d’eau diminue ce qui implique une augmentation de la concentration des sels. Un paramètre qui rend compte de l’intensité de l’évapo-concentration est le FL (Fraction Lessivée).( M. Lahlou et al…).
La concentration des sels dans le sol y favorisée la faible percolation, qui favorise la concentration en sel dans un endroit précis du profil (BENNACER et MORSLI, 1988/1989)Les fonds de dépressions salées d’Afrique du nord sont nettement hydro-halomorphes. La concentration en sel est principal facteur qui y limite la croissance des végétaux. Pendant l’hiver, quant les oueds amènent de l’eau à ces déprissions, le sel descend mais au cours de l’été, il revient en surface.L’explication proposée par Kovda et Samoilova (1969) réside dans la solubilité différentielles de ions Ca+, Mg+2 et Na+ lorsque la concentration augmente, c’est –a-dire en saison sèche ; les ions les mois solubles précipitent, Ca+2 d’abord, puis Mg+2
.Dans ces conditions, le complexe absorbe préférentiellement les ions qui restent solubles le plus longtemps : Na+ surtout secondairement Mg++.
Les alternances saisonnières jouent dans ces conditions un rôle important, la dynamique des ions étant très différente en saison humide et en saison sèche.
En saison humide :
Altération des minéraux primaires et libération des ions Na+ , Mg++ et Ca++ , les uns et les autres sont entraînés vers le bas mais ne peuvent être éliminés en raison de l’insuffisance ou de l’absence de drainage .
En saison sèche :
La remontée par capillarité des solutions du sol sous l’influence de l’évaporation la concentration des solutions augmente, la précipitions des sels intervient, ce qui permet la saturation par le sodium d’une fraction de l’humus et des argiles, qui pourront être
entraînés à la période humide suivante (DUCHAUFFOUR .PH, 1983). 26
Source de sels
Le sel provient des minéraux de la croûte terrestre. Les agents atmosphériques décomposent les minéraux et libèrent le sel sous une forme soluble. L’altération des roches contenant des minéraux sodiques, potassiques, magnésiens, donne des sels souvent solubles, en particulier carbonates et bicarbonates, parfois silicates, de ces métaux. En région aride ceux-ci se concentrent sur place ou dans les dépressions et zones basses du paysage. Parfois en zone endoréique, ils peuvent être apportés par les rivières qui viennent s’y jeter.
Les régions humide ; ont généralement une pluviosité suffisamment forte pour lessiver le sel à travers le sol et dans la nappe phréatique qui l’entraîne vers les cours d’eau. Ces derniers le transporte dans les Océans.
L’irrigation apporte au sol de grandes quantités de sels et il est fréquent d’entendre les agricultures refuser l’eau qui leur est proposée sous le prétexte qu’ils ne veulent pas du sel qu’elle apporte.
L’utilisation d’eaux contenant 1g de sels solubles au litre apporte, en culture maraîchère, utilisant 8000 m3/ha tonnes de sels a l’hectare (DURAND J.H, 1983).
Drainage
La nécessité du drainage des sols irrigués apparaît dans les conséquences de l’engorgement par l’eau des sols lourds pour les quels l’équilibre hydrique naturel est rompu par l’apport des irrigations.
Le drainage est l’unique solution durable pour maintenir la production agricole .on le pratique pour lessiver les sels en excès et pour abaisser le niveau de la nappe, pour limiter l’effet du sel sur les plantes (ECHEVARRIA. G).
Seuls les sols bien drainés, à texture plus grossière, sont non salins. Bien que les eaux fluviales utilisées pour l’irrigation n’aient que des teneurs assez faibles en sels, on considère que c’est le manque de drainage qu’a provoqué la salure des sols, dans l’antiquité comme de nos jours.
Intrusion d’eau de mer
Intrusion de l’eau de mer dans la nappe près des côtes est due à une inversion du gradient hydraulique à cause de la surexploitation des nappes souterraines. L’utilisation de l’eau de cette nappe à des fins d’irrigation entraîne l’intrusion de l’eau saline près de la zone racinaire. L’effet est amplifié par la présence d’une surface évaporatrice. Dans ce cas le volume de l’eau et la masse des sels augmentent donc la concentration en sels augmente ou diminue en fonction de la salinité initiale de la zone racinaire. Mais en général le résultat final est une augmentation.
Aspect pédologique de salinisation, salinisation primaire ou secondaire
Salinisation primaire ou secondaire ; Il faut adopter ces expressions dans leur acception pédologique. Une pédogenèse est primaire quand elle se développe directement sur une roche, elle est secondaire quand elle fait suite à une pédogenèse antérieure.
Transposée dans le domaine de l’allomorphie, cette conception amène à considérer comme une salinisation primaire. Tout processus d’holomorphose qui débute avec la pédogenèse. En somme dans la salinisation primaire, le caractère halomorphe est congénital.
Par contre, si une partie d’une plaine littorale est envahie par la mer, bien que le contact soit direct, la salinisation reste secondaire car le sol était déjà formé et avait acquis une personnalité pédologique avant l’intervention du processus d’allomorphie. Il en est même d’un sol alluvial qui se sale sous l’effet de la remontée d’une nappe chloruré.
Mais s’il se produit par exemple un dépôt d’alluvions dans une eau salée, (Sebkha ou chott), la salinisation est primaire, car elle est concomitante de la phase initiale de la pédogenèse : elle est bien congénitale (GILBERT G, SYLVIE B, 1974).
Signes d’un sol salé
La croissance des plantes cultivées sur sols salins est généralement médiocre et éparse parceque le sel retarde ou empêche la germination des semences. Si les semences ne donnent pas des germes. Les jeunes plants ne tardent pas à mourir. Il se produit alors des plaques irrégulières dénudées dans le champ. Le peuplement médiocre et épars. Ainsi que ces plaques nues et irrégulières sont généralement entourées par des zones de croissance inégale.
Un autre indice de salinité du sol est la présence d’une croûte blanche à la surface du sol. Cependant. Ce signe peut ne pas être une indication de la salinité car les sols non salins qui contiennent du gypse présentent également des croûtes blanches.
Il n’est pas toujours possible de terminer par inspection visuelle si un champ contient trop de sel. Un meilleur système consiste à analyser les sols suspects.
Les principaux signes de la salinité des sols sont :
-Croissance irrégulière des cultures et manque de vigueur des plantes.
-Apparition d’une croûte blanchâtre en surface
-Apparition des mauvaises herbes tolérantes aux sels, comme : Spergularia Salina, Atriplex halimus, Suaeda fructicosa, Salicornia fructicosa.
Normes d’interprétation de la salinité du sol
En ce qui concerne le sol, le paramètre majeur retenu pour interpréter la qualité saline d’un sol est celle de la conductivité électrique.
La conductivité permet d’obtenir rapidement une estimation de la teneur globale en sels dissous ; en plus la connaissance de la conductivité est nécessaire pour l’étude du complexe absorbant des sols salés (Aubert.G, 1986).
On mesure alors la conductivité électrique de la solution extraite du sol saturé 1/5. On utilisera l’échelle suivante (µS/cm):
– sol non salin CE<2000
– sol légèrement salin 2000<CE<4000
– sol salin 4000<CE<8000
– sol très salin CE >8000
Classification des sols salés
La Classification des sols sodiques est délicate du fait des variations saisonnières ou sous l’action de l’homme qu’ils peuvent subir. En particulier, dans ce dernier cas, elles peuvent être extrêmement importantes comme dans les sols très sableux.
La Classification française insiste sur l’importance des modifications morphologiques et écologiques, même si elles sont variables dans le temps, subies par les sols dont I’évolution est soumise à l’influence d’un excès de sels solubles ou d’ions provenant de leur dissociation et susceptibles de provoquer la modification de leurs caractéristiques physiques. De ces sols elle fait une classe. Celle-ci est définie soit par la présence de sels solubles en quantité suffisante dans un horizon d’au moins 20 cm pour y élever la conductivité de l’extrait de pâte saturée jusqu’à au moins 8 millimhos par centimètre, à 25 °C, soit par la dégradation de la structure d’un horizon d’au moins 20 cm sous l’influence d’un excès d’ions échangeables alcalins (Na/T variable suivant les sols mais toujours supérieur à 10%).
Plusieurs noms lui ont été donnés: Sols salés, Sols halomorphes, Sols sodiques; aucun ne recouvre l’ensemble des sols concernés. La dénomination de Sols Salsodiques que propose J. SERVANT parait bien meilleure. Deux sous-classes y sont distinguées en fonction de la présence ou de l’absence d’un horizon à structure dégradée. Dans une première sous-classe, de sols salsodiques, à structure non dégradée, on peut distinguer deus groupes:
Celui des sols salins à complexe calci-magnésique dont la teneur en sodium du complexe d’échange est inférieur à 15%.
|
Table des matières
Introduction générale
Partie théorique
Chapitre I : présentation de la zone d’étude
Introduction
I-1-Localisation
I-2-Géologie
I-3-Géomorphologie
I-3-2-Dépressions
I-3-2-1-Sebkhas
I- 3-2-2-Dayas
I-3-2-3-Chotts et Mekmens
1-4-Aperçu pédologique
1-4-1-Les sols calcimagnésiques
1-4-2-Les sols gypseux
1-4-3-Les sols salés
1-4-3-1-Les sols salés à structures non dégradées
1-4-3-2-Les sols salés à structure dégradée
1-4-3-3-Sols hydromorphes ou sols à gley
I-4-4-Les sols cultivés
I-4-4-1-La Surface agricole utilisée
I-4-4-2-Les terres mises en valeur
I- 5 – Etude climatiques
I-5-1-Cartes des precipitations
I-5-2- Precipitations
I- 5-3- Température
I-5-4-Les vents
I-5-5-La gelée
I-6-Synthèse climatique
I-6-1- Amplitude thermique moyenne et indice de continentalité
-6-2-Indice de sécheresse estivale
I-6-3- Indice d’aridité de Demortonne (1923)
I-6-4- Indice d’aridité annuel
I-6-6-Diagramme ombrothermique de BANGNOULS et GAUSSEN
I-6-7- Quotient pluviométrique et climagramme d’EMBERGER (1955)
I-6-8-É vapotranspiration (ETP)
Conclusion
Chapitre II : Les sols salés
Introduction
II-1-Les sols salés (définitions et pédogenèse)
II-2-Répartition de la salinité du sol
II-2-1-Les sols salés dans le monde
II-2-2-Les sols salés en Algérie
II-3-Facteurs de la salinisation des sols
II-3-1–Climat
II-3-2-Source de sels
II-3-3-Drainage
II-3-4- Intrusion d’eau de mer
II-4-Aspect pédologique de salinisation, salinisation primaire ou secondaire
II-5-Signes d’un sol salé
II-6-Normes d’interprétation de la salinité du sol
II-7-Classification des sols salés
II-8- Ecologie des sols salés
II-8- L’utilisation agricole des sols salés
II-9- Amendements et mise en valeur des sols salés
II-9-1-La restauration par lessivage
II-9-2-Traitements chimiques
II-9-2-1- Traitement par le gypse
II-9-2-1-1-Action du gypse sur le sol
II-9-2-2- Traitement par l’acide sulfurique
Conclusion
Chapitre III : les sels dans les sols salés
Introduction
III-1- Définition de la fixation ionique
III-2-Les phénomènes d’échange dans les sols, généralités
III-2-1-Fixation préférentielle des cations sur les sols
III-2-2– Les formes et sources de l’ion Sodium
III-3-Les principaux sels responsables de la salinité
III-3-1- Les carbonates
III-3-1-1- Les carbonates de magnésium
III-3-1-2- Les carbonates de sodium
III-3-1-3- Les carbonates de potassium
III-3-2– Les chlorures
III-3-2– 1- Le chlorure de sodium
III-3-2– 2- Le chlorure de magnésium
III-3-2– 3 – Le chlorure de calcium
III-3-3- Le chlorure de potassium
III-3-4 – Les sulfates
III-3-4 1- Les sulfates de magnésium
III-3-4-2- Les sulfates de sodium
III-3-4 -3 – Les sulfates de potassium
III-4-Les caractères principaux des sels dans le sol
III-4-1– La solubilité
III-4-2- La mobilité
III-4-2-1- Les mouvements descendants
III-4-2-2- Les mouvements ascendants
III-4-2-3- Les mouvements verticaux et obliques
Conclusion
Chapitre IV: Les problèmes de la salinité
Introduction
IV-1- L’action des sels sur les propriétés du sol
IV-1-1- Les effets des sels sur les propriétés physiques du sol
IV-1-2- Les effets des sels sur la stabilité structurale
IV-1-3 L’effet des sels sur la perméabilité
IV-1-4-L’action des sels sur la rétention de l’eau
IV-2- Le stress salin
IV-2-1-Notion de stress
IV-2-2- Influences des sols salés sur les plantes
IV-3-1- L’effet de la salinité sur la croissance
IV-3-2- L’effet de la salinité sur l’eau et l’Oxygène dans la plante
IV-3-3-L’effet de la salinité sur l’anatomie de la feuille
IV-3-4-L’effet de la salinité sur les pigments photosynthétiques et les protéines
IV-3-5-L’effet de la salinité sur les lipides
IV-3-6-L’effet de la salinité sur le taux des ions
IV-3-7-L’effet de la salinité sur les enzymes antioxydantes
IV-3-8-L’effet de la salinité sur le métabolisme de l’azote
IV-3-9-L’effet de la salinité sur l’ultrastructure du chloroplaste
IV-3-10-L’effet de la salinité sur la photosynthèse
IV-4- L’effet des sels sur la faune du sol
IV-4-La tolérance des plantes à la salinité
IV-5- Conséquences de la salinité sur les rendements
IV-1-5-1-Symptômes morphologiques d’un stress dû au sel
Conclusion
Chapitre V – Normes et méthodes de mesure
Introduction
V- Analyses chimiques
V –1- Les caractères d’évaluation de la salinité
V-1-1- La conductivité électrique (C. E)
V-1-2- Extrait de la pâte saturée
V-1-3- Les différentes échelles de salinité
V-1-4- Le taux de sodium échangeable (E S P)
V-1-5 – L’indice du risque de salinité (I. R. S)
V-1-6- Le pH
V-1-7- Le calcaire total
V-1-8- Le calcaire actif
V-1-9 – Bilan ionique dans les sols salés ou gypseux
V-2- Qualité de l’eau d’irrigation
V-2-1- La sodocité
V-2-2-Normes d’interprétation de la salinité de l’eau
V-2-3-La classification des eaux d’irrigation selon la conductivité
V-2-4-La classification des eaux d’irrigation selon la proportion relative du sodium, du calcium et du magnésium
V-3- Matière organique
V-3-1-Actions de la matière organique sur les propriétés physiques du sol
V-3-2-Actions de la matière organique sur les propriétés chimiques du sol
V-3-3-Actions de la M.O sur les propriétés biologiques du sol
V-4- Mode d’irrigation
V-4-1-Définition des systèmes d’irrigation
V-5- Prégermination
V-6- Effet des haies brise-vent
Conclusion
Partie Expérimentale
I- Etudes du sol et de l’eau d’irrigation
Introduction
I-1-Choix de la région d’étude
I-2-Localisation de la région d’étude
I-3-Analyse du sol
I-3-1-Description du terrain
I-3-2-Echantillonnage
I-4-Analyse au laboratoire
I-4-1-Les analyses physiques
I-4-1-1-L’analyse granulométrique
I-4-1-2-Mesure du pH
I-4-1-3-Humidité résiduelle
I-4-1-4-La matière organique
I-4-2-Les analyses chimiques
I-4-2-1-Calcaire total (CaCO3)
I-4-2-2-Bilan ionique dans les sols salés
I-4-2-3-La conductivité électrique du sol
I-5-Analyse de l’eau d’irrigation
I-5-1-Mesure de la conductivité électrique
I-5-2-Analyse chimique de l’eau d’irrigation
I-5-3-pH de l’eau d’irrigation
Essais expérimentaux
Introduction
II- Mode expérimentale :
II-1-Matériel végétal utilisé
II-1-1-La menthe
II-1-2-Pomme de terre
II-1-3- Carotte
II-1-4-Pastèque
II-2- matière organique
II-3-Mode d’irrigation
II-4- Prégermination
II-5- Rôle des haies brise-vent
Résultats et discussion
III- Résultats
III-1-Résultats de l’analyse du sol
III-1-1-Granulométrie
III-1-2-pH et conductivité électrique des quatre sols
III-1-3-Humidité résiduelle
III-1-4-La matière organique
III-1-5-Taux de calcaire
III-1-6-Bilan ionique des quatre échantillons
III-2-Résultats de l’analyse de l’eau d’irrigation
IV-1-La matière organique
IV-1-1-Le sol non traité
IV-1-1-1-Evolution de la structure du sol
IV-1-1-2- la conductivité électrique du sol témoin
IV-1-1-3-le rendement
IV-1-2- Le sol traité par la matière organique
IV-1-2-1-Le suivi de l’effet de la matière organique sur la structure du sol
IV-1-2-2-Conductivité du sol traité par la matière organique
IV-1-2-3- Le rendement
IV-2- Mode d’irrigation
IV-2-1- L’irrigation par submersion
IV-2-1-1- La structure du sol
IV-2-1-2- Conductivité électrique
IV-2-1-3- Le rendement
IV-2-2- Irrigation par aspersion
IV-2-2-1- La structure du sol
IV-2-2-2- La conductivité électrique
IV-2-2-3- Rendement
IV-3- Prégemination
IV-3-1- Taux de levée des graines prégermées
IV-4- Rôle des haies brise-vent
IV-4-1-Evolution de la conductivité d’un sol clôturé par une haie brise-vent
IV-4-2-Rendement de la pomme de terre
V- L’interprétation statistique des résultats
V-1- Corrélation entre la CE et l’humidité résiduelle du sol
V-2- Corrélation entre l’humidité résiduelle et la matière organique du sol
V-2-3- Corrélation entre l’humidité résiduelle et le pourcentage du sable du sol
V-2-4- Test de calcul de l’intervalle de confiance pour la différence entre les moyennes (Menthe)
1-Test t et intervalle de confiance pour données appariées
2-Test t et intervalle de confiance pour 2 échantillons
VI- Discussion
Conclusions générales et perspectives
Bibliographie
![]() Télécharger le rapport complet
Télécharger le rapport complet