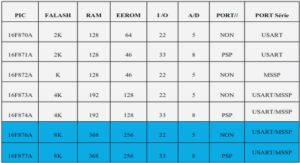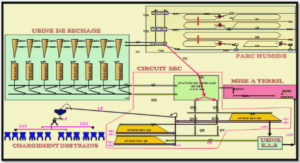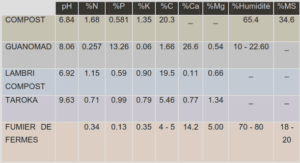Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
Un mouvement spatialisé
Le lâcher-prise serait également connecté à l’espace. Il permettrait de “se laisser tomber, enfin se laisser aller”. Dans ces actions passives de chute ou de laisser-aller, il n’y a pas de faille spatio-temporelle possible : le mouvement se déroule dans une temporalité et un espace donnés. Peut-être qu’en se laissant tomber, nous sommes amenés à contacter le sol, la solidité des appuis, et qu’en se laissant aller, nous accueillons la marche, nous avançons. Être soutenu dans une progression de mouvement, une hypothèse topologique du lâcher-prise ? Et si celui-ci nous emmenait quelque part, ce serait où ? Dans plusieurs de mes discussions, je note l’évocation d’une direction ou d’un chemin que le lâcher-prise propose. Ce serait “sortir de sa zone de confort, lâcher quelque chose auquel on peut se retenir pour aller vers quelque chose qu’on connaît peut-être moins” ou encore “lâcher ce qui est futile et qui demande de l’énergie inutile que tu pourrais lâcher sur le chemin”. A mon sens, s’affranchir d’une zone de confort va de pair avec la possibilité d’y revenir lorsque le besoin se fait sentir. S’il est question d’un cheminement, la route est parfois sinueuse et nous n’en voyons pas la fin. Alors nous nous tenons aux sentiers familiers, et si détour il y a, pourvu que ce ne soit pas un hors-piste.
Si le lâcher-prise est associé à la spatialité, il engage le sujet qui l’éprouve à se mouvoir. Au cœur des enjeux idéologique et pratique en psychomotricité, il m’apparaît essentiel de définir le mouvement. Du latin movere, il renvoie à l’action de se mouvoir, de se mettre en mouvement, de changer de place.12 Il se présenterait à première vue comme un “phénomène physique ou matériel mettant en jeu un changement corporel ou un déplacement spatial”13. La définition peut être complétée par Suzanne Robert-Ouvray et Agnès Servant-Laval en ajoutant que le mouvement constitue “un changement de position des différents segments corporels les uns par rapport aux autres, avec pour objectif, soit de modifier la posture, soit d’entraîner un déplacement du corps dans l’espace”14. Enfin, le mouvement serait “plus ou moins finalisé, plus ou moins volontaire ou réflexe, plus ou moins automatisé, plus ou moins conscient”15.
Dans le mouvement, le lâcher-prise nous fait “se retrouver soi mais autrement. C’est plutôt concret, non ? (rires). C’est lâcher une partie de nous mais ce qu’on retrouve, c’est nous- mêmes avec une conscience en plus, ou au niveau du corps, un espace en plus qui va être accessible”. Mon amie fascia-thérapeute m’aide dans le lien que nous établissons, au fil de nos discussions, entre la détente musculaire et la création d’espace dans le corps. Physiologiquement, un muscle relâché occupe plus de place que celui qui se contracte en resserrant les fibres qui le constituent. Elle poursuit : “l’idée de lâcher-prise c’est se permettre de prendre du recul dans une intention de se relâcher et donc se permettre de changer de point de vue.” De la libération de l’espace du corps découle un changement de point de vue, de rapport à l’espace environnant. Et dans cet espace, il y a l’autre…
Avoir confiance, -s’-abandonner
La confiance est un sujet régulièrement abordé lors de mes entretiens. Souvent associée à l’abandon, elle exprime parfois la possibilité de s’abandonner soi dans le lâcher-prise. D’autres fois, elle vient signifier la perte de contrôle, l’abandon d’une entité extérieure. “Ça me renvoie à un laisser faire, un abandon à quelque chose de plus grand que soi, que j’ai pu longtemps vivre comme abdiquer, ou perdre le contrôle. Ça a à voir avec la confiance, mais ce terme-là n’y amène pas forcément facilement”. Effectivement, lorsque j’entends le mot abandonner, il résonne négativement, comme une séparation, un échec, une renonciation. Pour Daisetz Teitaro Suzuki, penseur japonais, il constitue un état de disposition intérieure permettant de renoncer à essayer de nous sauver pour accéder à un état spirituel de passivité : cet état permet d’entrer dans une réalité plus grande que nous-mêmes. Cette passivité n’étant pas absolue, il précise que l’abandon va de pair avec “quelque chose d’intensément actif en nous”17.
Le lâcher-prise peut également être perçu comme “une forme d’acceptation” : “accepter des choses, des gens tels qu’ils sont, tels que les événements arrivent. Ne pas lutter contre. Faire confiance aussi. Lâcher prise par rapport à soi-même, c’est vraiment se faire confiance (…). Il y a quelque chose de spirituel dans le lâcher-prise, d’abandon parce qu’il y a une espèce de confiance, de foi.” Nous pourrions par analogie penser le lâcher-prise comme un abandon de ce qu’on tient ou une façon d’“abandonner le combat”18.
Parfois associé au corps et au sentiment de sécurité, le lâcher-prise peut être considéré comme un abandon de soi en toute sécurité, lorsqu’on lâche “sur un tapis de relaxation”, ainsi “soutenu par quelque chose de solide”. En outre, cet appui peut être identifié dans le corps propre : “le corps, c’est ce qui va me permettre de lâcher prise : il me donne des appuis, un canal, une confiance”. Je me permets d’associer cette thématique au langage courant. Lorsqu’elle est absente ou excessive, la confiance ne semble pas faire bon ménage : perdre la confiance dans des situations de déception ou au contraire, pour les jeunes générations, prendre la confiance lorsque nous nous avérons trop sûrs de nous. A ce propos, lorsqu’une personne prend la confiance, nous disons aussi familièrement qu’elle ne se sent plus. Mais au sens propre du terme, si elle ne se sent plus, c’est que le corps ne répond plus d’elle. Alors peut-être existe-t-il un lien, au-delà du langage courant, entre l’espace corporel et le seuil de confiance nécessaire pour lâcher ou se lâcher ?
Le lâcher-prise a finalement été abordé d’une façon double et “paradoxale” : il supposerait au sein d’une même action “de tenir et d’abandonner en même temps”. Il ne s’agirait alors pas d’abandonner tout ni complètement mais de conjoindre ces deux façons d’être au monde.
Étymologie et contexte d’apparition
Étymologiquement, nous pouvons soulever une première définition en prenant séparément les termes “lâcher” et “prise”. Du latin lessicare, lâcher signifierait relâcher, détendre. Le verbe pourrait être entendu comme “laisser aller en détendant ce qui retient. Associé aux mains, il évoque l’action de desserrer. La prise provient du latin prehensus et renvoie à ce “qui est saisi avec les mains en serrant fortement”. Les deux termes ainsi juxtaposés pourraient traduire l’action de desserrer ce que l’on tient avec force. L’engagement corporel apparaît ainsi dans la définition étymologique du lâcher-prise.19
Parce qu’il faut un peu de théorie pour étayer cette réflexion, je m’appuierai sur la thèse de Félix Tanguay20, dont le travail fut dévoué à l’approche historique du lâcher-prise. L’apparition du terme se greffe à l’histoire du letting go anglo-saxon tout en revêtant une acception singulière. La version originale est traduite telle qu’elle : “Si vous voulez arriver à la vérité non adultérée du non-égotisme, vous devez une fois pour toutes lâcher prise et tomber dans le précipice, d’où vous vous relèverez nouvellement éveillé et en pleine possession de vos quatre vertus d’éternité, de félicité, de liberté et de pureté qui appartiennent au moi réel”21. Ce que l’on nomme aujourd’hui lâcher-prise fut introduit par René Daumal, traducteur et poète épris de spiritualité, dont l’idéologie est décrite comme une “pensée en acte”22.
Multiples “usages”
Dans sa thèse de maîtrise en sciences des religions, Félix Tanguay 23 retrace l’évolution historique du concept de lâcher-prise. Je m’appuierai sur son travail pour élucider les différents contextes d’apparition de la locution dans le monde contemporain. En premier lieu, le domaine du développement personnel en recense le plus grand nombre d’occurrences. Les littératures proposées dans ce registre sont diverses et variées, fortement accessibles et promulguées. Elles auraient largement participé à l’acceptation de la notion, au point que les différents domaines scientifiques -psychologie, professions soignantes et industrielles- se l’ont appropriée. Écrivain et conférencier américain, Guy Finley serait largement représentatif de ce courant : après un voyage spirituel, il écrit The secret of letting go en 1990, premier ouvrage d’une longue série. Selon lui, le lâcher-prise consisterait à embrasser le “vrai moi” en se débarrassant du “faux moi”, à savoir tout le mauvais capable de contraindre notre bonheur et l’harmonie de notre développement. Ce processus agirait en faveur du potentiel qui nous habite, de la liberté de notre être et de la divinité en nous. La psychologie est le domaine scientifique dans lequel le lâcher-prise est le plus évoqué. Il est régulièrement associé à l’abandon d’idées intrusives, d’obsessions ou diverses émotions nuisibles telles que la haine ou le ressentiment. Il serait utile pour les patients, mais aussi pour le thérapeute, dont l’acceptation inconditionnelle permettrait d’accompagner ce lâcher-prise. Dans le domaine des soins infirmiers et palliatifs, il est utilisé pour parler du processus d’acceptation de la mort d’un proche ou de sa propre mort, notamment lorsqu’il s’agit d’abandonner les suites d’un traitement qui maintiendrait la personne en vie. Pour le patient devant s’abandonner à la mort, l’expérience ultime consisterait à lâcher prise sur ce qui adviendra et ne dépendra pas de lui. Chez les fraternités anonymes, le lâcher-prise est une réponse aux problématiques de dépendance. Il est également évoqué dans le domaine de la philosophie et dans l’ensemble des religions. Enfin, en pédagogie et relations industrielles, le lâcher-prise permettrait à l’enseignant ou au patron d’échapper à une posture de contrôle, de désamorcer d’éventuels conflits ou encore de déléguer, favorisant ainsi l’autonomie et la liberté des personnes encadrées.
Ainsi, l’expression est largement répandue, dans des domaines et applications variées. Le lien entre toutes ces approches se situe dans les acceptions diverses de la croissance personnelle.24 Dans cette liste probablement non exhaustive, quid de la psychomotricité ? La profession n’est pas citée dans la recherche de Tanguay. Le lâcher-prise fait régulièrement état d’une réponse apportée à des problématiques ou situations conflictuelles d’ordre psychologique, omettant ainsi toute possibilité de l’incarner.
Contrôle et lâcher-prise
Le lâcher-prise est souvent défini dans ce qui l’oppose à une posture de contrôle. Je pense aux occurrences du mot prise car il s’agit bien dans ce contrôle d’arrêter d’avoir prise sur ou d’exercer une emprise. Qu’il s’agisse d’une situation, de notre travail, d’une relation ou d’émotions, il arrive à tout le monde d’avoir l’intention de contrôler. Avec le contrôle va la perte de contrôle et s’il vient à l’esprit de quelqu’un d’y associer le lâcher-prise, je comprends que le processus puisse faire peur. L’impasse me paraît résider dans l’intention de vouloir contrôler quelque chose qui, par nature, est “hors-de-contrôle”25 .
Lâcher prise serait se déprogrammer d’une société régie par le contrôle : en renonçant à cette tentation, nous acceptons ne pas anticiper ni sécuriser. Nous choisissons le risque en nous dirigeant vers l’inconnu.26 Les propos d’une participante aux interviews décrivent un processus somme toute similaire : le lâcher-prise serait inné mais le conditionnement de la société viendrait contraindre son accès. “Le lâcher prise est inné, mais le conditionnement de la société et des interactions sociales fait que t’y as de moins en moins accès. J’ai l’impression que c’est plus facile pour un enfant d’accéder au lâcher-prise qu’un adulte. Pour un adulte, il faut déconstruire le conditionnement.”
Dans le lâcher-prise, il n’y aurait en réalité “pas plus à prendre qu’à lâcher”27. Cette expérience relèverait d’une culture et d’une spiritualité individuelle et cosmique. A ni trop prendre et ni trop lâcher, le sujet ferait l’expérience d’un équilibre intermédiaire. Il se rapprocherait ainsi d’un rythme naturel qu’il ne nous appartient pas de contrôler : “c’est un temps de l’eau, de la montagne et du ciel, pas un temps “pour”, pas un temps personnel”28.
Être un acteur à l’écoute de soi
Être acteur, ou simplement être ? Lâcher prise et accéder à l’être ne riment pas avec attitude passive. L’idée serait d’accepter ce qui nous est donné et d’accueillir les imprévus de la vie : voilà le chemin de l’implication. Le lâcher-prise semble être le chemin de l’entre-deux : c’est une composition subtile qui fait se rencontrer abandon et engagement, passivité et action, réceptivité et prise d’initiatives.29
“Lâcher prise, apprendre à accomplir pleinement un geste sans “tirer”, sans se faire souffrir, accueillir la respiration dans sa lenteur et son expression naturelle, écouter les “messages” apportés par les sensations, apaiser les tensions physiques et mentales, ne laissent pas désarmé car elles créent une fermeté sereine sur laquelle s’appuyer avec confiance”30. Pour ce même auteur, “le lâcher prise débute dans le corps : c’est une expérience physique de relâchement des
tensions”31.
Lâcher-prise : entre angoisse de mort et angoisse de vie
A propos de ce que nous lâchons, il m’a été confié que “c’est une part de nous mais qui est déjà morte si ça se trouve (rires), qui n’est plus en mouvement. (…) C’est un ancien nous pour retrouver un nouveau nous. C’est vraiment le processus de mort et de renaissance à l’intérieur de nous. Une petite mort intérieure, une mini-mort.” Il est ici question d’intériorité, et dans ce processus de lâcher-prise, l’homme se transforme continuellement, alternant entre une mort intérieure et une renaissance. Zoomons un peu. Si nous pensons le lâcher-prise au niveau microscopique, nous observons ce même phénomène au niveau cellulaire. Dans le fonctionnement même de notre organisme, la mort fait partie intégrante de la vie, elle en est même la cause. Jean-Claude Ameisen, médecin et chercheur en biologie, montre que la vie organique dépend du “suicide” de milliers de cellules (apoptose) qui laissent place aux nouvelles. Ainsi, l’autodestruction cellulaire participe au renouvellement de soi.32
“Croître et lâcher prise, c’est prendre le risque d’exister maintenant” 33 . Dans Le jardin d’Épicure, Irvin Yalom explique l’existence au regard de la tension qui existe entre angoisse de vie et angoisse de mort. En progressant dans l’existence humaine, nous sommes en quête de différenciation, croissance et réalisation de notre potentiel. En nous distinguant, nous rencontrons l’angoisse de vie en ressentant la solitude, la perte de la relation et la vulnérabilité. Lorsque cette différenciation devient insupportable, nous marchons à reculons pour renouer avec ce qui nous relie, c’est-à-dire la fusion à l’autre. 34 Néanmoins, la fusion nous fait contacter l’angoisse de mort : elle nous fait perdre notre Moi35 unique. Entre angoisse de vie et angoisse de mort, nous vivons nos vies.36
Une tentative de réunification du corps et de l’esprit ?
Lâcher prise, “ça résonne comme arrête de te prendre la tête, souffle et détends-toi”. D’une prise de tête, le discours s’oriente vers le souffle et la détente, manifestations respiratoire et tonique. “Quand on se détend, quand on lâche prise sur son corps, on est dans un état d’esprit plus relaxé, c’est plus facile de prendre du recul et lâcher prise sur d’autres choses et inversement, en lâchant prise sur des choses, on se détend” : ici, ce n’est plus la tête qui est prisée, mais le corps. S’extraire d’une prise sur son corps ou d’une prise de tête permettrait selon ces dires d’accéder à la détente. Peut-être que ne pas trop prendre serait de vigueur pour restaurer un équilibre entre le corps et l’esprit ? Dans le langage prêté au lâcher-prise comme en psychomotricité, il est difficile de penser la globalité de l’être humain en s’extrayant d’une dualité linguistique. Lorsque que j’entends que le lâcher-prise serait un “moyen de décontracter un contrôle qu’on peut avoir aussi bien dans le corps que dans les pensées”, je sens que le concept tente de s’incarner. Si l’esprit se “décontracte” comme un muscle, ne serait-il pas simplement dans le muscle, autant que dans la tête, dans les épaules ou dans les pieds ?
Dualisme et monisme en psychomotricité
Le lâcher-prise et la façon dont nous le percevons met en exergue une confrontation idéologique encore très présente dans la définition que l’on donne à la psycho(-)motricité. C’est avec René Descartes que s’est réellement installée une opposition entre le soma et la psyché. La pensée cartésienne repose sur la certitude de notre existence par la pensée, “je pense donc je suis”, mise en chacun de nous par Dieu, créateur de toute chose. Selon le dualisme cartésien, le corps est une mécanique au service de l’esprit et seules la volonté et la raison doivent guider nos actes. Ce dualisme participe au clivage entre maladies somatiques et maladies psychiques. Le développement des soins médicaux, aux XIXème et XXème siècles, remet en question la nature de la relation corps-esprit. Des liens sont progressivement établis entre maladies nerveuses et maladies mentales.42 En 1844, Wilhelm Griesinger, fondateur de la neuropsychiatrie allemande, énonce que “dans les états de mélancolie nous pouvons observer, sur le plan psycho-moteur, une inhibition de l’élan vital et de l’action”43 : un petit tiret entre “psycho” et “moteur”, un grand pas pour l’humanité. C’est la première fois que le mot apparaît tel quel dans la littérature.
Petit bond dans le temps pour aborder la pensée moniste décrite par Baruch Spinoza, philosophe néerlandais. Du grec monos -seul, unique- et ismos -doctrine, théorie-, le monisme est une doctrine selon laquelle tout ce qui existe -univers, cosmos, monde- est un tout unique, constitué d’une seule substance. Spinoza s’oppose à la perspective dualiste de l’homme et propose un modèle dans lequel les puissances du corps et celles de l’esprit se situent à égalité. Dans ce système de compréhension, le corps et l’esprit sont l’expression d’une seule et même réalité, celle de l’être humain. “Le corps ne peut déterminer l’Esprit à penser, ni l’Esprit déterminer le corps au mouvement”44, écrit-il.
En observant la nature même du mot “psychomotricité”, nous comprenons toute la difficulté d’assemblage et d’intrication que revêt la tentative d’unification du corps et de l’esprit. Positionnés l’un à côté de l’autre, les deux termes ainsi juxtaposés contribuent à perpétuer l’empreinte dualiste avec laquelle il nous faut composer. Le terme est, selon Olivier Grim, porteur d’ambiguïtés. Grâce au regard qu’il porte sur l’importance étymologique du terme, il évoque qu’il ne s’agit pas ici d’allier le psychique et le corporel : la psychomotricité est une “mise en mouvement de l’être”45. A cet effet, elle nous invite à chercher la vérité dans la dynamique plutôt que dans la structure.
Des événements de santé qui se cumulent
La vie d’Isaure est marquée par une succession d’événements de santé que je ne saurais restituer entièrement et dont le contexte d’apparition ne m’est pas toujours accessible.
Du fait de mauvais traitements, Isaure développe une algodystrophie 46 diagnostiquée et expliquée par les suites de sa fracture au pied. A la suite de ce diagnostic, elle arrête son travail et doit se déplacer en fauteuil roulant. Les différentes erreurs médicales dont Isaure est victime l’amènent à engager des poursuites judiciaires contre la sécurité sociale. Elle gagnera une partie de ce procès. Par ailleurs, Isaure est une personne souffrant de dépression. Pour ce même motif, elle sera hospitalisée en clinique privée, dans laquelle elle rencontrera Claire47, ma maître de stage. Dans ce contexte d’hospitalisation, Isaure apprend qu’elle ne peut avoir d’enfants -trompes utérines bouchées- malgré un désir présent. Elle développe ensuite un cancer de l’utérus.
En 2013, Isaure fait un triple infarctus que son mari, ivre, n’a pas remarqué tout de suite. Elle échange quelques temps après cet accident avec Claire et dit qu’elle lui a “sauvé la vie”. Au moment où elle pensait approcher la mort, elle se souvint avoir pu “respirer par la peau” et s’est alors saisi de ce souvenir de séance pour réguler sa respiration, jusqu’à temps que son compagnon réagisse et appelle les pompiers. Elle exprime avoir été morte cliniquement lors de l’arrivée des pompiers.
Cadre de la rencontre en psychomotricité
Isaure est suivie en psychomotricité par Claire depuis dix ans. La rencontre a lieu lors de son hospitalisation pour burnout consécutif à son algodystrophie. Depuis cet événement, sa santé, sur les plans relationnel et professionnel, semble s’effondrer. Au commencement de cette prise en charge, Isaure fait la demande d’un travail autour de la voix, pour pouvoir soutenir sa parole lors d’audiences. Elle a mis beaucoup de temps à pouvoir “entrer dans le travail” en psychomotricité car c’était très angoissant pour elle de porter son attention au corps. Le suivi a été bref dans cette clinique mais il se poursuit au domicile conjugal puis dans les différents cabinets libéraux dans lesquels ma maître de stage a exercé.
Cette année, je rencontre Isaure dans le cadre de la prise en charge groupale du “groupe des femmes” : constitué ainsi depuis maintenant deux ans, ce groupe a fait se rencontrer deux femmes, Isaure, et Sylvia48, âgée de 62 ans, les deux plus anciennes patientes de Claire. Le nom du groupe s’est constitué au fur et à mesure de la rencontre et des attentes de chacune. L’atelier est ouvert pour des femmes qui manquent de confiance en elles, se sentent mal à l’aise dans leur corps ou fragilisées par la maladie. Il constitue un tremplin pour restaurer des liens harmonieux et respectueux avec son corps, retrouver des appuis et une confiance en soi, développer sa propre créativité, soutenir l’ouverture aux autres, oser dans la relation, partager et trouver sa place en s’affirmant dans son environnement. Le travail en psychomotricité se découpe en cycles : les trois séances de chaque cycle portent un thème différent et une quatrième séance est “intégrative”, au regard des vécus traversés lors des trois premières. Les trois séances que nous avons traversées toutes les quatre et que j’ai découvert en même temps que les patientes ont été nommées : “Tenir-lâcher, retenir-relâcher”, “A la rencontre de soi” et “Se redécouvrir”.
Cette année, nous avons traversé seulement trois séances, contraintes de composer avec les indisponibilités successives de salles et la crise sanitaire sans précédent que nous avons vécue lors de l’épidémie du Covid-19.
Je perçois chez Isaure un fort investissement du suivi en psychomotricité. Elle est curieuse et verbalise beaucoup sur son vécu et sur la nécessité de cette discipline dans sa vie. Dans la continuité de mes recherches sur le lâcher-prise, j’ai souhaité l’interroger, me permettant de mettre en lien sa perception du lâcher-prise, ses éprouvés au sein du groupe des femmes et son histoire.
Lâcher-prise “en interview”
Dans la continuité de mon élaboration autour du lâcher-prise, j’ai retrouvé Isaure au café le plus proche du lieu de notre troisième séance, une heure avant son commencement. Claire est présente, quelques mètres plus loin, me laissant l’opportunité de vivre cet échange seule.
Lorsque nous arrivons, Isaure buvait un vin chaud au comptoir et en recommande un nouveau lorsque nous nous installons en terrasse. Quel lâcher-prise, pourrais-je penser, de boire juste avant une séance de psychomotricité, nous sachant toutes deux présentes. Ou pas, compte tenu de sa relation de dépendance à l’alcool : la prise de substances, par analogie. Avant même que l’interview ne commence, elle allume une cigarette et me dit en accentuant la rencontre gestuelle main-bouche-cigarette : “J’ai besoin de me tenir à ça pour ne pas sentir la douleur”. Lors de notre discussion, je suis surprise par les confidences que me livre Isaure sur l’intimité de son parcours, alors même qu’elles ne sont pas directement en lien avec les questions de mon entretien. Je sens que son discours déborde d’entre les lignes de mon interview. Je prendrai le temps de présenter les idées importantes qui sont apparues lors de notre échange.
Question de limites : “Lâcher prise c’est tomber”
Avant même que je n’aborde la question des limites, celles-ci apparaissent déjà dans les propos d’Isaure. Si le lien entre limites et lâcher-prise n’a pas toujours été évident pour les personnes que j’interrogeais, il apparaît très présent chez Isaure. Dans un premier temps, les limites soutiennent une organisation en “tout ou rien” : “ou je prends trop ou je lâche tout”. Elle dit lâcher quand ça va mal, comme arrivée au bout de quelque chose. “Moi mon problème c’est que je lâche pas beaucoup prise et donc je fatigue mon corps énormément”. Autrement, elle lâche quand son corps la “rappelle à l’ordre”, lorsqu’elle est épuisée, “intellectuellement et physiquement”. Le lâcher-prise résonne négativement pour elle : ce serait renoncer ou abandonner. Dans des situations où elle aurait pu se ménager ou s’y prendre autrement, elle pense s’être mise en danger. A cet effet, elle repousse ses limites au point que le lâcher-prise entraîne une chute Elle énonce avoir “tendance à pousser, pousser, pousser, pousser, et quand ça lâche ça tombe. Lâcher c’est tomber”. Ses limites “ne sont pas dans la normale”. D’un point de vue professionnel, elle estime avoir repoussé ses limites de nombreuses fois. “Mon rapport au lâcher-prise est lié à ce contexte-là.” En évoquant ses vécus de maltraitance familiaux et professionnels, elle poursuit en m’expliquant la complexité pour elle de désapprendre ce qui l’a construite. “Il faudrait que je me crée des limites, des plus proches de ce que je peux supporter”. En écoutant fidèlement l’histoire qu’elle me confie, je fais face à l’épreuve de vie qu’a été la sienne. Je ne peux qu’entendre à quel point ses limites ont été repoussées, comme expulsées de son propre corps : “mes limites sont à hauteur de ce que j’ai vécu dans ma jeunesse”.
La maltraitance infantile
C’est en citant les événements parcourus dans son enfance qu’Isaure positionne la “hauteur” de ses limites. Elle me raconte un traumatisme vécu enfant. Alors que sa tante faisait chauffer de l’eau pour faire du thé, le couvercle de la casserole tombe par terre. Se baissant pour le ramasser, sa tante tire vivement la casserole et l’eau bouillante lui tombe sur la tête. “J’ai eu les cheveux brûlés, j’ai été brûlée au troisième degré, je me suis évanouie”. “Elle s’en n’est pas vraiment rendue compte”, dit-elle en évoquant l’absence de réaction de sa tante. C’est son amie qui est allée chercher le pharmacien le plus proche. Celui-ci l’emmène d’urgence en clinique, dans laquelle il lui est demandé de rester pour être hospitalisée. Malgré les recommandations médicales, elle signe une décharge pour ne pas rester, par peur de la réaction de ses parents. “J’ai refusé l’hospitalisation, je suis repartie donc en fait, j’avais peur de mes parents… Je sais pas… Quand je suis arrivée je me suis faite engueulée. J’ai perdu tous mes cheveux c’était horrible, j’ai beaucoup souffert.” Un autre souvenir renvoie à ses 7 ans : elle a utilisé la hache du jardinier de la famille et s’est involontairement coupé le doigt. A table, elle tente de cacher sa blessure, de peur d’être grondée. Lorsque ses parents et son grand-père lui demandent de mettre les mains sur la table, ils découvrent sa blessure. “Je me tenais pas bien (…) hop j’ai pris deux baffes et j’avais carrément le bout de doigt qui pendait.”
“Je suis très dure à la douleur”
Associée à son histoire et ses limites, Isaure me parle de sa douleur. Son algodystrophie la fait beaucoup souffrir mais je sens dans son discours que la question de la douleur est plus ancienne encore. “J’ai une limite à la douleur qui est énorme”. En laissant revenir des souvenirs d’enfance, elle me dit être “très dure à la douleur”, comme s’il lui avait fallu se construire une véritable armure protectrice. Elle poursuit en parlant de la souffrance qu’engendre sa blessure : elle éprouve des douleurs au pied et à la jambe droite. La solution utilisée pour pallier ce mal-être corporel fait état d’une dissociation entre son corps et son mental. “Je souffre tellement de mon corps que mentalement j’ai réussi à me couper de ma douleur”. Selon elle, la possibilité de se couper de son corps est un exercice mental. Elle m’assure que c’est possible : “On se concentre et on fait en sorte que l’endroit douloureux ne fasse plus partie de notre corps”. Elle met en lien cette dissociation avec une forme de “défense” qu’elle juge néanmoins mauvaise parce qu’elle empêche de soigner ses parties du corps douloureuses. Les ressources mobilisées pour éloigner sa douleur ont des conséquences : “le problème c’est qu’à force de s’anesthésier de la douleur, on pousse de plus en plus les limites et c’est pour ça qu’on arrive à des infarctus où j’ai vu la mort. J’étais morte d’ailleurs cliniquement”. De cet événement tragique mais pas fatal, elle me dit s’être vue “au-dessus de son corps” : “j’ai vu la lumière.” Selon elle, le travail en psychomotricité consiste à se réapproprier cette jambe malade : “c’est douloureux quand elle revient dans mon corps mais c’est un soulagement parce que je me rends compte que ma jambe fait partie de moi”.
La relation aux autres
Lorsque je demande à Isaure sur quoi elle s’appuie pour lâcher prise, elle me répond d’abord “sur des conditions dramatiques”, pour ensuite évoquer la relation aux autres. “On me force à me mettre ailleurs et à laisser tomber tout”. Il faut selon elle qu’elle soit dans un lit, couchée, à ne plus pouvoir rien faire. S’il s’agit de se tenir pour lâcher-prise, il en est selon elle du ressort de l’autre : “ça tient aux autres, il faut que les autres me prennent en charge”. Et dans cette prise en charge, le déplacement “hors de son ordinaire”, hors cadre professionnel ou familial, lui permet de lâcher prise. Aussi, elle dit s’occuper peu d’elle-même mais beaucoup des autres, ce qui l’épuise beaucoup. D’ailleurs, lorsqu’il s’agit de payer l’addition… “C’est moi qui règle ! Et là, je ne lâcherai pas prise !”
Les éprouvés à l’épreuve du corps
Selon Isaure, l’amour que l’on se porte à soi-même entretiendrait un lien intime avec la possibilité de lâcher prise. Néanmoins, l’image du corps est désinvestie du fait de son parcours de vie ; celle-ci n’est pas un objet ou une représentation figée mais un processus d’investissement actif et affectif évolutif.60 Si j’observe la problématique affective qu’elle porte sur son pied sur le long terme, je peux penser qu’elle s’inscrit dans une temporalité dont l’histoire remonterait à ses 13 ans. A ce même âge, ses pieds furent touchés de façon déplacée par son médecin généraliste dont elle fut agressée sexuellement. Ce médecin était par ailleurs médecin légiste et avait donc pour coutume d’attacher à la cheville des défunts un bracelet indiquant leur identité. Pendant longtemps, Isaure a porté un bracelet à la cheville qu’il lui était compliqué d’enlever, même en séance de psychomotricité. Cette même partie du corps est celle qui se fracture, des années plus tard, à la suite d’un acharnement au travail et d’une pression subie par son environnement professionnel. Aujourd’hui, elle exprime un fort dégoût à propos de ses pieds et dit ne pas les aimer. Cette même partie du corps est celle qu’elle voudrait voir s’en aller. A l’échelle du temps, ces affects négatifs attribués à cette zone du corps sont liés, d’une façon qui lui appartient, à l’ensemble de ces atteintes portées au corps.
Lorsque je discute avec Isaure, je ressens cette fragilité narcissique qui me fait penser qu’elle tient difficilement, comme un vase en apparence solide mais dont les fissures discrètes menacent de le briser. La fatalité apparente de son histoire fait qu’elle en a perdu pied, contrainte de se déplacer autrement et de vivre la tourmente infernale de la douleur. “Le déprimé ne trouve plus l’étayage nécessaire à une bonne image de lui-même (…) L’appui corporel n’existe plus, ce qui renforce le malaise dépressif”61. Lors de la première séance du groupe des femmes, Isaure se trouve, dans le cadre d’une proposition, en position d’observation. Après cela, elle confie avoir eu l’impression de “n’avoir servi à rien”. Elle lie ce ressenti à sa situation de handicap qui l’empêchait auparavant de marcher et la difficulté qu’elle éprouvait à “ne pouvoir rien faire”. Peut-être que le lâcher-prise se situerait à ce niveau : accepter d’interrompre l’agir sans pour autant se perdre.
“Se couper de la douleur, c’est un exercice mental. On se concentre et on fait en sorte que l’endroit douloureux ne fasse plus partie de notre corps. Vous l’envoyez ailleurs.” Désintéressée de son corps propre, la personne dépressive est comme coupée de son corps.62 Lors de la troisième séance, nous avons terminé par un enchaînement que nous mettions littéralement en corps et en scène. Sur une trajectoire de l’espace de la salle, nous devions créer une histoire à partir de mots récoltés pendant la séance. L’histoire était découpée en trois temps : “La première fois que je l’ai vue, elle m’a parue…”, “Peu à peu, elle se révélait…”, “Au fond, elle était…”. Lorsqu’Isaure met en scène son histoire, elle évoque à un moment “une douleur qui l’empêchait de marcher”. Ce qu’elle met en acte à ce moment-là, c’est un comportement auto-agressif : elle se cogne fortement la jambe à plusieurs reprises et mime de pleurer. Je dois avouer qu’à ce moment, je n’arrivais plus à distinguer quelle part de fantasme et quelle part de réalité ce geste recouvrait. Ce n’est peut-être pas si étonnant qu’elle soit “si bonne actrice” dans ce rôle-là, compte tenu de sa probable difficulté, petite, à distinguer fantasme de destruction et réalité. La scène m’a paru très violente. Elle semblait se frapper jusqu’à contacter l’os. Je me demande si dans ce geste, elle n’est pas justement venue chercher la solidité de son ossature, ce sur quoi elle pourrait tenir et qui a tant fléchi auparavant. Pour Alexander, les os sont une question de sécurité intérieure. “L’os fait figure d’espace personnel indiscutable et stable”63.
L’addiction à l’alcool
Isaure est une personne alcoolo-dépendante. Quand je la rencontre, je trouve son visage vieilli et ses dents gravement abîmées. Lorsque Claire, quelques années passées, commence un suivi à domicile, elle remarque l’état de sa maison : elle la décrit complètement désorganisée, des bouteilles d’alcool traînant partout par terre. Dans cette quête infernale de la prise de substances, elle est allée jusqu’à s’intoxiquer à l’éther. Chez la femme, l’alcoolisme serait souvent consécutif à la dépression.64 Concernant le corps, il est perçu de façon neutre et non sexuée.65 Je sais par ma maître de stage que la féminité est une question largement abordée dans la prise en charge en psychomotricité. En séance, Isaure remarque quand la statuette de Sylvia est asexuée et prend le temps de donner une forme féminine à la sienne. Le désir de réappropriation d’un corps féminisé est présent chez Isaure, qui est par ailleurs dans l’impossibilité de procréer. Le corps non-sexué chez le dépressif “ne possède pas de contenu (…) et tout se passe comme si le patient cherchait à nier son corps tout en exhibant les stigmates de son intoxication chronique”66.
Il existe un lien entre l’alcoolisme et l’érotisme du stade oral décrit par Sigmund Freud. La quête de plaisir propre à l’absorption d’alcool est recherchée par la personne pour le plaisir propre à ce stade de développement. Sur le plan relationnel, la personne alcoolique se montre dépendante de l’autre, comme s’il venait se substituer à la figure nourricière infantile. “Le type de relation infantile que le sujet noue avec les autres est à l’origine de nombreuses frustrations. L’alcool représente alors pour la personne un moyen de satisfaire ses pulsions orales, quelles que soient les contraintes du monde extérieur”67. Boire pourrait être une solution utilisée par Isaure pour ingérer une substance qui la contienne de l’intérieur, lui procure des sensations qu’elle décide d’avoir. Serait-ce là une façon de combler un vide indicible et insupportable ?
Dépendance et (in)capacité d’être seule
Dépendance à l’alcool, dépendance à la cigarette… S’ajoutent à cela une importante dépendance relationnelle. Malgré la maltraitance subie à l’intérieur même de son couple, Isaure entretenait avec son compagnon une forte dépendance. En dépit de la toxicité relationnelle qu’elle éprouvait au quotidien, trouver racine dans cette relation était peut-être moins angoissant que d’affronter le vide et la solitude. Isaure ne lâche prise qu’en présence de l’autre et lorsque, de façon extrême, tout est lâché, elle se retrouve comme immobilisée. “Il faut que je sois dans un lit que je reste couchée et que je fasse rien.” J’entends de ses paroles un lâcher- prise qui se rapproche de la mort, métaphorique ou réelle. J’entends également que pour sortir de cet état, la présence de l’autre est nécessaire. Si le lâcher-prise est fatal et que personne ne lui vient en aide à ce moment, je comprends dans cette perspective qu’il puisse évoquer la mort, celle dont on ne peut se relever. Selon Winnicott, la “capacité d’être seul” se développe dans la petite enfance : elle est le signe d’une maturité affective. La mère, grâce à ce qu’il nomme la “préoccupation maternelle primaire” est en capacité de répondre de façon adaptée aux besoins de son enfant. Grâce notamment au holding 68 et handling 69 , le bébé peut éprouver un sentiment de continuité d’existence.70 D’une dépendance au départ absolue aux soins “suffisamment bons” de sa mère, il passe progressivement à une dépendance relative et éprouve la capacité à “être seul en présence d’un autre”71. Cette capacité permet à l’enfant de jouir de la solitude, d’être créatif sans être débordé par son excitation et sans être dépendant de la présence de l’autre. Elle permet à l’individu d’être heureux temporairement en l’absence de l’autre et de stimulations externes.72 Le sentiment d’être seul advient chez le sujet si la solitude apparaît structurante et non désorganisatrice.
Chez certaines personnes, l’incapacité d’être seul se situe au cœur d’une problématique addictive. Dans ce cas, les stratégies addictives pallient l’éprouvé de solitude ressenti alors comme une impossibilité de se sentir vivant. Dans ces conditions, le sujet peut être amené à entretenir avec les autres des relations addictives orientées sous le spectre du besoin plutôt que de l’amour. Grâce à la prise de substances, l’individu contourne la désorganisation psychique et les angoisses de disparition, d’annihilation, d’éclatement ou encore de liquéfaction. Par ces conduites, les personnes dépendantes “tentent ainsi de rétablir, de manière autosensuelle, une “persistance dans l’être” (Winnicott) grâce à des substances, ou à des activités, qui deviennent addictives par la nécessaire répétition que la menace d’un effondrement de soi implique”73.
|
Table des matières
PARTIE 1 : ETAT DES LIEUX DU LÂCHER PRISE : UNE CLINIQUE DU NORMAL?
I) Le lâcher prise “en interview” : un lien avec la psychomotricité ?
1. Tensions, détentes : question de tonus
2. Des sensations aux émotions
3. Lâcher prise, une histoire de temps
4. Un mouvement spatialisé
5. La relation
6. Avoir confiance, s’ abandonner
II) Un brin de littérature
1. Étymologie et contexte d’apparition
2. Multiples “usages”
4. Contrôle et lâcher prise
5. Être un acteur à l’écoute de soi
6. Lâcher prise : entre angoisse de mort et angoisse de vie
7. Lâcher prise : le paradoxe occidental
III) Lâcher prise : état d’e sprit, état corporel ou état d’être ?
1. Le lâcher prise, c’est dans la tête ?
2. Une tentative de réunification du corps et de l’esprit ?
3. Dualisme et monisme en psychomotricité
IV) Conclusion
PARTIE 2 : TENIR–LÂCHERLÂCHER : DYNAMIQUE DU LÂCHER: DYNAMIQUE DU LÂCHER–PRISE EN PRISE EN PSYCHOMOTRICITÉPSYCHOMOTRICITÉ
I) Isaure : rencontre au sein du groupe des femmes
1. Récit de vie
a) Un contexte familial maltraitant
b) Vie relationnelle
c) Chuter au travail
d) Des événements de santé qui se cumulent
2. Cadre de la rencontre en psychomotricité
3. Lâcher–prise “en interview”prise “en interview”
a) Question de limites : “Lâcher prise c’est tomber”
b) La maltraitance infantile
c) “Je suis très dure à la douleur”
d) La relation aux autres
e) Quand on n’a que l’amour
4. Le lâcher–prise d’Isaure au sein du groupe des femmesprise d’Isaure au sein du groupe des femmes
a) Accroche–toi si tu peuxtoi si tu peux
b) Perdre pied — tenir sur piedstenir sur pieds
c) Porter un regard sur l’image du corps
d) La voix, le souffle
e) “La éveillée”
II) De la clinique à la théorie
1. Dépression et dépendance
a) La dépression
b) Les éprouvés à l’épreuve du corps
c) L’addiction à l’alcool
2. Dépendance et (in)capacité d’être seule
3. Enveloppe, limites et traumatisme
4. Le tonus à la limite de la pathologie
5. Lâcher prise en mouvement
a) La pathologie : une interruption du mouvement ?
b) Le corps comme système tensègre
c) Les flux toniques
d) Modulation tonique, poids et espace–tempstemps
e) Lâcher–priseprise : le souffle de la vie: le souffle de la vie ??
f) Lâcher–prise et équilibreprise et équilibre
g) Lâcher–prise et prise de conscienceprise et prise de conscience
IV) Conclusion
PARTIE 3 : LE LÂCHER–PRISE D’UNE PROFESSIONPRISE D’UNE PROFESSION
I) Le cadre
1. Interviews : la question du cadre
2. Ma posture de stagiaire en psychomotricité
3. Un référentiel clinico–théorique ternairethéorique ternaire
a) Triade fonctionnelle
b) Tomber, peser, repousser : les trois temps d’un processus
c) Tomber : la question de la chutee
d) Peser : l’entre–deuxdeux
e) Repousser : nouveau départ
4. Le cadre professionnel du psychomotricien
a) Cadre en formation
b) Le cadre en quelques maux
3. La contenance du cadre en psychomotricité
4. Tenir–lâcher dans la prise en charge psychomotricelâcher dans la prise en charge psychomotrice
II) Psychomotricité et perspectives sociales
1. Constat occidental
a) “Cogito ergo sum”
b) Une profession en mal de définition
c) Vouloir ou pouvoir lâcher prise ?
2. Spinoza pour une profession de l’unité:
3. L’art et la technique : apports philosophiquesapports philosophiques
III) Tenir–lâcher en templâcher en temps de crise : de l’épidémie aux s de crise : de l’épidémie aux enjeux d’une professionenjeux d’une profession
1. Un temps de crise
a) “Nous sommes en guerre”
b) Les aléas du confinement
c) Ensemble et séparément : comment panser la discontinuité: comment panser la discontinuité ??
d) Individualisme et interdépendance : du confinement à la nécessité d’un “vivre ensemble”ensemble”
2. Vers une approche systémique du lâcher–priseprise
a) Être au monde) Être au monde
b) De l’architecture au corps) De l’architecture au corps : approche systémique: approche systémique
CONCLUSION GENERALE
BIBLIOGRAPHIE
Télécharger le rapport complet