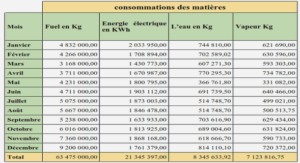Récolte et préparation du matériel végétal
Les feuilles de Dombeya macrantha ont été récoltées sur le mont Ibity (S : 20° 03ʹ 56. 7″ ; E : 047° 00′ 02. 2″) au mois de juin 2014. Au moment de la récolte, la plante était en fleurs et en fruits. Les feuilles sont séchées à l’air libre, à l’abri du soleil pendant deux semaines, puis broyées à l’aide d’un mixer de marque Blender (Robot coupe GT550) afin d’obtenir une poudre fine qui est conservée dans une boîte hermétique à la température du laboratoire. Elle constitue notre matériel végétal de départ (figure 3, p. 13).
Chromatographie sur couche mince
Principe La chromatographie sur couche mince (CCM) est un procédé de microanalyse basé sur les phénomènes physico-chimiques de partage et d’adsorption. Les substances à séparer migrent suivant une direction déterminée sur un support solide : le gel de silice. La vitesse de déplacement des molécules dépend de leur affinité pour la phase mobile organique d’une part et des forces d’adsorption dues au support d’autre part.
Mode opératoire
Dépôt de l’échantillon : Les extraits à analyser sont déposés à l’aide d’un capillaire sur la plaque en fins traits horizontaux de 7 mm espacés de 6 mm, à 1,5 cm du bord inférieur et à 1,3 cm de chaque bord latéral de la plaque. Chaque dépôt est immédiatement séché au séchoir à main.
Développement du chromatogramme : La plaque ainsi préparée est mise à développer dans une cuve à chromatographie (Desaga) dont l’atmosphère a été préalablement saturée par les vapeurs du solvant de migration. Il s’agit d’un mélange constitué par 60 parties de n-butanol ; 20 parties d’acide acétique et 20 parties d’eau distillée, en poids : B/A/E (60/20/20) (p/p/p). Quand le front du solvant parvient à 0,5 cm du bord supérieur de la plaque (chromatographie ascendante), la plaque est retirée de la cuve puis séchée au séchoir à main.
Révélation du chromatogramme : La révélation permet de mettre les substances incolores qui ont migré en évidence. Deux méthodes de révélation ont été adoptées :
Examen sous lumière ultraviolette (UV) : Grâce à l’absorption de la lumière ultraviolette, certains produits deviennent visibles. Ils apparaissent sous forme des bandes ou spots, à des longueurs d’ondes caractéristiques : 254 nm et 366 nm.
Réactions colorées : Plusieurs composés peuvent être révélés au moyen de réactifs très généraux comme le réactif à vanilline sulfurique dont la composition est donnée en Annexe 1. Le réactif est pulvérisé sur la plaque. Les substances apparaissent ainsi sous forme de taches colorées qui peuvent être très claires, d’où la nécessité de chauffer la plaque à 100°C. On obtient alors des taches plus foncées.
METHODES NON ADOPTEES DANS LE PROTOCOLE DE PURIFICATION
Précipitation par la chaleur L’EB (5 ml) est chauffé pendant 15 min au bain-marie bouillant (voir § 2.2.2.1.2, p. 14). Aucun précipité n’apparait lors du chauffage et aucun culot n’est obtenu par centrifugation. L’extrait est actif sur les microorganismes, mais l’activité reste comparable à celle de l’EB. Cette méthode peu performante n’a donc pas été retenue dans le protocole définitif.
Précipitation par l’acétate neutre de plomb Après traitement par l’ANP (voir § 2.2.2.3.2, p. 15), l’EB (5 ml) est devenu presque incolore mais n’a montré aucune activité sur les microorganismes. Nous n’avons pas retenu cette technique, mais elle a montré que les principes toxiques sont précipitables par l’ANP.
Elimination des tanins L’EB (5 ml) traité par la poudre de peau comme décrit au § 2.2.2.4.2. (p. 15) est devenu pratiquement incolore mais n’a aucune activité sur les microorganismes. Nous n’avons pas retenu cette technique, mais elle nous a informé que les principes toxiques sont retenus par la poudre de peau et pourraient être des tanins.
Traitement par le charbon actif L’extrait E1 (5 ml) obtenu après fractionnement par le n-butanol est filtré sur une couche de charbon actif (cf. § 2.2.2.5., p.15), il est devenu incolore mais inactif sur les microorganismes. La technique a permis de noter que les principes actifs sont adsorbés sur le charbon actif.
Les milieux de culture
Les milieux solides Deux milieux solides ont été utilisés pendant cette étude :
– le milieu de MUELLER-HINTON : C’est un milieu de culture solide utilisé pour mettre en évidence l’activité des extraits vis-à-vis des germes pathogènes telles que : Salmonella enterica, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter cloaceae, Klebsiella oxytoca, Streptococcus pneumoniae et Bacillus megaterium.
– le milieu SABOURAUD : c’est un milieu sélectif pour les levures (Candida albicans). Le milieu préparé est stérilisé à l’autoclave à 121°C pendant 20 min, ensuite coulé dans de boites de Petri stériles de 90 mm de diamètre ; l’épaisseur de la gélose est de 4 mm environ.
Le milieu liquide Le milieu liquide utilisé est le bouillon nutritif (Nutrient Broth) qui sert à la conservation et la culture des souches. Il permet le développement et la croissance des bactéries qui ne présentent pas d’exigences particulières comme Salmonella enterica, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Enterobacter cloaceae, Klebsiella oxytoca, Streptococus pneumoniae et Bacillus megaterium.
Détermination de la CMI
La CMI ou concentration minimale inhibitrice est la concentration minimale de l’antibiotique pour laquelle il y a inhibition de la croissance microbienne. Elle est déterminée sur le germe le plus sensible, par la méthode des disques en milieu solide et par la méthode de dilution en milieu liquide.
a). Méthode des disques en milieu solide
Principe : La technique est la même que celle décrite au § 2.2.3.2.1 (p. 37). Ainsi, la CMI est la plus faible concentration d’extrait donnant un résultat positif.
Mode opératoire : Une gamme de 6 concentrations de l’extrait à étudier dilué avec de l’ED est préparée selon la méthode de dilution en cascade avec un coefficient de dilution de 0,5. Six disques stériles sont imprégnés de 10 µl des extraits à tester, puis déposés sur le milieu de MUELLER-HINTON uniformément ensemencé avec 10 ml d’inoculum de concentration 106 cellules/ml. La CMI est déterminée après incubation à 37°C pendant 24 h. La CMI correspond à la plus petite concentration donnant le plus faible diamètre de halo d’inhibition. L’antibiotique de référence utilisé est le Netilmicine (CA-SFM, 2010).
b). Méthode de dilution en milieu liquide
Principe : En milieu liquide, la croissance des bactéries se traduit par un aspect trouble du milieu de culture ensemencé. Par contre, en cas d’inhibition de la multiplication cellulaire, le milieu reste limpide. Ainsi, la CMI correspond à la plus faible concentration d’antibiotique pour laquelle une inhibition de la concentration bactérienne, après un temps d’incubation de 24 h (KIL et coll., 2009) est notée.
Mode opératoire : Le test est effectué dans 8 tubes à vis dont 2 tubes sont utilisés comme témoin :
témoin négatif (T-) : 5 ml de milieu liquide (absence de croissance bactérienne) ;
témoin positif (T+) : 5 ml de milieu liquide et 1 ml d’inoculum (présence de croissance bactérienne) ;
Dans les tubes restants, l’extrait à étudier est dilué avec le milieu liquide (dilution en cascade avec un facteur de dilution de 0,5) pour avoir des concentrations allant de 1,56mg/ml à 100 mg/ml dans un volume final de 5 ml. 1ml d’inoculum sont introduits à l’aide d’une pipette stérile dans chaque tube. Les tubes sont incubés pendant 24 h à 37°C. Après 24 h, la lecture se fait à l’œil nu par comparaison avec les 2 témoins et la CMI correspond à la plus faible concentration de l’extrait pour laquelle la culture reste limpide.
CONCLUSION GENERALE ET PERSPECTIVES
Les résultats des travaux réalisés dans le cadre de ce mémoire, bien qu’ils soient préliminaires, nous ont permis :
de mettre au point une technique d’extraction et de purification des principes actifs présents dans les feuilles de Dombeya macrantha, en vue d’en déduire leur nature chimique, leurs propriétés physico-chimiques et toxicologiques ;
de mettre en évidence la toxicité des feuilles de cette plante sur diverses espèces animales, végétales et microorganismes.
Cette étude est préliminaire et pourrait être approfondie. Ainsi, dans l’avenir nous envisageons :
d’améliorer les différentes méthodes d’extraction et de purification afin d’obtenir les principes toxiques en plus grande quantité et à l’état pur ;
de déterminer exactement la nature chimique des toxines ;
d’étudier leur mécanisme d’action ;
d’élargir l’étude des propriétés toxicologiques à d’autres animaux, végétaux et microorganismes ;
d’étudier les possibilités d’exploitation des effets toxiques.
|
Table des matières
REMERCIEMENTS
GLOSSAIRE
LISTE DES ABREVIATIONS
LISTE DES TABLEAUX
LISTE DES FIGURES
INTRODUCTION GENERALE
SYNTHESE BIBLIOGRAPHIQUE
I. DONNEES SUR LES Dombeya
II. DONNEES SUR Dombeya macrantha
II.1.Classification
II.2. Description botanique
II.3. Utilisations
II.4. Répartition géographique
Première partie : ETUDE chimique
1.INTRODUCTION
2.MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériels
2.1.1. Matériel végétal
2.1.1.1. Récolte et préparation du matériel végétal
2.1.2. Produits chimiques
2.2. Méthodes
2.2.1. Méthodes d’extraction
2.2.1.1. Extraction à froid
2.2.1.2 Extraction à chaud
2.2.2. Méthodes de purification
2.2.2.1. Traitement par la chaleur
2.2.2.1.1. Principe
2.2.2.1.2. Mode opératoire
2.2.2.2. Fractionnement par le n-butanol
2.2.2.2.1. Principe
2.2.2.2.2. Mode opératoire
2.2.2.3. Traitement par l’acétate neutre de plomb
2.2.2.3.1. Principe
2.2.2.3.2. Mode opératoire
2.2.2.4. Elimination des tanins
2.2.2.4.1. Principe
2.2.2.4.2. Mode opératoire
2.2.2.5. Traitement par le charbon actif
2.2.2.5.1. Principe
2.2.2.5.2. Mode opératoire
2.2.3. Calcul des rendements
2.2.4. Méhode de concentration
2.2.5. Méthodes analytiques
2.2.5.1. Chromatographie sur couche mince
2.2.5.1.1. Principe
2.2.5.1.2. Mode opératoire
2.2.5.2. Réactions de détection des familles chimiques
2.2.5.2.1. Préparation des extraits
a). Extrait aqueux
b). Extrait hydroéthanolique
c). Extrait acide
d). Extrait chloroformique
2.2.5.2.2. Détection des alcaloïdes
a). Test de MAYER
b). Test de WAGNER
c). Test de DRAGENDORFF
2.2.5.2.3. Détection des flavonoïdes : Test de WILLSTÄTTER
2.2.5.2.4. Détection des leucoanthocyanes : Test de BATE-SMITH
2.2.5.2.5. Détection des stérols insaturés : Test de SALKOWSKI
2.2.5.2.6. Détection des stéroïdes et triterpènes : Test de LIEBERMANNBURCHARD
2.2.5.2.7. Détection des tanins et polyphénols
a) Test à la gélatine
b) Test à la gélatine salée
c) Test au FeCl3
2.2.5.2.8. Détection des désoxyoses : Test de KELLER-KILIANI
2.2.5.2.9. Détection des iridoïdes
2.2.5.2.10. Détection des saponines
3.RESULTATS
3.1. Extraction
3.1.1. Extraction à froid
3.1.2. Extraction aqueuse à chaud à reflux
3.2. Purification
3.2.1 Méthodes adoptées dans le protocole de purification
3.2.1.1 Fractionnement par le n-butanol
3.2.2 Méthodes non adoptées dans le protocole de purification
3.2.2.1. Précipitation par la chaleur
3.2.2.2 Précipitation par l’acétate neutre de plomb
3.2.2.3. Elimination des tanins
3.2.2.4 Traitement par le charbon actif
3.4. Analyse des extraits
3.5. Caractérisation chimique
3.5.1. Propriétés physico-chimiques
3.5.2. Nature chimique des principes actifs
4. DISCUSSION ET CONCLUSION
Deuxième partie : ETUDE TOXICOLOGIQUE
1.INTRODUCTION
2.MATERIELS ET METHODES
2.1.Matériels
2.1.1. Les animaux d’expérimentation
2.1.1.1. Les animaux à sang chaud
2.1.1.2. Les animaux à sang froid
2.1.2. Les plantes d’expérimentation
2.1.3. Les microorganismes utilisés
2.1.3.1. Les souches microbiennes utilisées
2.1.3.2. Les milieux de culture
2.1.3.2.1. Les milieux solides
2.1.3.2.2. Le milieu liquide
2.1.3.3. Les disques pour les tests d’antibiogramme
2.2. Méthodes
2.2.1. Méthode d’étude des effets sur les animaux
2.2.1.1. Evaluation de la toxicité sur les animaux à sang chaud
2.2.1.1.1. Estimation de la toxicité sur les souris
2.2.1.2. Evaluation de la toxicité sur les animaux à sang froid
2.2.1.2.1. Principe
2.2.1.2.2. Mode opératoire
2.2.1.2.3. Détermination de la CL50 (24 h)
2.2.2. Méthodes d’étude des effets sur les végétaux
2.2.2.1. Etude des effets sur le pouvoir germinatif des graines
2.2.2.1.1 Principe
2.2.2.1.2. Mode opératoire
a). Trempage
b). Germination
2.2.2.2. Détermination des effets sur la croissance des jeunes plantules
2.2.2.2.1. Principe
2.2.2.2.2. Mode opératoire
a). Trempage
b). Germination
2.2.3.1. Stérilisation
2.2.3.2. Etude de l’activité antimicrobienne des extraits
2.2.3.2.1. Principe
2.2.3.2.2. Mode opératoire
2.2.3.3. Détermination de la CMI et de la CMB
2.2.3.3.1. Détermination de la CMI
a). Méthode des disques en milieu solide
b). Méthode de dilution en milieu liquide
2.2.3.3.2. Détermination de la CMB
a). Définition
b). Mode opératoire
3.RESULTATS
3.1. Effets sur les animaux
3.1.1. Effets sur les animaux à sang chaud
3.1.1.1. Description des symptômes d’intoxication chez la souris
3.1.2. Effets sur les animaux à sang froid
3.1.2.1. Effets sur les têtards de grenouille
3.1.2.2. Effets sur les alevins de carpe
3.1.2.3. Effets sur les larves de moustique
3.2. Effets sur les végétaux
3.3. Effets des extraits sur les microorganismes
3.3.1. Effets des extraits bruts
3.3.2. Effets des extraits obtenus au cours des étapes de purification sur les microorganismes
3.3.3. Détermination de la CMI et de la CMB
3.3.3.1. Détermination de la CMI
3.3.3.2. Détermination de la CMB
4.DISCUSSION ET CONCLUSIONS
Conclusion générale et perspectives
Références bibliographiques
Annexes
Télécharger le rapport complet