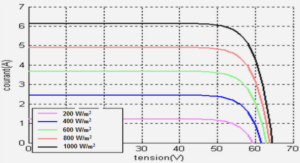L’eau est une source vitale, indispensable à la population mondiale pour maintenir l’équilibre vital. La recherche d’eau potable tient une grande place dans le monde dont les méthodes utilisées ne cessent d’évoluer. Des méthodes modernes ; hydrogéophysique et hydrochimique ont été effectués dans le monde y compris Madagascar. Actuellement, les ressources en eau sont menacées naturellement ou par l’activité anthropique. Des rejets chimiques (venant des Industries, des Urbains,…) et la dégradation de l’environnement affectent directement à la qualité et à la quantité des réserves en eau mondiale. Dans le cas de Madagascar, toutes les régions rencontrent ce problème (quantité et qualité de l’eau) mais surtout dans les zones urbanisées et les zones côtières y compris la Commune Urbaine de Fénérive-Est. Cette Commune souffre beaucoup de problème de la salinisation des eaux aussi bien de surfaces que souterraines. Par conséquent, la plupart de la population de la ville de Fénérive-Est a des doléances sur l’amélioration du service de la société JIRAMA (tant sur la quantité que la qualité) qui y est la seule société d’Etat responsable de l’adduction d’eau potable.
PEDOLOGIE
Les types de sols qui se trouvent dans le District sont :
– les sols sableux ;
– les sols hydromorphes des bas-fonds, appelés aussi horaka ;
Ce sont des sols saturés d’eau en permanence. Ils sont de couleur noirâtre et d’odeur soufrée, composés par des dépôts ferrugineux de couleur rouille à la surface et aussi des débris de matières organiques. Ces sols ne conviennent qu’à la riziculture s’ils sont bien drainés.
– les sols ferralitiques de couleur jaune sur rouge ;
Ce sont des sols constitués spécialement par des latérites et qui apparaissent sur les hauts massifs, ils sont parfois humifères, peu profonds et sensibles à l’érosion au moment de la mise en culture (Tavy).
– les sols d’apport fluvial, appelés aussi baiboho.
Ce sont des sols fertiles sur alluvions argileuses ou sableuses, surtout dans les vallées. Ils se trouvent tout au long de la côte et en bordure des cours d’eau. Ils sont favorables aux cultures pérennes pour autant qu’ils ne soient pas inondables, ou peuvent être aménagés en rizière [11].
CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE
Le District de Fénérive-Est est formé par la plaine côtière dans la partie Est et les montagnes dans la partie Ouest avec les dénivellations variant entre 6 à 465 m. Les 75% du District sont formées par les montagnes dont l’altitude décroit vers l’Est. Elles sont séparées par des réseaux de vallées et ont des caractères d’une série d’axes orographiques de direction N 15°- NE. Elles présentent des successions de paliers formés par des failles normales. Les zones côtières ou des plaines littorales non continues forment 25% de la zone avec l’altitude inférieure de 50 m vers la cote. Elles sont parfois discontinues à cause des reliefs et basses collines d’origine fluviatile ou marine. Les formations sédimentaires qui se trouvent tout au long des grandes vallées, sont formées par des alluvions sableuses ou argileuses.
CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
A part de l’Océan Indien dans la partie Est de la Commune, il y a aussi les rivières (Itendro, Marokiso et Sohihy) qui traversent la ville de Fénérive avant de sortir à la mer. D’abord la rivière Itendro se trouve dans la partie Nord de la Commune et de direction Ouest vers Est. Cette rivière est déjà exploitée par la JIRAMA pour l’alimentation en eau de la ville. Puis les deux petites rivières Marokiso et Sohihy, qui traversent aussi la ville d’Ouest à l’Est en se jetant dans l’océan indien.
GENERALITES SUR LES AQUIFERES
L’aquifère est une formation hydrogéologique, contenant de façon temporaire ou permanente de l’eau mobilisable. Elle est constituée des roches perméables (formation poreuses ou fissurées) et capable de la restituer naturellement ou par exploitation comme le drainage et pompage. Le système aquifère est constitué par le substratum imperméable ou plancher, l’aquifère et le toit. Suivant la perméabilité du toit, on distingue des aquifères à nappe libre, captive ou semi captive.
AQUIFERE A NAPPE LIBRE
C’est un aquifère surmonté de terrains perméables et disposant d’une surface piézométrique libre et d’une zone non saturée. Cette surface piézométrique peut s’élever ou s’abaisser librement dans la formation hydrogéologique perméable formant le réservoir.
AQUIFERE A NAPPE CAPTIVE
C’est un aquifère intercalé entre deux formations quasi-imperméables. Les eaux souterraines sont comprimées entre deux formations imperméables fixes qui sont le substratum et le toit. L’aquifère subit une pression dirigée de haut en bas, due au poids de la colonne de terrain. Cette pression est équilibrée par la pression de couche à l’intérieur de l’aquifère.
TYPES DES AQUIFERES
On distingue deux types d’aquifères, aquifère de type poreux et aquifère de type discontinus :
➤ Les aquifères « poreux »
Les aquifères de type » poreux » sont dotés d’une perméabilité d’interstice. L’eau souterraine qu’ils renferment chemine au sein des vides microscopiques de la roche, situés entre les grains constitutifs de celle-ci. Largement répandus à la surface du globe, ils sont formés pour l’essentiel de roches sédimentaires, meubles ou consolidées, déposées soit sous forme d’alluvions, par les cours d’eau, soit, au sein des bassins sédimentaires, sous forme de couches de grande extension (sables, grès, etc.), superposées les unes aux autres et séparées par des niveaux peu perméables, généralement argileux. Les propriétés de porosité et de perméabilité de ces aquifères permettent de capter l’eau qu’ils contiennent, au moyen de forages, sur toute la superficie d’extension de ces réservoirs. C’est en ce sens qu’ils sont qualifiés de » continus « . Ces propriétés favorables ont conduit à leur exploitation de longue date. Ils ont donc contribué, et contribuent encore de manière importante, à l’économie de notre société. Pour ces raisons, ces aquifères sont les mieux connus et les plus sollicités.
➤ Les aquifères discontinus
Les roches calcaires d’origine sédimentaire d’une part et les roches de socle plutoniques (granites, volcaniques : laves, et métamorphiques : schistes, gneiss, etc.) d’autre part ne présentent, en l’absence de fractures, qu’une très faible perméabilité. Elles renferment néanmoins des eaux souterraines exploitables. Celles-ci circulent au sein des vides qui se sont localement développés en leur sein:
– dans les roches de socle, par fracturation et fissuration sous l’effet des contraintes tectoniques et lors de leur refroidissement,
– pour ce qui concerne les calcaires, par fracturation et fissuration suivies de la dissolution de la roche, du fait même du cheminement des eaux souterraines.
De ce fait, ces aquifères particuliers possèdent des propriétés de perméabilité qui ne sont pas continués dans l’espace. Ils présentent donc la particularité de montrer, selon les sites où ils sont forés et de manière en apparence aléatoire, soit de bonnes capacités pour le captage d’eau souterraine soit de très mauvaises qualités aquifères.
PHOTO-INTERPRETATION
Pour déterminer la direction des profils de mesure et les emplacements des points de mesure dans la zone d’étude. Il est très nécessaire de réaliser la photo-interprétation de la zone. Le terme « photo-interprétation » désigne l’interprétation des photographies aériennes et des images spatiales. C’est l’acte d’examiner les photographies pour le but d’identifier des objets et juger leur signification. Les applications de la photo-interprétation peuvent être classées en deux principales catégories: celle des processus d’inventaire et celle des processus d’explication. Le processus d’inventaire consiste à toutes les identifications de formes d’objets connus, les délimitations et les dénombrements, ce qui conduit à une cartographie. Dans cette catégorie se rangent les prospections, les cartographies proprement dites (géomorphologie, géologie, végétation), les inventaires par points ou par zonages (par exemple, foresterie, urbanisme, circulation routière). La seconde catégorie d’applications utilise la méthode analytique. Les thèmes traités sont souvent ceux dont l’aspect dynamique est prépondérant : hydrographie, chronologie des états d’un paysage, écologie. Cependant, les applications évoluent sans cesse, soit qu’elles concernent de nouveaux thèmes rendus accessibles par des progrès techniques. Ainsi, la méthodologie de la photointerprétation évolue vers un automatisme de plus en plus poussé des tâches d’inventaire, et l’invasion de thèmes de plus en plus fins par la photo-interprétation d’explication. Les données obtenues par les méthodes de télédétection qui complètent la photographie aérienne classique, ayant un support informatique, plus adapté au traitement automatique, ont favorisé cette tendance.
|
Table des matières
INTRODUCTION
Chapitre I : CONTEXTE GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE
I.1. PRESENTATION DE LA ZONE D’ETUDE
I.2. CONTEXTE CLIMATIQUE
I.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET PEDOLOGIQUE
I.4. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE
I.5. CONTEXTE HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
I.6. STRUCTURE DE LA POPULATION
I.7. ESTIMATION DU BESOINS EN EAU DE LA POPULATION
Chapitre II : METHODOLOGIES APPLIQUEES A CETTE ETUDE
II.1 GENERALITES SUR LES AQUIFERES
II.2. PHOTO-INTERPRETATION
II. 3. PROSPECTION ELECTRIQUE
II.4. ANALYSEDE L’EAU
Chapitre III : RESULTATS ET INTERPRETATIONS
III.1. RESULTATS ET INTERPRETATIONS DE LA PHOTOINTERPRETATION
III.2. EMPLACEMENT DE PANNEAUX ELECTRIQUES
III.3. RESULTATS ET INTERPRETATIONS GEOPHYSIQUES
III.4. ANALYSES PHYSICO-CHIMIQUES
III.5. CARACTERE GENERAL DE LA NAPPE AQUIFERE DE CUF
CONCLUSION
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
TABLE DES MATIERES
ANNEXES