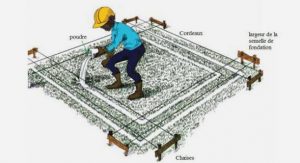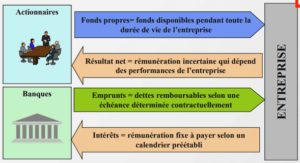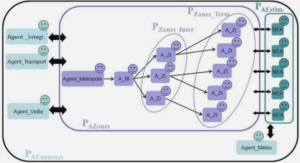Télécharger le fichier pdf d’un mémoire de fin d’études
GENERALITES SUR LE DELTA DE LA TSIRIBIHINA
Contexte géologique
Coupe géologique des régions traversées par la basse du delta
Delta et plateaux d’Amboliandro et d’Ambodira s’inscrivent dans le cadre plus vaste du bassin sédimentaire malgache. Celui-ci occupe le tiers occidental de l’île en s’appuyant sur le socle ancien métamorphique. Après avoir quitté ce dernier au niveau de Miandrivazo, la Tsiribihina s’ouvre une voie étroite dans la cuesta du Bemaraha par un bel entonnoir de percée cataclinale [19] (cf. Figure 4).
Contexte géologique de surface
Le Delta de la Tsiribihina est formé de socle cristallin appartenant au groupe de Vohibory dont l’âge oscille autour de 2500MA. Les roches sont formées de migmatites granitoïdes, des granites, des gneiss amphibolites et des migmatites.
Les dépôts sédimentaires sont constitués des formations de type Karroo qui peut être subdivisé en deux : la série de type Karroo à la base, suivie de la série post-Karroo.
Elle est appelée en Inde « Gondwana System » ou Système de Santa Catarina au Brésil, ou « Karroo System » (Dwyka, Stormberg série) en Afrique du Sud.
Elle va du Carbonifère supérieur au Jurassique moyen (Bajocien – Bathonien).
Elle est bien développée dans le sud-ouest et est formée par des sédiments continentaux, lacustres et marins.
Le Karroo malagasy est divisé en 3 groupes respectivement séparés les uns des autres par une discordance [2] et est composé de bas en haut par:
Le groupe de la Sakoa (Permo – Carbonifère – Permien moyen)
Un affleurement très limité du groupe de la Sakoa, à faciès, argilo- gréseux rouge apparaît sporadiquement à 5 km au Nord d’Ankotrofotsy-sur-Mania, entre Miandrivazo et Malaimbandy.
Le groupe de la Sakamena (Permien supérieur à Trias Inférieur)
Un affleurement de la Sakamena supérieur à faciès de grès, schistes et pelites apparaît localement et a été traversé à 5 km au Nord d’Ankotrofotsy-sur-Mania.
La série post-Karroo
La série post-Karroo comporte quatre séries :
Le Jurassique
Le Jurassique se comporte :
· Le Lias supérieur à faciès mixte d’Andafia : Jurassique Inférieur
· Le Bemaraha Inférieur : Jurassique Moyen
Il s’agit de formations calcaires – marneuses.
· Le Bemaraha Moyen ou Isalo IIIa à faciès mixte : Jurassique Moyen
Les dépôts de faciès mixtes correspondent à des phénomènes de régression et transgressions marines. La série est à prédominance gréseuse à stratification entrecroisée et argiles de nature continentale avec intercalations marines fréquentes sous forme de calcaire et de marne.
·Le Bemaraha Supérieur à faciès mixte ou Isalo IIIb : Jurassique Moyen
Il est caractérisé par une alternance de bancs calcaires et marnes et de grès à stratification entrecroisée.
·Argovien / Oxfordien: Marne jaune d’Ankilizato, à Belemnites et quelques
Ammonites (Argovien). L’Oxfordien n’est pas identifié ou très réduite :
Jurassique Supérieur.
·Madagascar s’est séparé de l’Afrique au Jurassique Supérieur.
Le Crétacé
Le Crétacé se comporte quatre types différentes: L’Albo-cenomanien, le turonien, le Campanien et le Maestrien.
·L’Albo-Cenomanien (Crétacé moyen)
L’ensemble est une formation à prédominance continentale à quelques intercalations marines fossilifères. Il est représenté par des grès grossiers blancs à rouges, à stratification entrecroisée, avec des niveaux conglomératiques ou argileux. Ces grès sont souvent de nominés grès de Tsiandava.
·Le Turonien (Crétacé moyen)
Au Sud de la Tsiribihina et au Nord -Est d’Andranomena, le Turonien affleure avec des grès blancs et rouges, des marnes blanches et des calcaires gréseux.
Dans la région d’Antsoha, d’épanchements basaltiques du Turonien affleurent par endroit.
·Le Campanien et Campanien/Maestrichtien (Crétacé Supérieur)
Le Campanien au Nord de la Tsiribihina présente un faciès continental de grès rouges qui disparaît à Andranomena sous la transgression Eocène. Il est possible qu’il soit encore présent plus au Sud, entre Dabara et Ankilizato mais son faciès de grès rouge pourrait se confondre des grès rouges Albo- Cenomaniens du Tsiandava.
·Le Maestrichtien: (Crétacé Supérieur)
Le Maestrichtien comprend une série marine marno-calcaire.
Au Sud de la Tsiribihina, à l’Ouest des basaltes d’Antsoha, on distingue des affleurements de haut vers le bas, de:
Calcaires compacts, gréseux et marneux
Marnes grises à huîtres
Calcaires marneux
Grès calcaires et marnes
Marnes blanches et calcaires marneux et gréseux
Le tertiaire
Le tertiaire est formé de l’éocène
·L’éocène
L’Eocène est très répandue dans l’Ouest, surtout dans la partie Sud- Ouest du bassin de Morondava. Elle est en grande partie masquée par les grès et sables du Pliocène et aussi par la carapace sableuse. Elle est surtout calcaire caractérisée par des microfossiles foraminifères (Nummulites et Alvéolines) et gréseux au sommet avec des grès quartziques à ciment calcedonieux.
L’Eocène calcaire et gréseuse affleure sporadiquement, respectivement au Nord-est de Belo et au Nord-Ouest de Soatanimbary, au Nord de la Tsiribihina.
Entre la Tsiribihina et la route Ankilizato-Morondava, l’Eocène calcaire et gréseuse prend de l’importance dans les zones de Dabara (Eocène calcaire), d’Andranomena (Eocène calcaire et gréseuse) de Mandroatra (Eocène calcaire) à l’Ouest et au Sud d’Andranomandeha (Eocène calcaire et gréseuse), à l’Est de Beroboka et Marofandilihy (Eocène gréseuse).
Entre la route Dabara-Morondava et la rivière Maharivo, l’Eocène calcaire affleure et plus ou moins recouverte par la carapace sableuse.
Le Quaternaire
Le quaternaire est essentiellement : le pliocène, la carapace sableuse, l’alluvion et les dunes.
·Le Pliocène
Il est continental: ce qui correspond à un retrait notable de la mer.
Il est constitué de formations gréseuses grossières, généralement blancs, parfois rouges conglomératiques, à stratification entrecroisée avec carapace sableuse produit de désagrégation des grès.
Ces grès comportent des intercalations d’argile, gris verdâtre
L’affleurement du Pliocène est surtout bien développé au Nord de Belosur Tsiribihina, près du village Ampasimandroatra en contact discordant sur l’Eocène inférieure calcaire
·Carapace sableuse
Elle est surtout très répandue dans la zone côtière où elle provient principalement des grès du Pliocène (désagrégation). Elle se présente sous forme de sables roux à grain fin ou de sables blancs un peu plus grossiers surtout dans la forêt côtière. Sur les formations anciennes, elle est argilo-sableuse et parfois carapacée.
·Alluvions
Des terrasses alluviales bordent largement le long des grands cours d’eau comme Tsiribihina, Andranomena, Morondava / Kabatomena, Maharivo, Lampaolo et Mangoky.
Elles forment des deltas aux embouchures (delta de Tsiribihina, de Morondava, etc) avec des vases de mangroves.
·Dunes
Une transgression marine Quaternaire atteignant la cote +10 s’est avancée d’au moins une trentaine de kilomètre dans la vallée de la Tsiribihina et a déposé des huîtres à l’Est de Belo.
Cadre tectonique et structural
D’une manière générale le cadre tectonique et structural du bassin de Morondava est rattaché aux séparations de Madagascar de l’Afrique d’une part et Madagascar de l’Inde d’autre part, au Jurassique supérieur et Crétacé moyen (phases de rift et drift). Selon RAZAFINDRAKOTO [37], deux principales directions tectoniques peuvent être distinguées:
Une direction NNW-SSE du trait du socle suivant la faille de Ranotsara et la fracture de Davie.
Une direction NNE-SSW de faille d’extension et de glissement oblique suivant la faille de l’Ilovo.
Cette séparation de Madagascar de l’Afrique et de l’Inde a conditionné et contrôlé par conséquent, le cadre structural du bassin de Morondava engendrant la création de système de failles et favorisant le développement de système de « Horst » et « Graben » et le basculement du bassin vers l’Ouest.
Deux manifestations éruptives datées du Turonien-Coniacien et d’âge post- Eocène, composées de coulées (basaltes) des intrusions (gabbros) et de dyke (dolerite) ont été reconnues au Sud de la Tsiribihina (Antsoha), à Ankilizato, au nord-est d’Andranomena et au Sud de Mahabo (Andrangory).
L’ensemble de la région possède un style monoclinal à pendage Ouest, généralement de 3° à 5° Ouest avec quelques pendages Est à Ankilizato.
Dans le Karroo, les failles sont rares et se situent essentiellement au contact des environs immédiats du socle.
Entre Miandrivazo et la Mania les formations gréseuses de l’Isalo transgresse le socle cristallin.
Le Jurassique moyen est le plus affecté par des grandes failles longitudinales de direction N 10 à 30° Ouest avec des rejets jusqu’à 100 mètres.
Dans le Jurassique supérieur les failles sont nombreuses mais avec des rejets minimes. Au Sud- Ouest d’Ankilizato elles ont une direction constante Nord-Nord Est; Sud-Sud Ouest.
Dans le Crétacé moyen, les failles sont plus ou moins nombreuses.
Au sud du parallèle 660, une faille subméridienne marque le contact Crétacé- Eocène. Les grès Cenomaniens sont souvent en contact direct avec l’Eocène.
Au Nord de la Tsiribihina on assiste à une zone d’effondrement (« halfgraben ») du nord-est de Belo jusqu’à Soanafindra, limitée à l’Ouest par le plateau élevé du Pliocène / Eocène calcaire et à l’Est par le plateau élevé du Crétacé supérieur (Campanien /Maestrichtien) et comblée par des carapaces argilo-sableuses formant une vaste pénéplaine.
L’Eocène est affectée d’une série de failles généralement de faible rejet de direction, allant du Nord-Sud.
Géologies d’Antsakoamaliniky
Presque la surface d’Antsakoamaliniky est couverte par de vases de mangrove. C’est une formation à partir d’accumulation de sédiments semblable à celui de la basse-slikke. Ces sédiments ont une teneur en eau très élevé (plus de 100% en général) et sont parfois fluides, sauf sur les bords des chenaux de mangrove. Ils sont sans consistance ou très malléables, et on les groupe parmi les sols à consistance peu développée ou semi-développée. Au-delà de quelques dizaines de centimètre, le substrat devient très malléable, sablonneux et brun foncé en général.
Dans la partie Sud est marquée par la présence des alluvions et des sables. Des terrasses alluviales bordent la surface entre Antsamaka et Antsakoamaliniky.
Quant aux sables, ils sont surtout très répandue à l’intérieur de la zone côtière où ils proviennent principalement des grès du Pliocène (désagrégation). Ils se présentent sous forme de sables roux à grain fin ou de sables blancs un peu plus grossiers. Sur les formations anciennes, ils sont argilo-sableuses et parfois carapacés (cf. Figure 5).
Contexte géomorphologique
Géomorphologie du Delta de la Tsiribihina
Le delta de la Tsiribihina, situé entre 19°30’ et 20°00’ de latitude Sud, forme grossièrement un lobe de 50.000 hectares (cf. Figure 6).
D’après une étude de Lebigre en 1988 [2], il mesure une cinquantaine de kilomètres du nord au sud sur une vingtaine de kilomètres d’Est en Ouest. Il a démontré, en outre que, le delta est accolé aux plateaux d’Amboliandro et d’Ambodira. Ceux-ci sont formés de grès et de conglomérats de galets quartzitiques recouverts uniformément par une « carapace sabloargileuse ». Sous ce terme on désigne ici un ensemble de dépôts continentaux rubéfiés, rattachés au « continental terminal africain ».
Localement, on note quelques lambeaux de cuirasse ferrugineuse pisolothique [16]. Un talus d’une vingtaine de mètres marque la transition entre plateau et delta, du moins, au nord de Belo-sur-Tsiribihina. C’est la paléo-falaise d’Andranofotsy.
Géomorphologie d’Antsakoamaliniky
La géomorphologie est une discipline de la géographie physique et des géosciences qui décrit les formes de la surface de la terre (relief) et explique leur formation et leur évolution sous l’effet de la tectonique et de l’érosion.
Dans l’ensemble : les côtes d’Antsakoamaliniky sont caractérisées par des mangroves et des marécages, par des dunes vives dans la partie Nord-ouest et par des vases de mangrove à l’extrême Sud-est (cf. Figure 5). Le relief est relativement plat en général et marqué par une altitude inférieure à 25 m (cf. Figure 6) avec une alternance de vallées très faibles, de vastes plateaux. On a deux zones remarquables :
Les zones côtières : Le littoral est formé de mangroves ayant une importance capitale pour la population vivant de la cueillette, en particulier : la chasse aux crabes, la pêche traditionnelle. Les mangroves couvrent presque la totalité de la superficie du littoral (cf. Figure 3).
Les plaines : On rencontre de vastes étendues de plaines pouvant recevoir soit des spéculations irriguées et/ou celles se contentant de l’eau de pluie.
Le paysage est constitué en général par une grande culture et une forêt de palétuviers ou mangroves : de familles : (avicenniceae) « afiafy », rhizophoraceae) « tanga » (meliaceae) « fobo ».
Hydrographie d’Antsakoamaliniky
Antsakoamaliniky dispose une potentialité hydraulique énorme des eaux de surface et de profondeur. On peut considérer cette zone comme une presqu’île, car d’un côté, elle est limitée par la fleuve Tsiribihina et l’autre côté, elle est bornée par la mer.
Tsiribihina prend également sa source du massif de Bongolava, débouche dans le fivondronana de Miandrivazo, au niveau du Chef-lieu de la Commune d’Ankotrofotsy (pont de la Mania), continue sa course sur le plateau de Bemaraha ; elle prolonge son trajet dans le fivondronana de Belo sur Tsiribihina où elle se divise en deux dont une partie regagne Bejio au Nord et l’autre partie se disperse dans le Sud à Nosibe. Avant de rejoindre le Canal de Mozambique où ces affluents passent le long du bord de la zone d’étude (cf. Figure 7). Ce fleuve transporte et dépose les apports alluvionnaires et les matières minéraux qui enrichir la zone d’études (fertilisation du sol) au bénéfice de l’agriculture.
|
Table des matières
INTRODUCTION GENERALE
PARTIE I. ETUDES BIBLIOGRAPHIQUES DE LA REGION
CHAPITRE I. CONTEXTE DE L’ETUDE
I.1. PRESENTATION DU LOUVAIN COOPERATION AU DEVELOPPEMENT [18]
I.1.1. Louvain Coopération au Développement
I.1.2. Organisation de Louvain Coopération au Développement
I.1.3. Zones d’activités de Louvain Coopération au Développement
I.1.4. Les partenaires de Louvain Développement
I.2. ZONE D’ETUDE
I.2.1. Choix de zone d’études
I.2.2. Problèmes du développement du Fokontany
I.2.3. Accès
I.2.4. Aperçu sur le site
I.2.5. Climatologie [23]
I.2.6. Milieu biologique
I.2.7. Milieu social
I.2.8. Milieu économique
CHAPITRE II. GENERALITES SUR LE DELTA DE LA TSIRIBIHINA
II.1. CONTEXTE GEOLOGIQUE
II.1.1. Coupe géologique des régions traversées par la basse du delta
II.1.2. Contexte géologique de surface [3]
II.1.3. Cadre tectonique et structural
II.1.4. Géologies d’Antsakoamaliniky
II.2. CONTEXTE GEOMORPHOLOGIQUE
II.2.1. Géomorphologie du Delta de la Tsiribihina
II.2.2. Géomorphologie d’Antsakoamaliniky
II.3. HYDROGRAPHIE D’ANTSAKOAMALINIKY
II.4. HYDROGEOLOGIE D’ANTSAKOAMALINIKY
CHAPITRE III. PRESENTATION DE LA GEOMECANIQUE
III.1. HISTORIQUE DE LA GEOMECANIQUE [7]
III.2. OBJECTIFS
III.3.METHODES ET APPLICATIONS
III.3.1. Méthode de la géomécanique [1]
III.3.2. Méthode de la géomécanique [47] [33]
PARTIE II. ETUDE GEOMECANIQUE ET SALINITE DU SOL
CHAPITRE I. LES SOLS
I.1. PROPRIETES DU SOL
I.1.1. Propriétés du sol
I.2. PROPRIETES D’ETAT DU SOL
I.2.1. Les constituants du sol [50]
I.3. PROPRIETES FONDAMENTALES DU SOL [36]
I.3.1. Granularité
I.3.2. Plasticité
I.3.3. Compressibilité
I.3.4. Cohésion
I.4. PROPRIETES A CARACTERE CHIMIQUE [11]
I.5. CARACTERISTIQUES DES SOLS FINS [36]
I.5.1. Comportement du sol
I .5.2. Caractéristiques des sols fins
I.6. PRESENCE D’EAU DANS LE SOL
I.6.1. Différentes formes de présence d’eau dans le sol
I.6.2. Mouvement d’eau dans le sol
I.7. ORIGINES DE SALINISATION [13]
I.7.1. Salinisation marine
I.7.2. Salinisation des lagunes littorales
I.7.3. Salinisation d’origine continentale ou géologique
I.7.4. Salinisation d’origine volcanique
I.7.5. Salinisation des sols de mangroves
I.8. CRITERE DE DETECTION ET D’IDENTIFICATION DES TERRAINS SALES [13]
I.8.1. Critères lithologiques
I.8.2. Critères orogéniques et géomorphologiques
I.8.3. Critères climatologiques et hydrologiques
I.8.4. Critères utilisés dans l’interprétation des caractéristiques chimiques du salant
I.8.5. Critères floristiques et phytosociologiques
I.9. INFLUENCE DU SEL SUR LE SOL [13]
CHAPITRE II. ETUDE GEOMECANIQUE DU SOL
II.1. PRELEVEMENT DE L’ECHANTILLON
II.1.2. Choix de zone de prélèvement
II.1.3. Coupe de sondage du sol d’Antsakoamaliniky
II.1.4. Caractérisation des échantillons
II.2. ANALYSES DE SALINITE DU SOL
II.2.1. Détermination du pH du sol et de la conductivité du sol
II.2.2. Détermination de la densité réelle
II.2.3. Perméabilité
II.2.4. Carbone organique et matière organique
PARTIE III. RESULTATS ET INTERPRETATIONS
CHAPITRE I. INTERPRETATIONS ET SUGGESTIONS DE RESULTATS GEOMECANIQUE
I.1. RESULTATS
I.1.1. Calcul de la teneur en eau
I.1.2. Résultats d’analyse granulométrique
I.1.3. Résultats de limites d’Atterberg
I.1.4. Le poids spécifique γs
I.1.5. Résultats et traçage de courbe Proctor modifié
I.1.6. Résultats et traçage de courbe C.B.R
I.1.7. Résultats de l’essai Proctor modifié
I.1.8. Résultats et traçage de courbe triaxial
I.1.9. Calculs et expression des résultats de VBS
I.2. AMELIORATION DU SOL
I.2.1. Amélioration du sol par un traitement
I.2.2. Ciment
I.2.3. Traitement mixte
I.2.4. Avantages de la technique
I.2.5. Choix de liants pour le traitement
CHAPITRE II. APERÇU DE LA SALINITE
II.1. RESULTATS DE L’ETUDE DE SALINITE
II.1.1. Résultats de mesure de pH et de la conductivité du sol
II.1.2. Calcul et résultats de la densité réelle
II.1.3. Calcul et résultats de la perméabilité du sol
II.1.4. Calcul et résultats de la matière organique
II.3. SUGGESTIONS POUR AMELIORER LE SOL
II.3.1. Méthode recours au labour du sol
II.3.2. Méthode recours à l’utilisation de l’eau et des amendements chimiques
CONCLUSION
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ANNEXES
Télécharger le rapport complet