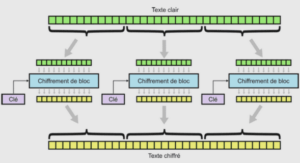L’Ecole Supérieure Polytechnique d’Antananarivo, notamment le Département Télécommunication, a pour mission de former des Ingénieurs en télécommunication. La formation se fait en mode tant théorique que pratique. En effet, le Département dispose d’équipements électronique analogique, d’équipements électronique numérique ainsi que de plusieurs équipements informatiques. L’existant informatique se résume à des ordinateurs et des commutateurs.
GENERALITES SUR LE RESEAU LOCAL
Terminologie
Un « réseau local » est un ensemble d’éléments matériels et logiciels, qui met en relation physique et logique, des ordinateurs et leurs périphériques, à l’intérieur d’un site géographiquement limité. Son but est de permettre le partage de ressources communes entre plusieurs utilisateurs.
On emploie généralement les termes de :
➤ LAN pour un réseau géographiquement limité à l’entreprise ou à un bâtiment ;
➤ MAN ou réseau de campus pour un réseau s’étendant sur des distances ne dépassant pas les 10km ;
➤ WAN pour des LAN interconnectés ou des stations réparties sur de grandes distances.
Topologies
La topologie définie la manière d’interconnecter les différents équipements qui composent le réseau. On distingue trois types de topologies :
Topologie en bus
Dans la liaison en bus, les stations de travail connectées se partagent une même voie de transmission. Le câble coaxial est le support de transmission fréquemment utilisé. Toutefois, du fait des faibles débits supportés par ces câbles coaxiaux (10Mbps), cette topologie est en régression dans les réseaux locaux.
Avantages :
– Economie de câble.
– Mise en œuvre facile.
Inconvénients :
– Si le câble principal (épine dorsale ou backbone) est touché, toutes les stations se retrouvent en panne. De plus, sur un même câble encastré, par exemple dans le sol, il n’est pas facile de diagnostiquer l’endroit exact de la rupture. Il faut donc tout ouvrir.
– Faible sécurité sur tout le réseau due au média partagé.
– Ralentissement du trafic en cas de nombreuses stations.
Topologie en étoile
La liaison la plus simple entre deux stations de travail est celle qui ne comporte que deux extrémités. Une telle liaison est dite point à point. Un ensemble de liaison point à point axées autour d’un nœud central (concentrateur ou commutateur) va former une configuration étoile. La topologie en étoile est la plus utilisée en réseau local.
Avantages :
– La simplicité : les stations de travail sont reliées directement au serveur.
– La gestion de ressources est centralisée.
– Si un ordinateur tombe en panne ou si un câble de liaison est coupé, un seul ordinateur est affecté et le reste du réseau continu à fonctionner.
– Facilité d’extension.
Inconvénients :
– Si le nœud central (concentrateur ou commutateur) tombe en panne, c’est tout le réseau qui est hors service.
– Elle nécessite autant de voies de liaisons que de stations de travail reliées au nœud central. Ce qui est générateur de coût.
Topologie en anneau
La topologie en anneau consiste en une série de liaisons points à points formant une boucle qui interconnecte un ensemble de stations de travail. Un poste plus puissant joue le rôle de serveur et distribue les jetons (token). Un boîtier central MAU joue généralement le rôle de l’anneau (ring). L’accès des stations au réseau en anneau, appelé également réseau en boucle, est réglementé par le passage d’un « relais » appelé jeton. Dans cette configuration, la station n’est autorisée à émettre que si elle dispose du jeton.
Avantages :
– Câblage moins important.
– Accès égalitaire de toutes les stations.
Inconvénients :
– Une interruption à un endroit quelconque de l’anneau empêche toute transmission sur le réseau.
– Le temps de réponse devient lent à l’ajout de nouvelles stations.
– Une panne d’ordinateur (qui est souvent le cas) peut affecter l’anneau.
– Problème difficile à isoler.
– La reconfiguration du réseau peut interrompre son fonctionnement.
Remarques :
– Ces 3 types de topologies peuvent être combinées pour avoir des topologies hybrides (exemple : bus connecté en étoile).
– Plusieurs bus peuvent se connecter pour former des arbres.
Eléments constitutifs du réseau local
Les stations de travail
Ce sont les machines (ordinateurs) interconnectées pour former le réseau. On peut distinguer :
Le serveur
Un serveur peut être assimilé à une boîte contenant deux éléments :
– Le logiciel : ce terme désigne le système d’exploitation (Windows 2000 Server, Windows Server 2003, Linux, …) s’exécutant sur le matériel. Les services fournis par le serveur se dénombrent avec les logiciels qu’il faut lui ajouter (ou déjà disponible : cas de Linux). Chacun des logiciels est appelé logiciel serveur, ou tout simplement, serveur (exemple : Apache est un serveur Web).
– Le matériel : le matériel désigne l’ordinateur qui héberge et qui exécute le logiciel. Etant donné que le serveur fournit plusieurs services(transfert de fichiers, serveur de pages Web, …) sur les autres machines (clients), sa plate-forme devra être plus performante que celle des clients qui leurs sont connectés. En effet, la taille du disque dur désigne la capacité d’information qu’une machine (serveur) peut stocker, le RAM désigne la capacité d’information qu’elle peut transporter simultanément, la fréquence du processeur désigne la vitesse de transport d’information. Plus les valeurs de ces paramètres sont élevées plus meilleur est le serveur.
Le client
Le poste client est souvent un PC (affichage et traitement). Pour pouvoir communiquer avec le serveur, il devra disposer un logiciel client (exemple : Internet Explorer est un logiciel client Web). Au terme du matériel, la performance du plate forme n’est pas exigée.
La carte réseau
C’est une plaquette de circuits imprimés logée dans l’emplacement d’extension d’un bus de la carte mère d’un ordinateur. On l’appelle aussi adaptateur réseau car il permet la connexion du PC au réseau. Chaque carte porte un nom de code unique appelé adresse MAC. La carte réseau peut être intégrée sur la carte mère.
|
Table des matières
INTRODUCTION
CHAPITRE 1 GENERALITES SUR LE RESEAU LOCAL
1 . 1 . Terminologie
1 . 2 . Topologies
1 . 2 . 1 . Topologie en bus
1 . 2 . 2 . Topologie en étoile
1 . 2 . 3 .Topologie en anneau
1 . 3 . Eléments constitutifs du réseau local
1 . 3 . 1 . Les stations de travail
1 . 3 . 1 . 1 . Le serveur
1 . 3 . 1 . 2 . Le client
1 . 3 . 2 . La carte réseau
1 . 3 . 3 . Le concentrateur (hub)
1 . 3 . 4 . Le commutateur (switch)
1 . 3 . 5 . Les segments de réseau
1 . 3 . 6 . Le pont
1 . 3 . 7 . Le répéteur
1 . 3 . 8 . Le routeur
1 . 3 . 9 . Les supports de transmission
1 . 3 . 9 . 1 . Les câbles coaxiaux
1 . 3 . 9 . 1 . 1 . Le câble coaxial fin (Thinnet)
1 .3 . 9 . 1 . 2 . Le câble coaxial épais (Thicknet)
1 . 3 . 9 . 2 . Les paires torsadées
1 . 3 . 9 . 2 . 1 . La paire torsadée non blindée (UTP)
1 . 3 . 9 . 2 . 2 . La paire torsadée blindée (STP)
1 . 3 . 9 . 3 . Les fibres optiques
1 . 3 . 9 . 3 . 1 . La fibre optique monomode
1 . 3 . 9 . 3 . 2 . La fibre optique multimode
1 . 3 . 9 . 4 . Les réseaux locaux sans fil
1 . 3 . 9 . 4 . 1 . Les liaisons infrarouges
1 . 3 . 9 . 4 . 2 . Les liaisons hertziennes
1 . 4 . Le modèle architectural OSI
1 . 4 . 1 . La couche physique (niveau 1)
1 . 4 . 2 . La couche liaison (niveau 2)
1 . 4 . 3 . La couche réseau (niveau 3)
1 . 4 . 4 . La couche transport (niveau 4)
1 . 4 . 5 . La couche session (niveau 5)
1 . 4 . 6 . La couche présentation (niveau 6)
1 . 4 . 7 . La couche application (niveau 7)
1 . 5 . Les méthodes d’accès
1 . 5 . 1 . Les méthodes aléatoires
1 . 5 . 1 . 1 . CSMA / CD
1 . 5 . 1 . 2 . CSMA / CA
1 . 5 . 2 . Les méthodes déterministes
1 . 5 . 2 . 1 . Le jeton sur anneau (Token Ring)
1 . 5 . 2 . 2 . Le jeton en bus
1 . 6 . Les types de transmission
1 . 6 . 1 . Transmission en bande de base
1 . 6 . 2 . Transmission à large bande
1 . 7 . Protocole de communication : TCP / IP
1 . 7 . 1 . Le protocole IP
1 . 7 . 1 . 1 . L’adressage IP
1 . 7 . 1 . 2 . Le routage IP
1 . 7 . 2 . Le protocole TCP
1 . 7 . 3 . L’architecture TCP / IP
CHAPITRE 2 TECHNOLOGIE DES RESEAUX LOCAUX
2 . 1 . Définition
2 . 2 . Technologie Ethernet
2 . 2 . 1 . L’origine d’Ethernet
2 . 2 . 2 . Les caractéristiques du réseau Ethernet
2 . 2 . 3 . Les principales architectures Ethernet
2 . 3 . Technologie Token-Ring
2 . 3 . 1 . L’origine de Token-Ring
2 . 3 . 2 . Caractéristiques du réseau Token-Ring
2 . 3 . 3 . Architecture de Token-Ring
2 . 4 . Les autres types de technologies
2 . 4 . 1 . Technologie Starlan
2 . 4 . 2 . Technologie Arcnet
CHAPITRE 3 PERFORMANCE ET SECURITE DANS LE RESEAU LOCAL
3 . 1 . Introduction
3 . 2 . La performance d’un réseau local
3 . 2 . 1 . Caractéristiques des équipements à mettre en œuvre
3 . 2 . 2 . La performance de transmission
3 . 3 . La sécurisation du réseau local
CHAPITRE 4 ETUDE DE L’INSTALLATION D’UN RESEAU DANS LE DEPARTEMENT TELECOMMUNICATION
4 . 1 . Introduction
4 . 2 . Choix de la topologie
4 . 3 . Eléments nécessaires pour l’installation
4 . 3 . 1 . Poste de travail
4 . 3 . 2 . Switch
4 . 3 . 3 . Support de transmission
4 . 3 . 4 . Accessoires
4 . 4 . Câblage
4 . 5 . Evaluation des coûts de matériels
CHAPITRE 5 L’ARCHITECTURE CLIENT – SERVEUR
CONCLUSION